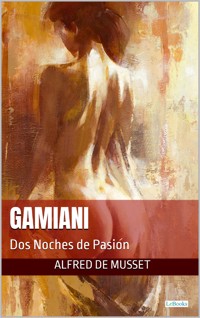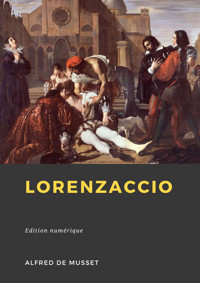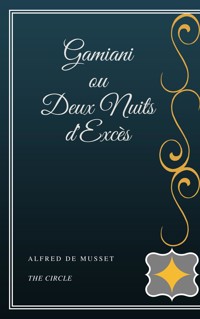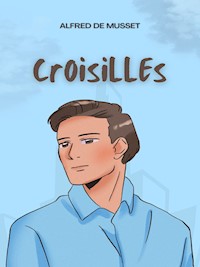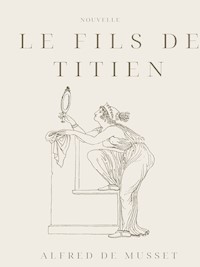Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"La Confession d'un enfant du siècle" est un roman semi-autobiographique d'Alfred de Musset publié en 1836. L'histoire suit le personnage principal Octave, qui est désespéré après la fin de sa relation avec sa bien-aimée Eléonore, une femme mariée qui l'a trahi. Octave sombre dans la dépression et la débauche, essayant de noyer sa douleur dans l'alcool, les jeux d'argent et les aventures amoureuses sans lendemain. Mais malgré ses efforts pour oublier Eléonore, il continue à être hanté par ses souvenirs et ses sentiments pour elle.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alfred de Musset (1810-1857) est un poète, dramaturge et romancier français célèbre pour ses œuvres romantiques. Né à Paris, il a commencé à écrire de la poésie dès son plus jeune âge. En 1832, il rencontre George Sand, une écrivaine française célèbre, avec qui il a une relation tumultueuse qui a inspiré certaines de ses œuvres les plus célèbres. Parmi ses pièces de théâtre les plus connues, on peut citer "Les Caprices de Marianne" (1833) et "On ne badine pas avec l'amour" (1834). Alfred de Musset a été élu à l'Académie française en 1852, mais sa santé mentale s'est détériorée à la fin de sa vie et il est décédé en 1857 à l'âge de 46 ans.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Confession d'un enfant du siècle
Alfred de Musset
– 1836 –
PREMIÈRE PARTIE.
CHAPITRE PREMIER
Pour écrire l’histoire de sa vie, il faut d’abord avoir vécu ; aussi n’est-ce pas la mienne que j’écris.
Ayant été atteint, jeune encore, d’une maladie morale abominable, je raconte ce qui m’est arrivé pendant trois ans. Si j’étais seul malade, je n’en dirais rien ; mais comme il y en a beaucoup d’autres que moi qui souffrent du même mal, j’écris pour ceux-là, sans trop savoir s’ils y feront attention ; car, dans le cas où personne n’y prendrait garde, j’aurai encore retiré ce fruit de mes paroles de m’être mieux guéri moi-même, et, comme le renard pris au piège, j’aurai rongé mon pied captif.
CHAPITRE II
Pendant les guerres de l’Empire, tandis que les maris et les frères étaient en Allemagne, les mères inquiètes avaient mis au monde une génération ardente, pâle, nerveuse. Conçus entre deux batailles, élevés dans les collèges aux roulements des tambours, des milliers d’enfants se regardaient entre eux d’un œil sombre, en essayant leurs muscles chétifs. De temps en temps leurs pères ensanglantés apparaissaient, les soulevaient sur leurs poitrines chamarrées d’or, puis les posaient à terre et remontaient à cheval.
Un seul homme était en vie alors en Europe ; le reste des êtres tâchait de se remplir les poumons de l’air qu’il avait respiré. Chaque année, la France faisait présent à cet homme de trois cent mille jeunes gens ; c’était l’impôt payé à César, et, s’il n’avait ce troupeau derrière lui, il ne pouvait suivre sa fortune. C’était l’escorte qu’il lui fallait pour qu’il pût traverser le monde, et s’en aller tomber dans une petite vallée d’une île déserte, sous un saule pleureur.
Jamais il n’y eut tant de nuits sans sommeil que du temps de cet homme ; jamais on ne vit se pencher sur les remparts des villes un tel peuple de mères désolées ; jamais il n’y eut un tel silence autour de ceux qui parlaient de mort. Et pourtant jamais il n’y eut tant de joie, tant de vie, tant de fanfares guerrières dans tous les cœurs. Jamais il n’y eut de soleils si purs que ceux qui séchèrent tout ce sang. On disait que Dieu les faisait pour cet homme, et on les appelait ses soleils d’Austerlitz. Mais il les faisait bien lui-même avec ses canons toujours tonnants, et qui ne laissaient de nuages qu’aux lendemains de ses batailles.
C’était l’air de ce ciel sans tache, où brillait tant de gloire, où resplendissait tant d’acier, que les enfants respiraient alors. Ils savaient bien qu’ils étaient destinés aux hécatombes ; mais ils croyaient Murat invulnérable, et on avait vu passer l’empereur sur un pont où sifflaient tant de balles, qu’on ne savait s’il pouvait mourir. Et quand même on aurait dû mourir, qu’était-ce que cela ? La mort elle-même était si belle alors, si grande, si magnifique dans sa pourpre fumante ! elle ressemblait si bien à l’espérance, elle fauchait de si verts épis, qu’elle en était comme devenue jeune, et qu’on ne croyait plus à la vieillesse. Tous les berceaux de France étaient des boucliers ; tous les cercueils en étaient aussi ; il n’y avait vraiment plus de vieillards ; il n’y avait que des cadavres ou des demi-dieux.
Cependant l’immortel empereur était un jour sur une colline à regarder sept peuples s’égorger ; comme il ne savait pas encore s’il serait le maître du monde ou seulement de la moitié, Azraël passa sur la route ; il l’effleura du bout de l’aile, et le poussa dans l’Océan. Au bruit de sa chute, les vieilles croyances moribondes se redressèrent sur leurs lits de douleur, et, avançant leurs pattes crochues, toutes les royales araignées découpèrent l’Europe, et de la pourpre de César se firent un habit d’Arlequin.
De même qu’un voyageur, tant qu’il est sur le chemin, court nuit et jour par la pluie et par le soleil, sans s’apercevoir de ses veilles ni des dangers ; mais, dès qu’il est arrivé au milieu de sa famille et qu’il s’assoit devant le feu, il éprouve une lassitude sans bornes et peut à peine se traîner à son lit ; ainsi la France, veuve de César, sentit tout à coup sa blessure. Elle tomba en défaillance, et s’endormit d’un si profond sommeil, que ses vieux rois, la croyant morte, l’enveloppèrent d’un linceul blanc. La vieille armée en cheveux gris rentra épuisée de fatigue, et les foyers des châteaux déserts se rallumèrent tristement.
Alors ces hommes de l’Empire, qui avaient tant couru et tant égorgé, embrassèrent leurs femmes amaigries et parlèrent de leurs premières amours ; ils se regardèrent dans les fontaines de leurs prairies natales, et ils s’y virent si vieux, si mutilés, qu’ils se souvinrent de leurs fils, afin qu’on leur fermât les yeux. Ils demandèrent où ils étaient ; les enfants sortirent des collèges, et ne voyant plus ni sabres, ni cuirasses, ni fantassins, ni cavaliers, ils demandèrent à leur tour où étaient leurs pères. Mais on leur répondit que la guerre était finie, que César était mort, et que les portraits de Wellington et de Blücher étaient suspendus dans les antichambres des consulats et des ambassades, avec ces deux mots au bas : Salvatoribus mundi.
Alors s’assit sur un monde en ruines une jeunesse soucieuse. Tous ces enfants étaient des gouttes d’un sang brûlant qui avait inondé la terre ; ils étaient nés au sein de la guerre, pour la guerre. Ils avaient rêvé pendant quinze ans des neiges de Moscou et du soleil des Pyramides. Ils n’étaient pas sortis de leurs villes, mais on leur avait dit que par chaque barrière de ces villes on allait à une capitale d’Europe. Ils avaient dans la tête tout un monde ; ils regardaient la terre, le ciel, les rues et les chemins ; tout cela était vide, et les cloches de leurs paroisses résonnaient seules dans le lointain.
De pâles fantômes, couverts de robes noires, traversaient lentement les campagnes ; d’autres frappaient aux portes des maisons, et dès qu’on leur avait ouvert, ils tiraient de leurs poches de grands parchemins tout usés, avec lesquels ils chassaient les habitants. De tous côtés arrivaient des hommes encore tout tremblants de la peur qui leur avait pris à leur départ, vingt ans auparavant. Tous réclamaient, disputaient et criaient ; on s’étonnait qu’une seule mort pût appeler tant de corbeaux.
Le roi de France était sur son trône, regardant çà et là s’il ne voyait pas une abeille dans ses tapisseries. Les uns lui tendaient leur chapeau, et il leur donnait de l’argent ; les autres lui montraient un crucifix, et il le baisait ; d’autres se contentaient de lui crier aux oreilles de grands noms retentissants, et il répondait à ceux-là d’aller dans sa grand’salle, que les échos en étaient sonores ; d’autres encore lui montraient leurs vieux manteaux, comme ils en avaient bien effacé les abeilles, et à ceux-là il donnait un habit neuf.
Les enfants regardaient tout cela, pensant toujours que l’ombre de César allait débarquer à Cannes et souffler sur ces larves ; mais le silence continuait toujours, et l’on ne voyait flotter dans le ciel que la pâleur des lis. Quand les enfants parlaient de gloire, on leur disait : Faites-vous prêtres ; quand ils parlaient d’ambition : Faites-vous prêtres ; d’espérance, d’amour, de force, de vie : Faites-vous prêtres.
Cependant, il monta à la tribune aux harangues un homme qui tenait à la main un contrat entre le roi et le peuple ; il commença à dire que la gloire était une belle chose, et l’ambition et la guerre aussi ; mais qu’il y en avait une plus belle, qui s’appelait la liberté.
Les enfants relevèrent la tête et se souvinrent de leurs grands-pères, qui en avaient aussi parlé. Ils se souvinrent d’avoir rencontré, dans les coins obscurs de la maison paternelle, des bustes mystérieux avec de longs cheveux de marbre et une inscription romaine ; ils se souvinrent d’avoir vu le soir, à la veillée, leurs aïeules branler la tête et parler d’un fleuve de sang bien plus terrible encore que celui de l’Empereur. Il y avait pour eux dans ce mot de liberté quelque chose qui leur faisait battre le cœur à la fois comme un lointain et terrible souvenir et comme une chère espérance, plus lointaine encore.
Ils tressaillirent en l’entendant ; mais, en rentrant au logis, ils virent trois paniers qu’on portait à Clamart : c’étaient trois jeunes gens qui avaient prononcé trop haut ce mot de liberté.
Un étrange sourire leur passa sur les lèvres à cette triste vue ; mais d’autres harangueurs, montant à la tribune, commencèrent à calculer publiquement ce que coûtait l’ambition, et que la gloire était bien chère ; ils firent voir l’horreur de la guerre et appelèrent boucheries les hécatombes. Et ils parlèrent tant et si longtemps que toutes les illusions humaines, comme des arbres en automne, tombaient feuille à feuille autour d’eux, et que ceux qui les écoutaient passaient leur main sur leur front, comme des fiévreux qui s’éveillent.
Les uns disaient : Ce qui a causé la chute de l’Empereur, c’est que le peuple n’en voulait plus ; les autres : Le peuple voulait le roi ; non, la liberté ; non, la raison ; non, la religion ; non, la constitution anglaise ; non, l’absolutisme ; un dernier ajouta : Non ! rien de tout cela, mais le repos.
Trois éléments partageaient donc la vie qui s’offrait alors aux jeunes gens : derrière eux un passé à jamais détruit, s’agitant encore sur ses ruines, avec tous les fossiles des siècles de l’absolutisme ; devant eux l’aurore d’un immense horizon, les premières clartés de l’avenir ; et entre ces deux mondes… quelque chose de semblable à l’Océan qui sépare le vieux continent de la jeune Amérique, je ne sais quoi de vague et de flottant, une mer houleuse et pleine de naufrages, traversée de temps en temps par quelque blanche voile lointaine ou par quelque navire soufflant une lourde vapeur ; le siècle présent, en un mot, qui sépare le passé de l’avenir, qui n’est ni l’un ni l’autre et qui ressemble à tous deux à la fois, et où l’on ne sait, à chaque pas qu’on fait, si l’on marche sur une semence ou sur un débris.
Voilà dans quel chaos il fallut choisir alors ; voilà ce qui se présentait à des enfants pleins de force et d’audace, fils de l’Empire et petits-fils de la Révolution.
Or, du passé, ils n’en voulaient plus, car la foi en rien ne se donne ; l’avenir, ils l’aimaient, mais quoi ? comme Pygmalion Galathée ; c’était pour eux comme une amante de marbre, et ils attendaient qu’elle s’animât, que le sang colorât ses veines.
Il leur restait donc le présent, l’esprit du siècle, ange du crépuscule, qui n’est ni la nuit ni le jour ; ils le trouvèrent assis sur un sac de chaux plein d’ossements, serré dans le manteau des égoïstes, et grelottant d’un froid terrible. L’angoisse de la mort leur entra dans l’âme à la vue de ce spectre moitié momie et moitié fœtus ; ils s’en approchèrent comme le voyageur à qui l’on montre à Strasbourg la fille d’un vieux comte de Sarverden, embaumée dans sa parure de fiancée. Ce squelette enfantin fait frémir, car ses mains fluettes et livides portent l’anneau des épousées, et sa tête tombe en poussière au milieu des fleurs d’oranger.
Comme à l’approche d’une tempête il passe dans les forêts un vent terrible qui fait frissonner tous les arbres, à quoi succède un profond silence, ainsi Napoléon avait tout ébranlé en passant sur le monde ; les rois avaient senti vaciller leur couronne, et, portant leur main à leur tête, ils n’y avaient trouvé que leurs cheveux hérissés de terreur. Le pape avait fait trois cents lieues pour le bénir au nom de Dieu et lui poser son diadème ; mais il le lui avait pris des mains. Ainsi tout avait tremblé dans cette forêt lugubre de la vieille Europe ; puis le silence avait succédé.
On dit que, lorsqu’on rencontre un chien furieux, si l’on a le courage de marcher gravement, sans se retourner, et d’une manière régulière, le chien se contente de vous suivre pendant un certain temps, en grommelant entre ses dents ; tandis que, si on laisse échapper un geste de terreur, si on fait un pas trop vite, il se jette sur vous et vous dévore ; car une fois la première morsure faite, il n’y a plus moyen de lui échapper.
Or, dans l’histoire européenne, il était arrivé souvent qu’un souverain eût fait ce geste de terreur et que son peuple l’eût dévoré ; mais si un l’avait fait, tous ne l’avaient pas fait en même temps, c’est-à-dire qu’un roi avait disparu, mais non la majesté royale. Devant Napoléon la majesté royale l’avait fait ce geste qui perd tout, et non seulement la majesté, mais la religion, mais la noblesse, mais toute puissance divine et humaine.
Napoléon mort, les puissances divines et humaines étaient bien rétablies de fait ; mais la croyance en elles n’existait plus. Il y a un danger terrible à savoir ce qui est possible, car l’esprit va toujours plus loin. Autre chose est de se dire : Ceci pourrait être, ou de se dire : Ceci a été ; c’est la première morsure du chien.
Napoléon despote fut la dernière lueur de la lampe du despotisme ; il détruisit et parodia les rois, comme Voltaire les livres saints. Et après lui on entendit un grand bruit, c’était la pierre de Sainte-Hélène qui venait de tomber sur l’ancien monde. Aussitôt parut dans le ciel l’astre glacial de la raison ; et ses rayons, pareils à ceux de la froide déesse des nuits, versant de la lumière sans chaleur, enveloppèrent le monde d’un suaire livide.
On avait bien vu jusqu’alors des gens qui haïssaient les nobles, qui déclamaient contre les prêtres, qui conspiraient contre les rois ; on avait bien crié contre les abus et les préjugés ; mais ce fut une grande nouveauté que de voir le peuple en sourire. S’il passait un noble, ou un prêtre, ou un souverain, les paysans qui avaient fait la guerre commençaient à hocher la tête et à dire : « Ah ! celui-là nous l’avons vu en temps et en lieu ; il avait un autre visage. » Et quand on parlait du trône et de l’autel, ils répondaient : « Ce sont quatre ais de bois ; nous les avons cloués et décloués. » Et quand on leur disait : « Peuple, tu es revenu des erreurs qui t’avaient égaré ; tu as rappelé tes rois et tes prêtres » ; ils répondaient : « Ce n’est pas nous ; ce sont ces bavards-là. » Et quand on leur disait : « Peuple, oublie le passé, laboure et obéis », ils se redressaient sur leurs sièges, et on entendait un sourd retentissement. C’était un sabre rouillé et ébréché qui avait remué dans un coin de la chaumière. Alors on ajoutait aussitôt : « Reste en repos du moins ; si on ne te nuit pas, ne cherche pas à nuire. » Hélas ! ils se contentaient de cela.
Mais la jeunesse ne s’en contentait pas. Il est certain qu’il y a dans l’homme deux puissances occultes qui combattent jusqu’à la mort ; l’une, clairvoyante et froide, s’ attache à la réalité, la calcule, la pèse, et juge le passé ; l’autre a soif de l’avenir et s’élance vers l’inconnu. Quand la passion emporte l’homme, la raison le suit en pleurant et en l’avertissant du danger ; mais dès que l’homme s’est arrêté à la voix de la raison, dès qu’il s’est dit : C’est vrai, je suis un fou ; où allais-je ? la passion lui crie : Et moi, je vais donc mourir ?
Un sentiment de malaise inexprimable commença donc à fermenter dans tous les cœurs jeunes. Condamnés au repos par les souverains du monde, livrés aux cuistres de toute espèce, à l’oisiveté et à l’ennui, les jeunes gens voyaient se retirer d’eux les vagues écumantes contre lesquelles ils avaient préparé leur bras. Tous ces gladiateurs frottés d’huile se sentaient au fond de l’âme une misère insupportable. Les plus riches se firent libertins ; ceux d’une fortune médiocre prirent un état et se résignèrent soit à la robe, soit à l’épée ; les plus pauvres se jetèrent dans l’enthousiasme à froid, dans les grands mots, dans l’affreuse mer de l’action sans but. Comme la faiblesse humaine cherche l’association et que les hommes sont troupeaux de nature, la politique s’en mêla. On s’allait battre avec les gardes du corps sur les marches de la chambre législative, on courait à une pièce de théâtre où Talma portait une perruque qui le faisait ressembler à César, on se ruait à l’enterrement d’un député libéral. Mais des membres des deux partis opposés, il n’en était pas un qui, en rentrant chez lui, ne sentît amèrement le vide de son existence et la pauvreté de ses mains.
En même temps que la vie du dehors était si pâle et si mesquine, la vie intérieure de la société prenait un aspect sombre et silencieux ; l’hypocrisie la plus sévère régnait dans les mœurs ; les idées anglaises se joignant à la dévotion, la gaîté même avait disparu. Peut-être était-ce la Providence qui préparait déjà ses voies nouvelles ; peut-être était-ce l’ange avant-coureur des sociétés futures qui semait déjà dans le cœur des femmes les germes de l’indépendance humaine, que quelque jour elles réclameront. Mais il est certain que tout d’un coup, chose inouïe, dans tous les salons de Paris, les hommes passèrent d’un côté et les femmes de l’autre ; et ainsi, les unes vêtues de blanc comme des fiancées, les autres vêtus de noir comme des orphelins, ils commencèrent à se mesurer des yeux.
Qu’on ne s’y trompe pas : ce vêtement noir que portent les hommes de notre temps est un symbole terrible ; pour en venir là, il a fallu que les armures tombassent pièce à pièce et les broderies fleur à fleur. C’est la raison humaine qui a renversé toutes les illusions ; mais elle en porte elle-même le deuil, afin qu’on la console.
Les mœurs des étudiants et des artistes, ces mœurs si libres, si belles, si pleines de jeunesse, se ressentirent du changement universel. Les hommes, en se séparant des femmes, avaient chuchoté un mot qui blesse à mort : le mépris ; ils s’étaient jetés dans le vin et dans les courtisanes. Les étudiants et les artistes s’y jetèrent aussi ; l’amour était traité comme la gloire et la religion ; c’était une illusion ancienne. On allait donc aux mauvais lieux ; la grisette, cette classe si rêveuse, si romanesque, et d’un amour si tendre et si doux, se vit abandonnée aux comptoirs des boutiques. Elle était pauvre, et on ne l’aimait plus ; elle voulut avoir des robes et des chapeaux : elle se vendit. Ô misère ! le jeune homme qui aurait dû l’aimer, qu’elle aurait aimé elle-même, celui qui la conduisait autrefois aux bois de Verrières et de Romainville, aux danses sur le gazon, aux soupers sous l’ ombrage ; celui qui venait causer le soir sous la lampe, au fond de la boutique, durant les longues veillées d’hiver ; celui qui partageait avec elle son morceau de pain trempé de la sueur de son front, et son amour sublime et pauvre ; celui-là, ce même homme, après l’avoir délaissée, la retrouvait quelque soir d’orgie au fond du lupanar, pâle et plombée, à jamais perdue, avec la faim sur les lèvres et la prostitution dans le cœur.
Or, vers ces temps-là, deux poètes, les deux plus beaux génies du siècle après Napoléon, venaient de consacrer leur vie à rassembler tous les éléments d’angoisse et de douleur épars dans l’univers. Goethe, le patriarche d’une littérature nouvelle, après avoir peint dans Werther la passion qui mène au suicide, avait tracé dans son Faust la plus sombre figure humaine qui eût jamais représenté le mal et le malheur. Ses écrits commencèrent alors à passer d’Allemagne en France.
Du fond de son cabinet d’étude, entouré de tableaux et de statues, riche, heureux et tranquille, il regardait venir à nous son œuvre de ténèbres avec un sourire paternel. Byron lui répondit par un cri de douleur qui fit tressaillir la Grèce, et suspendit Manfred sur les abîmes, comme si le néant eût été le mot de l’énigme hideuse dont il s’enveloppait.
Pardonnez-moi, ô grands poètes, qui êtes maintenant un peu de cendre et qui reposez sous la terre ; pardonnez-moi ! vous êtes des demi-dieux, et je ne suis qu’un enfant qui souffre. Mais en écrivant tout ceci, je ne puis m’empêcher de vous maudire. Que ne chantiez-vous le parfum des fleurs, les voix de la nature, l’espérance et l’amour, la vigne et le soleil, l’azur et la beauté ? Sans doute vous connaissiez la vie, et sans doute vous aviez souffert ; et le monde croulait autour de vous, et vous pleuriez sur ses ruines, et vous désespériez ; et vos maîtresses vous avaient trahis, et vos amis calomniés, et vos compatriotes méconnus ; et vous aviez le vide dans le cœur, la mort devant les yeux, et vous étiez des colosses de douleur. Mais dites-moi, vous, noble Goethe, n’y avait-il plus de voix consolatrice dans le murmure religieux de vos vieilles forêts d’Allemagne ? Vous pour qui la belle poésie était la sœur de la science, ne pouvaient-elles à elles deux trouver dans l’immortelle nature une plante salutaire pour le cœur de leur favori ? Vous qui étiez un panthéiste, un poète antique de la Grèce, un amant des formes sacrées, ne pouviez-vous mettre un peu de miel dans ces beaux vases que vous saviez faire, vous qui n’aviez qu’à sourire et à laisser les abeilles vous venir sur les lèvres ? Et toi, et toi, Byron, n’avais-tu pas près de Ravenne, sous tes orangers d’Italie, sous ton beau ciel vénitien, près de ta chère Adriatique, n’avais-tu pas ta bien-aimée ? Ô Dieu ! moi qui te parle, et qui ne suis qu’un faible enfant, j’ai connu peut-être des maux que tu n’as pas soufferts, et cependant je crois encore à l’espérance, et cependant je bénis Dieu.
Quand les idées anglaises et allemandes passèrent ainsi sur nos têtes, ce fut comme un dégoût morne et silencieux, suivi d’une convulsion terrible. Car formuler des idées générales, c’est changer le salpêtre en poudre, et la cervelle homérique du grand Goethe avait sucé, comme un alambic, toute la liqueur du fruit défendu. Ceux qui ne le lurent pas alors crurent n’en rien savoir. Pauvres créatures ! l’explosion les emporta comme des grains de poussière dans l’abîme du doute universel.
Ce fut comme une dénégation de toutes choses du ciel et de la terre, qu’on peut nommer désenchantement, ou si l’on veut, désespérance, comme si l’humanité en léthargie avait été crue morte par ceux qui lui tâtaient le pouls. De même que ce soldat à qui l’on demanda jadis : À quoi crois-tu ? et qui le premier répondit : À moi ; ainsi la jeunesse de France, entendant cette question, répondit la première : À rien.
Dès lors il se forma comme deux camps : d’une part, les esprits exaltés, souffrants, toutes les âmes expansives qui ont besoin de l’infini, plièrent la tête en pleurant ; ils s’enveloppèrent de rêves maladifs, et l’on ne vit plus que de frêles roseaux sur un océan d’amertume. D’une autre part, les hommes de chair restèrent debout, inflexibles, au milieu des jouissances positives, et il ne leur prit d’autre souci que de compter l’argent qu’ils avaient. Ce ne fut qu’un sanglot et un éclat de rire, l’un venant de l’âme, et l’autre du corps.
Voici donc ce que disait l’âme :
Hélas ! hélas ! la religion s’en va ; les nuages du ciel tombent en pluie ; nous n’avons plus ni espoir ni attente, pas deux petits morceaux de bois noir en croix devant lesquels tendre les mains. L’astre de l’avenir se lève à peine ; il ne peut sortir de l’horizon ; il y reste enveloppé de nuages, et comme le soleil en hiver, son disque y apparaît d’un rouge de sang, qu’il a gardé de quatre-vingt-treize. Il n’y a plus d’amour, il n’y a plus de gloire. Quelle épaisse nuit sur la terre ! Et nous serons morts quand il fera jour.
Voici donc ce que disait le corps :
L’homme est ici-bas pour se servir de ses sens ; il a plus ou moins de morceaux d’un métal jaune ou blanc, avec quoi il a droit à plus ou moins d’estime. Manger, boire et dormir, c’est vivre. Quant aux liens qui existent entre les hommes, l’amitié consiste à prêter de l’argent ; mais il est rare d’avoir un ami qu’on puisse aimer assez pour cela. La parenté sert aux héritages : l’amour est un exercice du corps ; la seule jouissance intellectuelle est la vanité.
Pareille à la peste asiatique exhalée des vapeurs du Gange, l’affreuse désespérance marchait à grands pas sur la terre. Déjà Chateaubriand, prince de poésie, enveloppant l’horrible idole de son manteau de pèlerin, l’avait placée sur un autel de marbre, au milieu des parfums des encensoirs sacrés. Déjà, pleins d’une force désormais inutile, les enfants du siècle raidissaient leurs mains oisives et buvaient dans leur coupe stérile le breuvage empoisonné. Déjà tout s’abîmait, quand les chacals sortirent de terre. Une littérature cadavéreuse et infecte, qui n’avait que la forme, mais une forme hideuse, commença d’arroser d’un sang fétide tous les monstres de la nature.
Qui osera jamais raconter ce qui se passait alors dans les collèges ? Les hommes doutaient de tout : les jeunes gens nièrent tout. Les poètes chantaient le désespoir : les jeunes gens sortirent des écoles avec le front serein, le visage frais et vermeil, et le blasphème à la bouche. D’ailleurs le caractère français, qui de sa nature est gai et ouvert, prédominant toujours, les cerveaux se remplirent aisément des idées anglaises et allemandes, mais les cœurs, trop légers pour lutter et pour souffrir, se flétrirent comme des fleurs fanées. Ainsi le principe de mort descendit froidement et sans secousse de la tête aux entrailles. Au lieu d’avoir l’enthousiasme du mal nous n’eûmes que l’abnégation du bien ; au lieu du désespoir, l’insensibilité. Des enfants de quinze ans, assis nonchalamment sous des arbrisseaux en fleur, tenaient par passe-temps des propos qui auraient fait frémir d’horreur les bosquets immobiles de Versailles. La communion du Christ, l’hostie, ce symbole éternel de l’amour céleste, servait à cacheter des lettres ; les enfants crachaient le pain de Dieu.
Heureux ceux qui échappèrent à ces temps ! heureux ceux qui passèrent sur les abîmes en regardant le ciel ! Il y en eut sans doute, et ceux-là nous plaindront.
Il est malheureusement vrai qu’il y a dans le blasphème une grande déperdition de force qui soulage le cœur trop plein. Lorsqu’un athée, tirant sa montre, donnait un quart d’heure à Dieu pour le foudroyer, il est certain que c’était un quart d’heure de colère et de jouissance atroce qu’il se procurait. C’était le paroxysme du désespoir, un appel sans nom à toutes les puissances célestes ; c’était une pauvre et misérable créature se tordant sous le pied qui l’écrase ; c’était un grand cri de douleur. Et qui sait ? aux yeux de celui qui voit tout, c’est peut-être une prière.
Ainsi les jeunes gens trouvaient un emploi de la force inactive dans l’affectation du désespoir. Se railler de la gloire, de la religion, de l’amour, de tout au monde, est une grande consolation, pour ceux qui ne savent que faire ; ils se moquent par là d’eux-mêmes et se donnent raison tout en se faisant la leçon. Et puis, il est doux de se croire malheureux, lorsqu’on n’est que vide et ennuyé. La débauche, en outre, première conclusion des principes de mort, est une terrible meule de pressoir lorsqu’il s’agit de s’énerver.
En sorte que les riches se disaient : Il n’y a de vrai que la richesse ; tout le reste est un rêve ; jouissons et mourons. Ceux d’une fortune médiocre se disaient : Il n’ y a de vrai que l’oubli ; tout le reste est un rêve ; oublions et mourons. Et les pauvres disaient : Il n’y a de vrai que le malheur ; tout le reste est un rêve ; blasphémons et mourons.
Ceci est-il trop noir ? est-ce exagéré ? Qu’en pensez-vous ? Suis-je un misanthrope ? Qu’on me permette une réflexion.
En lisant l’histoire de la chute de l’Empire romain, il est impossible de ne pas s’apercevoir du mal que les chrétiens, si admirables dans le désert, firent à l’État dès qu’ils eurent la puissance. « Quand je pense, dit Montesquieu, à l’ignorance profonde dans laquelle le clergé grec plongea les laïques, je ne puis m’empêcher de le comparer à ces Scythes dont parle Hérodote, qui crevaient les yeux à leurs esclaves, afin que rien ne pût les distraire et les empêcher de battre leur lait. – Aucune affaire d’État, aucune paix, aucune guerre, aucune trêve, aucune négociation, aucun mariage, ne se traitèrent que par le ministère des moines. On ne saurait croire quel mal il en résulta. »
Montesquieu aurait pu ajouter : Le christianisme perdit les empereurs, mais il sauva les peuples. Il ouvrit aux Barbares les palais de Constantinople, mais il ouvrit les portes des chaumières aux anges consolateurs du Christ. Il s’agissait bien des grands de la terre ; et voilà qui est <plus> intéressant que les derniers râlements d’un empire corrompu jusqu’à la moelle des os, que le sombre galvanisme au moyen duquel s’agitait encore le squelette de la tyrannie sur la tombe d’Héliogabale et de Caracalla ! La belle chose à conserver que la momie de Rome embaumée des parfums de Néron, cerclée du linceul de Tibère ! Il s’agissait, messieurs les politiques, d’aller trouver les pauvres et de leur dire d’être en paix ; il s’agissait de laisser les vers et les taupes ronger les monuments de honte, mais de tirer des flancs de la momie une vierge aussi belle que la mère du Rédempteur, l’espérance, amie des opprimés.
Voilà ce que fit le christianisme ; et maintenant, depuis tant d’années, qu’on fait ceux qui l’ont détruit ? Ils ont vu que le pauvre se laissait opprimer par le riche, le faible par le fort, par cette raison qu’ils se disaient : Le riche et le fort m’opprimeront sur la terre ; mais quand ils voudront entrer au paradis, je serai à la porte et je les accuserai au tribunal de Dieu. Ainsi, hélas ! ils prenaient patience.
Les antagonistes du Christ ont donc dit au pauvre : Tu prends patience jusqu’au jour de justice, il n’y a point de justice ; tu attends la vie éternelle pour y réclamer ta vengeance, il n’y a point de vie éternelle ; tu amasses tes larmes et celles de ta famille, les cris de tes enfants et les sanglots de ta femme, pour les porter au pied de Dieu à l’heure de ta mort ; il n’y a point de Dieu.
Alors il est certain que le pauvre a séché ses larmes, qu’il a dit à sa femme de se taire, à ses enfants de venir avec lui, et qu’il s’est redressé sur la glèbe avec la force d’un taureau. Il a dit au riche : Toi qui m’opprimes, tu n’es qu’un homme ; et au prêtre : Toi qui m'as consolé, tu en as menti. C’était justement là ce que voulaient les antagonistes du Christ. Peut-être croyaient-ils faire ainsi le bonheur des hommes, en envoyant le pauvre à la conquête de la liberté.
Mais si le pauvre, ayant bien compris une fois que les prêtres le trompent, que les riches le dérobent, que tous les hommes ont les mêmes droits, que tous les biens sont de ce monde, et que sa misère est impie ; si le pauvre, croyant à lui et à ses deux bras pour toute croyance, s’est dit un beau jour : Guerre au riche ! à moi aussi la jouissance ici-bas, puisqu’il n’y en a pas d’autre ! à moi la terre, puisque le ciel est vide ! à moi et à tous, puisque tous sont égaux ! ô raisonneurs sublimes qui l’avez mené là, que lui direz-vous s’il est vaincu ?
Sans doute vous êtes des philanthropes, sans doute vous avez raison pour l’avenir, et le jour viendra où vous serez bénis ; mais pas encore, en vérité, nous ne pouvons pas vous bénir. Lorsque autrefois l’oppresseur disait : À moi la terre ! – À moi le ciel, répondait l’opprimé. À présent que répondra-t-il ?
Toute la maladie du siècle présent vient de deux causes ; le peuple qui a passé par 93 et par 1814 porte au cœur deux blessures. Tout ce qui était n’est plus ; tout ce qui sera n’est pas encore. Ne cherchez pas ailleurs le secret de nos maux.
Voilà un homme dont la maison tombe en ruine ; il l’a démolie pour en bâtir une autre. Les décombres gisent sur son champ, et il attend des pierres nouvelles pour son édifice nouveau. Au moment où le voilà prêt à tailler ses moellons et à faire son ciment, la pioche en mains, les bras retroussés, on vient lui dire que les pierres manquent et lui conseiller de reblanchir les vieilles pour en tirer parti. Que voulez-vous qu’il fasse, lui qui ne veut point de ruines pour faire un nid à sa couvée ? La carrière est pourtant profonde, les instruments trop faibles pour en tirer les pierres. Attendez, lui dit-on, on les tirera peu à peu ; espérez, travaillez, avancez, reculez. Que ne lui dit-on pas ? Et pendant ce temps-là cet homme, n’ayant plus sa vieille maison et pas encore sa maison nouvelle, ne sait comment se défendre de la pluie, ni comment préparer son repas du soir, ni où travailler, ni où reposer, ni où vivre, ni où mourir ; et ses enfants sont nouveau-nés.
Ou je me trompe étrangement, ou nous ressemblons à cet homme. Ô peuples des siècles futurs ! lorsque, par une chaude journée d’été, vous serez courbés sur vos charrues dans les vertes campagnes de la patrie ; lorsque vous verrez, sous un soleil pur et sans tache, la terre, votre mère féconde, sourire dans sa robe matinale au travailleur, son enfant bien-aimé ; lorsque, essuyant sur vos fronts tranquilles le saint baptême de la sueur, vous promènerez vos regards sur votre horizon immense, où il n’y aura pas un épi plus haut que l’autre dans la moisson humaine, mais seulement des bleuets et des marguerites au milieu des blés jaunissants ; ô hommes libres ! quand alors vous remercierez Dieu d’être nés pour cette récolte, pensez à nous qui n’y serons plus ; dites-vous que nous avons acheté bien cher le repos dont vous jouirez ; plaignez-nous plus que tous vos pères ; car nous avons beaucoup des maux qui les rendaient dignes de plainte, et nous avons perdu ce qui les consolait.
CHAPITRE III
J’ai à raconter à quelle occasion je fus pris d’abord de la maladie du siècle.
J’étais à table, à un grand souper, après une mascarade. Autour de moi mes amis richement costumés, de tous côtés des jeunes gens et des femmes, tous étincelants de beauté et de joie ; à droite et à gauche des mets exquis, des flacons, des lustres, des fleurs ; au-dessus de ma tête un orchestre bruyant, et en face de moi ma maîtresse, créature superbe que j’idolâtrais.
J’avais alors dix-neuf ans ; je n’avais éprouvé aucun malheur ni aucune maladie ; j’étais d’un caractère à la fois hautain et ouvert, avec toutes les espérances et un cœur débordant. Les vapeurs du vin fermentaient dans mes veines ; c’était un de ces moments d’ivresse où tout ce qu’on voit, tout ce qu’on entend vous parle de la bien-aimée. La nature entière paraît alors comme une pierre précieuse à mille facettes, sur laquelle est gravé le nom mystérieux. On embrasserait volontiers tous ceux qu’on voit sourire, et on se sent le frère de tout ce qui existe. Ma maîtresse m’avait donné rendez-vous pour la nuit, et je portais lentement mon verre à mes lèvres en la regardant.
Comme je me retournais pour prendre une assiette, ma fourchette tomba. Je me baissai pour la ramasser, et, ne la trouvant pas d’abord, je soulevai la nappe pour voir où elle avait roulé. J’aperçus alors sous la table le pied de ma maîtresse qui était posé sur celui d’un jeune homme assis à côté d’elle ; leurs jambes étaient croisées et entrelacées, et ils les resserraient doucement de temps en temps.
Je me relevai parfaitement calme, demandai une autre fourchette et continuai à souper. Ma maîtresse et son voisin étaient, de leur côté, très tranquilles aussi, se parlant à peine et ne se regardant pas. Le jeune homme avait les coudes sur la table et plaisantait avec une autre femme qui lui montrait son collier et ses bracelets. Ma maîtresse était immobile, les yeux fixes et noyés de langueur. Je les observai tous deux tant que dura le repas, et je ne vis ni dans leurs gestes, ni sur leurs visages rien qui pût les trahir. À la fin, lorsqu’on fut au dessert, je fis glisser ma serviette à terre, et, m’étant baissé de nouveau, je les retrouvai dans la même position, étroitement liés l’un à l’autre.
J’avais promis à ma maîtresse de la ramener ce soir-là chez elle. Elle était veuve, et par conséquent fort libre, au moyen d’un vieux parent qui l’accompagnait et lui servait de chaperon. Comme je traversais le péristyle, elle m’appela. « Allons, Octave, me dit-elle, partons, me voilà. » Je me mis à rire et sortis sans répondre. Au bout de quelques pas, je m’assis sur une borne. Je ne sais à quoi je pensais ; j’étais comme abruti et devenu idiot par l’infidélité de cette femme dont je n’avais jamais été jaloux, et sur laquelle je n’avais jamais conçu un soupçon. Ce que je venais de voir ne me laissant aucun doute, je demeurais comme étourdi d’un coup de massue et ne me rappelle rien de ce qui s’opéra en moi durant le temps que je restai sur cette borne, sinon que, regardant machinalement le ciel et voyant une étoile filer, je saluai cette apparence fugitive, où les poètes voient un monde détruit, et lui ôtai gravement mon chapeau.
Je rentrai chez moi tranquillement, n’éprouvant rien, ne sentant rien, et comme privé de réflexion. Je commençai à me déshabiller, et me mis au lit ; mais à peine eus-je posé la tête sur le chevet, que les esprits de la vengeance me saisirent avec une telle force, que je me redressai tout à coup contre la muraille, comme si tous les muscles de mon corps fussent devenus de bois. Je descendis de mon lit en criant, les bras étendus, ne pouvant marcher que sur les talons, tant les nerfs de mes orteils étaient crispés. Je passai ainsi près d’une heure, complètement fou et raide comme un squelette. Ce fut le premier accès de colère que j’éprouvai.
L’homme que j’avais surpris auprès de ma maîtresse était un de mes amis les plus intimes. J’allai chez lui le lendemain, accompagné d’un jeune avocat nommé Desgenais ; nous prîmes des pistolets, un autre témoin, et fûmes au bois de Vincennes. Pendant toute la route, j’évitai de parler à mon adversaire et même de l’approcher ; je résistai ainsi à l’envie que j’avais de le frapper ou de l’insulter, ces sortes de violence étant toujours hideuses et inutiles, du moment que la loi permet le combat en règle. Mais je ne pus me défendre d’avoir les yeux fixés sur lui. C’était un de mes camarades d’enfance, et il y avait eu entre nous un échange perpétuel de services depuis nombre d’années. Il connaissait parfaitement mon amour pour ma maîtresse et m’avait même plusieurs fois fait entendre clairement que ces sortes de liens étaient sacrés pour un ami, et qu’il serait incapable de chercher à me supplanter, quand même il aimerait la même femme que moi. Enfin, j’avais toute sorte de confiance en lui, et je n’avais peut-être jamais serré la main d’une créature humaine plus cordialement que la sienne.
Je regardais curieusement, avidement, cet homme que j’avais entendu parler de l’amitié comme un héros de l’Antiquité et que je venais de voir caressant ma maîtresse. C’était la première fois de ma vie que je voyais un monstre ; je le toisais d’un œil hagard pour observer comment il était fait. Lui que j’avais connu à l’âge de dix ans, avec qui j’avais vécu jour par jour dans la plus parfaite et la plus étroite amitié, il me semblait que je ne l’avais jamais vu. Je me servirai ici d’une comparaison.
Il y a une pièce espagnole, connue de tout le monde, dans laquelle une statue de pierre vient souper chez un débauché, envoyée par la justice céleste. Le débauché fait bonne contenance et s’efforce de paraître indifférent ; mais la statue lui demande la main, et dès qu’il la lui a donnée, l’homme se sent pris d’un froid mortel et tombe en convulsions.
Or, toutes les fois que, durant ma vie, il m’est arrivé d’avoir cru pendant longtemps avec confiance, soit à un ami, soit à une maîtresse, et de découvrir tout d’un coup que j’étais trompé, je ne puis rendre l’effet que cette découverte a produit sur moi qu’en le comparant à la poignée de main de la statue. C’est véritablement l’impression du marbre, comme si la réalité, dans toute sa mortelle froideur, me glaçait d’un baiser ; c’est le toucher de l’homme de pierre. Hélas ! l’affreux convive a frappé plus d’une fois à ma porte ; plus d’une fois nous avons soupé ensemble.
Cependant, les arrangements faits, nous nous mîmes en ligne mon adversaire et moi, avançant lentement l’un sur l’autre. Il tira le premier et me fracassa le bras droit. Je pris aussitôt mon pistolet de l’autre main ; mais je ne pus le soulever, la force me manquant, et je tombai sur un genou.
Alors je vis mon ennemi s’avancer précipitamment, d’un air inquiet et le visage très pâle. Mes témoins accoururent en même temps, voyant que j’étais blessé ; mais il les écarta et me prit la main de mon bras malade. Il avait les dents serrées et ne pouvait parler : je vis son angoisse. Il souffrait du plus affreux mal que l’homme puisse éprouver. « Va-t’en, lui criai-je, va-t’en t’essuyer aux draps de *** ! » Il suffoquait et moi aussi.
On me mit dans un fiacre, où je trouvai un médecin. La blessure ne se trouva pas dangereuse, la balle n’ayant point touché les os ; mais j’étais dans un tel état d’excitation qu’il fut impossible de me panser sur-le-champ. Au moment où le fiacre partait, je vis à la portière une main tremblante ; c’était mon adversaire qui revenait encore. Je secouai la tête pour toute réponse ; j’étais dans une telle rage, que j’aurais vainement fait un effort pour lui pardonner, tout en sentant bien que son repentir était sincère.
Arrivé chez moi, le sang qui coulait abondamment de mon bras me soulagea beaucoup ; car la faiblesse me délivra de ma colère, qui me faisait plus de mal que ma blessure. Je me couchai avec délices, et je crois que je n’ai jamais rien bu de plus agréable que le premier verre d’eau qu’on me donna.
M’étant mis au lit, la fièvre me prit. Ce fut alors que je commençai à verser des larmes. Ce que je ne pouvais concevoir, ce n’était pas qu’elle eût cessé de m’aimer, mais c’était qu’elle m’eût trompé. Je ne comprenais pas par quelle raison une femme qui n’est forcée ni par le devoir, ni par l’intérêt, peut mentir à un homme lorsqu’elle en aime un autre. Je demandais vingt fois par jour à Desgenais comment cela était possible. « Si j’étais son mari, disais-je, ou si je la payais, je concevrais qu’elle me trompât ; mais pourquoi, si elle ne m’aimait plus, ne pas me le dire ? pourquoi me tromper ? » Je ne concevais pas qu’on pût mentir en amour ; j’étais un enfant alors, et j’avoue qu’à présent je ne le comprends pas encore. Toutes les fois que je suis devenu amoureux d’une femme, je le lui ai dit, et toutes les fois que j’ai cessé d’aimer une femme, je le lui ai dit de même, avec la même sincérité, ayant toujours pensé que, sur ces sortes de choses, nous ne pouvons rien par notre volonté et qu’il n’y a de crime qu’au mensonge.
Desgenais, à tout ce que je disais, me répondait : C’est une misérable ; promettez-moi de ne plus la voir. Je le lui jurai solennellement. Il me conseilla en outre de ne lui point écrire, même pour lui faire des reproches, et, si elle m’écrivait, de ne pas répondre. Je lui promis tout cela, presque étonné qu’il me le demandât et indigné de ce qu’il pouvait supposer le contraire.
Cependant la première chose que je fis, dès que je pus me lever et sortir de la chambre, fut de courir chez ma maîtresse. Je la trouvai seule, assise sur une chaise dans un coin de sa chambre, le visage abattu et dans le plus grand désordre. Je l’accablai des plus violents reproches ; j’étais ivre de désespoir. Je criais à faire retentir toute la maison, et en même temps les larmes me coupaient parfois la parole si violemment, que je tombais sur le lit pour leur donner un libre cours. Ah ! infidèle, ah ! malheureuse, lui disais-je en pleurant, tu sais que j’en mourrai ; cela te fait-il plaisir ? que t’ai-je fait ?
Elle se jeta à mon cou, me dit qu’elle avait été séduite, entraînée ; que mon rival l’avait enivrée dans ce fatal souper, mais qu’elle n’avait jamais été à lui ; qu’elle s’était abandonnée à un moment d’oubli, qu’elle avait commis une faute, mais non pas un crime ; enfin, qu’elle voyait bien tout le mal qu’elle m’avait fait, mais que, si je ne la reprenais, elle en mourrait aussi. Tout ce que le repentir sincère a de larmes, tout ce que la douleur a d’éloquence, elle l’épuisa pour me consoler ; pâle et égarée, sa robe entr’ouverte, ses cheveux épars sur ses épaules, à genoux au milieu de la chambre, jamais je ne l’avais vue si belle, et je frémissais d’horreur pendant que tous mes sens se soulevaient à ce spectacle.
Je sortis brisé, n’y voyant plus et pouvant à peine me soutenir. Je ne voulais jamais la revoir ; mais au bout d’un quart d’heure j’y retournai. Je ne sais quelle force désespérée m’y poussait ; j’avais comme une sourde envie de la posséder encore une fois, de boire sur son corps magnifique toutes ces larmes amères et de nous tuer après tous les deux. Enfin, je l’abhorrais et je l’idolâtrais ; je sentais que son amour était ma perte, mais que vivre sans elle était impossible. Je montai chez elle comme un éclair ; je ne parlai à aucun domestique, j’entrai tout droit, connaissant la maison, et je poussai la porte de sa chambre.
Je la trouvai assise devant sa toilette, immobile et couverte de pierreries. Sa femme de chambre la coiffait ; elle tenait à la main un morceau de crêpe rouge qu’elle passait légèrement sur ses joues. Je crus faire un rêve ; il me paraissait impossible que ce fût là cette femme que je venais de voir, il y avait un quart d’heure, noyée de douleur et étendue sur le carreau. Je restai comme une statue. Elle, entendant sa porte s’ouvrir, tourna la tête en souriant. Est-ce vous ? dit-elle. Elle allait au bal et attendait mon rival qui devait l’y conduire. Elle me reconnut, serra ses lèvres et fronça le sourcil.
Je fis un pas pour sortir ; je regardais sa nuque, lisse et parfumée, où ses cheveux étaient noués et sur laquelle étincelait un peigne de diamant. Cette nuque, siège de la force vitale, était plus noire que l’enfer ; deux tresses luisantes y étaient tordues, et de légers épis d’argent se balançaient au-dessus. Ses épaules et son cou, plus blancs que le lait, en faisaient ressortir le duvet rude et abondant. Il y avait dans cette crinière retroussée je ne sais quoi d’impudemment beau qui semblait me railler du désordre où je l’avais vue un instant auparavant. J’avançai tout d’un coup et frappai cette nuque d’un revers de mon poing fermé. Ma maîtresse ne poussa pas un cri ; elle tomba sur ses mains. Après quoi je sortis précipitamment.
Rentré chez moi, la fièvre me reprit avec une telle violence que je fus obligé de me remettre au lit. Ma blessure s’était rouverte et j’en souffrais beaucoup. Desgenais vint me voir ; je lui racontai tout ce qui s’était passé. Il m’écouta dans un grand silence, puis se promena quelque temps par la chambre comme un homme irrésolu. Enfin il s’arrêta devant moi, et partit d’un éclat de rire. « Est-ce que c’est votre première maîtresse ? me dit-il. – Non ! lui dis-je, c’est la dernière. »
Vers le milieu de la nuit, comme je dormais d’un sommeil agité, il me sembla dans un rêve entendre un profond soupir. J’ouvris les yeux et vis ma maîtresse debout près de mon lit, les bras croisés, pareille à un spectre. Je ne pus retenir un cri d’épouvante, croyant à une apparition sortie de mon cerveau malade. Je me lançai hors du lit et m’enfuis à l’autre bout de la chambre ; mais elle vint à moi. – C’est moi, dit-elle ; et, me prenant à bras-le-corps, elle m’entraîna. – Que me veux-tu ? criai-je ; lâche-moi ! je suis capable de te tuer tout à l’heure.
– Eh bien ! tue-moi, dit-elle. Je t’ai trahi, je t’ai menti, je suis infâme et misérable ; mais je t’aime, et ne puis me passer de toi.
Je la regardai ; qu’elle était belle ! Tout son corps frémissait ; ses yeux, perdus d’amour, répandaient des torrents de volupté ; sa gorge était nue, ses lèvres brûlaient. Je la soulevai dans mes bras. – Soit, lui dis-je ; mais, devant Dieu qui nous voit, par l’âme de mon père, je te jure que je te tue tout à l’heure et moi aussi. – Je pris un couteau de table qui était sur ma cheminée et le posai sous l’oreiller.
– Allons, Octave, me dit-elle en souriant et en m’embrassant, ne fais pas de folie. Viens, mon enfant ; toutes ces horreurs te font mal ; tu as la fièvre. Donne-moi ce couteau.
Je vis qu’elle voulait le prendre. – Écoutez-moi, lui dis-je alors ; je ne sais qui vous êtes et quelle comédie vous jouez, mais quant à moi je ne la joue pas. Je vous ai aimée autant qu’un homme peut aimer sur terre, et pour mon malheur et ma mort, sachez que je vous aime encore éperdument. Vous venez me dire que vous m’aimez aussi, je le veux bien ; mais par tout ce qu’il y a de sacré au monde, si je suis votre amant ce soir, un autre ne le sera pas demain. Devant Dieu, devant Dieu, répétai-je, je ne vous reprendrai pas pour maîtresse, car je vous hais autant que je vous aime. Devant Dieu, si vous voulez de moi, je vous tue demain matin. – En parlant ainsi, je me renversai dans un complet délire. Elle jeta son manteau sur ses épaules et sortit en courant.
Lorsque Desgenais sut cette histoire, il me dit : « Pourquoi n’avez-vous pas voulu d’elle ? vous êtes bien dégoûté ; c’est une jolie femme.
– Plaisantez-vous ? lui dis-je. Croyez-vous qu’une pareille femme puisse être ma maîtresse ? croyez-vous que je consente jamais à partager avec un autre ? songez-vous qu’elle-même avoue qu’un autre la possède, et voulez-vous que j’oublie que je l’aime, afin de la posséder aussi ? Si ce sont là vos amours, vous me faites pitié. »
Desgenais me répondit qu’il n’aimait que les filles, et qu’il n’y regardait pas de si près. « Mon cher Octave, ajouta-t-il, vous êtes bien jeune ; vous voudriez avoir bien des choses, et de belles choses, mais qui n’existent pas. Vous croyez à une singulière sorte d’amour ; peut-être en êtes-vous capable ; je le crois, mais ne le souhaite pas pour vous. Vous aurez d’autres maîtresses, mon ami, et vous regretterez un jour à venir ce qui vous est arrivé cette nuit. Quand cette femme est venue vous trouver, il est certain qu’elle vous aimait ; elle ne vous aime peut-être pas à l’heure qu’il est, elle est peut-être dans les bras d’un autre ; mais elle vous aimait cette nuit-là, dans cette chambre ; et que vous importe le reste ? Vous aviez là une belle nuit ; et vous la regretterez, soyez-en sûr, car elle ne reviendra plus. Une femme pardonne tout, excepté qu’on ne veuille pas d’elle. Il fallait que son amour pour vous fût terrible, pour qu’elle vînt vous trouver, se sachant et s’avouant coupable, se doutant peut-être qu’elle serait refusée. Croyez-moi, vous regretterez une nuit pareille, car c’est moi qui vous dis que vous n’en aurez guère. »
Il y avait dans tout ce que disait Desgenais un air de conviction si simple et si profond, une si désespérante tranquillité d’expérience, que je frissonnais en l’écoutant. Pendant qu’il parlait, j’éprouvai une tentation violente d’aller encore chez ma maîtresse, ou de lui écrire pour la faire venir. J’étais incapable de me lever ; cela me sauva de la honte de m’exposer de nouveau à la trouver ou attendant mon rival, ou enfermée avec lui. Mais j’avais toujours la facilité de lui écrire ; je me demandais malgré moi, dans le cas où je lui écrirais, si elle viendrait.
Lorsque Desgenais fut parti, je sentis une agitation si affreuse, que je résolus d’y mettre un terme, de quelque manière que ce fût. Après une lutte terrible, l’horreur surmonta enfin l’amour. J’écrivis à ma maîtresse que je ne la reverrais jamais, et que je la priais de ne plus revenir, si elle ne voulait s’exposer à être refusée à ma porte. Je sonnai violemment, et ordonnai qu’on portât ma lettre le plus vite possible. À peine mon domestique eut-il fermé la porte, que je le rappelai. Il ne m’entendit pas ; je n’osai le rappeler une seconde fois ; et, mettant mes deux mains sur mon visage, je demeurai enseveli dans le plus profond désespoir.
CHAPITRE IV
Le lendemain, au lever du soleil, la première pensée qui me vint fut de me demander : « Que ferai-je à présent ? »
Je n’avais point d’état, aucune occupation. J’avais étudié la médecine, le droit, sans pouvoir me décider à prendre l’une ou l’autre de ces deux carrières ; j’avais travaillé six mois chez un banquier, avec une telle inexactitude, que j’avais été obligé de donner ma démission à temps pour n’être pas renvoyé. J’avais fait de bonnes études, mais superficielles, ayant une mémoire qui veut de l’exercice, et qui oublie aussi facilement qu’elle apprend.