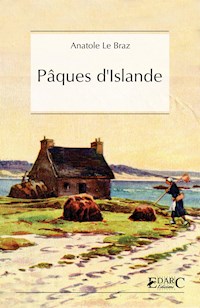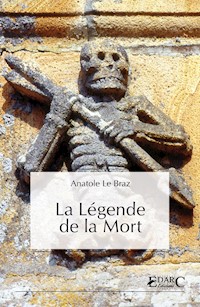1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Ce n’étaient, à première vue, que de banals imprimés, des « tableaux » divisés en colonnes, avec des rubriques sans intérêt et des chiffres indiquant soit le nombre des heures de veille durant le mois, soit la quantité d’huile consommée pour l’éclairage. Mais, au verso des feuilles, s’étageaient les sillons réguliers d’une solide écriture paysanne. Une âme sombre et douloureuse y contait, en manière d’« Observations sur les circonstances du service », le drame peut-être le plus atroce dont les tragiques annales du Raz aient conservé le souvenir. Je laisse la parole à Goulven Dénès, « chef gardien — ainsi qu’il se qualifie lui-même — du phare de Gorlébella ».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
ANATOLE LE BRAZ
LE GARDIEN DU FEU
© 2024 Librorium Editions
ISBN : 9782385745707
LE GARDIEN DU FEU
— Voici le dossier de cette étrange affaire, me dit l’ingénieur.
Il étala devant moi, sur la table du bureau où nous étions assis, une chemise verte contenant divers papiers et portant, en grosses lettres rondes, cette suscription : « Phare de Gorlébella, 1876. »
— Vous connaissez le phare, n’est-ce pas ?
Je l’avais visité l’année précédente, au cours d’une excursion à l’île de Sein, et je n’avais pas à faire grand effort pour revoir, par le souvenir, sa haute silhouette de pierre dressée en plein Raz, dans une solitude éternelle, au milieu d’une mer farouche agitée d’incessants remous et dont les sourires même, les jours de calme, ont quelque chose d’énigmatique et d’inquiétant. L’ingénieur poursuivit :
— Il vous suffira, quant au reste, de savoir ceci. En 1876, tout comme à présent, le personnel de Gorlébella se composait de trois hommes. Mais, de ces trois hommes, il n’y en avait que deux qui fussent de service en même temps. Le règlement porte, en effet, que chaque gardien, après avoir demeuré un mois au phare, a droit à un congé de quinze jours. Tous les seconds samedis, à moins que l’état de la mer n’y mette obstacle, le bateau ravitailleur accoste au récif, débarque les provisions et prend à son bord, pour le ramener à terre, l’exilé dont c’est le tour d’être rapatrié. Au sommet de la Pointe du Raz s’élève ou plutôt se tapit, si vous vous souvenez, une sorte de hameau administratif, formé des bâtiments désaffectés de l’ancien phare. C’est un groupe de maisonnettes basses, raccordées bout à bout et ceintes d’un vaste enclos où dans l’abri des murs, poussent chétivement quelques légumes. A l’entour s’étend le sinistre paysage que vous savez, un dos de promontoire nu et comme rongé de lèpre, troué çà et là par des roches coupantes, de monstrueuses vertèbres de granit. Nulle autre végétation que des brousses à ras de sol, des ajoncs rampants, une herbe éphémère, tout de suite brûlée par les acides marins. Vous n’êtes pas sans avoir remarqué l’air de stupeur muette et résignée qu’ont toutes choses en ces parages, les plantes comme les bêtes, et les habitations aussi bien que les gens. Voilà pourtant l’oasis de bon repos après laquelle aspirent de tous leurs vœux les factionnaires de Gorlébella. Du moins ne s’y sentent-ils plus les emmurés des eaux. Si peu récréatifs que soient ces horizons, encore délassent-ils leurs yeux de la perpétuelle et obsédante agitation des vagues. Et puis, ils ont là leur « chez eux » ; ils y retrouvent la femme, les enfants, la figure chère des êtres et des objets familiers, rentrent enfin dans la vie normale, savourent la joie, irraisonnée mais profonde, d’appartenir de nouveau à la grande communauté humaine… J’ai dit ; maintenant, feuilletez.
La première pièce était un télégramme sur papier jaune adressé par le conducteur des Ponts et Chaussées d’Audierne à l’ingénieur ordinaire chargé du service des phares, en résidence à Quimper. Elle était datée du 2 mai et conçue en ces termes : « Feu de Gorlébella, resté allumé toute la journée d’hier, éteint cette nuit. Rumeurs bizarres circulent. Prière donner instructions, si ne pouvez venir vous-même. »
Suivait une lettre de l’ingénieur ordinaire à l’ingénieur en chef : « J’ai l’honneur de vous transmettre les pages ci-jointes, trouvées sur le banc de quart, dans la chambre de la lanterne. Goulven Dénès, avant de disparaître, a pris soin d’y consigner tout le détail des événements. Nous n’avons pas encore pu pénétrer dans la pièce où sont enfermés les deux cadavres. Il faudra sans doute briser la porte à coups de hache. A bientôt un rapport qui vous fournira les renseignements complémentaires… »
Je sautai vite à la liasse de vieux papiers qui accompagnaient cette note.
Ce n’étaient, à première vue, que de banals imprimés, des « tableaux » divisés en colonnes, avec des rubriques sans intérêt et des chiffres indiquant soit le nombre des heures de veille durant le mois, soit la quantité d’huile consommée pour l’éclairage. Mais, au verso des feuilles, s’étageaient les sillons réguliers d’une solide écriture paysanne. Une âme sombre et douloureuse y contait, en manière d’« Observations sur les circonstances du service », le drame peut-être le plus atroce dont les tragiques annales du Raz aient conservé le souvenir. Je laisse la parole à Goulven Dénès, « chef gardien — ainsi qu’il se qualifie lui-même — du phare de Gorlébella ».
I
Que mon ingénieur me pardonne. Je me suis rendu coupable, ces derniers temps, des manquements les plus graves à mes fonctions, et, dans quelques jours, je vais déserter mon poste. Il s’en étonnera, je pense, lui qui m’a souvent cité comme un employé modèle. Je n’aurais pas cessé de l’être, s’il n’avait dépendu que de moi ; mais il y a une fatalité plus forte que la volonté de l’homme. Je dois à mon ingénieur, je me dois à moi-même de lui exposer pourquoi et comment j’ai failli. Si ce n’avait été à cause de cela je n’aurais pas pris la peine d’écrire ces lignes.
La date portée au calendrier est celle du 20 avril, et le chronomètre marque dix heures du soir. Le mois d’avril est mon mois. Je l’ai tenu longtemps pour un mois heureux ; je croyais à son influence bienfaisante sur ma destinée. Je sais maintenant qu’il n’y a que de faux bonheurs.
J’étais, du reste, à présent que j’y songe, l’homme le plus enclin à être dupe. Je suis né de cette race austère des laboureurs du Léon, dont la religion est le souci suprême. Mon enfance fut sérieuse et un peu triste. Là-bas, point de chansons, ni de danses, ni de ces jeux qui égayent la vie. Je ne me rappelle de ce passé que des bruits de prières et des sonneries de cloches tintant des offices. Une famille s’y considérerait comme maudite, si elle ne comptait parmi ses membres un prêtre. Je fus élevé en vue du sacerdoce ; à douze ans, j’entrais au petit séminaire de Saint-Pol.
Nul écolier ne se montra plus docile ni plus appliqué. Mais la lenteur de mes progrès dans les études latines me nuisit dans l’esprit de mes maîtres, et, sur la fin de ma seconde, ils conseillèrent à mes parents de me garder auprès d’eux. Ce fut une grande déception pour ma mère qui voyait déjà, dans ses rêves, l’église dont je serais le desservant, et le presbytère, fleuri de clématite, où se reposeraient ses vieux jours. Je ne pus supporter le spectacle de ses larmes. Les travaux de la moisson terminés, je m’engageai dans la Flotte.
Non que la mer me dît beaucoup : le Léon n’est pas une pépinière de marins. J’étais moins fait que personne pour goûter cette existence vagabonde. Tout me déplaisait en elle, ses joies plus encore que ses dangers. Une répugnance invincible m’empêchait de m’amuser comme les camarades, aux escales dans les ports lointains. Je les accompagnais dans leurs orgies, mais j’en sortais intact. A cause de ma réserve et parce que j’avais étudié pour la prêtrise, ils m’avaient surnommé Pater-Noster. « Tu n’auras jamais l’âme d’un matelot », me disaient-ils. Et c’était vrai. Je n’en remplissais pas moins consciencieusement mes devoirs. Il n’y a pas une seule punition sur mon livret. Mais, dans la tranquillité des quarts nocturnes, libre de me laisser aller à mes songeries, sous les étoiles, je me représentais, sur une des collines de mon pays, une maison de pierre grise dans un courtil, un filet de fumée paisible au-dessus du toit, et, dans l’ombre du logis, une jeune femme, lumineuse comme une clarté.
Par exemple, je ne me figurais pas bien ses traits, à cette jeune femme. Il ne m’était pas encore arrivé d’en regarder aucune, sauf peut-être, avant mon entrée au collège, des petites amies de catéchisme, pâles images anciennes, confuses et décolorées.
Explique cela qui pourra : un jour, brusquement, je la vis paraître et, comme par une révélation intérieure, je la reconnus. J’avais alors vingt-six ans. Après une croisière aux Indes, où j’avais étrenné mes galons de quartier-maître, je venais d’être désigné pour servir à bord de l’Alcyon, un garde-pêche minuscule, presque un yacht de plaisance, avec Tréguier pour port d’attache.
Or, ce dimanche-là — un dimanche d’avril — , nous étions rangés à quai, nos hautes vergues plongeant parmi les branches des vieux ormes reverdis. L’équipage, désœuvré, jouait aux cartes sur le pont. Moi, debout à l’arrière, j’échangeais de vagues propos avec le douanier de planton sous les arbres. C’était à l’issue de vêpres. Des groupes d’artisanes descendaient la Grand’Rue, leurs psautiers dans les mains. Machinalement je tournai la tête de leur côté. Si pourtant je ne l’avais pas fait, ce geste quelconque, je ne monterais pas, à cette heure, cette sinistre faction de vengeance et d’agonie au phare de Gorlébella.
— Quelle est donc celle qui marche un peu en avant des autres ? demandai-je au gabelou, en déguisant de mon mieux la subite émotion qui m’avait saisi.
J’entends encore sa réponse.
— Ça, c’est la plus jolie fille de Tréguier, Adèle Lézurec. Son père, un retraité de la marine, tient l’auberge des Trois-Rois… Vous savez bien, rue Colvestre ?
Elle, cependant, avait passé, de son allure élégante de citadine, sans daigner s’apercevoir qu’il y avait là deux hommes qui parlaient d’elle, sans se douter surtout que son charme venait d’ensorceler la pensée de l’un d’eux, de l’ensorceler toute, et pour jamais. Je suivis des yeux, jusqu’à ce qu’elles se fussent effacées dans l’éloignement du mail, la blancheur claire de sa cornette à deux pointes et la nuance gris perle de son grand châle à franges, qui tombait de ses épaules à ses talons comme les ailes repliées d’un goéland. Et, le reste de l’après-midi, retiré dans le poste, où j’étais sûr de n’être point troublé, je ne fis que murmurer sur un ton de litanie ces mots à qui je prêtais je ne sais quelles significations magiques : « Rue Colvestre… les Trois-Rois… Adèle Lézurec !… »
C’était dans la haute ville, cette rue Colvestre, presque à l’orée de la campagne, en des parages silencieux, peu fréquentés des matelots. On préférait les tavernes du port, plus animées, plus engageantes, et dans lesquelles on pouvait s’attarder davantage, sans compter que les servantes, familiarisées avec les habitudes des hommes de mer, y étaient accortes et faciles. Le soir venu, ma permission de minuit en poche, je m’acheminai pour la première fois vers les faubourgs.
L’air était doux ; les vergers des monastères embaumaient. Les sentiments les plus contradictoires s’agitaient en moi : c’était un mélange singulier d’incertitude et d’audace. En passant au pied de la cathédrale, je vis que l’intérieur en était illuminé. Je franchis le seuil du porche et m’agenouillai derrière une confrérie laïque de vieilles femmes qui récitaient le rosaire dans la chapelle de la Vierge. L’encens des vêpres se respirait encore sous les voûtes et l’odeur des cires pascales emplissait la nef. Je priai de toute ma ferveur de Léonard. Quand je sortis, ma fièvre était tombée, ma résolution ne tremblait plus, et ce fut d’une main délibérée que je soulevai le loquet des Trois-Rois.
Je me trouvai dans une salle basse, aux boiseries peintes de vert et de blanc, comme une cabine de navire. De-ci, de-là, étaient accrochées des vues de mer ou de paysages lointains, une « Éruption du Vésuve », un « Combat de Trafalgar », et, à la place d’honneur, au-dessus de la cheminée, un diplôme, sous verre, de second maître de timonerie. Pour ameublement, quelques tables, garnies de leurs tabourets, sur un parquet de briques aspergé de son ; dans les étagères d’angle, des bouteilles de boissons diverses qui attendaient encore, pour la plupart, qu’on brisât leur cachet. Tout cela un peu fané, un peu pauvre, mais d’une pauvreté décente et quasi coquette.
Mon ingénieur m’excusera de me complaire de la sorte en d’aussi menus détails. Je suis comme le naufragé qui va mourir, et je baise une à une les reliques chères, les tristes reliques de mon passé défunt…
Il n’y avait dans l’auberge, quand j’entrai, qu’un homme d’un âge respectable, à mine usée, avec ce teint de bistre que donnent les soleils de la mer aux gens qui ont longtemps « bourlingué ». Il semblait plongé dans la lecture d’un journal dont j’ai retenu le titre — vous saurez tout à l’heure pourquoi, — le Moniteur des Sémaphores et des Phares. En réalité, je crois bien qu’il sommeillait, car il me dévisagea d’abord de l’air ahuri d’un dormeur qu’on dérange. Il ne me témoigna, du reste, aucun empressement ; sans même m’inviter à m’asseoir, il se contenta de crier :
— Adèle !
Une porte vitrée s’ouvrit au fond de la pièce ; la jeune fille parut.
Elle avait quitté sa toilette des dimanches, mais n’en était que plus gracieuse dans sa robe d’étamine noire, qui dégageait toute la souplesse de sa taille, son buste svelte sur des hanches un peu larges, finement arrondies. Un « mouchoir » de soie des Indes, souvenir, sans doute, des voyages paternels, était noué sur sa poitrine ; sa coiffe mince, épinglée au-dessus du front, laissait à découvert les épais bandeaux de ses cheveux, d’un noir bleuâtre, qu’elle portait en bourrelets sur les tempes, à la manière des Trégorroises. Ses yeux, de nuances changeantes, étaient vifs et doux. Les couleurs de son visage étaient légèrement pâlies, comme d’une plante qui a poussé à l’ombre.
Je la regardais en extase, immobile et muet au milieu de la salle. Mais, au dedans de moi, s’était mis à galoper furieusement le vieux sang barbare qui est, dit-on, dans les veines léonardes et que je tiens de mes ancêtres. Cette femme dont, la veille encore, j’ignorais l’existence, j’aurais voulu la saisir d’un bond, l’étreindre, l’entraîner comme une proie.
Elle, cependant, soulevée sur la pointe de ses pieds fins, à demi sortis de leurs babouches, avait haussé la mèche d’une petite lampe de porcelaine, suspendue aux solives, qui était tout l’éclairage de l’humble logis.
— On verra du moins la moitié de sa misère ! — dit-elle avec gaieté, d’une voix chantante, au timbre grave et pur.
Et j’eus l’impression que je l’avais déjà entendue, cette voix, dans les songes de mes traversées, durant les quarts solitaires, sous les nuits calmes, alors que des musiques invisibles semblent courir le long du bordage, parmi les phosphorescences de la mer… Elle reprit, en se tournant vers moi :
— Asseyez-vous donc, matelot ! Que faut-il vous servir ?
— Si tu l’appelais quartier-maître, hein ! fit à ce moment, d’un ton assez bourru, le vieux qui n’avait pas encore desserré les lèvres, pas même pour me donner le bonsoir.
Et, s’adressant à moi, maintenant, il continua :
— Elle devrait pourtant savoir reconnaître un gradé d’avec un simple mathurin, puisqu’elle est ma fille. Car j’ai navigué, moi aussi. Le brevet que voilà, c’est le mien.
Il me montrait le diplôme qui était sur la cheminée, dans un cadre.
— Oh bien ! déclarai-je, nous allons donc trinquer ensemble. Vous ne me refuserez pas cela, mon ancien ?
Nous trinquâmes une fois, deux fois… Il me contait ses campagnes, tout heureux d’évoquer, devant un cadet, les croisières belliqueuses du temps de l’Empire, les mouillages dans les eaux de Sébastopol, les débarquements dans les arroyos du Cambodge et sur les plages du Mexique. Je feignais de l’écouter religieusement, mais mon attention était ailleurs : elle suivait chacun des mouvements d’Adèle, son geste harmonieux pour remplir nos verres, et, quand elle s’était rassise à l’écart, dans la lumière de la lampe qui la baignait toute, le tremblement délicat que faisait l’ombre de ses grands cils bruns sur ses pommettes de frais ivoire. Ce m’était une douceur inexprimable de la sentir là, tout près. Les tumultes de mon sang, s’étaient apaisés. Je goûtais un bien-être intime, une joie silencieuse et profonde, l’oubli complet de tout ce qui n’était pas cette belle fille, cette fleur de jeunesse et de grâce, cette rose d’enchantement. Les cloches des moûtiers voisins tintaient les heures dans la nuit. Puis une lourde sonnerie s’ébranla, roula par grandes ondes solennelles sur la ville.
— Le couvre-feu, dit Adèle.
Le vieux repartit :
— Un dernier coup, camarade, à la santé des gars de la Flotte !… Il n’y a que la mer, voyez-vous, il n’y a que la mer. Moi, je la pleure comme un paradis perdu.
Il avait abattu son poing sur la table, faisant voler à terre la gazette qui l’absorbait si fort, sur le tantôt, quand j’étais entré. Adèle se pencha pour la ramasser et, jetant les yeux sur le titre, articula d’une voix ferme.
— Lorsqu’on la contemple en toute sécurité de la chambre d’un phare ou de la maisonnette blanche d’un sémaphore, comme cela, oui, je comprends la mer. Autrement non ! Paradis des hommes, mais enfer des femmes !…
C’était ma destinée et la sienne dont elle venait de prononcer l’arrêt.
II
21 avril.
Rien à signaler, mon ingénieur, du moins pour ce qui est du service. Le baromètre est sur « variable » ; il souffle grande brise de noroît. Ce matin, après l’extinction du feu, j’ai monté mon matelas dans la lanterne, ainsi que des provisions de bouche pour plusieurs jours. Car, d’ici quelque temps, je ne me soucie pas de redescendre. Comme je passais sur le palier du deuxième étage, devant la porte de leur chambre — de leur tombe, — je l’ai entendue, elle, qui disait à l’autre :
— Je savais bien qu’il avait trop de religion pour vouloir cela !
Puis, mon pas s’éloignant, elle a poussé une clameur folle, un cri d’angoisse désespérée :
— Au nom de Dieu et de saint Yves ! Goulven !… Goulven Dénès !…
J’ai continué de gravir les marches, j’ai mangé un biscuit trempé d’eau et je me suis étendu sur le matelas, les bras en croix sous ma tête. J’ai dormi du sommeil de mes nuits anciennes, du temps que l’image de la femme ne me hantait point, — d’un sommeil sans pensée et sans rêves. Le soleil se couchait derrière l’Ar-Mèn, dans les lointains de la mer, quand j’ai rouvert les yeux. Je suis reposé : j’ai les idées d’une lucidité qui tient du prodige, comme si l’éblouissante flamme du phare projetait son éclat jusqu’au fond de mon esprit.
Saint Yves ! Elle a osé invoquer saint Yves !… Ce fut la veille de son pardon que nous nous fiançâmes. Je revenais de Smyrne, libéré ; à Toulon, j’avais trouvé ma nomination de gardien de troisième classe au phare de Bodic. Sans même prendre le temps d’aller embrasser mes parents, en Léon, j’avais escaladé la diligence de Tréguier, bondée de voyageurs. Je fis mon entrée dans la vieille ville des évêques, juché sur un monceau de malles ; mais, au tournant de la rue de l’Hospice, je me laissai couler à terre. Adèle Lézurec était là qui m’attendait. Par espièglerie, elle s’était couvert tout le visage du capuchon de sa mante.
— C’était pour savoir si votre cœur m’aurait devinée, me dit-elle.
Je lui répondis :
— Là-bas, en Orient, je sentais, à un parfum d’herbe mouillée, tout à coup répandu dans l’air, qu’il y avait dans le courrier de France une lettre de vous.
Depuis un an que je ne l’avais revue, elle avait encore embelli. Elle était dans tout l’épanouissement de ses formes, exhalait une odeur de sève chaude, comme les jeunes écorces en travail des printemps. Toute trace d’étiolement avait disparu. Ses yeux avaient tour à tour des lassitudes et des ardeurs étranges. Un sortilège émanait d’elle. Je me souviens que j’en fus parfois troublé jusqu’à en éprouver une sorte d’effroi. Je me remémorais ce dicton de la sagesse léonarde : « Tu reconnaîtras la jeune fille digne d’être épousée à ce qu’elle ne t’inspirera que des pensées chastes. » J’en avais d’autres auprès d’Adèle Lézurec. Ce n’était point là, je m’en rendais compte, l’amour probe et calme, exempt de toute fièvre, qui aurait été mon lot si j’eusse aimé chez nous, au grave pays de Léon. Un mot de ma mère aussi me revenait par moments ; lorsque je lui avais fait part de ma détermination, elle m’avait écrit : « Tu prends femme hors de ta race ; puisses-tu n’avoir pas à t’en repentir !… »
Mais un regard d’Adèle dissipait tous ces nuages.
Les reflets de ses yeux produisaient sur moi un effet de vertige qui m’étourdissait l’âme, comme de fixer longtemps le scintillement du soleil sur la mer. Je ne m’appartenais plus, j’étais sa chose. Je pus, à notre messe de mariage, mesurer à quel point elle me possédait. Vainement, je m’efforçai de prier : je ne savais plus ; j’étais comme ces ivrognes qui recommencent toujours leur chanson au même vers et n’arrivent pas plus à en sortir la trentième fois que la première. Il fallait vraiment que je fusse bien changé ! Autre détail non moins significatif. Mes parents, alléguant l’état de leur santé, avaient envoyé leur consentement sur timbre. Or, ma mère, ma propre mère m’était à cet instant devenue si indifférente que son absence n’attrista point mon bonheur.
Sur le soir, pourtant, je fus saisi d’une douloureuse impression de mélancolie. Adèle, conformément à l’usage trégorrois, avait décidé qu’un bal suivrait le repas de noces et elle avait loué, à cette intention, la salle du Rocher de Cancale, sur le quai, plus spacieuse que le petit café de la rue Colvestre. Quelques jours auparavant, elle avait essayé de m’apprendre les pas les plus simples. Mais j’y apportais une maladresse native qui la fit rire d’abord, puis la découragea.
— Vous dansez comme un ours des foires, me dit-elle, non sans dépit… Ma foi, tant pis ! Vous ferez comme les vieux, vous assisterez aux ébats des autres.
Toute la soirée, effectivement, je demeurai sur ma chaise, regardant passer les couples et Adèle tournoyer aux bras des jeunes hommes. Elle glissait, onduleuse, à demi pâmée ; un frémissement voluptueux gonflait sa gorge, entrouvrait ses lèvres, agitait son corps. Je me rappelai des bayadères que j’avais vues se trémousser, avec des gestes pareils, dans un mauvais lieu, à Singapore. Pour secouer l’obsession de cette image pénible, je sortis.
C’était, dehors, une nuit d’avril, comme à présent, une nuit pâle et tiède, parsemée d’étoiles. Au pied des quais bruissait doucement le clapotis de la mer montante. Une détresse infinie me serra le cœur ; je me sentais seul, loin de tout, détaché de la vie même… A ce moment, une forme s’approcha : je reconnus le douanier qui m’avait donné, l’année précédente, le nom et l’adresse de celle qui était aujourd’hui ma femme.
— Un peu d’air fait du bien, n’est-ce pas ? me dit-il.
— Oui, en vérité, répondis-je.
Et, feignant d’être tout heureux de la rencontre, je l’emmenai prendre un verre au Rocher de Cancale.
Vers les deux heures du matin, les gens de la noce vinrent, aux sons d’une musette et d’un accordéon, nous reconduire dans la haute ville, et je dus boire encore avec eux, avant de rejoindre Adèle dans sa chambre. Lorsque j’y pénétrai, elle était au miroir, qui défaisait sa coiffure. La cornette ôtée, ses lourds cheveux s’épandirent, l’enveloppèrent toute d’un flot sombre où des clartés frissonnaient çà et là, comme des lueurs d’astres sur un étang nocturne. J’en rassemblai par derrière deux pleines poignées et, y plongeant mes lèvres, mes yeux, tout mon visage, sans que j’eusse su dire si c’était d’amour ou de désespoir, je fondis en sanglots.
Les jours, les ans qui suivirent n’ont pas d’histoire. En me retournant vers ce passé, je vois des pays gais, riches en moissons, des estuaires d’eau profonde entre des collines boisées, des nappes de mer aussi délicatement nuancées que le plumage des mouettes, et les bourgs, des villages, — les jolis villages de là-bas, avec leurs toits d’ardoises claires qui semblent dire au voyageur : « Arrête-toi. Qu’irais-tu chercher plus loin ? Le bonheur est ici ! »
Nous habitâmes tour à tour les postes de Bodic, de Port-Béni, de Lantouar. Tous, des phares terriens, situés sur les hauteurs verdoyantes ou à l’embouchure des rivières salées du Trégor. Il eût été difficile de rêver à notre félicité des nids plus charmants. Nous y vivions, Adèle et moi, côte à côte, jamais séparés. Les nuits même, lorsque j’étais de quart, elle les passait avec moi dans la lanterne. Ces veillées aériennes dans la grande lumière éclatante, lui étaient un prétexte à mille imaginations délicieuses ou folâtres. Élevée, toute petite, sur les genoux des conteuses trégorroises, adonnée plus tard, dans le désœuvrement de ses après-midi solitaires, aux lectures les plus romanesques, elle avait à un degré surprenant l’esprit fécond et la verve ingénieuse de sa race… Sa fantaisie, tout naturellement, créait des merveilles.