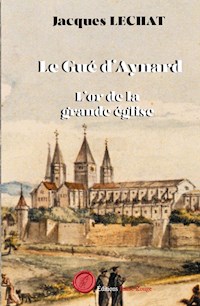Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encre Rouge
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Le Gué d'Aynard
- Sprache: Französisch
Ce roman en deux volumes est l’histoire d’un forgeron qui a vécu sur les terres de la fameuse abbaye de Cluny au début du douzième siècle. Pierrick, fils du forgeron Edwin le rhénan, raconte à la fin de sa vie, ses nombreuses aventures dans une période très particulière du Moyen-Âge que certains ont appelé la petite renaissance. Partout en Europe, la vie économique et culturelle se développe et des églises, des abbayes, des bourgs et des châteaux forts sont construits. Les cités retrouvent progressivement la taille qu’elles avaient à l’époque romaine. Pierrick avec sa famille et ses amis, traverse cette époque pleine de croissance mais aussi dangereuse. La mort et la guerre y sont partout présentes et la paix de Dieu rarement appliquée.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jacques Lechat
LEGUÉD’AYNARD
*
L’épée de Brancion
Prologue
Ce roman est l’histoire d’un jeune homme qui a vécu sur les terres de la fameuse abbaye de Cluny au début du XIIe siècle. Pierrick, fils du forgeron Edwin le Rhénan, raconte à la fin de sa vie ses nombreuses aventures dans une période très particulière du Moyen-Âge que certains ont appelé la petite renaissance. Partout en Europe, la vie économique et culturelle se développe et des églises, des abbayes, des bourgs et des châteaux forts sont construits. Les cités retrouvent progressivement la taille qu’elles avaient à l’époque romaine.
Un réchauffement climatique a permis à l’agriculture de se développer et la population de l’Europe croît. Les bourgs et villages se repeuplent, s’agrandissent et les nombreux chantiers donnent du travail à des milliers d’artisans et ouvriers. Comme la monnaie est encore rare, le troc reste souvent la base des échanges.
Cluny est d’abord une abbaye avec quelques habitations construites hors les murs dans cette belle vallée du sud de la Bourgogne. Le bourg se développe progressivement grâce à l’activité générée par l’abbaye. Des artisans, marchands et autres serviteurs s’enrichissent et créent petit à petit une communauté qui se dote aussi d’une enceinte protectrice. L’abbaye vit essentiellement du culte des morts qui lui permet d’étendre son domaine grâce à des dons en terre ou en or. Les seigneurs, grands ou petits, donnent beaucoup pour que les moines prient pour le repos éternel de leur âme.
Les moines bénédictins de Cluny, qui sont très souvent des fils de familles seigneuriales, ont réussi à se placer depuis plus d’un siècle au centre du jeu politique et religieux de l’Europe. Pour Cluny, cette période est cependant source de problèmes puisque ses deux grands protecteurs, le Pape et l’Empereur sont en conflit permanent pour la question des investitures des évêques.
Des grands féodaux comme les comtes de Toulouse, de Provence, de Flandre, de Bourgogne, de Catalogne ou le duc de Normandie sont très puissants et le roi des francs, Louis VI, augmente petit à petit son pouvoir en étendant ses fiefs et ses alliances. C’est aussi l’époque de la première croisade. Jérusalem a été prise le 15 juillet 1099 et la Terre sainte attire un grand nombre de seigneurs ou de simples gens partis pour défendre leur foi, pour y faire fortune, pour y chercher l’aventure ou plus simplement pour se faire pardonner de graves péchés. La foi chrétienne, la peur de l’enfer, la médiation des saints avec le culte des reliques, le pouvoir des évêques et des abbayes structurent profondément les valeurs et l’organisation de la vie de presque tous les peuples européens de l’époque.
La lutte contre l’Islam et les Sarrasins est un devoir de tous les chrétiens. À côté de la croisade en Palestine, la reconquête de l’Espagne sarrasine occupe aussi une partie de la chevalerie européenne. Mais dans ce monde moyenâgeux, les lignes de front sont très poreuses. Tout le monde s’allie avec tout le monde selon ses besoins et la guerre n’empêche pas nécessairement de faire du commerce avec ses ennemis.
Pierrick, avec sa famille et ses amis, traverse cette époque pleine de croissance, mais aussi de dangers. La mort et la guerre y sont partout présentes et la paix de Dieu rarement appliquée.
La plupart des personnages rencontrés par Pierrick ont réellement existé. La trame de ses aventures est basée sur des faits historiques relatés par des témoins de l’époque et étudiés depuis des siècles par de très nombreux historiens. Tous les lieux mentionnés existent et méritent une visite, car souvent oubliés par les aléas de l’histoire.
Cette première moitié du XIIe siècle déborde de vie et de développements inattendus qui donnent l’occasion à Pierrick de nous raconter en plusieurs tomes ses nombreuses aventures passionnantes et surprenantes.
Chapitre 1
Mon destin sort de la rivière
Année1115
Mon destin a basculé lors d’une belle fin de journée de printemps. Nous étions la veille du jour du Seigneur. Comme le temps était beau et sec depuis deux semaines, la nature explosait en ce mois d’avril 1115. Les arbres, les fleurs, les insectes, les oiseaux, tous avaient repris vie après le long sommeil hivernal.
Après avoir fini les rangements de la forge demandés par notre père, j’étais parti avec mon frère Mathias et ma sœur Alix pêcher le long de la rivière la Guye, un peu en amont de notre village d’Aynard. Alix gardait nos oies qui broutaient calmement à quelques toises de la rive. Mathias, comme toujours passionné par tout ce qui vit, était en train de contempler sans bruit un nid de fourmis en construction.
Moi, j’étais figé comme un héron dans une mare, debout dans l’eau, mes courtes braies remontées sur mes cuisses, le regard fixé sur ma future proie. J’avais déjà retourné plusieurs pierres et récolté quelques écrevisses que je gardais dans une petite bourse en filet que ma sœur Aliénor avait fabriquée pour moi. Je les plaçais par la suite dans un petit vivier que j’avais construit le long du ruisseau qui prenait sa source dans notre domaine.
Nous ne pouvions normalement pas pêcher dans la Guye. C’était le privilège de l’abbaye, mais j’apportais régulièrement au cellérier{1} de Cluny quelques écrevisses et je ne manquais pas non plus de donner chaque année aux moines du prieuré de Saint-Hippolyte des brochets, saumons ou truites que je piégeais avec des nasses dans la Guye. Ces victuailles prisées par les moines me servaient de sauf-conduit. Comme je n’étais pas le seul à améliorer notre ordinaire avec du poisson frais et que cette pêche restait limitée, je me disais que le risque en valait bien la chandelle.
Mon père et ma mère me mettaient pourtant souvent en garde car ils redoutaient aussi Bernard Gros, le seigneur du château d’Uxelles situé à près d’une lieue{2} de notre village. Ce hobereau contestait les droits de l’abbaye et nous envoyait ses soldats pour nous le rappeler. Le prieur de Saint-Hippolyte nous disait bien qu’il n’avait aucune autorité sur nous. Le Pape l’avait confirmé par écrit. Mais le Pape était à Rome et les soldats d’Uxelles jamais très loin.
J’essayais donc d’attraper une truite à la main avant que la lumière du jour ne décline de trop. J’étais devenu assez bon à ce mode de pêche qui demande de bons yeux, une grande dextérité et une poigne bien ferme pour ne pas laisser s’échapper ce poisson glissant !
Le silence n’était troublé que par le bourdonnement des insectes qui volaient au ras de l’eau ou les pépiements des petits troglodytes en train de construire leur nid dans la berge de la rivière. Les rives étaient couvertes de taillis dont nous faisions de bonnes perches pour construire nos bâtiments. Nous allions aussi en couper dans la forêt au-dessus de Bonnay où l’on fait pousser de jeunes arbres pour la construction des murs en torchis des maisons et des granges.
Ces taillis, avec le soleil rasant, compliquaient ma pêche. Les jeux d’ombres qu’ils faisaient à la surface de l’eau rendaient encore plus difficile la vue d’un poisson posé au fond de la rivière. Heureusement, si je le voyais difficilement, lui aussi ne devait voir que des ombres au-dessus de lui. Soudain mon œil fut attiré par un bref éclat au fond de l’eau. « Voilà ma première proie », me dis-je en moi-même. Mais cet éclat semblait ne pas bouger, contrairement à une truite qui ondule lentement dans l’eau.
Tout doucement, je me penchai plus en avant pour apercevoir enfin ce poisson. Rien, sauf encore cet éclat qui reflétait le soleil. Mon expérience de cette pêche à la main me poussait toujours à la patience.
Je scrutai attentivement et j’attendis tout en approchant progressivement ma main de la surface. Mais toujours aucun mouvement dans l’eau ? Je commençais à douter et me disais que ce n’était peut-être qu’un morceau de cristal de roche qui brillait au soleil. Mon père m’avait dit que l’on en trouvait souvent dans le passé dans les rivières de certaines régions. Dans notre rivière, je n’en avais jamais vu. Ou peut-être était-ce une pièce d’argent perdue ?
Ma main plongea alors dans la rivière comme le martin-pêcheur plonge sur sa proie. Mon ami Harald, le fils du vigneron Foulques, m’avait appris à faire attention de frapper l’eau un peu en avant de ma cible car dans l’eau, les objets ne sont pas où l’on croit qu’ils sont ! Mes doigts heurtèrent alors violemment quelque chose de dur et coupant. Je poussai un cri car j’avais poigné dans l’objet avec force comme il faut le faire pour capturer une truite.
Mathias sursauta : « Pierrick, tu t’es fait mal ? ». « Ça va », lui répondis-je, « Je me suis seulement coupé sur un objet tranchant que j’ai pris pour un poisson ». Mathias se leva et descendit à côté de moi dans l’eau pour voir ce que j’avais attrapé. Nous étions tous les deux penchés sur la surface de l’eau, essayant de distinguer malgré la vase que mon geste avait soulevée ce qui m’avait blessé. Petit à petit, l’eau devint plus claire et nous pûmes distinguer un objet métallique en partie enfoui sous les galets de la rivière.
Doucement, pour éviter de troubler l’eau à nouveau, Mathias et moi nous dégageâmes l’objet. « Une épée ! » m’exclamais-je. Quand elle fut libérée des alluvions, je la retirai toute entière de l’eau. Mathias et moi étions tous les deux fascinés par cette arme sortie de l’onde, toujours aussi brillante, comme si on l’y avait jetée la veille !
Que faisait cette épée dans la Guye ? Comment était-elle arrivée là ? Ce furent les premières questions que je me posai en contemplant l’arme encore toute dégoulinante d’eau. Cette épée devait avoir séjourné depuis longtemps dans la rivière car la poignée avait disparu, mais la garde et le pommeau étaient bien intacts.
Mathias et moi restâmes sans voix devant ce magnifique objet sorti de la rivière. La lame luisait sous les rayons du soleil qui passaient au travers des taillis. Le moment était magique, comme une nouvelle naissance. Un don venu de l’eau et pas du ciel !
Après ces moments d’étonnement et d’émerveillement, je repris mes esprits. J’avais compris que cette épée avait quelque chose de surnaturel. Qu’elle était un message venu du passé. Mais qu’elle était aussi une source d’inquiétudes. Que faire de cette arme si spéciale ? Je dis à Mathias : « Petit frère, ceci doit rester secret. Il ne faut en parler à personne. Sauf avec notre père, car lui pourra sans doute nous dire d’où vient cette épée. Mais, silence sur notre découverte même pour nos sœurs. Sinon, toutes leurs amies d’Aynard seront vite au courant. Cherchons un endroit pour la cacher avant de venir plus tard avec Papa la reprendre. »
Mathias repéra un trou dans la rive en dessous d’un grand arbre. Sans doute l’entrée du nid d’une poule d’eau. Un bon endroit pour y cacher notre découverte. L’épée faisait plus de trois pieds avec sa poignée et le pommeau, mais le tunnel de l’oiseau était assez profond pour l’y cacher en entier. Nous mîmes ensuite une grosse pierre pour en fermer l’entrée.
« Pierrick, Mathias, il est temps de rentrer. J’entends la cloche de Saint-Jean-Baptiste qui sonne les Vêpres. Maman va s’inquiéter si nous tardons trop », nous criait Alix qui avait rejoint le bord de la rivière avec ses oies. « Mais que faites-vous tous les deux dans l’eau ? Et Pierrick, tu t’es encore une fois blessé ! Un poisson t’a mordu ? » Du haut de ses sept ans, Alix aimait se moquer de moi et elle savait combien j’aimais ma petite sœur. Surtout quand je pouvais la taquiner et lui tirer les tresses.
Mathias ne sut quoi répondre et rougit à la question de sa sœur. Je repris vite la parole : « J’ai glissé sur une pierre et je me suis ouvert la main en me rattrapant. Mon adorable petit frère est venu à mon secours heureusement. Ma sœur Alix, elle, s’intéresse manifestement plus à ses oies qu’à son grand frère ! » « Vilain », me répondit-elle, « Moi qui t’apporte toujours à boire quand tu as soif et qui cueille des baies quand tu te reposes dans l’herbe ! Ingrat ».
Mathias, qui avait repris ses esprits, nous cria : « Vous pouvez rester là à vous chamailler, les grands, mais moi j’ai faim et je rentre chez nous avec ou sans vous ! » L’audace de notre cadet nous fit éclater de rire et tous trois, nous partîmes en courant vers le village en poussant nos oies devant nous qui appréciaient modérément cette course endiablée sous le regard perçant d’un milan qui cerclait dans les airs au-dessus de nous.
Chapitre 2
Mon village d’Aynard
Comme nous étions sur la rive du côté de Saint-Germain, nous retrouvâmes rapidement la chaussée empierrée qui descendait d’Autun vers Cluny en passant par notre village. En suivant cette route, nous arrivâmes au pont sur la Guye qui nous permettait toute l’année de retrouver notre maison sans nous mouiller les pieds. Le gué était toujours présent à côté de ce pont que les moines de Cluny avaient fait reconstruire avec des poutres posées sur deux piles de pierres élevées sur les rives.
Notre rivière est un cours d’eau parfois capricieux qui serpente dans notre vallée et qui va rejoindre vers la Bise{3}, la rivière Grosne une demi-lieue plus loin en aval. À certaines époques de l’année, elle peut être violente et déborder de ses rives, à d’autres, elle coule paisiblement sans se presser. Elle était pour moi un fabuleux domaine de jeux et de pêche. Et depuis ce fameux jour d’avril 1115, pas uniquement pour attraper des poissons ou des écrevisses.
Cette rivière faisait vivre de nombreux habitants d’Aynard car nous avions quatre moulins qui utilisaient sa force pour moudre du grain et d’autres denrées. Il y en avait un en aval vers le hameau de Cortevaix, un tout près du pont et deux un peu plus loin près d’une petite chênaie. Un lavoir était installé au bord de l’eau avec un toit en paille pour protéger en toute saison les femmes du village qui venaient y battre leur linge.
Notre village d’Aynard comptait à cette époque près d’une trentaine de foyers{4}. Frère Clément, le moine de l’abbaye qui me donnait des leçons de latin près de l’église Saint Odon{5} à Cluny, m’avait raconté qu’à l’époque romaine, il y a près de mille ans, Aynard avait été une importante villa romaine qui possédait tous les villages environnants. Le domaine d’Aynard s’étendait aux villages de Bonnay, Ougy, Ameugny, Saint-Hippolyte, Sercy, Malay et de nombreux autres hameaux.
Nous les habitants d’Aynard, nous nous considérions donc comme nettement supérieurs par rapport à tous nos voisins qui n’étaient que d’anciens vassaux d’Aynard. Nous aimions le rappeler en particulier aux habitants de Saint-Hippolyte qui depuis qu’ils étaient devenus une obédience de Cluny, aimaient nous mépriser car nous dépendions de leur prieur.
Chaque année, le treize août, jour de la fête du Saint, un grand pèlerinage était organisé à Saint-Hippolyte. Les pèlerins y venaient de partout pour prendre de l’eau à la source du Jactin{6}. Les anciens racontaient que Saint Hippolyte, alors soldat romain, avait vu ses blessures guérir miraculeusement après les avoir lavées avec l’eau de cette fontaine. À cette occasion, les discussions sur l’origine seigneuriale d’Aynard et sur le respect que tous nos voisins nous devaient se terminaient parfois en bagarre, le vin aidant.
La bande de gosses d’Aynard, encouragée par ces vieilles histoires, ne manquait pas non plus une opportunité pour provoquer celle de Saint-Hippolyte. Cela dégénérait souvent dans de belles escarmouches à coup de pommes sauvages ou d’orties. Comme j’étais devenu, dès mes douze ans, le chef de notre groupe d’enfants, j’étais toujours en première ligne pour la bataille. Ma mère et mes sœurs me regardaient avec désespoir revenir couvert de bleus et de griffures. Mais le sourire de mon père m’en disait long sur sa fierté d’avoir un fils n’ayant peur de rien et défendant l’honneur d’Aynard.
Après avoir franchi le pont, nous remontâmes, toujours en poussant nos oies devant nous, sur la route empierrée qui longe le cimetière et notre église Saint-Jean-Baptiste. Mon professeur de latin m’avait aussi expliqué que notre église et beaucoup de bâtiments d’Aynard avaient été construits sur d’anciennes maisons et temples romains dont on avait récupéré les pierres. Notre père avait, lui, trouvé deux jolies petites colonnes dans notre champ le long de la Guye et les avait placées de chaque côté de notre âtre en moellons.
Après l’église paroissiale, nous quittâmes la route pour tourner à droite dans un chemin qui mène à notre domaine en longeant le puits du village, le four banal{7} et la chapelle Saint-Martin, juste en face de notre église. À côté de l’église habitait notre chapelain Robert. Il avait été nommé par Bernard de Châtillon, l’évêque de Mâcon, et ne s’entendait pas bien avec le prieur de Saint-Hippolyte. Chacun de ces deux ecclésiastiques nous réclamait la dîme due à l’église.
Les moines, s’appuyant sur un privilège du Pape, estimaient qu’eux seuls pouvaient percevoir cet impôt dans le ban de Cluny{8}. Mais l’évêque Bernard de Châtillon ne partageait pas ce point de vue et donc, les conflits étaient permanents. Le brave Robert était pris entre ses paroissiens, qui ne pouvaient payer deux fois les messes ou les enterrements, et les instructions de son évêque. Mon père avait résolu le problème. Il payait aux deux afin d’avoir la paix. Heureusement qu’il avait des appuis haut placés à Cluny, car le prieur de Saint-Hippolyte n’appréciait guère cette double allégeance.
Dans notre village, une majorité des habitants vivaient sur des tenures appartenant à l’abbaye. C’étaient des laboureurs ou des vignerons qui cultivaient la terre de l’obédience de Cluny en gardant une partie pour vivre eux-mêmes. Cinq familles étaient des serfs qui avaient été donnés à l’abbaye avec la terre qu’ils cultivaient. Il y avait quelques artisans qui travaillaient sur les nombreux chantiers de la région. Des charpentiers ou des tailleurs de pierre étaient venus s’installer chez nous avec leur famille. Nous avions aussi des bergers qui gardaient les troupeaux du prieuré de Saint-Hippolyte et les meuniers qui en faisaient tourner les moulins.
Depuis la famine de 1110, le nombre d’habitants augmentait tout comme les récoltes. Mais quand j’étais enfant, les périodes de disette avaient été très dures pour les villageois, surtout pendant la mauvaise saison où rien ne poussait. Maman distribuait trois fois par semaine avant les vêpres, une soupe chaude pour les femmes et les enfants d’Aynard tenaillés par la faim. L’aumônier{9} de Cluny, qui devait entretenir dix-huit pauvres tous les jours, intervenait aussi pour donner de la nourriture pendant ces périodes difficiles.
Trois fois par an, à la Saint-Vincent, la Saint-Jean-Baptiste et la Saint-Martin, notre village fournissait avec celui de Saint-Hippolyte du vin, des porcs, des moutons, du blé, des volailles et autres denrées pour nourrir la grande abbaye de Cluny. Le prieur de Saint-Hippolyte était responsable de la bonne tenue de toutes ces contributions et devait en rendre compte au chambrier{10} de l’abbaye. Il devait par ailleurs se rendre tous les samedis à Cluny avant les vêpres, pour se faire raser et laver son linge.
La majorité des maisons du village étaient en torchis avec un toit de paille. L’église Saint Jean-Baptiste avait un toit en lauzes, tout comme la forge de mon père pour laquelle un toit en paille n’aurait pu résister aux flammes de son fourneau. Nous avions aussi une auberge située près de la rivière au bord de la route empierrée. Elle était tenue par Mayeul qui gardait aussi, dans une pâture derrière l’auberge, des chevaux pour les messagers qui venaient ou allaient à Cluny. Son fils Roger était mon meilleur ami et nous avons partagé de nombreuses aventures. Quelques marchands s’étaient également installés le long de la grand-route.
Le trafic incessant de visiteurs et de marchandises venant ou allant à Cluny ou plus loin vers le Midi était une bonne source de revenus. Les uns achetaient de quoi boire ou manger, d’autres du vin ou de la farine de nos moulins, ou encore des étoffes tissées dans la région. Comme beaucoup de paysans n’avaient pas d’argent et qu’ils ne pouvaient payer leurs achats que par du troc, ces marchands constituaient un lieu d’échanges permanents pour toutes sortes de denrées. Des poulets pour de la farine, des pommes pour de la viande salée, des œufs pour des planches.
La forge de Papa fonctionnait aussi en partie avec ce système de troc et c’est pourquoi, dès que j’ai eu quatorze ans, j’allais à Cluny chaque semaine porter les marchandises échangées avec des produits de la forge à mon oncle Lambert, le frère de Maman et riche commerçant du bourg. Il vendait ces marchandises sur le marché de Cluny où les acheteurs ne manquaient jamais, et je pouvais ainsi retourner chez nous avec des deniers et des sous d’argent.
À Aynard, nos parents ne nous laissaient pas beaucoup de moments de liberté pour nous amuser, car dès sept ou huit ans, nous devions travailler pour nos familles. D’abord pour garder des volailles ou des cochons, mais aussi pour travailler dans les jardins potagers qui entouraient chaque maison. Ensuite, dès douze ou treize ans, selon les métiers de nos pères, travaux dans la vigne, les champs, les moulins, ou pour moi la forge. Pas d’école ni de loisirs, si ce n’est les fêtes religieuses et les dimanches qui étaient fériés. Mais quand il fallait rentrer les récoltes avant le mauvais temps, même ces jours fériés disparaissaient dans un lourd labeur.
Maman, qui avait appris à lire et à écrire dans sa riche famille de Mazille, nous donnait le soir des cours de lecture, de calcul et d’écriture. Mes sœurs Isabelle et Aliénor étaient plus disciplinées que moi pour ces exercices intellectuels. Heureusement, ma sœur Alix était ma complice pour suivre le vol d’une mouche plutôt que d’écouter l’enseignement de notre mère. Mais ses efforts ont quand même porté leurs fruits, car tous ses enfants ont su lire, écrire et compter.
Moi, à partir de mes quatorze ans, j’eus aussi la chance exceptionnelle, grâce sans doute à l’argent de mon père et aussi aux relations de mon oncle Lambert, d’être accepté à Cluny deux jours par semaine, dans une école destinée aux enfants des nobles et aux futurs moines. Le vieux frère Clément et le jeune frère Martin étaient nos professeurs de latin. Ma mère, qui avait eu la chance d’apprendre à lire et à écrire le latin avec ses frères à Massily, avait absolument voulu que j’en sois aussi capable.
Comme j’étais habitué à courir dans la nature ou à travailler dans la forge, il me fallut du temps, comme pour mon compagnon d’études, le jeune Hugues, seigneur de Berzé, pour nous habituer à rester assis à écouter et écrire pendant des heures. Hugues, qui était né comme moi en 1099, était devenu le seigneur de Berzé à la mort en 1105 de son oncle maternel, le seigneur Hugues Ier qui était resté sans enfant.
L’Abbé Pons de Cluny et son père, Roland le Bressan, avaient estimé que ce jeune seigneur devait aussi apprendre le latin et pas uniquement l’art de la guerre. Mais Hugues rêvait plus de tournois et de chasses que de version latine ! Nous étions devenus amis car nous nous entraidions en nous arrangeant pour cacher des traductions écrites sur des petits bouts de parchemin que nous nous partagions ensuite. Cette amitié complice avec Hugues de Berzé ne fit que grandir au fil des années. Et elle me fut bien utile plus tard dans mes aventures avec mon épée.
Chapitre 3
Landry Gros, maître d’Uxelles
Année1106
Notre pont sur la Guye était aussi régulièrement une source de problèmes car les seigneurs d’Uxelles aimaient réclamer un péage pour les marchands et voyageurs qui y passaient. Mais les moines de Cluny ne l’entendaient pas de cette oreille et veillaient sur les terres qui leur avaient été données.
En 1106, Landry Gros, le vieux maître de la forteresse d’Uxelles, sans doute à court d’argent, s’était mis en tête de rançonner les marchands se rendant à Cluny pour la foire qui se tient chaque année le 29 juin à l’occasion de la fête de Saints Pierre et Paul. Informé par un de ses espions, il envoya un matin ses soldats bloquer dans notre village le passage de la Guye.
Les villageois, dont mon père que j’accompagnais avec tous ses ouvriers, alertés par le tumulte, s’étaient regroupés devant les soldats pour leur demander quelles étaient leurs intentions. À ce moment-là arriva, accompagné de ses fils et de plusieurs chevaliers, le seigneur Landry. Il nous cria de nous écarter et de laisser ses soldats percevoir le péage qui lui revenait de droit depuis les temps anciens. Mon père, voyant que la discussion ne conduirait à rien, me dit de courir chez notre chapelain Robert pour qu’il sonne le tocsin, et ensuite de monter le plus vite possible prévenir le prévôt Guntelme de Saint-Hippolyte.
Entre-temps, la longue caravane des marchands qui descendait de Langres arriva petit à petit devant le pont. Je les croisai en remontant vers l’église avec mon ami Roger, le fils de l’aubergiste qui, ayant été aux premières loges pour assister à cet événement, m’avait emboîté le pas. Des dizaines de mules et de chariots tirés par des bœufs avançaient lourdement chargés sur la route empierrée. Notre curé Robert avait déjà compris que quelque chose de grave se passait et faisait sonner le tocsin à toute volée avec la petite cloche de notre église, au risque de la briser.
Roger et moi courûmes à en perdre haleine vers Saint-Hippolyte. En chemin, nous rencontrâmes le prévôt qui, au son du tocsin, avait enfourché un cheval en compagnie de deux soldats qui avaient été engagés pour protéger le prieuré contre une bande de voleurs qui sévissaient dans la région. Je lui expliquai brièvement ce qui se passait et, me saisissant par le bras, il me hissa derrière lui sur son destrier. Roger fut pris lui aussi en croupe par un de ses soldats. Je m’accrochai très fort au haubert du prévôt pour ne pas tomber et, un grand sourire de fierté barrant ma figure, nous fonçâmes vers Aynard.
Notre arrivée au galop devant le pont n’impressionna guère le seigneur Landry qui discutait avec le chef des marchands. Le prévôt Guntelme s’adressa immédiatement avec courage à Landry d’Uxelles : « Messire Landry, ce pont a été construit par l’abbaye de Saint-Pierre. Rodolphe le roi de Bourgogne et le Pape ont confirmé cette immunité{11}. Vous n’avez aucun droit de réclamer un péage sur cette rivière ! » Landry, toujours sur son destrier, maîtrisait avec peine sa colère d’être interpellé de la sorte. « Guntelme, vous n’avez aucun ordre à me donner. Vous n’êtes rien ici. Moi je suis le seigneur d’Uxelles et je fais la loi chez moi. Ce passage a toujours appartenu à ma famille et ce n’est pas vous qui m’en empêcherez. Les pierres et les bois de ce pont viennent de mes terres, donc il est bien à moi. »
Guntelme osa encore répliquer : « Ce pont a été construit et entretenu par les moines de Cluny depuis plusieurs années. Vous n’avez jamais demandé de péage auparavant. Vous ne pouvez méconnaître l’immunité donnée par le roi et le Pape Urbain ! Je vous en prie, Messire, laissez passer ces marchands sans leur faire de mal. »
« Vous entendez ce maraud qui veut m’expliquer mes droits ! Je ne sais ce qui me retient de te faire rendre gorge, Guntelme. Et ce ne sont pas tes deux malheureux soldats qui vont nous chasser d’ici ! » lança Landry en provoquant l’hilarité de sa bande de soldats et chevaliers.
Guntelme, ne se démontant pas, reprit encore une fois : « Messire, je vais devoir avertir votre frère Bernard le chambrier et Bernard du Mont, le connétable de notre Abbé Hugues. Je pense que nous pourrions éviter cela en trouvant ici un arrangement ? »
« Mon frère ne pense qu’à s’enrichir et faire du commerce à mes dépens. Ce n’est pas parce que mon père m’a déjà dépouillé d’une grande partie de mon héritage en faisant tous ces dons à l’abbaye que je dois laisser mon frère me prendre le reste ! Et ce ne sont pas les soldats de Cluny qui me feront peur ! »