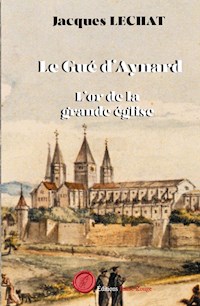
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encre Rouge
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Le Gué d'Aynard
- Sprache: Französisch
Ce roman en deux volumes est l’histoire d’un forgeron qui a vécu sur les terres de la fameuse abbaye de Cluny au début du douzième siècle. Pierrick, fils du forgeron Edwin le rhénan, raconte à la fin de sa vie, ses nombreuses aventures dans une période très particulière du Moyen-Âge que certains ont appelé la petite renaissance. Partout en Europe, la vie économique et culturelle se développe et des églises, des abbayes, des bourgs et des châteaux forts sont construits. Les cités retrouvent progressivement la taille qu’elles avaient à l’époque romaine. Pierrick avec sa famille et ses amis, traverse cette époque pleine de croissance mais aussi dangereuse. La mort et la guerre y sont partout présentes et la paix de Dieu rarement appliquée.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jacques Lechat
LEGUÉD’AYNARD
**
L’or de la grande église
Prologue
Ce roman est l’histoire d’un jeune homme qui a vécu sur les terres de la fameuse abbaye de Cluny au début du XIIe siècle. Pierrick, fils du forgeron Edwin le Rhénan, raconte à la fin de sa vie, ses nombreuses aventures dans une période très particulière du Moyen Âge que certains ont appelé la petite renaissance. Partout en Europe, la vie économique et culturelle se développe et des églises, des abbayes, des bourgs et des châteaux forts sont construits. Les cités retrouvent progressivement la taille qu’elles avaient à l’époque romaine.
Un réchauffement climatique a permis à l’agriculture de se développer et la population de l’Europe croît. Les bourgs et villages se repeuplent, s’agrandissent et les nombreux chantiers donnent du travail à des milliers d’artisans et ouvriers. Comme la monnaie reste rare, le troc reste souvent la base des échanges.
Cluny est d’abord une abbaye avec quelques habitations construites hors les murs dans cette belle vallée du sud de la Bourgogne. Le bourg se développe progressivement grâce à l’activité générée par l’abbaye. Des artisans, marchands et autres serviteurs s’enrichissent et créent petit à petit une communauté qui se dote aussi d’une enceinte protectrice. L’abbaye vit essentiellement du culte des morts qui lui permet d’étendre son domaine grâce à des dons en terre ou en or. Les seigneurs, grands ou petits, donnent beaucoup pour que les moines prient pour le repos éternel de leur âme.
Les moines bénédictins de Cluny, qui sont très souvent des fils de familles seigneuriales, ont réussi à se placer depuis plus d’un siècle au centre du jeu politique et religieux de l’Europe. Pour Cluny, cette période est cependant source de problèmes puisque ses deux grands protecteurs, le Pape et l’Empereur sont en conflit permanent pour la question des investitures des évêques.
Des grands féodaux comme les comtes de Toulouse, de Provence, de Flandre, de Bourgogne, de Catalogne ou le duc de Normandie sont très puissants et le roi des francs, Louis VI, augmente petit à petit son pouvoir en étendant ses fiefs et ses alliances. C’est aussi l’époque de la première croisade{1}. Jérusalem a été prise le 15 juillet 1099 et la Terre sainte attire un grand nombre de seigneurs ou de simples gens partis pour défendre leur foi, y faire fortune, y chercher l’aventure ou plus simplement se faire pardonner de graves péchés. La foi chrétienne, la peur de l’enfer, la médiation des saints avec le culte des reliques, le pouvoir des évêques et des abbayes structurent profondément les valeurs et l’organisation de la vie de presque tous les peuples européens de l’époque.
La lutte contre l’Islam et les Sarrasins est un devoir de tous les chrétiens. À côté de la croisade en Palestine, la Reconquista{2} de l’Espagne sarrasine occupe aussi une partie de la chevalerie européenne. Mais dans ce monde moyenâgeux, les lignes de front sont très poreuses. Tout le monde s’allie avec tout le monde selon ses besoins et la guerre n’empêche pas nécessairement de faire du commerce avec ses ennemis.
Pierrick, avec sa famille et ses amis, traverse cette époque pleine de croissance mais aussi de dangers. La mort et la guerre y sont partout présentes et la paix de Dieu rarement appliquée. La plupart des personnages rencontrés par Pierrick ont réellement existé. La trame de ses aventures est basée sur des faits historiques relatés par des témoins de l’époque et étudiés depuis des siècles par de très nombreux historiens. Tous les lieux mentionnés existent et méritent une visite car souvent oubliés par les aléas de l’histoire. Cette première moitié du XIIe siècle déborde de vie et de développements inattendus qui donnent l’occasion à Pierrick de nous conter en plusieurs tomes ses aventures passionnantes et surprenantes.
Résumé du tome précédent :
L’épée de Brancion
Pierrick a découvert par hasard une ancienne épée normande dans la rivière Guye qui coule à côté du domaine de son père à Aynard, petit village situé sur les terres de l’abbaye de Cluny près du prieuré de Saint-Hippolyte. Cette arme sur laquelle sont gravées les lettres +VLFBERH+T{3} est très particulière car elle a été fabriquée dans un métal aux propriétés uniques. Ce fer qui est appelé du wootz{4} provenait probablement d’Inde via Bagdad et Damas. À l’époque de Pierrick, il était toujours utilisé pour fabriquer des épées destinées aux combattants sarrasins.
Malheureusement, cette arme aux qualités exceptionnelles n’a pas manqué d’attiser l’envie de Bernard Gros, seigneur d’Uxelles et de Brancion, et voisin turbulent des terres de l’abbaye. Après le vol de cette épée redoutable par des inconnus commandités par ce chevalier peu scrupuleux, Pierrick réussit à la récupérer au prix d’une aventure périlleuse et grâce à la complicité de son ami, le seigneur Hugues de Berzé. Pour éviter la vengeance de Bernard Gros furieux d’avoir été humilié par Pierrick, le Grand Prieur de l’abbaye a décidé de l’envoyer quelque temps à Barcelone pour sa sécurité et pour accompagner une délégation de l’abbaye.
À la fin de l’année 1117, le jeune forgeron s’est fiancé à la belle Marguerite de Tournus, à laquelle il a promis le mariage dès son retour de son périple qui devra durer plusieurs mois. Peu de temps avant son départ, il a aussi retrouvé la belle saltimbanque Esméralda, avec laquelle il avait eu une aventure. Cette femme lui a présenté Sinvatre, le fils qu’elle aurait eu suite à leur brève étreinte mais qu’elle souhaite élever seule avec son clan. C’est donc troublé par tous ces événements que Pierrick s’apprête à partir à Barcelone, à la recherche de ce wootz qui lui permettrait de refaire des épées de la même qualité que sa fameuse Ulfberht.
Chapitre 1
Le grand départ
Carême 1118
Les dernières semaines avant notre départ ressemblèrent à un tourbillon comme on les voit parfois dans les rivières en crue. Je passais mon temps d’une part aux préparatifs du voyage et d’autre part à d’interminables adieux avec la famille de Marguerite et la mienne. J’avais été équipé de pied en cap par ma mère de nouveaux vêtements pour toutes les saisons. Frère Martin m’avait dit que dans le Midi, vers lequel nous allions nous diriger, le soleil brûlait une grande partie de l’année comme chez nous au temps des moissons. Je ne voyais donc pas l’utilité de m’encombrer de trop de bagages. Mais rien n’y fit, j’eus droit à un beau coffre en bois cerclé de fer rempli de pelisses, chausses, bliauds, chaînses{5}, froc à capuchon, bottes fourrées et sandales. J’espérais que le chariot qui devait nous accompagner au départ de Cluny pourrait contenir également mes bagages car je ne me voyais pas porter ce coffre sur mon dos jusqu’en Catalogne.
Mon père m’avait fait fabriquer par un artisan de Malay, une belle sacoche en cuir solide pour y transporter mes outils de forgeron, et une autre plus petite pour y garder tous les parchemins que mon futur beau-père Adémar me demandait de transporter pour être remis un peu partout sur notre chemin à ses amis marchands. Je cumulais bien des métiers en ce début d’année 1118 car Dom Bernard, le Grand Prieur, avait décidé que je serais présenté comme étant le clerc de Dom Colomban, prieur de Mazille et chef de notre expédition. Messager, marchand, clerc, forgeron, chercheur de wootz, futur marié, père d’un enfant secret, je ne savais plus très bien qui j’étais. J’espérais que le voyage me donnerait le temps de remettre tout cela en place dans ma tête bousculée.
Ma mère avait aussi fabriqué une ceinture de toile pour y transporter les quelques sous et pièces d’or que mon père m’avait donnés pour être utilisés en cas de nécessité. Normalement je n’aurais besoin de rien, puisque je faisais partie de la délégation de l’Abbé et que tous les frais du voyage étaient pris en charge par le Grand Prieur.
Adémar le marchand m’avait aussi remis deux besants{6} d’or pour que je puisse offrir à boire ou à manger à ses collègues marchands qu’il voulait que je rencontre sur mon chemin. Je lui avais pourtant précisé que j’étais au service des moines de Cluny et que je ne pourrais guère choisir mes propres itinéraires et mon emploi du temps. Rien n’y fit, il était certain qu’un garçon comme son futur beau-fils parviendrait toujours à ses fins. Lucas, le frère de Marguerite, m’avait aussi renseigné le nom d’un ami rencontré lors de ses voyages à Gênes. Jacob, un marchand juif, était selon lui maintenant installé à Barcelone et devrait certainement pouvoir m’aider dans mes recherches de forgerons sarrasins et de lingots de wootz.
J’avais rencontré à Cluny le sergent Guichard et ses trois soldats qui seraient chargés de la sécurité de notre voyage. Une plus grande troupe de soldats nous rejoindrait à Saint-Saturnin-du-Port{7} pour nous protéger lors de la partie terrestre de notre expédition.
Nous allions en effet d’abord descendre en bateau sur la Saône jusqu’à Lyon et ensuite sur un plus grand fleuve que l’on appelle le Rhône jusqu’au prieuré de Cluny à Saint-Saturnin. À Mâcon, la veille de notre départ, frère Martin allait me présenter au prieur Colomban et aux deux frères Clotaire et Adelin qui devaient nous accompagner.
Le mauvais temps reportait sans cesse notre départ qui avait d’abord été prévu le mercredi des Cendres. À chaque fois j’étais obligé de faire des adieux déchirants à ma famille qui me voyait revenir plus tard dans la même journée. J’avais déjà dit au revoir à Marguerite et à sa famille le dimanche précédant le carême. Les larmes avaient coulé à flots et j’avais dû faire mille promesses de fidélité et de retour. J’étais triste de devoir me séparer de cette jeune femme que j’aimais, mais je savais que je reviendrais et que nous nous marierions. Je n’avais aucun doute à ce sujet. Mais les yeux de Marguerite me disaient la peur qu’elle avait de me perdre. Et mes mots n’y changeaient rien.
Finalement, le signal du départ fut donné à la Saint-Tranquille{8}. Je partis accompagné de frère Martin et de deux soldats sur un beau chariot tout neuf chargé de nos coffres et d’autres équipements. Il y avait même une petite forge de voyage avec du charbon de bois pour des réparations d’urgence aux roues ou aux fers des chevaux. Le sergent Guichard nous précédait sur son destrier. Le prieur et sa suite nous attendaient déjà à Mâcon pour embarquer en direction de Lyon dès que le débit du fleuve le permettrait. En montant le chemin de la Mutte, nous eûmes l’occasion de jeter un dernier regard sur l’abbaye et la grande église en construction qui dominait déjà tout le bourg. Les reverrions-nous bientôt ?
Comme nous passions par Berzé, j’eus le temps d’aller faire aussi mes adieux à mon ami Hugues, seigneur du lieu. Il me confia un autre message pour un de ses parents lointains, Bernard Aton, vicomte d’Albi, de Béziers et de Carcassonne. Heureusement que nous embarquions le soir même, sinon j’aurais dû faire l’achat d’une nouvelle sacoche pour réussir à transporter toutes ces missives emballées dans des toiles cirées pour les protéger de l’eau et des intempéries. Notre valet Florent, qui m’avait accompagné jusque-là avec le mulet Lucifer, repartit vers Cluny après m’avoir embrassé une dernière fois, le regard envieux de ne pas pouvoir m’accompagner à la découverte du vaste monde.
J’ai embarqué dès notre arrivée au port comtal de Mâcon sur une des deux barques qui devaient nous conduire jusqu’à Lyon. Chariots et chevaux furent hissés à bord grâce à des planches placées adroitement de la rive jusqu’aux embarcations. Les barques, que les mariniers appelaient des sisselandes{9}, faisaient une dizaine de toises de long sur une largeur de dix pieds. L’avant de la barque était un peu plus relevé mais les bordées n’étaient guère hautes. Je m’inquiétais déjà de devoir naviguer sur ces bateaux au milieu des vagues du courant.
Au centre du bateau se dressait un mât auquel était accrochée une grande toile. Frère Martin m’expliqua que c’était une voile et que lorsque le vent était favorable, elle pouvait faire avancer ila barque sans requérir la force des bateliers, mais pour cela il fallait attendre le bon vent. Actuellement la force du courant suffisait amplement. Le fleuve était toujours haut suite aux pluies de ces derniers jours et sa remontée était impossible. Un peu partout sur notre trajet, nous allions croiser sur les rives des bateaux attendant que le courant se calme pour remonter vers l’amont.
Chacune des sisselandes était menée par une famille de mariniers qui vivaient toute l’année à bord. Une tente les abritait pour la nuit, la mère cuisinait sur un feu contenu dans un grand chaudron, les petits enfants passaient leur temps à écoper l’eau qui remplissait sans cesse le bateau au travers des planches et les autres adolescents ou adultes guidaient avec de grandes perches la barque au travers des écueils dont le fleuve était parsemé. Une vie rude comme pour beaucoup de paysans ou de serfs, mais une vie d’hommes libres guidant leur barque et leur famille là où ils le souhaitaient.
Je logeai cette première nuit sur le navire pendant que mes compagnons de route dormaient confortablement dans une maison de l’abbaye. En partageant mon souper avec la famille du ribayrier{10} Gildas, ce dernier m’expliqua combien cette rivière était dangereuse et difficile pour la navigation. Les bancs de sable bougeaient sans cesse, de gros troncs d’arbres arrachés aux rives risquaient de briser la barque s’ils la heurtaient, à de nombreux endroits le fleuve se rétrécissait et le courant s’accélérait, menaçant de jeter le bateau sur de gros rochers à fleur d’eau. Pour corser le tout, des brigands ou des seigneurs voleurs n’hésitaient pas la nuit ou dans le brouillard à attaquer les bateaux mal défendus. Un triste récit fait pour rassurer le nouveau voyageur que j’étais.
Je m’étais très vite lié d’amitié avec Gildas car je l’avais aidé avec mes outils à réparer une grosse ferrure placée à l’arrière du bateau qui servait à caler une grande rame permettant de le guider dans la bonne direction. Le prieur Colomban arriva avec sa suite après la Tierce{11} et à peine étaient-ils embarqués que les bateliers poussèrent les deux barques vers le milieu du fleuve où le courant était le plus fort. Nous avions une vingtaine de lieues à parcourir jusqu’à Lyon et nous avions prévu de nous arrêter pour la première nuit à Lymans{12} où se trouvait aussi un prieuré de Cluny.
J’admirais la dextérité de tout notre équipage pour garder notre sisselande dans le courant tout en évitant les tourbillons et en choisissant toujours le bon bras du fleuve. La Saône était très large à certains endroits et se divisait régulièrement en plusieurs branches qui formaient ainsi de grandes îles sur lesquelles on voyait parfois quelques masures ou simplement des vaches et moutons que l’on y laissait paître en liberté.
Sur les rives du fleuve, on apercevait de nombreux oiseaux aquatiques et des castors, mais nous avancions trop rapidement pour pouvoir les chasser au lance-pierre ou avec un arc. Florent m’avait fait cadeau avant de partir d’un bel arc avec un carquois rempli de flèches. Il les avait fabriquées lui-même afin que je puisse chasser et améliorer notre ordinaire.
Comme nous passions à côté d’un banc de sable où des dizaines de canards se prélassaient au soleil, Julius, le fils de Gildas qui avait l’âge de mon petit frère Mathias, me proposa d’en tuer quelques-uns pour notre repas du soir. Dom Colomban qui se tenait à côté de nous intervint : « Non Pierrick, hors de question de les tuer pour les manger. Ces oiseaux sont de la viande et nous sommes en Carême ». Le frère Clotaire, qui était un érudit, osa cependant le contredire. « Le célèbre clerc de l’abbaye de Saint-Denis, Pierre Abélard{13}, n’est pas de votre avis Dom Colomban. Il a écrit que ces canards ont les pattes palmées et que donc ils font partie de l’espèce des poissons{14} ».
Pendant que les deux religieux se lançaient dans une discussion zoologique que j’essayais en vain de comprendre, Julius me fit remarquer que le banc de sable sur lequel se tenaient ces volatiles était déjà loin derrière nous, ce qui mettait évidemment fin à mon espoir de pouvoir améliorer mon maigre ordinaire. « La prochaine fois, tu tires d’abord avec ton lance-pierre et on discutera après ! » dit-il dans un grand éclat de rire.
Je remis donc mes projets de chasse à plus tard pensant d’abord me consacrer à la pêche dès que j’en aurais l’occasion. Julius m’avait expliqué que le soir, si nous étions installés sur une île ou sur la rive, nous pourrions aller chercher des écrevisses. Je lui promis de lui apprendre aussi comment attraper des truites à la main.
Après être passés à côté du village de Montmerle, nous arrivâmes, comme annoncé par Gildas, avant les vêpres à Lymans. Après une mauvaise nuit passée dans le dortoir des frères infesté de vermines, nous repartîmes dès l’aube sur nos barques en direction de Lyon. Le prieur Colomban avait emporté dans un des chariots un petit autel portatif, et comme nous étions le jour du Seigneur, nous pûmes assister à la messe tout en glissant à bonne vitesse sur l’eau du fleuve. Le paysage changea en arrivant à l’approche de la cité de Lyon. De hautes collines entouraient la Saône qui se rétrécissait, rendant le courant encore plus rapide.
Sur le fleuve, nous naviguions entourés de nombreux autres navires. Certains très grands chargés de bois étaient appelés des sapines, d’autres plus petits, des barquettes, transportaient des passagers ou du bétail. Gildas me raconta que Lyon était une cité importante qui comptait des centaines de foyers et qu’il fallait beaucoup de provisions pour la nourrir tous les jours. Les mariniers, qui se connaissaient souvent bien, échangeaient bruyamment entre eux en criant pour se faire entendre malgré le bruit du fleuve. Ils se saluaient ou s’injuriaient copieusement quand une barque coupait la route d’une autre ou quand ceux qui étaient rattrapés ne s’écartaient pas assez rapidement.
Au tournant d’une boucle du fleuve, nous aperçûmes sur une haute colline du côté du soleil couchant, le château de Pierre-Scize. Il gardait la cité de Lyon des attaques venues de la Bise et surveillait la rive du Levant qui était terre d’Empire. La cité avec ses murailles très anciennes nous apparut ensuite sur la rive du Couchant. Frère Martin m’avait expliqué pendant notre voyage que Lyon s’appelait Lugdunum à l’époque des Romains et que cette cité dirigeait toute la Gaule. C’était alors une très grande agglomération avec des monuments impressionnants dont il restait de nombreuses ruines. Il espérait que nous aurions le temps de monter sur la colline qui s’appelle la Fourvière pour y voir ces traces du passé.
Nous accostâmes au port Saint-Jean devant l’entrée fluviale des bâtiments de l’archevêché. En aval de ce port, une grande chaîne était tendue en travers du fleuve pour obliger les navires à accoster et payer un droit de passage. Les moines noirs{15} en route vers le Midi étaient évidemment dispensés de cette taxe. À la vue de cette énorme chaîne de fer de plus de cinquante toises de long, je me dis que le forgeron qui l’avait fabriquée avait dû bien gagner sa vie !
Toute l’activité de l’agglomération était tournée vers la vie religieuse. L’archevêque Josserand régnait en maître, avec les chanoines de la cathédrale Saint-Jean, sur la cité qui n’était plus aussi grande que du temps des Romains. La muraille romaine englobait un espace beaucoup plus large avec notamment toute la colline de la Fourvière située derrière la cathédrale. Nous pouvions voir sur les flancs de cette colline de nombreuses ruines abandonnées qui servaient de carrière pour les habitants de Lyon. Un mauvais pont de bois reliait le quartier de l’archevêché à la rive opposée de la Saône qui était en fait une île{16} et qui semblait n’être habitée que par des paysans et l’abbaye Saint-Martin.
J’accompagnai le prieur et les frères de Cluny qui souhaitaient aller saluer l’Archevêque Josserand. Nous fûmes accueillis à la porte par un chanoine de la cathédrale Saint-Jean qui nous dit que le vieil archevêque était très malade et qu’il se reposait dans l’abbaye Saint-Martin dont il avait été longtemps l’Abbé. Il n’y avait à l’archevêché que le légat du Pape, le Cardinal Kuno von Urach.
Nous allâmes donc le saluer comme il se devait. Il nous invita à nous joindre à lui pour les vêpres dans la cathédrale que l’archevêque Josserand avait fait embellir en y plaçant au sol des milliers de petites pierres qui formaient de beaux dessins. Frère Martin m’expliqua que cela s’appelait des mosaïques et que si nous avions le temps de visiter les ruines romaines, nous en verrions d’autres encore plus belles. Comme je faisais remarquer naïvement que notre église de Saint-Pierre de Cluny était plus grande et plus haute que cette cathédrale, le chanoine Windukind qui nous guidait nous dit, un peu vexé, qu’un nouvel édifice devait bientôt être construit car cette église était déjà très ancienne. Le prieur me fit comprendre d’un regard que je devais garder ce genre de remarque pour moi-même. Mon rôle de gentil clerc n’était pas aisé à assumer par un forgeron bavard !
Le légat Kuno nous invita ensuite à partager son repas de carême dans l’hôtellerie de l’archevêché. Je compris des conversations que le prieur Colomban était très inquiet des événements qui se déroulaient alors à Rome. Le Pape Pascal II, que j’avais vu à Aynard, était décédé au début de l’année et le Pape Gélase II avait été désigné par les cardinaux. Mais une grande famille romaine, les Frangipani, qui ne l’aimait pas l’avait capturé et il n’avait retrouvé sa liberté que grâce à la foule menée par le préfet de la ville.
Ses ennuis n’étaient cependant pas terminés car le nouvel Empereur germanique, Henri V, exigeait que la consécration du Pape se fasse en sa présence. Gélase II, ayant refusé cette mainmise sur la papauté, n’eut d’autre salut que de s’enfuir hors de Rome, poursuivi par les soldats de l’Empereur. Celui-ci avait alors commis l’irréparable en nommant un faux Pape. L’Abbé Pons avait tout fait pour éviter cette rupture entre les deux plus fidèles alliés de Cluny : le Pape et l’Empereur.
Je compris mieux, suite à ces explications, le pourquoi de toutes les délégations de princes, archevêques et autres ambassadeurs que j’avais croisées depuis le début de l’année à Cluny. Les affaires de l’Église me semblaient bien compliquées et je me dis que la vie à Aynard, même avec un voisin comme Bernard Gros, était quand même plus heureuse. Le légat et le prieur se retirèrent ensuite dans les appartements de l’archevêque pour discuter plus discrètement de cette grave affaire. Avec mes trois compagnons, nous allâmes nous reposer dans un dortoir réservé aux hôtes de passage.
Le lendemain matin, Colomban nous dit : « Je dois attendre l’arrivée d’un envoyé venu de Rome avant de continuer notre route vers Barcelone, et je dois aussi me rendre au chevet de l’archevêque Josserand à l’abbaye Saint-Martin. Vous allez sans doute devoir patienter un jour ou deux. Profitez-en pour aller découvrir la vieille ville romaine et instruisez-vous ».
Frère Martin ne se fit pas prier et demanda immédiatement au chanoine Windukind s’il pouvait nous fournir un serviteur pour nous montrer ces ruines romaines. Il se proposa d’être lui-même notre guide et nous parcourûmes, de la Tierce à la Nonne, la colline de la Fourvière où je pus découvrir des ruines étranges. La plus spectaculaire ressemblait à un escalier de géants adossé à la colline. Windukind nous expliqua que cela s’appelait un théâtre et que ces marches étaient des sièges sur lesquels s’asseyaient plusieurs milliers de spectateurs. Je ne pus m’empêcher de penser alors à la danse de la belle Esméralda et je me demandais s’il y avait déjà des saltimbanques qui participaient à ces spectacles romains.
Dans les ruines de ce qui avait dû être des palais ou des habitations, nous pûmes aussi admirer des mosaïques, comme les appelait frère Martin. Les sujets de ces tapisseries de pierres étaient cependant plus amusants à regarder que ceux de la cathédrale Saint-Jean, car il s’agissait généralement de femmes très dénudées ou d’étranges animaux que je n’avais jamais vus dans nos contrées.
Mes religieux compagnons de route étant retournés à leurs nombreux offices quotidiens et prières, je passai le reste de la journée à découvrir le bourg construit au pied de la colline à côté du domaine de l’archevêque. Il y avait beaucoup plus de maisons en pierre qu’à Cluny et de nombreux marchands arrivaient de partout pour la foire annuelle de Pâques. Je partis naturellement d’abord à la recherche des forgerons des lieux, afin de m’enquérir sur le minerai de wootz. Mais comme je le craignais, ces artisans qui travaillaient principalement du métal pour les outils et les bâtiments ne purent m’aider ou me renseigner.
Je pus alors me consacrer à mon rôle de messager en remettant les documents d’Adémar à deux marchands juifs avec lesquels il échangeait ses monnaies étrangères. Je me rendis ensuite, comme mon futur beau-père me l’avait demandé, chez un dénommé Béranger pour lui donner une lourde bourse remplie de sous et de deniers que j’avais cachés dans mon coffre sur le bateau. Béranger, qui était le cousin d’Adémar, m’invita à rester manger avec sa famille qui fut ravie de découvrir le fiancé de la belle Marguerite. Je ne refusai pas cette invitation car la table de l’archevêque en période de Carême n’était pas faite pour satisfaire l’appétit d’un jeune forgeron.
Comme notre départ vers le Midi était encore reporté, je profitai du jour suivant pour aller visiter l’autre côté de la Saône. Je ne passai pas par le pont qui ne me semblait guère rassurant tant il oscillait sous la force du courant, mais je choisis une barquette conduite par une femme pour traverser le fleuve. Ce métier dur de passeur était curieusement pratiqué par de très nombreuses femmes qui parvenaient, apparemment sans trop de peine, à braver le courant et à amener leurs clients sains et saufs sur l’autre rive. L’île d’Ainay était aussi un champ de ruines antiques et je découvris facilement, en suivant le tracé d’une ancienne voie romaine, l’autre fleuve que l’on appelle le Rhône et qui allait nous porter jusqu’à Saint-Saturnin-du-Port. En espérant que le bon déroulement des entretiens et autres rencontres du prieur Colomban nous permette de reprendre notre voyage rapidement.
Chapitre 2
Les dangers de la navigation
Mes prières furent exaucées car nous pûmes enfin repartir dès le lendemain. Chacun avait repris sa place sur les deux sisselandes avec des provisions pour les quatre ou cinq jours que devait durer notre décise{17} jusqu’à Saint-Saturnin-du-Port, dernière étape de notre voyage fluvial. À moins d’une demi-lieue de Lyon, notre fleuve la Saône se jetait dans le Rhône qui devait nous conduire à destination. Le grand fleuve pénétra après quelques heures de navigation dans un défilé entouré de hautes collines sur chaque rive. Il devint moins large et le courant se renforça encore. Nous passâmes ainsi très rapidement, au détour d’un méandre, à côté de Vienne qui était aussi un bourg important gouverné, selon le prieur Colomban, par un autre archevêque, Guy de Bourgogne qui devait devenir peu de temps après le Pape Calixte II.
Notre ribayrier connaissait ce fleuve et ses rives par cœur. Afin de ne rater aucune de ses histoires, je ne quittais pratiquement jamais l’arrière du bateau où il tenait fermement la rame centrale. Il semblait s’amuser à faire peur à ses passagers car j’eus droit à plusieurs de ses récits effrayants. Celui qui m’impressionna le plus fut le récit du Drac{18} du Rhône, un monstre amphibie qui portait sur le corps d’un reptile les épaules et la tête d’un beau jeune homme. Ce démon attirait les jeunes filles et les jeunes gens pour les noyer dans le fleuve en leur faisant miroiter des pierres précieuses.
Gildas était certain de l’existence de ce monstre car il me disait avoir rencontré des personnes qui avaient échappé à ses griffes. Il me mit donc en garde contre la tentation de me pencher trop sur l’eau et d’essayer d’attraper des objets brillants dans les eaux peu profondes. Je ne sais pas si c’était le Drac qui avait mis l’épée Ulfberht dans notre rivière pour m’attirer, mais il ne m’avait en tout cas pas attrapé quand j’y avais plongé la main. Je restai cependant prudent durant le reste de notre navigation sur le Rhône, préférant ne pas trop me pencher ni chercher des pierres précieuses sur le fond du fleuve.
Comme nous avancions à bonne vitesse, nous arrivâmes avant les vêpres à Saint-Rambert de Fulcimagne{19}. Le lendemain matin, Gildas, qui regardait le ciel de ce mois de mars avec inquiétude, nous dit que nous allions rencontrer du brouillard et que cela ne présageait rien de bon pour la suite de notre navigation. En effet, des nuages bas cachaient le haut des collines de la rive du Couchant. Le temps s’était aussi considérablement refroidi et je pris dans mon coffre un chaud manteau de laine. Malgré les risques, Gildas et Étienne avaient décidé de poursuivre quand même notre navigation pour rallier Valence, notre prochaine étape.
Julius, le jeune fils du marinier, m’interpella discrètement : « Je ne pense pas que ce soit prudent de partir aujourd’hui. Ma mère Mathilde m’a dit qu’elle avait fait un cauchemar dans lequel nous étions tous engloutis par le fleuve ». Je lui répondis : « Tous nos rêves ne deviennent pas la réalité, Julius. Et de plus, moi je sais flotter sur l’eau. J’ai déjà sauvé une fois une petite fille grande comme toi de la noyade dans la Saône ». Le gamin me regarda avec de grands yeux étonnés et s’empressa de me dire : « Alors moi, je reste près de toi. Si la barque coule, tu seras mon sauveur ».
Après quelques heures, une nappe de brume s’abattit sur nous comme un drap que l’on jette sur une poule pour l’attraper. Nos deux mariniers avaient prudemment passé une longue corde de chanvre entre les deux bateaux pour éviter de trop s’éloigner l’un de l’autre. Un grand silence accompagnait ce brouillard qui semblait nous engloutir. Comme la navigation devenait trop dangereuse dans ces conditions, Gildas décida d’échouer les deux embarcations sur un banc de sable au milieu du fleuve. Nous entendîmes une cloche sonner la Sixte dans la brume. Selon Étienne, cela devait être la cloche de Serves, petit village niché au pied d’un château sur la rive du Levant. Mais comme notre visibilité se limitait à quelques toises, nous ne pouvions rien en apercevoir.
Il nous apparut rapidement que le brouillard ne se lèverait plus de la journée et que nous devrions donc camper sur cette île déserte en attendant un jour meilleur. Nous installâmes un campement sur le sable de l’île en espérant qu’une brusque montée des eaux ne nous emporte pas. Avec les ribayriers et leurs familles, nous étions une vingtaine de personnes serrées autour d’un grand feu que nous alimentions avec des morceaux de bois plus ou moins sec que nous trouvions sur l’île. Les bateliers utilisèrent aussi le charbon de bois qu’ils transportaient sur leurs barques afin de cuisiner pour eux et leurs passagers.
Mathilde, la femme de Gildas, avait eu la bonne idée d’acheter avant notre départ de Saint-Rambert plusieurs grosses carpes que des pêcheurs lui avaient proposées. Elle comptait les fumer pour faire quelques réserves, mais comme nous étions bloqués sur cette île, elle accepta de nous les vendre et de les préparer. Étrangement, elle ouvrit et vida ces poissons en les découpant par le dos et non pas par le ventre. Elle les découpait complètement en leur donnant ainsi une forme arrondie grâce à des baguettes de bois placées astucieusement pour écarter les deux filets. Elle plaça ensuite toutes ces carpes en cercle autour du feu en les appuyant côté peau contre des bouts de bois que Julius avait plantés dans le sable. Gildas nous raconta qu’elle avait appris cette méthode de cuisson d’un croisé qui était revenu de Palestine.
Le malheureux avait été prisonnier des Sarrasins durant de nombreux mois dans une cité que l’on nommait Bagdad et dont il avait réussi à être libéré grâce à une forte rançon payée par sa famille. Ce poisson cuit de cette manière s’appelait dans ce pays lointain du masgouf. Nous nous en sommes régalés en nous brûlant les doigts car nous devions saisir la chair avec nos mains pour la placer ensuite sur des galettes de pain que Mathilde avait cuites sur un chaudron retourné. Ce repas de carême fut un délice que toute l’assemblée apprécia malgré l’humidité ambiante et le silence inquiétant créé par ce brouillard qui nous cachait tout notre environnement.
Étienne et Gildas nous dirent qu’ils se méfiaient du brouillard dans cette région car des bandes de voleurs en profitaient souvent pour attaquer et piller des barques arrêtées imprudemment sur des îles inhabitées. Ils nous conseillèrent de prévoir un tour de garde durant la nuit pour éviter toute surprise. Je m’installai donc près du feu avec mon lance-pierre et de nombreux petits galets trouvés sur le sol de cette île. J’avais confié mon arc à Éloi, un des deux soldats qui accompagnaient notre sergent Guichard. Nous avions aussi fait un peu partout autour de notre campement des tas de pierres prêtes à être lancées sur des assaillants.
Le sergent avait distribué les tours de garde qui devaient se relayer en fonction des sonneries de la cloche de l’église invisible de Serves. L’obscurité nous enveloppa, rendant le brouillard dans lequel notre feu se reflétait encore plus inquiétant. Heureusement, nos mariniers avaient aussi avec eux deux grands chiens qui allaient nous aider à donner l’alerte si des brigands s’approchaient. Ces chiens étaient, selon Julius, d’excellents chasseurs de loutres et de gibiers d’eau. J’espérais donc que leur flair nous éviterait des surprises.
Comme je n’arrivais pas à m’endormir, je restai pratiquement toute la nuit assis près du feu avec les différentes équipes qui se succédaient à la garde. Nous n’entendions que le clapotis de l’eau contre nos barques, les ronflements de quelques dormeurs installés dans les tentes et le bruit de nos chevaux restés attachés sur les barques.
Soudain, après que les Laudes{20} eurent sonné au clocher de Serves, un des deux chiens se releva et se mit à grogner. Nous fûmes debout en un instant, scrutant la brume au travers de laquelle une lune laiteuse transparaissait. Guichard nous fit signe de garder le silence et de nous répartir sur le pourtour de notre campement pour découvrir ce qui se tramait. J’entendis des bruits de clapots et j’eus alors la conviction que des embarcations s’approchaient traîtreusement de nous. Mais ce brouillard étouffait les sons et il n’était pas possible de deviner de quel côté ces personnes malveillantes s’approchaient.
Tous les mariniers et passagers, y compris nos moines, étaient réveillés et avaient pris leurs postes en silence, formant un cercle sur les rives de l’île. Chacun tendant l’oreille et cherchant à distinguer des ombres dans la nuit. Plusieurs flèches enflammées s’abattirent alors en sifflant et grésillant à quelques pas de moi sur le sable de l’île. Je compris que nos agresseurs cherchaient par ce moyen à mieux s’orienter et se diriger vers nous à la lueur de ces flammes. Les enfants, sous la conduite de Julius, s’empressèrent de les arracher du sable et de les éteindre dans l’eau du fleuve. J’entrevis entre deux bancs de brume une ombre s’avancer sur le fleuve. Je pris mon lance-pierre et je tirai plusieurs galets dans la direction que m’indiquait frère Martin qui scrutait le brouillard à côté de moi. Nous entendîmes quelques ploufs dans l’eau et surtout un cri, qui nous confirma qu’une de mes pierres avait fait mouche et que nous avions bien des visiteurs malintentionnés.
Quelques toises plus loin, de l’autre côté de l’île, Éloi le soldat, muni de mon arc, tira aussi vers une de ces ombres fugaces. Un hurlement humain suivi du bruit d’un corps tombant dans l’eau fut le résultat de ce tir quasiment à l’aveugle. Nos assaillants, toujours invisibles, comprirent que l’effet de surprise était passé et commencèrent à nous injurier tout en nous lançant des pierres et des flèches.
Nous répliquions de la même manière avec une pluie de galets et de jets de lance-pierre qui firent quelques fois mouche, à entendre les cris de douleurs derrière le rideau de brume. Heureusement, aucune flèche de nos agresseurs n’atteignit l’un d’entre nous. Quelques cailloux ennemis firent de petites plaies et des bosses, mais sans gravité. Nous entendions toujours quelqu’un se débattre en hurlant dans l’eau. Manifestement nos assaillants se retiraient et essayaient de récupérer leur complice touché par la flèche d’Éloi.
Petit à petit le calme revint. Comme plus personne n’avait envie de dormir, nous nous retrouvâmes tous serrés autour du feu ravivé, sauf quatre gardes qui restaient postés sur les rives de l’île pour parer à toute nouvelle attaque. Après avoir récité sous la conduite du prieur un Notre Père et un Ave Maria pour remercier le Seigneur de nous avoir épargnés, nous nous racontâmes à voix basse la bataille, chacun étant persuadé d’avoir touché au moins un de nos brigands. À nous entendre, ces voleurs devaient être plus de cent, et nous allions découvrir le lendemain les rives de notre île couvertes d’assaillants blessés ou morts.
Le jour se leva d’abord toujours embrumé, mais le soleil finit par percer et réussit à faire disparaître ce brouillard qui nous retenait prisonniers sur cette île. Nous nous retrouvions paisiblement installés au milieu du fleuve, les deux rives éloignées d’une cinquantaine de toises. La nature avait repris ses droits et des canards barbotaient tranquillement le long de l’île. Aucun assaillant en vue ni de trace de l’attaque de la nuit. Comme si tout cela n’avait été qu’un mauvais rêve. D’où venaient ces voleurs ? Le village de Serves apparaissait paisible à cent toises de nous en amont. Des femmes lavaient du linge sur la rive du fleuve et quelques barques étaient abandonnées sur la grève. Je savais que ce voyage comporterait des risques, mais je n’imaginais pas être déjà attaqué par des brigands au milieu de ce fleuve où je nous croyais en sécurité.
Le campement démonté, chacun reprit place à bord des deux bateaux en route vers Valence qui n’était plus qu’à quelques lieues. Moi, n’ayant pas fermé l’œil de toute la nuit, je m’endormis rapidement, appuyé contre un chariot, et je ne vis donc pas les grandes îles qui annoncent sur le Rhône la cité de Valence, ni le confluent avec un autre fleuve qui s’appelle l’Isère. Frère Martin réussit juste à me réveiller au moment où notre barque touchait la rive d’un des ports de Valence, vieille cité romaine construite sur les terres impériales. La Sixte venait seulement de sonner, mais le prieur souhaitait rester ce soir à l’abri de ce gros bourg, plutôt que de devoir passer la nuit dans la nature au risque d’être à nouveau attaqué.
Gildas nous expliqua que Valence était le lieu où, au printemps, se regroupaient les hommes qui à la force de leurs bras faisaient remonter les bateaux sur le fleuve à l’aide de longues cordes. Ces haleurs, comme il les appelait, formaient des équipes de parfois cent hommes qui tiraient, à partir de la rive des trains, de lourdes barques chargées de produits venus du Midi. Ils ne travaillaient pas pendant l’hiver quand le courant était trop fort et les eaux du fleuve trop hautes. Comme nous étions à la fin de la mauvaise saison, ils avaient, en attendant la reprise du halage, envahi la rive du fleuve au pied de la cité qui surplombait le Rhône sur une petite colline. Ces hommes voyageaient aussi avec leur famille et s’installaient, comme les artisans et ouvriers de Cluny, dans de grands campements de fortune.
Ayant laissé les barques à la garde de nos soldats, j’accompagnai Dom Colomban et les moines jusqu’à l’hospice installé à côté du prieuré et de l’église Saint-James. Le prieur nous expliqua que cette hôtellerie était aussi destinée à accueillir les pèlerins qui, profitant du retour du printemps, étaient en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle.
Frère Martin m’avait expliqué qu’il y a bien longtemps, les reliques de l’apôtre Saint-Jacques étaient venues s’échouer par miracle sur la rive d’un bourg situé à plus de deux cents lieues de nous vers le Couchant, par-delà les grandes montagnes qui nous séparaient de Barcelone. « Les pèlerins viennent de la Bise, de l’Empire et de toutes les régions connues pour aller prier devant ces reliques de Saint-Jacques et se faire pardonner leurs péchés. Parfois, c’est leur évêque ou leur seigneur qui les condamnent à ce pèlerinage pour expier une faute. Leur périple dure plusieurs mois et nombreux sont ceux qui n’en reviennent pas. D’autres vont aussi en pèlerinage à Rome, à Saint-Gilles ou même à Jérusalem », me précisa mon ami moine. Je me dis que peut-être mon voyage à Barcelone serait aussi considéré par Dieu comme un pèlerinage et qu’ainsi mes péchés, notamment celui très agréable avec Esméralda, seraient pardonnés.
Nous croisâmes dans l’église Saint-James, Eustache l’évêque de Valence, qui nous fit bon accueil et nous invita à venir manger après les vêpres dans sa demeure, située à quelques pas de l’hospice où nous logions. Encore une fois, j’allais devoir manger maigre et frugal.
Pour me prémunir de la faim, j’abandonnai mes moines à leurs prières et je redescendis dans la ville basse où j’avais vu de nombreuses échoppes de marchands et où je devrais trouver de quoi me sustenter. Mais je devais d’abord remplir mon rôle de messager et remettre un rouleau de parchemin d’Adémar à un certain Gontard, qui faisait le commerce du vin venant du Midi. Ce brave homme m’accueillit avec effusion. Il n’avait rencontré Adémar qu’une seule fois mais il en gardait un souvenir mémorable. Je dus résister pied à pied pour ne pas être obligé de déguster toutes les sortes de vin qu’il vendait. Ce fut donc dans un état très joyeux que je poursuivis ma visite de la ville basse en espérant y trouver à manger avant de regagner, un peu dégrisé, la maison de l’évêque Eustache pour le repas du soir.
Au détour d’une ruelle, sans doute distrait par tous les vins goûtés, j’entrai en collision avec un homme très basané que je n’avais pas vu venir et qui se retrouva au sol. L’homme très en colère se précipita sur moi, menaçant. Manifestement il m’injuriait dans une langue inconnue et voulait me corriger pour l’avoir renversé. Quelques témoins rigolaient de la scène et espéraient peut-être assister à une belle bagarre. Mais l’homme, qui ressemblait à un saltimbanque, s’arrêta soudain en prenant dans sa main le corail du collier donné par Esméralda{21} et qui était sorti de ma chaisne. « Où as-tu pris ce collier ? » me dit-il brutalement. « Une femme me l’a donné », lui répondis-je. En se redressant, l’homme me regarda alors dans les yeux : « Désolé l’ami, je ne te veux aucun mal. Va en paix, et que Dieu te protège ». Et il disparut dans la foule qui s’était agglutinée autour de nous.
Je restai planté là, ne comprenant rien à ce qui venait de se passer. Un homme appartenant manifestement à un groupe de croisés m’interpella : « Eh bien l’ami, tu as eu de la chance. Ces saltimbanques sont des adversaires redoutables et leurs couteaux sans pardon. Mais pourquoi t’a-t-il épargné si rapidement ? ». « Je n’en ai aucune idée », lui répondis-je. J’avais compris que le collier d’Esméralda me protégeait, mais je ne voulais pas en faire part à un inconnu. « Merci de prendre soin de moi mais je crois pouvoir m’en sortir seul. Vous allez en Palestine, si j’en crois la croix sur votre bliaud ? » lui répondis-je pour changer de sujet.
« Oui, je suis Remacle, un soldat du Comte Lambert de Montaigu et Clermont{22}. Nous venons du pays de Liège et nous sommes cinq douzaines de chevaliers et d’hommes d’armes qui accompagnent notre seigneur Lambert à Jérusalem pour combattre les infidèles sous les ordres du roi Baudouin 1er{23}. Nous allons à Saint-Gilles{24} prendre des navires qui doivent nous amener en Palestine. Mais le chemin est encore long jusque-là. Et toi, tu ne parles pas comme les gens d’ici. D’où viens-tu ? ».
J’étais tout heureux de pouvoir parler à un futur croisé, mais surtout à un homme originaire du pays de mon père. Je lui proposai de m’accompagner pour aller manger quelque chose avant qu’il ne soit trop tard. Je lui racontai d’où je venais et je lui parlai de ma famille de forgerons habitant dans son pays liégeois. Nous trouvâmes rapidement quelques galettes au miel et nous nous assîmes sur un muret non loin de la rive du fleuve. « Je connais bien ton oncle Karl. C’est un excellent forgeron et nombreuses sont les armes que nous emportons avec nous en Palestine qui viennent de sa forge. Cette belle dague qui ne me quitte jamais vient de chez lui ». J’avais les larmes aux yeux de trouver si loin du pays de mes ancêtres une lame forgée par le frère de mon père. Je ne l’avais jamais rencontré mais je sentis dans ce métal vibrer tout le sang de ma famille.
J’osai alors lui raconter l’histoire de mon Ulfberht et ma recherche de ces lingots de wootz. Mon récit l’intéressa beaucoup mais il me dit ne rien connaître des techniques de la forge. Remacle me promit cependant de chercher en Palestine si l’on pouvait encore trouver ces mystérieux lingots de fer et, s’il en revenait vivant, d’en informer mon oncle Karl à son retour.
Je le remerciai chaleureusement car cette sollicitude venant d’un homme que je ne connaissais pas ce matin me touchait réellement. Moi qui n’avais jamais été dans ce pays entre Meuse et Rhin, je compris soudain que j’étais lié par le sang et le fer à cette région et à ses habitants. Nous nous quittâmes avec regret après ces quelques instants de complicité imprévue et je regagnai l’évêché pour le repas du soir.
Après Monteil des Aimar{25} où nous avions fait étape, la dernière partie de notre navigation sur le Rhône fut assez mouvementée, car le rivage du bourg Saint-Andéol, situé du côté du Couchant à quelques lieues en amont de notre destination, était hérissé de nombreux rochers produisant de grosses vagues qui s’abattaient sur nous dans le bateau{26}. Grâce aux manœuvres adroites de Gildas et de son équipage, nous réussîmes à ne pas nous fracasser sur ces récifs.
Ayant échappé à ces ultimes dangers aquatiques, nous arrivâmes juste avant le coucher du soleil à Saint-Saturnin-du-Port. La première partie fluviale de notre voyage se terminait ainsi peu avant la Mi-Carême.





























