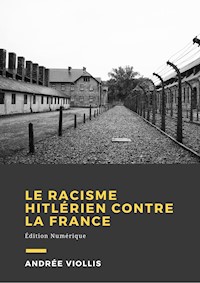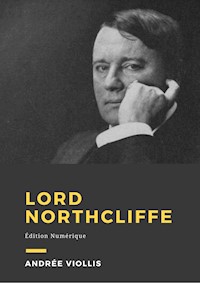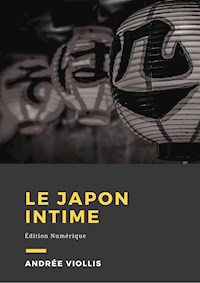
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Ce livre sur la vie japonaise fut rédigé d'après les notes prises pendant le séjour de quelques mois que je fis au Japon.
Ce n'était pas toutefois dans le dessein d'en pénétrer les mœurs que je m'étais rendue dans ce pays, mais pour étudier de près sa politique. La brusque mainmise du Japon sur la Mandchourie, son agression non moins inattendue à Shanghai, le ton nouveau de sa diplomatie, qu'appuyaient d'impressionnantes démonstrations de force, étaient les éloquents témoignages d'un impérialisme dont il devenait important de déterminer la nature et la portée.
Tout en m'y appliquant de mon mieux, je notais, chemin faisant, les impressions de tout ordre que je recevais de ce peuple étrange. On me conseilla d'en tirer une série de tableaux qui pourraient intéresser le lecteur français, peu au courant des nouvelles mœurs nippones. Je le prie pourtant de n'y voir aucune prétention d'enquête en profondeur, mais simplement les premières réactions, toutes spontanées, d'un reporter.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Andrée Viollis, née le 9 décembre 1870 aux Mées et morte le 10 août 1950 à Paris, est une journaliste et écrivaine française. Figure marquante du journalisme d'information et du grand reportage, militante antifasciste et féministe, elle a été plusieurs fois primée et s’est vu attribuer la Légion d’honneur.
De nationalité française, Andrée Viollis est née au sein d’une famille bourgeoise cultivée. En 1890, après l’obtention de son baccalauréat, elle passe trois ans en Angleterre en tant que préceptrice, tout en suivant des cours à Oxford. Elle poursuit des études supérieures en France et obtient une licence ès-lettres. Elle s’oriente vers le journalisme et fait ses débuts au sein du journal féministe La Fronde de Marguerite Durand où elle découvre le journalisme d’investigation et d’idée.
À partir de 1914, elle s'engage sur le front en tant qu'infirmière. Le Petit Parisien publie ses reportages auprès des blessés et l'envoie en 1917, à Londres interviewer le Premier ministre anglais. Ensuite, elle s’oriente vers le grand reportage et couvre les domaines les plus divers : manifestations sportives, grands procès, interviews politiques, correspondance de guerre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrée Viollis
Le Japon intime
Ce livre sur la vie japonaise fut rédigé d'après les notes prises pendant le séjour de quelques mois que je fis au Japon.
Ce n'était pas toutefois dans le dessein d'en pénétrer les mœurs que je m'étais rendue dans ce pays, mais pour étudier de près sa politique. La brusque mainmise du Japon sur la Mandchourie, son agression non moins inattendue à Shanghai, le ton nouveau de sa diplomatie, qu'appuyaient d'impressionnantes démonstrations de force, étaient les éloquents témoignages d'un impérialisme dont il devenait important de déterminer la nature et la portée.
Tout en m'y appliquant de mon mieux1, je notais, chemin faisant, les impressions de tout ordre que je recevais de ce peuple étrange. On me conseilla d'en tirer une série de tableaux qui pourraient intéresser le lecteur français, peu au courant des nouvelles mœurs nippones. Je le prie pourtant de n'y voir aucune prétention d'enquête en profondeur, mais simplement les premières réactions, toutes spontanées, d'un reporter.
ANDRÉE VIOLLIS.
1Le Japon et son Empire. (Grasset.)
I - L’HÔTEL LE PLUS EXTRAORDINAIRE DU MONDE
L'hôtel : point de contact initial et obligatoire de l'étranger avec le peuple chez lequel il débarque.
Mais d'ordinaire, dans toutes les capitales, se dressent par douzaines d'énormes palaces qui, sous les enseignes classiques et interchangeables de Claridge, Carlton, Métropole, Ritz ou Astoria, offrent au voyageur, des pôles aux tropiques, les mêmes grands halls blancs à palmiers, à rocking-chairs, à orchestres nègres, les mêmes portiers galonnés et polyglottes, les mêmes mets anglo-saxons, décorés de sauces chimiques et de noms ambitieux par des chefs français, fastueux comme des monarques.
Or à Tokyo, capitale de 2.500.000 âmes, une des cinq villes les plus peuplées de la planète, il n'existe qu'un seul hôtel cosmopolite : l'Impérial.
— L'hôtel le plus extraordinaire du monde ! disent les Américains.
C'est, il est vrai, un architecte yankee qui le construisit. Il en mourut fou, prétendent ses détracteurs.
De fait, cet hôtel a de quoi surprendre. Par son nom d'abord qui, en japonais, se dit : Tei Koku. La plupart des Nippons se demandent encore pourquoi les Européens ne peuvent réprimer un sourire en lançant à leur chauffeur une apostrophe que la légende réserve chez nous aux maîtres des voies ferrées et des trains. Quant à ceux qui savent, ils ne se dérident pas davantage. Car les Japonais n'ont aucun sens du ridicule.
Mais l'Impérial se distingue avant tout par son style.
Un style ? Vu de l'extérieur, long quadrilatère de briques, coiffé de doubles toits retroussés, agrémenté de galeries que soutiennent des colonnes, précédé d'un bassin à nénufars et à statues de pierre, il se rattache encore vaguement à l'architecture nippone. Mais à l'intérieur !
Escaladez le large escalier de théâtre ou de cinéma munichois conduisant au hall. Même par une éblouissante journée, vous voici soudain plongé dans de mystérieuses ténèbres, contre lesquelles luttent faiblement quelques lumières clignotantes. Êtes-vous dans un tombeau égyptien de la Vallée des Rois, dans la salle des horreurs du musée Grévin, dans une crypte byzantine. Qui sait ?
Les voûtes et les murs que nulle couche de peinture ne revêt, sont partout et uniformément construits en briques jaunes, alternant avec des pierres de ce même granit rugueux et gris qui forme les remparts du palais impérial. Et ces frustes matériaux, étrangement rapprochés, troués de dessins géométriques, sont réunis par le plus incongru des ciments, un ciment d'or rouge ! Des escaliers, également en briques, montent et descendent, par des tournants imprévus, vers des galeries sans but apparent, ou tombent dans des salles de lecture pareilles à des hypogées, dans des bars qui ont l'air d'abris contre le bombardement. Tandis que de longs couloirs obscurs courent vers des profondeurs inconnues, se croisent, s'entre-croisent, s'enchevêtrent à la manière des catacombes. Si bien que l'imprudent explorateur qui s'y aventure sans guide n'est jamais certain d'en revenir. Quant à la salle des fêtes, longue, basse, lugubre, elle vous incline aussitôt à des méditations sur la vanité des joies terrestres.
— C'est de l'architecture aztèque, me confiait mystérieusement un initié.
Il arrive aussi que soudain l'on ait la surprise d'un petit jardin intérieur à l'air de joujou : sable rose, pelouses de velours, bassin à rocaille et à poissons rouges, arbustes que l'on renouvelle à chaque saison. Au temps des cerisiers en fleurs, c'est une féerie de neige rose ; au temps des azalées, un éblouissement de soleil à son couchant.
Quant aux chambres, elles sont fort plaisantes, avec leurs étroites fenêtres à petits carreaux, leurs lits d'enfant ou de cabine, leur mélange de confort yankee et de grâce nippone, qui se traduit dans les plus infimes détails, dans la poignée d'un tiroir, le bouton d'une sonnette ou d'une porte.
Petites, par exemple, réduites à la taille du pays, ce qui ne convient pas à tous.
— Oh oui ! Très charmant ! Very refined ! s'écriait avec une ironie rageuse, un grand diable de correspondant britannique. Seulement mes pieds sortent de mon lit ; je suis recroquevillé dans ma baignoire comme un homard bouilli ; je peux avec ma main attraper les mouches au plafond et je cogne ma tête dans toutes les portes !
Autre singularité, celle-là fort appréciable : l'Impérial « est à l'épreuve du tremblement de terre », ainsi que l'annoncent pompeusement les guides. C'est à peu près le seul édifice qui résista à l'effroyable catastrophe de 1923. Il donna même asile à des centaines de réfugiés. Pensée réconfortante quand — ce qui arrive une ou deux fois par mois — on s'éveille brusquement à l'aube, avec la sensation d'être encore en mer : les murs craquent, le lit se balance, les planchers montent et descendent, les porcelaines tintent et l'on voit sur les murs les tableaux danser la gigue. Où courir ? Que faire ?
— Vous placer tout juste sous le chambranle de la porte, m'avaient conseillé des amis. Le seul endroit où le mur résiste...
D'ordinaire, le premier mouvement qui n'est pas le bon, est d'ouvrir cette porte. Les couloirs sont pleins de gens aux pyjamas cosmopolites, aux yeux éperdus qui titubent en gloussant. Avec des lueurs d'ironie dans leurs prunelles en fente, les boys, qui en ont vu d'autres, les rassurent brièvement dans toutes les langues.
— Nothing... Fini !
De courtois et parfaits automates, ces boys vêtus de blanc immaculé. Mais ne leur demandez pas l'attention individuelle du domestique chinois, par exemple, qui s'efforce de connaître vos goûts, vos préférences, respecte vos habitudes, prend même des initiatives où l'on sent de l'intelligence et de la sympathie. C'est vainement que, pendant une quinzaine, j'ai imploré mon boy de l'Impérial de ne pas tirer mes stores le soir ni fermer mes rideaux. Cette opération étant prévue dans son mécanisme, il ne put jamais y manquer.
Par contre, les boys sont les dociles instruments d'une sollicitude occulte et traditionnelle qui s'attache à vos mouvements, s'étend à vos livres, à vos papiers. Un jour, devant passer la journée à la campagne, je fis un retour imprévu. Ce fut pour trouver un parfait gentleman nippon penché avec intérêt sur ma table de travail. Sans nul embarras, il allégua qu'il était venu vérifier les robinets de ma salle de bains. De la même table disparurent mystérieusement des livres et des brochures sur les conditions de travail japonais, publiés en Amérique par divers proscrits politiques ; une autre fois encore, de grosses enveloppes, contenant des documents confidentiels, s'éclipsèrent. Je fis appel à toutes les puissances de l'hôtel et même du ministère des Affaires étrangères ; la chambre fut fouillée de fond en comble. Vainement. Mais trois jours plus tard les enveloppes resurgissaient miraculeusement, en même temps que le chef des boys de l'étage, qui s'était absenté pour raisons de famille.
— Voilà, me dit-il, en me montrant avec un sourire ingénu, sur une chaise, au pied de mon lit, les papiers dissimulés sous une couverture de voyage sortie pour l'occasion de mon cabinet de toilette. La police nippone est bon enfant.
— Elle vaut notre Intelligence service, si elle ne le dépasse ! me disait, avec admiration, un Anglais qui a de particulières raisons de s'y connaître.
C'est dans la lumière d'aquarium du grand hall de l'Impérial, autour des tables de sombre acajou, que communie le Tout-Tokyo fixe et flottant. Avec discrétion, car la joie bruyante ne saurait être de mise dans un décor aussi mélancolique. Ici, des représentants des diverses ambassades, encadrant tout ce que la colonie européenne compte de beautés et d'élégances, dégustent des cocktails polychromes, des potins et des mots d'esprit polyglottes. Là, les correspondants et envoyés spéciaux des journaux de puissances souvent hostiles, échangent fraternellement notes et dossiers. Entourée de ses admirateurs, la grande violoniste française dédie ses sourires les plus photogéniques au célèbre pianiste russe dont la femme ressemble à une sultane des Mille et une Nuits. Distant et digne sous ses cheveux poudrés de blanc, M. Charlie Chaplin, très gentleman, glisse entre les groupes, d'une démarche souple et rapide qui ne rappelle en rien le pas cocasse et saccadé de notre Charlot. Et on a l'impression de perdre un ami très cher.
De solides Américains, tout en rires cordiaux à dents d'or, offrent du champagne australien à un homme d'affaires nippon, qui vient d'obtenir un marché aux avantages trop certains, mais garde dans le triomphe le même sourire figé, le même air impassible de farouche vertu.
Autour des tables tournent et se multiplient de petits reporters jaunes à lunettes d'écaille et à nez de carlins. Tout nouveau débarqué est leur proie : « — Est-ce votre première visite au Japon ? — Comment l'aimez-vous ? — Que pensez-vous des Japonaises ? » On dirait un jeu innocent ou une leçon de la méthode Berlitz. Puis, insensiblement, ils passent des généralités aux questions les plus intimes, avec une agressive curiosité.
Leurs sourires et leurs courbettes s'adressent principalement aux Américains. Nul n'ignore que les Japonais sont loin de porter dans leur cœur leurs grands voisins de l'autre côté du Pacifique. Pas un qui ne serait heureux de soutirer une pinte de sang yankee pour y laver, entre autres, la mortelle injure que firent à l'Empire du Soleil Levant les lois contre l'émigration jaune.
Mais telle est la force de dissimulation asiatique, qu'en attendant ils étouffent ces ennemis sous des fleurs. Tout Américain nouveau venu à Tokyo, qu'il vende des locomotives, de la littérature ou des conserves, est toujours un as de l'espèce qu'il représente, the biggest in the world... Des festins d'honneur lui sont offerts, des dithyrambes prononcés ; et qu'un ministre de l'Empire japonais donne un dîner international, les places de choix y sont décernées aux citoyens de la libre Amérique. Les Nippons réservent, paraît-il, leur amitié pour d'autres peuples, mais c'est moins voyant.
Parfois, l'Impérial galvanisé, sort de son calme un peu funèbre. Les personnages assez arrogants, qui se tiennent derrière le comptoir de la « réception », raides et mastiquant perpétuellement du chewing-gum, arrondissent leur échine et leurs gestes. Les petits grooms verts des ascenseurs, abandonnant les livres sur lesquels ils sont d'ordinaire penchés, frétillent et babillent. Des arbustes en fleurs décorent le hall ; au-dessus de la porte du restaurant, resplendit en ampoules électriques un énorme « Welcome » et l'orchestre prépare ses jazz les plus spasmodiques. C'est un bateau de touristes américains qui déverse ses hôtes. Ils ne sont point de la classe opulente que nous connaissons en Europe et se rapprochent davantage des modestes trippers que, chez nous, au printemps, promène l'Agence Cook : employés, instituteurs en congé, vieux couples attendrissants qui, après une vie de labeur, s'offrent la récompense d'un voyage, demoiselles âgées et sentimentales, pasteurs méthodistes, étudiants — public très sympathique, drôlement fagoté et même un peu ridicule, et si prêt à s'émerveiller !
Pendant quelques jours, on les gave de temples de laque rouge, de montagnes poudrées de sucre, d'allées de cerisiers en fleurs et de danses de geishas. Ils envoient à leurs amis des cartes postales de lacs bleus, achètent « de très vieilles pièces d'antiquités » que d'astucieux commerçants réservent pour leur passage, se font photographier sur des escaliers de sanctuaires célèbres. A tout coin de rue, on les rencontre à pied, l'appareil braqué sur de vieux ponts croulants où des enfants morveux, poussant des My ! My ! ou des Fine ! d'extase, le regard somnambulique derrière leurs grosses lunettes de corne. Au retour, ils délireront sur les paysages du vieux pays de Yamato et ses délicieux petits « Japs ». De la belle propagande !
On fait moins de frais pour les Allemands qui, avec leurs lunettes d'or et leurs nuques plates, montent par escadrons à l'assaut du commerce et des industries nippones. Les Japonais apprécient en eux non seulement l'esprit belliqueux de la race la plus militaire du monde, mais des rivaux dont l'activité égale, si elle ne surpasse la leur, et qu'il est fort malaisé de « rouler », car leur astuce est sans cesse aux aguets. Ils leur témoignent donc une considération sans fioritures tout en exerçant sur leurs allées et venues la plus flatteuse surveillance.
Il arrive aussi que des Japonais descendent à l'Impérial Hôtel. Plus ou moins teintés d'européanisme, il est vrai.
Parfois, dans un des recoins obscurs dont abonde le hall, on aperçoit des êtres fantomatiques qui se livrent à d'étranges gesticulations. Rites religieux ou exercices rythmiques ? Tout simplement des gentlemen nippons qui s'abordent et se congratulent. Dans un concert de sifflements, de salive aspirée, de petits gloussements alternés, ce sont des saluts de marionnettes qui cassent en deux, des plongeons qui ne cessent que pour se renouveler ; parfois, inclinés de biais, en pendant, les mains collées aux genoux, les deux personnages semblent ne plus vouloir se relever ; c'est qu'il serait indécent à l'inférieur d'interrompre ses politesses avant le supérieur, plus indécent encore au supérieur de traiter celui-ci en subordonné...
Une femme s'en mêle-t-elle ? L'opération se perpétue alors indéfiniment, car la femme japonaise est éperdue d'humilité... Spectacle assez comique et sur lequel je ne me suis jamais blasée.
Il précède souvent un dîner de corporation ou un festin offert par quelque puissant directeur de compagnie à ses employés. Rien de plus lugubre que ces agapes. Après les rites compliqués des présentations, les convives, infiniment corrects dans d'impeccables costumes européens, vont s'asseoir autour d'une table fleurie. Très droits, leur éternel sourire mécanique aux lèvres, coudes collés au corps, ils manient leurs divers couteaux et fourchettes avec précaution, attentifs à ne point se tromper de couverts, à ne contrevenir en rien aux usages occidentaux, n'interrompant leur mastication que pour de laconiques remarques. Entre les plats, intermèdes de cure-dents dont on fait au Japon une consommation immodérée, et silences si pénibles qu'ils arrivent à glacer les tables voisines. Des Européens, qui, coudes sur la table, bavardaient d'abord avec abandon, s'inquiètent de tant de retenue et se demandent si eux-mêmes ne font pas figure de rustauds. Le sourire figé sur tous ces masques nippons ne cacherait-il pas une profonde ironie ?
— Qui le saura ? me répond-on. Mais ne vous étonnez pas : plus le Japonais de classe supérieure s'instruit d'après nos méthodes occidentales et plus il affecte une impeccable et froide politesse, plus il se pétrifie et s'éloigne de nous. C'est un fait. Nous nous sentons beaucoup plus proches des gens du peuple qui gardent toute leur bonne humeur, toute leur fantaisie naturelle.
Deux fois par semaine, le restaurant de l'hôtel se change en dancing. Ces soirs-là, les tables sont presque entièrement occupées par des familles japonaises de haut vol ; les hommes en smoking, les femmes en kimonos d'une riche sobriété ou en élégantes toilettes européennes. On sourit, comme de juste, mais on ne parle guère et l'on rit encore moins. Le père de famille décide seul et souverainement du menu, se sert le premier, passe les plats à ses garçons, échange quelques mots avec eux. Mais il ignore les membres féminins de sa famille qui reçoivent modestement, toujours avec le sourire, les miettes du festin. Si d'aventure il adresse la parole à son épouse, celle-ci se contente de répondre par un monosyllabe ou par une profonde inclinaison de tête. Au premier signal de l'orchestre, toutes ces marionnettes se lèvent et se mettent à tourner ou à glisser d'un air morne, et comme en service commandé. Les tables, d'ailleurs, ne communiquent pas. Le mari danse avec sa femme, le père avec ses filles, les frères avec leurs sœurs. La mère reste à sa place. Inutile de dire qu'aucun Européen ne prend part à ces petites fêtes de famille. La salle du restaurant demeure ces soirs-là exclusivement et obstinément japonaise.
La première conclusion que l'étranger tire donc de son séjour dans cet unique et extraordinaire hôtel, c'est que la vieille formule n'a pas menti : « L'Est est l'Est, l'Ouest est l'Ouest et jamais ils ne se comprendront. »
II - SUR LA GINZA, RUE DE LA PAIX NIPPONE
Sur le bateau, cet industriel nippon d'Osaka, retour d'Europe, m'avait dit avec orgueil :
— A Tokyo, allez vous promener sur la Ginza. C'est notre Regent Street, notre rue de la Paix !
Pendant plusieurs jours, j'avais donc exploré la capitale nippone, agglomération de quartiers hétéroclites et de villages accolés qui se déroule interminablement, sans forme ni limites : d'abord, les boulevards tout neufs, avec leurs banques, leurs ministères, leurs clubs, leurs buildings frais construits et leurs buildings futurs, immenses carcasses de fer rouillé, qu'entourent des terrains creusés d'ornières, bossués de décombres ; puis les collines aristocratiques, leurs ambassades, leurs parcs dont les feuillages laissent entrevoir des toits de chalets suisses, de manoirs britanniques, des tours gothiques, des coupoles et des minarets ; je m'étais perdue dans d'immenses faubourgs, géométriquement découpés par des rues étroites, sans trottoirs ni pavés, formant tranchées entre des kilomètres de maisonnettes de bois et de ciment armé, qu'ombrage une forêt de poteaux télégraphiques, aux frondaisons de fils de fer, fleuries des blancs isolateurs de porcelaine. Voies étroites, le long desquelles s'élancent furieusement, dans un terrible tintamarre d'énormes tramways vert pomme, monstres rugissants, démesurés dans ce monde fragile, chargés de grappes humaines, qu'ils semblent emporter vers je ne sais quel antre.
Dans ce monotone et bruyant océan urbain, j'avais soudain découvert des hameaux campagnards, havres imprévus de silence et de sérénité, semés de frêles cabanes de bois clair, dans des jardins aux haies de bambous ; et parfois aussi, dans des zones morosement industrielles, entre des entrepôts, des gazomètres, des tanks à pétrole, sous de hautes cheminées d'usines, c'était la surprise de petits temples bouddhiques tout en or et en laque rouge, assoupis dans des cours où des gamins, en uniforme de lycéens, jouaient au base-ball, entre d'antiques lanternes de pierre.
Chaos géant, désordonné, contradictoire, qui, tour à tour, choque et charme, mais possède pourtant un pôle d'attraction : le Mur cyclopéen, avec ses tours, ses donjons, ses portes massives, avec ses fossés et ses douves qui, au centre de la ville, entoure cette cité dans la cité, impénétrable et mystérieuse, — le Palais Impérial. Mur indestructible et symbolique vers lequel le promeneur est toujours malgré lui ramené, et se heurte.
Soit, mais la Ginza ? Je savais que les poètes d'antan célébrèrent les saules dont elle était bordée, qu'elle fut à l'époque de Meiji la première rue à se moderniser, à se targuer de magasins occidentaux, la première à connaître les délices d'un tramway ; qu'elle est toujours le centre de la vie mondaine et des élégances nippones. Pourtant, après plusieurs jours d'explorations, je ne l'avais pas encore découverte. Et je n'osais l'avouer.
— Où est la Ginza ? me répondit enfin un ami. Mais à cinq minutes de votre hôtel !
Dire que j'y étais allée dix fois sans la reconnaître ! Quelle désillusion ! Des tramways certes, et fort bruyants et se succédant comme les anneaux aux couleurs criardes d'une chaîne ininterrompue. Mais plus de saules élégiaques, rien du pittoresque nippon, mais pas grand-chose non plus de ce luxe éclatant et raffiné, de ce goût pour ainsi dire cosmopolite qui règne dans toutes les capitales du monde civilisé.
Imaginez la grande rue de telle préfecture de chez nous, ses trottoirs étroits, ses maisons sans caractère, ses magasins aux vitrines « à l'instar », et vous aurez la Ginza. Les Japonais, naguère si artistes, voulant adopter les modes occidentales et s'y adapter, leur ont sacrifié beaucoup de leur grâce naturelle, de leur libre et délicieuse fantaisie. Et cela, chose curieuse, au moment même où l'Europe s'engouait jusqu'au dégoût des japonaiseries de bazar.
Il faut aller dans les villages, les faubourgs ou même dans la partie démocratique de la Ginza pour découvrir des étalages populaires où, pour quelques sens l'on acquiert des théières aux formes harmonieuses, des plats et de fines tasses de porcelaine, décorées de dragons bleus, de branches ou de paysages du style le plus pur, le plus léger. Car le goût nippon actuel va ou plutôt court aux productions mécaniques de l'art le plus fâcheux que connurent, il y a un quart de siècle, l'Europe et l'Amérique. Il sévit souverainement pour les porcelaines, les faïences, les meubles, tout ce qui peut déshonorer une maison.
Quant à l'habillement, bien que la plupart des Japonais se vêtent à l'européenne, à peine peut-on compter deux ou trois magasins de chaussures où l'on ne trouve, d'ailleurs, jamais rien à son pied. Il faut commander sur mesure. Les tailleurs exhibent des mannequins comiquement surannés. Et bien qu'un certain nombre de dames japonaises aient adopté nos modes, il faut se rendre jusqu'à Yokohama pour découvrir une modiste tolérable, ou une maison de couture. Si, du moins, on pouvait caresser ses regards aux obis, ces belles ceintures éclatantes, aux somptueux kimonos de soies opulentes et diaprées que portent encore les geishas ! Mais non. On les achète dans des maisons, fermées comme des sanctuaires. Ce n'est pas sur la Ginza qu'ils chatoient. On n'y trouve pas non plus les magasins d'antiquités où les servants d'un art magnifique vous présentent avec des gestes rituels les paravents de laque, les kakémonos d'une exquise sobriété, les vases et les ornements précieux.
Par contre, coiffeurs et marchands de produits de beauté abondent. Les enseignes, dont la plupart sont en anglais ou plutôt en américain parfois panaché de français, annoncent le Tanaka Beauty Parlor près du Beauty Parlour de Hollywood. La plupart réservés aux hommes, car si certaines jeunes filles, les modgals (modern girls), comme on les appelle, ont fait couper et tentent de friser leurs lourds cheveux couleur de houille, les Japonaises sont presque toutes uniformément coiffées de beaux chignons massifs noués sur la nuque. Elles se rattrapent, il est vrai, sur les fards...
Mais la Ginza est surtout peuplée de marchands de comestibles, de pâtisseries que l'on appelle des cafeterias, de cafés qui portent le nom de bars, de restaurants installés dans le vieux chêne et l'acajou des respectables hôtels britanniques ou bien dans le décor pseudo-gothique allemand, avec ses vitraux, ses rondouillardes sculptures, ses ors, tout son fatras suranné.
— Il y a quarante et un restaurants sur la Ginza, me précisait un Japonais avec ce curieux souci de la statistique qu'ils estiment très à la page. Sans compter, ajoutait-il d'une voix solennelle, les restaurants de nos magnifiques magasins de nouveautés, les plus beaux de l'Extrême-Orient. Vous les connaissez, j'espère ?
J'allais les oublier ! Ils sont pourtant un sujet de perpétuelle fierté pour les habitants de Tokyo. Il y en a deux ou trois sur la Ginza, dont deux au moins appartiennent aux énormes trusts jumeaux et rivaux des Mitsui et des Mitsubishi. Ce sont de vastes édifices blancs avec baies, tours à clochetons, jardins sur le toit qui évoquent les diverses Galeries, parure de nos villes provinciales. En plus grand, à coup sûr, mais sans rien de comparable aux magasins analogues de Paris, Londres ou New-York. On y vend de tout, comme de juste, des conserves californiennes, des cotonnades nippones qui ne sont plus, comme jadis fabriquées à Man-chester, des vêtements européens, qui semblent made in Germany ou en Amérique, des souliers tchécoslovaques et des parfums français ; quant au rayon d'objets d'art, bronzes, marbres et plâtres polychromes, c'est un musée de toutes les horreurs internationales, pieusement conservées. Il touche, il est vrai, au rayon cocasse et charmant des arbres nains et des rocailles ; minuscules érables, pins parasols qui étendent leurs bras tordus au-dessus d'un plat de faïence. On peut acquérir pour cinq yens un beau petit cèdre à trois étages de branchages et un rocher de poche ne coûte que deux yens. Est-il bizarrement contourné, troué comme une ruche, il y faut un yen de plus. Le tout ira enjoliver un jardinet grand comme un mouchoir de poche.
Enfin, d'autres comptoirs offrent de fraîches étoffes japonaises, où, par malheur, des décors cubistes ont tendance à remplacer les feuilles de bambou, les oiseaux et les fleurs de prunier, et aussi tout un choix de gais furoshiki, ces mouchoirs bariolés qui remplacent les sacs à mains des femmes et les serviettes de cuir des hommes d'Europe, des mouchoirs où les personnages traditionalistes les plus importants ne dédaignent pas de transporter des secrets d’État.
Mais dans ces magasins de « nouveautés », pour nous un peu défraîchies, le spectacle le plus curieux, ce sont les clients. De gros autobus rouges appartenant à l'établissement, vont sans cesse les cueillir aux diverses gares de Tokyo et, gratuitement, les déversent jusque dans le hall d'entrée. On y voit des familles entières de braves campagnards, campant, accroupies autour du bassin à rocailles qui en décore le centre, ou bien affalées dans les fauteuils et sur les divans. Ils sont tous venus, vieux parents, femmes, gamins et gamines en costumes d'écoliers, bambins en robes à fleurs et jusqu'aux petits derniers. Tandis que des mamans courtaudes aux lourds chignons allaitent le nourrisson, leurs minces prunelles errent avec admiration du pavé de marbre au plafond peint de la coupole qui leur paraît aussi haut que le ciel. Et tant de statues, de dorures, de galeries pleines de marchandises inconnues ! C'est là un univers féerique pour ce petit monde habitué à ses minuscules boutiques.
Le bébé, de nouveau ensaché dans la poche de sarigue que la plupart des Japonaises portent sur leur dos, ce qui les transforme en curieux phénomènes à deux têtes, voici la famille qui escalade le somptueux escalier ou se risque dans l'ascenseur, avec des gloussements de joie et d'effroi. On retrouve bientôt ces braves gens dans la salle qui précède le restaurant. Ils bâillent d'étonnement ou s'esclaffent à grand fracas devant des vitrines où sont exposées, reproduites en plâtre peint ou en celluloïd, avec un miraculeux réalisme, toutes les merveilles du menu : œufs sur le plat, côtelettes flanquées de leurs pommes de terre frites, homard et mayonnaise, poisson frit et citron, et tous les puddings, toutes les glaces, tous les gâteaux, sans compter des bouteilles emplies de liquides colorés. Chaque produit, portant son étiquette en japonais est admiré, discuté, commenté. Mais la plupart des clients campagnards s'en tiennent prudemment à la vue.
Parfois, une famille plus hardie se décide ; d'ordinaire des petits bourgeois. Le père mène le train, en jaquette, avec des souliers sang de bœuf. Suivent trois garçons en uniforme bleu à boutons d'or, une ou deux filles en costume marin dont la jupe très courte découvre des jambes solides, aux mollets pareils à des sacs de noix. Enfin, la mère, qui s'en tient à un kimono de couleur neutre, traînant par la main un ou deux marmots de sexe indécis. Ils s'installent autour d'une table, leurs jambes, habituées à l'agenouillement, pendant dans le vide. C'est leur première initiation au couteau et à la fourchette. Prenant exemple sur le père, et manœuvrant sous ses ordres, ils manient leurs armes d'un air emprunté et triomphant, s'escrimant vertueusement sur ces mets européens que toutes les ressources d'une chimie compliquée ont élaborés, avec la conscience de pénétrer un des mystères de la civilisation occidentale. Ce qui, depuis l'empereur Meiji, est un devoir patriotique.
Mais la véritable vie de la Ginza ne commence que le soir. Elle est double, car chaque trottoir, chaque extrémité de la rue a sa vie et son caractère propres. A peine la nuit tombe-t-elle que surgissent de toutes parts de petits marchands, avec leurs éventaires de bambous ; ils s'installent et en un clin d'œil convertissent ce trottoir en une foire analogue à celle de nos grands boulevards au moment des fêtes. On y trouve le plus étonnant mélange de camelotes de tous pays : des « santons » japonais, tous les personnages des contes de fées, — le bonhomme à la loupe, le bébé Outamaro que l'on découvrit dans une coquille, le vieil homme qui fait fleurir les arbres, les petites divinités tutélaires de la campagne, renards, chats, et surtout le blaireau Tanuki, un blaireau indiscutablement mâle, debout sur ses pattes de derrière, avec un large chapeau et un lampion au bout d'un bambou. Il y a aussi les héros historiques du Japon, avec leurs barbes et leurs sabres, et tous les dignitaires de la cour nippone, en costume d'apparat. Mais il y a bien d'autres choses encore : d'étranges poissons aux yeux protubérants et cylindriques qui traînent dans des bocaux de longs voiles de tulle orange, des cannes de bambous à un yen, des bas de soie artificielle, de « très vieux antiques » fabriqués à Birmingham (very old antiques) pour touristes américains, des bretelles, de la pâte à rasoir, des instruments pour peler les pommes de terre, des lunettes de corne, des bonbons de glucose en forme de dragons et de diables. Les camelots, comme chez nous, font leur boniment, avec des cris et des grimaces, de terribles roulements de prunelles ; d'autres soufflent dans des trompettes ; les tramways grincent et cornent, les taxis font retentir leurs klaxons, les rires volent, éclatent, la foule se presse, se pousse, les servantes coudoient les hommes politiques, les ouvriers en cottes bleues écussonnées de médaillons blancs, les étudiants et les banquiers. C'est le côté plébéien, avec sa gaîté populaire et bon enfant.