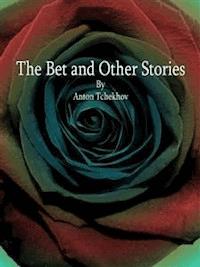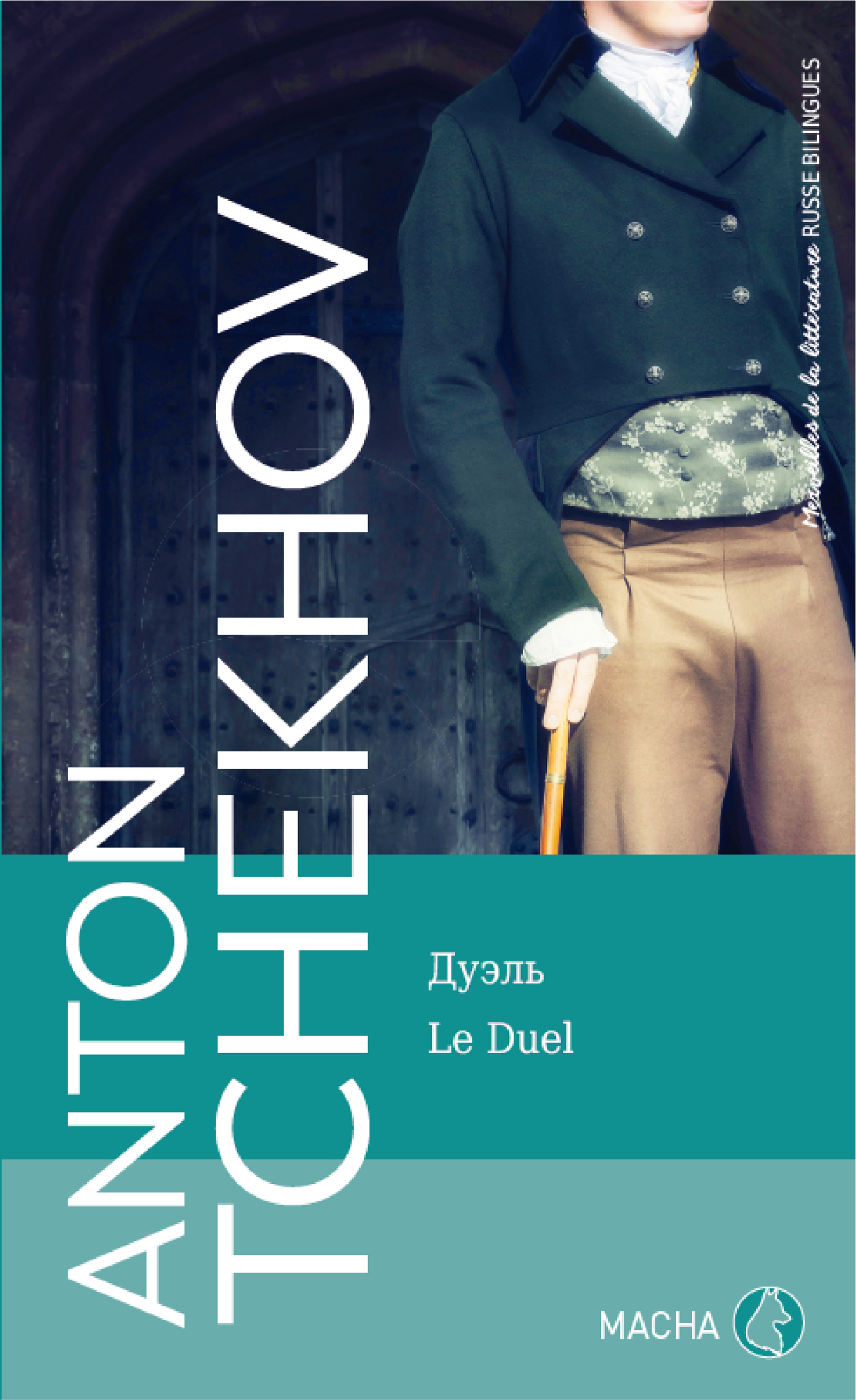Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ginkgo éditeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Andreï Kovrine, jeune et brillant intellectuel promis à une chaire à la Faculté, travailleur infatigable, part se reposer dans la propriété de province d’un de ses amis, immense domaine pourvu d’un verger et d’un jardin merveilleux dont ce dernier s’occupe passionnément avec l’aide de sa fille, la jeune et belle Tatiana. Mais Kovrine commence à avoir une vision récurrente : celle d’un mystérieux moine noir dont une prophétie annonce le retour prochain.
«
Le Moine noir est une splendeur », s’était exclamé Tolstoï à propos de ce récit inspiré d’un rêve que Tchekhov avait lui-même eu. Il est ici suivi de
Volodia et
Une morne histoire.
Trois nouvelles sur la folie, la vieillesse et la mort, à la beauté à la fois ordinaire et tragique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Petite Bibliothèque slave
— Collection dirigée par Xavier Mottez —
Chez le même éditeur
1. GOGOLLes Âmes mortes. Traduction d’Henri Mongault
2. TOURGUENIEVMémoires d’un chasseur. Traduction d’Henri Mongault
3. TOLSTOÏLes Récits de Sébastopol. Traduction de Louis Jousserandot
4. DOSTOÏEVSKIUn joueur. Traduction d’Henri Mongault
5. TOLSTOÏAnna Karénine. Traduction d’Henri Mongault
6. MEREJKOVSKILa Mort des dieux. Julien l’Apostat. Traduction d’Henri Mongault
7. BABELCavalerie rouge. Traduction de Maurice Parijanine
8. KOROLENKOLe Musicien aveugle. Traduction de Zinovy Lvovsky
9. KOUPRINELe Duel. Traduction d’Henri Mongault
10. GOGOLLe Révizor — Le Mariage. Traduction de Marc Semenoff
11. DOSTOÏEVSKIStépantchikovo et ses habitants. Traduction d’Henri Mongault
12. Les Bylines russes — La Geste du Prince Igor. Traductions de Louis Jousserandot et d’Henri Grégoire
13. PISSEMSKIMille âmes. Traduction de Victor Derély
14. RECHETNIKOVCeux de Podlipnaïa. Traduction de Charles Neyroud
15. TOURGUENIEVPoèmes en prose. Traduction de Charles Salomon
16. GONTCHAROVOblomov. Traduction de Jean Leclère
17. GOGOLVeillées d’Ukraine. Traduction d’Eugénie Tchernosvitow
18. DOSTOÏEVSKIMémoires écrits dans un souterrain. Traduction d’Henri Mongault
19. KOUPRINELe Bracelet de grenats — Olessia. Traduction d’Henri Mongault
20. GOGOLTarass Boulba. Traduction de Marc Semenoff
21. LESKOVGens d’Église. Traduction d’Henri Mongault
22. POUCHKINELa Fille du capitaine. Traduction d’Eugène Séménoff
23. LOUGOVOÏPollice Verso. Traduction d’Ely Halpérine-Kaminsky
24. CHMELIOVLe Soleil des morts. Traduction de Denis Roche
25. CHMELIOVGarçon !Traduction d’Henri Mongault
26. GOGOLNouvelles de Pétersbourg. Traductions de Michel-Rostislav Hofmann et Tatiana Rouvenne
27. ILF ET PETROVLes Douze Chaises. Traduction d’Alain Préchac
28. POUCHKINERécits de Belkine. Traduction de Pierre Skorov
29. LESKOVLady Macbeth du district de Mzensk et autres nouvelles. Traductions de Jean Leclère et d’Irène Tateossov
30. TOURGUENIEVPères et fils. Traduction de Marc Semenoff
31. ILF ET PETROVLe Veau d’or. Traduction d’Alain Préchac
32. PILNIAKRiazan-la-pomme. Traduction de Maurice Parijanine, révisée par Michel Niqueux
33. PILNIAKL’Année nue. Traduction de L. Desormonts et L. Bernstein, révisée par Dany Savelli
34. TOLSTOÏLe Faux Coupon. Traduction de Pierre Skorov
35. DOSTOÏEVSKISouvenirs de la maison des morts. Traduction d’Henri Mongault
36. POUCHKINELa Dame de pique — Le Nègre de Pierre le Grand. Traduction de Michel Niqueux
37. LESKOVLe Pèlerin enchanté — Aux confins du monde. Traductions d’Alice Orane et d’Hélène Iswolsky
38. ARSENIEVDersou Ouzala. Traduction de Pierre P. Wolkonsky
39. BOUNINELe Village. Traduction de Maurice Parijanine
40. BOUNINESoukhodol et autres nouvelles. Traduction de Maurice Parijanine
41. ILF ET PETROVKolokolamsk et autres nouvelles fantastiques. Traduction d’Alain Préchac
42. TOURGUENIEVFumée. Traduction de Génia Pavloutzky
43. BOUNINELe Monsieur de San Francisco et autres nouvelles. Traduction de Maurice Parijanine
44. BOULGAKOVCœur de chien. Traduction d’Alexandre Karvovski (Petite Bibliothèque slave)
45. LESKOVLe Gaucher. Traduction de Paul Lequesne (Petite Bibliothèque slave)
46. TOURGUENIEVMoumou. Traduction d’Henri Mongault. Préface de Dominique Fernandez (Petite Bibliothèque slave)
47. BOUNINETrois roubles. Traduction d’Anne Flipo Masurel. Préface d’Andreï Makine (Petite Bibliothèque slave)
48. LAZAREVIĆAu puits. Scènes de la vie serbe. Traduction d’Alain Cappon (Petite Bibliothèque slave)
49. TOLSTOÏMa confession. Suivi de Ce qu’un chrétien peut faire et ce qu’il ne peut pas faire. Traduction de J.-Wladimir Bienstock (Petite Bibliothèque slave)
50. KOUPRINEOlessia. Traduction d’Henri Mongault (Petite Bibliothèque slave)
51. TCHEKHOVLe Moine noir. Traduction de Gabriel Arout (Petite Bibliothèque slave)
Anton Tchekhov
Чехов Антон Павлович
1860-1904
LE MOINE NOIR
suivi deVOLODIAetUNE MORNE HISTOIRE
Traduction de Gabriel Arout
© Gabriel Arout, 1946, 2021
© Daniel-Rops [Henry Petiot], 1946, 2021
© Ginkgo Éditeur, 2021
Couverture : Émile WAUTERS, Le Peintre Hugo van der Goes au couvent de Rouge-Cloître, 1872. (détail)
Le Moine noir : 1894 ; Volodia : 1887 ; Une morne histoire : 1889.
PRÉFACE
Depuis longtemps je n’avais pas relu Tchekhov, je ne l’ai pas rouvert sans appréhension. C’est une expérience maintes fois décevante que de reprendre dans la maturité des œuvres qu’on a aimées au seuil de la jeunesse et auxquelles les ombres du souvenir ajoutent des prestiges qu’il vaut mieux parfois ne pas contrôler. Certaines s’effondrent au premier contact ; elles ressemblent à ces maisons incendiées qui gardent encore toute leur apparence, mais qu’un coup de vent suffira à jeter bas. D’autres résistent mieux, mais c’est parce que leur créateur a prévu toutes sortes d’échafaudages et de portants, dont, à vingt ans, on discerne fort mal l’artifice et que l’expérience du métier révèle par la suite assez cruellement. Je suis à peu près sûr que les Nourritures terrestres appartiennent à la seconde catégorie, et j’ai grand peur que le Grand Meaulnes soit un trop bel exemple de la première. Ayant relu, ces temps-ci, d’affilée, une demi-douzaine de ses livres, je sais que Tchekhov, lui, tient bon.
La plus immédiate impression que me donnent des œuvres comme Une morne Histoire, la Mouette ou la Cerisaie, c’est d’être, — comment dire ? — d’être vraies. À peine écrit, j’ai envie d’effacer ce mot banal ; il recouvre des réalités trop différentes. Peut-être vaudrait-il mieux dire : totalement soumises à la vérité. Il y a des écrivains qui nous imposent leur vérité, qui malaxent en quelque sorte le réel et le recréent si bien que, de gré ou de force, nous acceptons leurs points de vue et que nous tenons pour vraies des choses qui ne le sont que sous leur éclairage, dans leur climat. L’exemple des romans de Bernanos peut faire sentir ce que je veux dire. Chez Anton Tchekhov, ce qui s’impose à l’esprit avec une force poignante, c’est le renoncement absolu à toute construction, même si ce mot est entendu dans un sens parfaitement légitime, à toute transmutation. Dans la moindre de ses pages, on sent un tel respect de la vérité, une telle humilité devant elle, que la seule idée d’un artifice ne pourrait venir à l’esprit. Il n’y a même pas chez lui cette sorte de décalage entre l’observateur et l’auteur qui permet à Proust de subtils effets de perspectives, ni ce jugement sans cesse sous-entendu, ironique et assez satisfait de soi qui donne au style de Stendhal son charme acide ; aucun romancier, autant que Tchekhov, ne nous apparaît uniquement soucieux de saisir la vérité non pas telle qu’elle se reflète dans la glace, mais telle qu’elle est.
Il va de soi qu’il y a là une réussite strictement littéraire exceptionnelle, et si grande que seuls peut-être sont capables de la mesurer ceux qui ont eux-mêmes l’expérience du fait d’écrire. La pointe extrême de l’art est de sembler se supprimer soi-même et de passer tout à fait inaperçu. Une nouvelle comme Une morne Histoire me laisse émerveillé. Tchekhov y a tout mis contre lui ; son personnage n’est pas bien sympathique ; l’action, si faible, procède par effets prévus ; l’odeur du récit est celle de la vieille poussière remuée, avec je ne sais quoi d’aigre et de rance. Rien de tout cela pour piper le lecteur. Plus encore : la psychologie des héros obéit toujours à la loi de la plus grande pente ; c’est un processus de désagrégation qui mène les développements et je me souviens de cette remarque profonde que j’ai souvent entendu faire à Charles Du Dos (une fois, à propos de Tchekhov lui-même) : c’est lorsqu’il s’agit de rendre des états d’âme en voie de dissolution, des caractères sans force et sans armature, que l’écrivain doit posséder en lui le plus de rigueur ; pour peindre des âmes obscures il faut être absolument lucide, avoir en soi une grande clarté. Aussi quand, de tout un ensemble de petites notations, de remarques en apparence insignifiantes, de dialogues qui semblent excessivement lents, et poussiéreux, jaillit une lumière telle que celle dont se nimbe la silhouette du vieux professeur de Tchekhov, la chose ne fait pas de doute : c’est l’artiste qui a tiré de soi cette lumière, douce et profonde, aussi peu aveuglante que possible, mais qu’on n’oublie pas.
Tout cela, que j’avais aimé dans Tchekhov, je le retrouve. J’écoute, fût-ce dans la plus courte de ses nouvelles, le battement sourd de la vie, ce battement monotone synchronisé à celui de nos tempes et de nos artères, et dont on sent chaque jour davantage le pathétique, à mesure que l’instant approche où nous savons qu’il cessera pour nous. Je touche là cette matière rugueuse, pleine de crasse, qui est, sous notre main, la seule chose qui résiste et qui nous donne l’impression d’échapper à la solitude. De ces vingt volumes, des visages surgissent, que je redécouvre familiers, toutes ces Katia, ces Anna, ces Lida, et l’Ivanov douloureusement cruel du conte qui porte son nom, et le pauvre garçon qui demandait au Moine noir de le consoler de vivre. Il n’est pas jusqu’à la petite chienne Kachtânnka qui derechef ne m’émeuve lorsqu’elle essaie de chasser l’invisible intrus qui va frapper son amie l’oie, et qu’elle hurle, sentant la menace, impuissante devant l’informe, comme chacun de nous. Tout ce qui, chez Anton Tchekhov, doit si merveilleusement rendre la vie immédiate et présente, y compris l’affreux filigrane qui court dans la pâte du papier, je l’éprouve aussi pressant pour moi, aussi consolant et dramatique qu’à ma première lecture, il y a plus de vingt ans.
Cependant, si je me souviens de ce que je ressentais autrefois en découvrant Tchekhov, si je relis ce qu’alors j’écrivais de lui, je sens bien que mon point de vue a changé. Léon Chestov, dans l’étude qu’il lui a consacrée sous le titre la Création ex nihilo et qui demeure, en dépit d’aperçus profonds, assez extérieure à son objet, a insisté presque exclusivement sur le « désespoir » de Tchekhov. « Son vrai, son unique héros, c’est l’homme désespéré », écrit-il ; ce que son traducteur, Boris de Schloezer, précise encore ainsi : « Au cours de sa longue carrière littéraire, il n’a jamais fait que tuer tous les espoirs humains ; il faisait cela bien mieux que Maupassant ; des mains de Maupassant, la victime réussissait parfois à s’échapper, froissée, brisée, mais encore vivante. Entre les mains de Tchekhov, tout mourait. » Il y a vingt ans, ces notations me semblaient totalement valables ; elles ne me le paraissent plus que globalement, et d’une façon presque sommaire. C’est, en tout cas, en vidant la formule de tout romantisme, en lui prêtant au contraire une quantité infinie de chaleur et de délicatesse qu’il faut accepter de dire que Tchekhov est « le chantre de la désespérance ».
Il est bien vrai que de l’observation de la vie telle que Tchekhov la pratique se dégage une impression d’atonie et de fadeur qu’on dira communément désespérante. Le schéma significatif de ses récits, c’est celui de la pièce des Trois Sœurs ou d’un conte comme Beautés. Elles sont là, dans leur morne ville de province ; un régiment est venu ; elles ont l’espoir de se marier, le régiment part ; elles restent ; et c’est tout. Ou bien la voici, cette ravissante fille aperçue dans une petite gare, toute seule à côté d’un télégraphiste malingre, et dont on peut imaginer l’existence solitaire, monotone, horriblement « quotidienne », comme disait notre Laforgue. Ainsi personne mieux que Tchekhov n’a su peindre à travers des êtres cette sensation de vacuité et d’inanité qui, à certains moments, nous monte à la gorge comme une eau lourde. « La chair est triste, hélas, et j’ai lu tous les livres... », le vers de Mallarmé la résume ; les héros de Tchekhov ne lisent même pas.
Dès l’instant où ils se considèrent eux-mêmes (et la plupart d’entre eux sont totalement lucides), les personnages ont l’impression d’être désaccordés et de ne fonctionner plus qu’avec des ressorts aux trois quarts brisés. « Dans toutes mes pensées, dans tous mes sentiments, dans mes conceptions de choses, il manque toujours un élément commun, qui ferait de cela un tout », dit l’un d’eux. Et un autre parle de ces êtres qui « continuent à vivre en ayant perdu complètement la possibilité d’extraire de la vie et d’utiliser ce qui en constitue l’essence même et la signification. » Une puissance maléfique ronge ces âmes, qui est au plus intime d’elles-mêmes, participant à leur destin le plus secret. Est-ce cela le désespoir ?
Peut-être pas absolument. Car il y a, par rapport à cette atonie et à ce désaccord, un élément qui, chez Anton Tchekhov, l’empêche d’atteindre à son comble. Il y a le sens du tragique. Ce qu’il fait comprendre mieux que quiconque, c’est le tragique du médiocre, le tragique de ces existences vides et qui s’écoulent sans savoir pourquoi. Comme l’a bien noté Chestov, à la question ironique de Nietzsche : « Un âne peut-il être tragique ? » Tchekhov a répondu de la façon la plus pertinente, humainement. Il a montré que personne n’échappe au tragique, que ce n’est pas une question d’intelligence ni de génie ; le plus insignifiant, s’il pénètre dans l’ordre du drame par la force des événements, en reçoit une ordination mystérieuse. Or, entre le tragique véritable et le désespoir véritable, il y a une opposition d’essence : pour être absolu, le désespoir doit atteindre à un degré de froideur et de sécheresse où toute possibilité de reprise soit impossible et là alors il n’y a plus de tragique du tout.
D’ailleurs la plus grande partie des personnages de Tchekhov éprouvent de la honte devant le spectacle de leur propre médiocrité. Ils sont, en ce sens, très différents du fameux Oblomov de Gontcharov qui se vautre dans sa paresse avec un bonheur abject. Ils ne sont pas, à proprement parler, des résignés, et je pense que rien ne s’applique moins à eux que la citation de Baudelaire que Chestov fait à leur propos : « Résigne-toi, mon cœur, dors ton sommeil de brute. » Tout au contraire, maints d’entre eux (celui du Moine noir, par exemple) ne prennent conscience de leur vie qu’à travers cet état de misère intérieure : Tchekhov n’avait pas attendu telle école française retentissante pour sentir que « la nausée » permet à l’homme de se trouver. Autrement dit, son « désespoir » me paraît aujourd’hui non plus fermé sur soi et immobile dans la contemplation de son propre abîme, mais ouvert sur quelque chose d’infiniment plus consolant et se dirigeant, malgré tout, vers un but.
On fait un pas dans la connaissance de Tchekhov en observant qu’il n’y a en lui rien de violent, de fracassant. Devant le spectacle d’une certaine abjection du monde, à laquelle ne correspondent que trop les secrètes complicités de notre cœur, certains éprouvent le besoin de hurler, de gesticuler, de menacer. Évoquant, dans le poème liminaire aux Lettres du Centurion, la nuit affreuse où Ernest Psichari faillit se suicider, Claudel parle de « ce transport en nous de désespoir et de colère ». C’est aussi « la colère dans le sang » de Rimbaud dont la Saison en Enfer multiplie les images. Rien de tel chez Anton Tchekhov ; on ne trouve peut-être pas une seule page dans son œuvre où de tels sentiments transparaissent.
Au contraire, son attitude fondamentale est celle qui se révèle à travers son art d’une façon si frappante : c’est l’acceptation. La règle esthétique est ici en étroite coïncidence avec la loi spirituelle, et c’est par là qu’un Tchekhov se sépare radicalement de la grande majorité des naturalistes français, auxquels, en apparence, il ressemble. Peignant le monde dans sa médiocrité avec une application minutieuse, il ne se borne pas à une constatation, comme Zola par exemple. Sans jamais la formuler, il en tire une leçon profonde : celle du consentement à la vie. La soumission, humble et totale, à la vérité du réel dont témoigne son expression littéraire, c’est, en réalité, une soumission à la vérité de l’existence. Telle est, me semble-t-il, à la fois sa grandeur et l’élucidation de son « désespoir ».
Charles Du Bos, qui, dans son Journal, parle de lui maintes fois et parfaitement, a montré à quel point une totale acceptation de la vie est difficile, et combien exceptionnelle celle d’Anton Tchekhov. Il souligne le fait qu’une certaine façon d’accepter est, en réalité, un moyen de se leurrer soi-même. On place « l’acceptation dans ce premier plan de la conscience, où règne comme une lumière aveuglante, et, à l’abri de cette acceptation, au fond on n’accepte rien du tout. » Pour être totale, l’acceptation de la vie doit reposer sur un dépouillement tellement radical que la plupart des hommes en sont incapables. Or Tchekhov y arrive toujours. Pas plus qu’il n’y a chez lui de révolte, il n’y a non plus de ces sortes de mensonges inconscients qui nous font murmurer un « fiat » que la raison nous impose alors que le fond de notre cœur demeure plein d’amertume et de refus. Lui, il est tout entier simplicité et abandon.
Pourquoi ? Je me demande si l’explication ne réside pas dans le secret de la crise qu’il a traversée aux environs de sa vingt-septième année et dont son œuvre porte la trace flagrante. On sait qu’à ses débuts, il écrivait des contes humoristiques — d’un humour assez impitoyable — dans un journal amusant, le Réveil Matin. Pour pas mal de Russes et pour divers commentateurs, il est même resté longtemps, avant tout, un auteur comique. Puis, à la suite d’événements sur lesquels on est très mal renseigné et par un processus psychologique dont lui-même n’a rien dit, il a soudain changé d’optique et de style. Après un roman intermédiaire, Un drame à la chasse, qu’il ne devait pas reprendre dans ses œuvres complètes, il s’est mis à écrire selon le mode que nous connaissons. On a l’impression que, pour lui, ce fut comme si un voile s’était déchiré, et s’il s’était trouvé face à face avec une réalité que, jusqu’alors, il s’était masquée à lui-même sous le voile de sa propre ironie. Pourquoi ?
Il y a vingt ans, j’aurais été sans doute tenté d’expliquer cette crise par des motifs transcendants ; je me demande aujourd’hui si elle n’a pas été liée seulement à la rencontre de la maladie. Le vrai tragique a une simplicité épouvantable. Tchekhov devait mourir à quarante-quatre ans, tuberculeux, dans une bourgade de la Forêt-Noire, après avoir erré, comme tant de ces malades, cherchant tantôt la lénifiante atmosphère de la côte de Crimée, tantôt l’air tonique des montagnes. La maladie qui le rongeait, plus que quiconque, il était à même d’en suivre la progression en son être, livré à ce pathétique si particulier qu’a le sort du médecin malade, à qui est refusé le moindre secours de l’illusion.
La connaissance de la mort certaine, et particulièrement cette connaissance absolument lucide, sans détours, sans possibilité de tricherie, il me semble que c’est là le point central de son attitude spirituelle, de son acceptation et de son « désespoir ».
Je suis frappé, en relisant Tchekhov, de la place que tient chez lui le thème de la mort. Il n’est pour ainsi dire aucun de ses récits où il n’y soit fait allusion. On en discute dans la Mouette comme on en médite dans la Morne Histoire. On se demande ici : est-ce une peur animale ? et là : quel est son sens métaphysique ? Prise d’ensemble, l’œuvre entière en fait éprouver la présence constante, obsédante, plus pénible encore à supporter qu’elle ne s’habille d’aucun ornement, qu’elle aussi est constatée avec une totale simplicité. Les personnages de Tchekhov sont exactement définis par la fameuse formule de Heidegger, « des êtres pour la mort ». Elle est en face d’eux ; ils le savent ; qu’ils osent ou non la considérer, elle, elle les regarde. Non seulement l’attitude spirituelle de Tchekhov s’explique par là, mais son art même.
Le monde de Tchekhov est un monde vu à travers les lunettes de la mort, une humanité considérée dans la lumière de l’éternité. C’est, utilisée comme règle par un écrivain psychologique, la formule du Dies irae : « Quidquid latet apparebit. » Rien n’est caché, de ce point de vue : une insoutenable clairvoyance, voilà le don de la mort. Considérée de si haut, la vie n’est rien de plus qu’une agitation d’insectes, aussi vaine que celle des fourmis affairées. Quel est le but ? le savent-elles elles-mêmes, ces bestioles ? Oui, mais elles font semblant de l’ignorer. L’art de Tchekhov, minutieusement précis, totalement lucide, c’est l’art d’un homme qui, se sachant promis à la mort et ayant, en un sens, déjà pénétré dans son ordre, examine le monde, la vie, les hommes sub specie aeternitates.
On ne peut pas dire qu’elle soit, pour lui, l’explication décisive de la vie, ce qu’elle est pour Rilke, par exemple. « Car nous ne sommes que l’écorce et la feuille. La grande mort que chacun porte en soi est le fruit où tend tout le reste. » Non, même pas cela, ce qui est encore, d’une certaine façon, consolant. Elle est : cela suffit. Il en va de la mort comme de tous les aspects de la vie ; avec son calme sourire retenu, Tchekhov nous dit : « C’est comme cela. Rien d’autre. Il n’y a rien de plus à chercher ni à trouver. »
Toute sa vie, l’homme porte en soi l’angoisse, mais cette angoisse change de caractère avec les ans. L’inquiétude de l’adolescence, si déchirante, si douloureuse, jaillit du choc entre l’être et l’existence ; elle est une espérance retournée et qui se méconnaît. Devant la vie telle qu’elle est, devant les tristesses et les incohérences d’un cœur qui se découvre complice, la conscience se débat en d’obscures agitations. La cause la plus profonde de cette inquiétude est intérieure ; au fond, la vie, objectivement, ne l’intéresse guère (aussi en fait-elle assez souvent bon marché) ; les grandes réalités de la douleur et de la mort ne la requièrent que rapportées à soi, et comme de thèmes à sensations. La détresse de l’homme adulte est autre. Quand on a dépassé ce que Dante appelle « la mi-chemin de notre vie », l’angoisse vient de l’extérieur. Tous les aspects du monde la suggèrent et l’imposent. Le jour qui passe la porte avec soi. Une ombre grandit sur l’horizon et chaque heure en rapproche : heureux ceux qui peuvent lui donner un nom ineffable, et y reconnaître un visage de consolation !
Le désespoir de Tchekhov, je sais maintenant que c’est le désespoir de l’homme adulte et qui a compris. Quiconque l’a éprouvé a connu ce mystérieux phénomène de décoloration qui, en certains moments, semble interposer entre nous et les choses de la vie une glace inactinique ; c’est la lumière des récits de Tchekhov. Et il a entendu aussi résonner en lui la douce voix tentatrice : « À quoi bon ? » C’est celle des personnages de Tchekhov. Et, pour peu qu’il ait quelque sagesse, il sait encore que cela ne sert à rien de crier, de se révolter ; il faut accepter, consentir, et c’est la morale de Tchekhov.
En ce point, un choix reste à faire. Devant l’inéluctable, l’un se sentira le cœur plein de rancune ; il haïra cette vie qui le fuit, cette humanité qui continuera à s’agiter stupidement dans la lumière alors que l’ombre l’aura recouvert ; écrivain, il détestera ses personnages, les condamnera à la géhenne de passions sans rémission possible. Mais l’autre éprouvera une commisération sans limite pour ces insectes qu’un pied fatal va broyer et qui font semblant de l’ignorer ; il les aimera davantage d’être si absurdes, si laids, si médiocres ; cette déchirante pitié, presque surnaturelle, envers l’infinie misère des créatures, c’est celle de Tchekhov.
Ainsi la ligne de Tchekhov, telle qu’il ne l’a jamais formulée, mais telle qu’il l’a mise en pratique, me semble se résumer ainsi : c’est à travers ce qui nous détruit que nous pouvons trouver les éléments de notre grandeur. Elle suppose un oubli absolu de soi, extraordinairement difficile à l’homme de lettres, et auquel Tchekhov parvient toujours. Elle suppose encore davantage : un refus de toute connivence avec les processus de désagrégation dont l’écrivain se fait le témoin. Il y a, dans la mort acceptée en homme, un singulier pouvoir de décrassage ; on dirait qu’elle décape l’être de toute la boue dont la vie de la terre nous recouvre. Peindre l’existence humaine dans toute sa médiocrité et sa souillure, sans jamais tomber dans la bassesse, c’est non seulement un exceptionnel tour de force littéraire, mais le témoignage d’une nature morale également exceptionnelle.
Le peu que je sais sur l’homme que fut Tchekhov, je l’ai appris dans les extraordinaires souvenirs littéraires de Maxime Gorki sur lui. Comme il en parle bien ! Comme on voit bien, à travers ses pages, cette nature secrète et réservée, telle qu’on la devine à travers son œuvre. Il était simple : dans la lumière de la mort, que reste-t-il des affectations et des poses vaniteuses ? Il était généreux, plein de nobles aspirations sociales et humaines ; à un certain degré de détachement correspond volontiers le don de soi aux autres. Mais Gorki insiste surtout sur sa noblesse d’âme : « Décrivant les turpitudes de la vie, il haïssait tout ce qui est vil et bas » ; devant le spectacle si souvent abject du monde, devant tant d’hommes qui méconnaissent la dignité humaine, la réaction de Tchekhov était « le soupir étouffé et profond d’un cœur véritablement humain ».
De cette attitude, si noble soit-elle, nous voyons bien les limites. Il y a, dans toute son œuvre, une sorte de fuite constante devant le problème fondamental. La question religieuse n’est jamais posée par lui que par un biais, à travers des personnages qui en discutent, et il est absolument impossible de se rendre compte de ce qu’était le fond de sa conviction. On pense au personnage de Ma femme qui « haïssait les croyants parce que la foi est un indice de bêtise et d’ignorance », et qui ne haïssait pas moins les incroyants, « parce qu’ils n’ont ni foi ni idéal. » C’est en étudiant la pensée religieuse de Tchekhov qu’on pourrait certainement fixer avec précision ses limites et se rendre compte de ce qui, en définitive, le fait inférieur, et d’assez loin, à un Dostoïevski. Peints probablement avec plus d’exactitude que ceux de l’auteur de Karamazov, dessinés d’un trait plus minutieux et, à tout prendre, plus ferme, les personnages de Tchekhov manquent d’une certaine dimension que ceux de Dostoïevski possèdent. On a envie de les affronter, de force, à l’explication décisive ; de leur crier les bouleversantes questions de Kirillov, d’Ivan Karamazov. Selon le mot que Dostoïevski disait d’autres : « Ils ignorent qu’ils portent en eux une grande valeur éternelle. »
Pourtant, quand je pense à Tchekhov, cette âme que la foi ne semble pas avoir guidée sur les chemins de la lumière me paraît y avoir mystérieusement accédé. Son nom sonne en moi avec un écho de pureté, de transparence. Peut-être aura-t-il rejoint, par l’admirable pitié qui était en lui, l’absolu de la miséricorde. Il y a, dans son exemple, un profond encouragement à quiconque, écrivain, aura cherché par-dessus tout à aimer les hommes, non pas sans les connaître, mais en les connaissant le plus complètement possible : c’est qu’ainsi il aura participé à une vision supérieure du monde qui, par l’amour, adhère à l’amour suprême et en reçoit l’ordination.
Octobre 1946.
DANIEL-ROPS.
LE MOINE NOIR
Черный монах
I
Le maître André Vassiliévitch Kovrine éprouva brusquement une grande fatigue et ses nerfs lui semblèrent détraqués. Il ne se soigna point, mais eut, devant une bouteille de vin, une conversation avec un docteur de ses amis, et ce dernier lui recommanda de passer le printemps et l’été à la campagne. Fort à propos, il reçut une longue lettre de Tania Pessotzka qui l’invitait à faire un séjour dans son domaine de Borissovk. Et il décida qu’en effet, il ne ferait pas mal de voyager un peu.
Tout d’abord — au mois d’avril — il alla dans sa propriété héréditaire de Kovrinka, où il passa trois semaines dans la solitude ; puis, la bonne circulation des routes étant rétablie, il partit par la poste chez son ancien tuteur Pessotzki qui l’avait élevé et qui était connu dans toute la Russie pour sa compétence en matière de jardinage. De Kovrinka à Borissovk où habitaient les Pessotzki, on ne comptait guère plus de soixante-dix lieues et c’était un délice que de rouler sur la molle route printanière dans une calèche souple et bien suspendue.