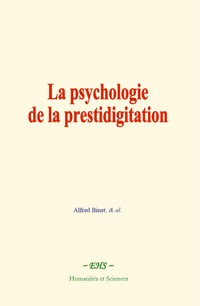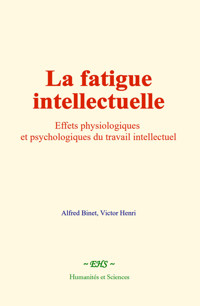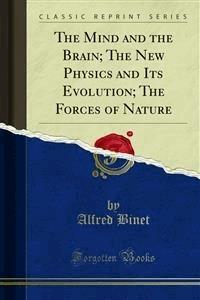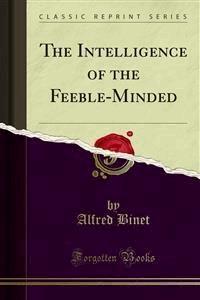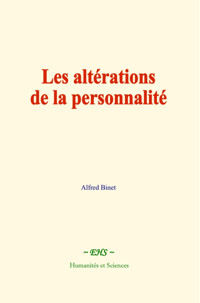
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Ce qui fait l’intérêt des phénomènes psychologiques spontanés, c’est qu’ils ont subi une influence très minime des personnes qui les observent ; ils n’ont pas été préparés de longue main et d’une manière inconsciente par un auteur qui avait son opinion faite ; ils ne répondent par conséquent à aucune théorie préconçue ; c’est par eux que nous commencerons nos études.
Les altérations de la personnalité qui peuvent se produire chez des malades revêtent un très grand nombre de formes différentes ; il n’est nullement question de les passer toutes en revue. Nous nous bornons ici à étudier les dédoublements de la personnalité ou plutôt la formation de personnalités multiples chez un même individu. Ce phénomène peut se présenter chez plusieurs catégories de malades ; nous l’envisagerons spécialement dans l’hystérie, où il a été surtout étudié dans ces derniers temps.
On a souvent désigné sous le nom de somnambules les personnes qui présentent ces altérations de la personnalité ; nous avons conservé ce terme de somnambulisme ; il a besoin d’être expliqué, car on ne lui a pas toujours donné un sens précis, et les recherches récentes, en multipliant le nombre et la variété des somnambulismes, ont singulièrement compliqué la question. Il en est de cette question comme de l’aphasie qui, à l’époque où Broca l’étudiait, pouvait recevoir une définition simple ; c’était la perte de la parole articulée ; aujourd’hui qu’on a découvert et analysé tant d’autres formes des maladies du langage, telles que l’agraphie, la cécité verbale, la surdité verbale et bien d’autres encore, il n’y a plus une aphasie, il y a des aphasies. De même, le terme de somnambulisme doit élargir sa signification ; il n’y a pas un somnambulisme, un état nerveux toujours identique à lui-même, il y a des somnambulismes.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alfredo Binetti, né le 8 juillet 1857 à Nice (alors dans la division de Nice du royaume de Sardaigne) et mort le 18 octobre 1911 à Paris (14e)1, est un pédagogue et psychologue français. Il est connu pour sa contribution essentielle à la psychométrie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les altérations de la personnalité
Les altérations de la personnalité
Alfred Binet
EHS
Humanités et Sciences
INTRODUCTION
Il y a une quinzaine d’années qu’on a commencé en France, en Angleterre, et dans quelques autres pays, des recherches de psychologie pathologique fondées sur l’étude de l’hystérie et de la suggestion ; nous savons tous avec quelle ardeur les physiologistes et les philosophes se sont livrés à cette étude nouvelle, et en un très court espace de temps on a recueilli une quantité vraiment considérable d’observations et d’expériences de toutes sortes ; l’hallucination, les paralysies par suggestion, les altérations de la personnalité, les troubles de la mémoire, le sens musculaire, les suggestions pendant l’état de veille et pendant l’hypnose, les suggestions inconscientes, etc., telles sont les principales questions qui ont été examinées et profondément fouillées.
À mesure que les recherches se multipliaient et s’étendaient, il s’est élevé entre les expérimentateurs de nombreuses discussions ; non seulement on ne s’est pas mis d’accord sur les théories, mais des faits importants affirmés par les uns ont été niés par les autres ; on a même vu s’élever école contre école. Les controverses, qu’on a pu regretter, mais qui, en somme, sont constantes et même nécessaires dans toute recherche nouvelle, ont jeté quelque doute sur la valeur véritable des matériaux amassés.
Mon intention, en écrivant ce livre, n’est point de continuer la tradition des discussions d’école ; au lieu d’opposer mes expériences à celles des autres auteurs, je vais prendre dans leur ensemble tous les résultats qui ont été obtenus dans l’étude d’une question, pour rechercher quels sont, parmi ces résultats, ceux qui s’accordent et peuvent être groupés dans une même synthèse. Je retiendrai seulement les expériences qui se répètent entre toutes les mains, et qui donnent toujours la même conclusion, quelle que soit la fin cherchée ; je mettrai au contraire en réserve, sans les juger, tous les phénomènes qui n’ont encore été observés que par une seule personne, et qui ne se rattachent pas logiquement à un ensemble de faits connus et acquis ; et bien entendu je ferai subir cette épuration à mes propres travaux comme à ceux des autres auteurs.
L’occasion me paraît être favorable pour tenter cette œuvre d’éclectisme ; il se produit en ce moment un fait assez curieux : un grand nombre d’observateurs qui n’appartiennent ni à la même école ni au même pays, qui n’expérimentent pas sur le même genre de sujets, qui ne se proposent pas le même objet d’expérience, et qui parfois s’ignorent profondément, arrivent au même résultat, sans le savoir ; et ce résultat, auquel on parvient par des chemins divers, et qui fait le fonds d’une foule de phénomènes de la vie mentale, c’est une altération particulière de la personnalité, un dédoublement ou plutôt un morcellement du moi. On constate que chez un grand nombre de personnes, placées dans les conditions les plus diverses, l’unité normale de la conscience est brisée ; il se produit plusieurs consciences distinctes, dont chacune peut avoir ses perceptions, sa mémoire et jusqu’à son caractère moral ; nous nous proposons d’exposer en détail le résultat de ces recherches récentes sur les altérations de la personnalité.
Première partie
LES PERSONNALITÉS SUCCESSIVES
CHAPITRE I
LES SOMNAMBULISMES SPONTANÉS
I.
Ce qui fait l’intérêt des phénomènes psychologiques spontanés, c’est qu’ils ont subi une influence très minime des personnes qui les observent ; ils n’ont pas été préparés de longue main et d’une manière inconsciente par un auteur qui avait son opinion faite ; ils ne répondent par conséquent à aucune théorie préconçue ; c’est par eux que nous commencerons nos études.
Les altérations de la personnalité qui peuvent se produire chez des malades revêtent un très grand nombre de formes différentes ; il n’est nullement question de les passer toutes en revue. Nous nous bornons ici, comme nous l’avons dit, à étudier un seul type de ces altérations, les dédoublements de la personnalité ou plutôt la formation de personnalités multiples chez un même individu. Ce phénomène peut se présenter chez plusieurs catégories de malades ; nous l’envisagerons spécialement dans l’hystérie, où il a été surtout étudié dans ces derniers temps.
On a souvent désigné sous le nom de somnambules les personnes qui présentent ces altérations de la personnalité ; nous avons conservé ce terme de somnambulisme ; il a besoin d’être expliqué, car on ne lui a pas toujours donné un sens précis, et les recherches récentes, en multipliant le nombre et la variété des somnambulismes, ont singulièrement compliqué la question. Il en est de cette question comme de l’aphasie qui, à l’époque où Broca l’étudiait, pouvait recevoir une définition simple ; c’était la perte de la parole articulée ; aujourd’hui qu’on a découvert et analysé tant d’autres formes des maladies du langage, telles que l’agraphie, la cécité verbale, la surdité verbale et bien d’autres encore, il n’y a plus une aphasie, il y a des aphasies. De même, le terme de somnambulisme doit élargir sa signification ; il n’y a pas un somnambulisme, un état nerveux toujours identique à lui-même, il y a des somnambulismes.
Dans le sens vulgaire et populaire du mot, on appelle somnambulisme naturel l’état des individus qui se lèvent la nuit et accomplissent des actes automatiques ou intelligents ; ils s’habillent, reprennent leur travail de la journée, font aller un métier, ou résolvent un problème dont ils ont vainement jusque-là cherché la solution ; puis, ils se recouchent, se rendorment, et le lendemain matin, ils ne conservent aucun souvenir de s’être levés pendant la nuit ; et ils sont souvent très surpris de voir terminé un travail qui la veille au soir était encore inachevé. D’autres font des promenades sur les toits et une foule d’excentricités. Les auteurs ne sont pas encore complètement d’accord sur la nature de ce noctambulisme ; on tend cependant à admettre aujourd’hui que c’est là un ensemble hétéroclite de phénomènes, qui ne se ressemblent qu’en apparence, et qui diffèrent de nature. Parmi les somnambules nocturnes, il faut d’abord faire la part des épileptiques, dont un certain nombre peuvent présenter ce qu’on appelle « l’automatisme ambulatoire ». On admet encore, au moins provisoirement, que des personnes saines peuvent figurer parmi les promeneurs nocturnes, et que par conséquent il existe un noctambulisme physiologique. Mais la majorité, l’immense majorité des somnambules, il n’en faut pas douter, est fournie par l’hystérie ; ce sont des hystériques en état de crise, avec cette particularité que leur attaque a une échéance nocturne.
On peut voir dans ces phénomènes un exemple de dédoublement de la personnalité ; il y a deux personnes chez les noctambules ; la personne qui se lève la nuit est bien distincte de celle qui veille pendant le jour, puisque cette dernière ne sait rien et ne conserve aucun souvenir de ce qui s’est passé pendant la nuit ; mais il serait peu utile de faire une analyse attentive de cette situation, les éléments d’étude en sont trop rares.
Il existe une autre forme de somnambulisme naturel qu’on peut mieux étudier, c’est le somnambulisme qui se manifeste pendant le jour, ou vigilambulisme : c’est celui dont nous nous occuperons exclusivement. On doit distinguer, avons-nous vu plus haut, plusieurs somnambulismes naturels ou spontanés. Les distinctions à établir reposent sur les conditions particulières où ces somnambulismes se produisent et aussi sur les caractères qu’ils présentent. Nous nous attacherons, dans ce chapitre, à une forme de somnambulisme naturel qui offre les caractères suivants : il s’agit de malades hystériques qui présentent, outre leur vie normale et régulière, une autre existence psychologique, ou, comme on dit, une condition seconde, dont ils ne gardent point de souvenir au retour de l’état normal ; le caractère propre de cette condition seconde, c’est qu’elle constitue une existence psychologique complète ; le sujet vit de la vie commune, il a l’esprit ouvert à toutes les idées et à toutes les perceptions, et il ne délire pas. Une personne non prévenue ne saurait pas reconnaître que le sujet est en état de somnambulisme.
Les meilleurs exemples qu’on puisse citer de ce somnambulisme que nous venons de définir, se trouvent dans les observations déjà anciennes d’Azam, de Dufay et de quelques autres médecins. Ces observations sont aujourd’hui bien connues, banales ; elles ont été publiées et analysées dans une foule de recueils médicaux et même purement littéraires ; mais nous espérons que les recherches récentes de psychologie expérimentale sur les altérations de conscience ajouteront quelque chose de nouveau à ces faits anciens ; nous les étudierons à un point de vue un peu différent de celui sous lequel on les a envisagés jusqu’ici, et peut-être arriverons-nous à mieux les comprendre. Considérés tout d’abord comme des phénomènes rares, exceptionnels, comme de véritables curiosités pathologiques, faites pour étonner plutôt que pour instruire, ces dédoublements de la personnalité nous apparaissent maintenant comme le grossissement d’un désordre mental qui est très fréquent dans l’hystérie et dans des états voisins.
Une des observations les plus célèbres est celle de la dame américaine de Mac-Nish : « Une jeune dame instruite, bien élevée, et d’une bonne constitution, fut prise tout à coup et sans avertissement préalable d’un sommeil profond qui se prolongea plusieurs heures au delà du temps ordinaire. À son réveil, elle avait oublié tout ce qu’elle savait, sa mémoire n’avait conservé aucune notion ni des mots ni des choses ; il fallut tout lui enseigner de nouveau ; ainsi, elle dut réapprendre à lire, à écrire et à compter ; peu à peu, elle se familiarisa avec les personnes et avec les objets de son entourage, qui étaient pour elle comme si elle les voyait pour la première fois ; ses progrès furent rapides.
« Après un temps assez long, plusieurs mois, elle fut, sans cause connue, atteinte d’un sommeil semblable à celui qui avait précédé sa vie nouvelle. À son réveil, elle se trouva exactement dans le même état où elle était avant son premier sommeil, mais elle n’avait aucun souvenir de tout ce qui s’était passé pendant l’intervalle ; en un mot, pendant l’état ancien, elle ignorait l’état nouveau. C’est ainsi qu’elle nommait ses deux vies, lesquelles se continuaient isolément et alternativement par le souvenir.
« Pendant plus de quatre ans, cette jeune dame a présenté à peu près périodiquement ces phénomènes. Dans un état ou dans l’autre, elle n’a pas plus de souvenance de son double caractère que deux personnes distinctes n’en ont de leurs natures respectives ; par exemple, dans les périodes d’état ancien, elle possède toutes les connaissances qu’elle a acquises dans son enfance et sa jeunesse ; dans son état nouveau, elle ne sait que ce qu’elle a appris depuis son premier sommeil. Si une personne lui est présentée dans un de ces états, elle est obligée de l’étudier et de la reconnaître dans les deux, pour en avoir la notion complète. Et il en est de même de toute chose.
« Dans son état ancien, elle a une très belle écriture, celle qu’elle a toujours eue, tandis que dans son état nouveau, son écriture est mauvaise, gauche, comme enfantine ; c’est qu’elle n’a eu ni le temps ni les moyens de la perfectionner.
« Cette succession de phénomènes a duré quatre années, et Mme X… était arrivée à se tirer très bien d’affaire, sans trop d’embarras, dans ses rapports avec sa famille. »
Il est inutile de s’attarder dans l’analyse de cette observation incomplète ; le seul avantage qu’elle présente est de nous donner une idée sommaire des altérations de la personnalité que nous cherchons à étudier. On voit de prime abord que ce qui caractérise chacune de ces personnalités, ce qui les distingue les unes des autres, ce qui fait qu’elles sont plusieurs et non une seule, c’est un état particulier de la mémoire. Dans l’état 1, la personne ne se souvient pas de ce qui s’est passé dans l’état 2 ; et, réciproquement, quand elle se retrouve dans l’état 2, elle oublie l’état 1 ; cependant, la mémoire propre à chacun de ces états est bien organisée et en relie toutes les parties, de sorte que la personne, au moment où elle est dans un état, se rappelle l’ensemble des événements qui s’y rattachent.
Nous nous arrêterons plus longtemps sur l’observation de Félida, recueillie par M. Azam (de Bordeaux). L’observation a été très longue, très minutieuse ; elle a commencé en 1858, elle dure encore ; elle s’étend donc sur un espace de plus de trente ans. Nous allons la reproduire presque in extenso.
Félida est née en 1843, à Bordeaux, de parents bien portants. Son développement s’est fait d’une façon régulière. Vers l’âge de treize ans, peu après la puberté, elle a présenté des symptômes dénotant une hystérie commençante, accidents nerveux variés, douleurs vagues, hémorragies pulmonaires, que n’expliquait pas l’état des organes de la respiration.
Bonne ouvrière et d’une intelligence développée, elle travaillait à la journée à des ouvrages de couture.
Vers l’âge de quatorze ans et demi, sans cause connue, quelquefois sous l’empire d’une émotion, Félida éprouvait une douleur aux deux tempes et tombait dans un accablement profond, semblable au sommeil. Cet état durait environ dix minutes. Après ce temps, et spontanément, elle ouvrait les yeux, paraissant s’éveiller, et entrait dans le deuxième état, qu’on est convenu de nommer condition seconde ; il durait une heure ou deux, puis l’accablement et le sommeil reparaissaient et Félida rentrait dans l’état ordinaire.
Cette sorte d’accès revenait tous les cinq ou six jours, ou plus rarement ; ses parents, et les personnes de son entourage, considérant le changement de ses allures pendant cette sorte de seconde vie et son oubli au réveil, la croyaient folle.
Bientôt les accidents de l’hystérie proprement dite s’aggravèrent. Félida eut des convulsions et les phénomènes de prétendue folie devinrent plus inquiétants.
M. Azam fut appelé à lui donner des soins en juin 1858 ; voici ce qu’il constata en octobre de la même année :
Félida est brune, de taille moyenne, assez robuste et d’un embonpoint ordinaire ; elle est sujette à de fréquentes hémoptysies, probablement supplémentaires ; très intelligente et assez instruite pour son état social, elle est d’un caractère triste, même morose ; elle parle peu, sa conversation est sérieuse, sa volonté est très arrêtée et son ardeur au travail très grande. Ses sentiments affectifs paraissent peu développés. Elle pense sans cesse à son état maladif qui lui inspire des préoccupations sérieuses, et souffre de douleurs vives dans plusieurs points du corps, particulièrement à la tête ; le symptôme nommé clou hystérique est chez elle très développé.
On est particulièrement frappé de son air sombre et du peu de désir qu’elle a de parler ; elle répond aux questions, mais c’est tout.
Si on l’examine avec soin au point de vue intellectuel, on trouve ses actes, ses idées et sa conversation parfaitement raisonnables.
Presque chaque jour, sans cause connue, ou sous l’empire d’une émotion, elle est prise de ce qu’elle appelle sa crise ; en fait, elle entre dans son deuxième état ; elle est assise, un ouvrage de couture à la main ; tout d’un coup, sans que rien puisse le faire prévoir, et après une douleur aux tempes plus violente que d’habitude, sa tête tombe sur sa poitrine, ses mains demeurent inactives et descendent inertes le long du corps ; elle dort ou paraît dormir, mais d’un sommeil spécial, car aucun bruit, aucune excitation, pincement ou piqûre, ne saurait l’éveiller ; de plus, cette sorte de sommeil est absolument subit. Il dure deux à trois minutes ; autrefois, il était beaucoup plus long.
Après ce temps, Félida s’éveille, mais elle n’est plus dans l’état intellectuel où elle était quand elle s’est endormie. Tout paraît différent. Elle lève la tête, et ouvrant les yeux, salue en souriant les personnes qui l’entourent, comme si elles venaient d’arriver ; la physionomie, triste et silencieuse auparavant, s’éclaire et respire la gaieté ; sa parole est brève, et elle continue en fredonnant l’ouvrage d’aiguille que dans l’état précédent elle avait commencé ; elle se lève, sa marche est agile et elle se plaint à peine des mille douleurs qui quelques minutes auparavant la faisaient souffrir ; elle vaque aux soins ordinaires du ménage, sort, circule dans la ville, fait des visites, entreprend un ouvrage quelconque, et ses allures et sa gaieté sont celles d’une jeune fille de son âge bien portante ; nul ne saurait trouver quelque chose d’extraordinaire à sa façon d’être. Seulement son caractère est complètement changé ; de triste, elle est devenue gaie et sa vivacité touche à la turbulence ; son imagination est plus exaltée ; pour le moindre motif elle s’émeut en tristesse et en joie ; d’indifférente à tout, elle est devenue sensible à l’excès.
Dans cet état, elle se souvient parfaitement de tout ce qui s’est passé pendant les autres états semblables qui ont précédé et aussi pendant sa vie normale. Il est bon d’ajouter qu’elle a toujours soutenu que l’état, quel qu’il soit, dans lequel elle est au moment où on lui parle, est l’état normal qu’elle nomme sa raison, par opposition à l’autre qu’elle appelle sa crise.
Dans cette vie comme dans l’autre, ses facultés intellectuelles et morales, bien que différentes, sont incontestablement entières : aucune idée délirante, aucune fausse appréciation, aucune hallucination. Félida est autre, voilà tout. On peut même dire que dans ce deuxième état, dans cette condition seconde, comme l’appelle M. Azam, toutes ses facultés paraissent plus développées et plus complètes.
Cette deuxième vie, où la douleur physique ne se fait pas sentir, est de beaucoup supérieure à l’autre ; elle l’est surtout par ce fait considérable que, pendant sa durée, Félida se souvient non seulement de ce qui s’est passé pendant les accès précédents, mais aussi de toute sa vie normale, tandis que pendant sa vie normale, elle n’a aucun souvenir de ce qui s’est passé pendant ses accès.
Après un temps variable, tout à coup la gaieté de Félida disparaît, sa tête se fléchit sur sa poitrine et elle retombe dans un état de torpeur. Trois à quatre minutes s’écoulent et elle ouvre les yeux pour rentrer dans son existence ordinaire. On s’en aperçoit à peine, car elle continue son travail avec ardeur, presque avec acharnement ; le plus souvent c’est un travail de couture entrepris dans la période qui précède ; elle ne le connaît pas, et il lui faut un effort d’esprit pour le comprendre. Néanmoins elle le continue comme elle peut, en gémissant sur sa malheureuse situation ; sa famille, qui a l’habitude de cet état, l’aide à se mettre au courant.
Quelques minutes auparavant elle chantonnait quelque romance ; on la lui redemande ; elle ignore absolument ce qu’on veut dire. On lui parle d’une visite qu’elle vient de recevoir ; elle n’a vu personne. L’oubli ne porte que sur ce qui s’est passé pendant la condition seconde, aucune idée générale acquise antérieurement n’est atteinte, elle sait parfaitement lire, écrire, compter, tailler, coudre, etc., et mille autres choses qu’elle savait avant d’être malade ou qu’elle a apprises pendant ses périodes précédentes d’état normal.
Vers 1858, s’est montré un troisième état qui n’est qu’un épiphénomène de l’accès. M. Azam a vu cet état seulement deux ou trois fois, et pendant seize ans son mari ne l’a observé qu’une trentaine de fois : étant dans sa condition seconde, elle s’endort de la façon déjà décrite, et au lieu de s’éveiller dans l’état normal comme d’habitude, elle se trouve dans un état spécial que caractérise une terreur indicible ; ses premiers mots sont : « j’ai peur… j’ai peur. » Elle ne reconnaît personne, sauf le jeune homme qui est devenu son mari. Cet état quasi délirant dure peu.
La séparation des deux existences est très nette, comme le fait suivant peut le démontrer. Un jeune homme de dix-huit à vingt ans connaissait Félida X… depuis son enfance, et venait dans la maison ; ces jeunes gens ayant l’un pour l’autre une grande affection s’étaient promis le mariage. Pendant sa condition seconde, elle s’abandonne à lui et devient grosse. Dans sa période de vie normale, elle l’ignore.
Un jour, Félida, plus triste qu’à l’ordinaire, dit à son médecin, les larmes dans les yeux, que « sa maladie s’aggrave, que son ventre grossit et qu’elle a chaque matin des envies de vomir » ; en un mot elle lui fait le tableau le plus complet d’une grossesse qui commence ; elle le consulte sur les troubles physiologiques de sa grossesse qu’elle prend pour des maladies. Dans l’accès qui suit de près, Félida dit : « Je me souviens parfaitement de ce que je viens de vous dire, vous avez dû facilement me comprendre, je l’avoue sans détours, … je crois être grosse. » Dans cette deuxième vie, sa grossesse ne l’inquiétait pas, et elle en prenait assez gaiement son parti. Devenue enceinte pendant sa condition seconde, elle l’ignorait donc pendant son état normal et ne le savait que pendant ses autres états semblables. Mais cette ignorance ne pouvait durer ; une voisine devant laquelle elle s’était expliquée fort clairement et qui, plus sceptique qu’il ne convient, croyait que Félida jouait la comédie, après l’accès lui rappela brutalement sa confidence. Cette découverte fit à la jeune fille une si forte impression qu’elle eut des convulsions hystériques très violentes.
À l’âge de dix-sept ans et demi, Félida a fait ses premières couches, et pendant les deux années qui ont suivi, sa santé a été excellente ; aucun phénomène particulier n’a été observé.
Vers dix-neuf ans et demi, les accidents reparaissent avec une moyenne intensité. Un an après, deuxième grossesse très pénible, crachements de sang considérables et accidents nerveux variés, se rattachant à l’hystérie, tels que accès de léthargie qui durent trois et quatre heures.
À ce moment et jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, les accès se sont montrés plus nombreux, et leur durée, qui a d’abord égalé celle des périodes d’état normal, commence à les dépasser. Les hémorragies pulmonaires sont devenues plus fréquentes et plus considérables. Félida a été atteinte de paralysies partielles, d’accès de léthargie, d’extase, etc.
De vingt-quatre à vingt-sept ans, la malade a eu trois années complètes d’état normal, puis la maladie a reparu. Dans l’espace de seize années, Félida a eu onze grossesses à terme ou fausses couches.
La condition seconde, la période d’accès qui en 1858 et 1859 n’occupait qu’un dixième environ de l’existence, a augmenté peu à peu de durée ; elle est devenue égale à la vie normale, puis l’a dépassée pour arriver graduellement à l’état actuel où elle remplit l’existence presque entière.
En 1875, M. Azam, après avoir longtemps perdu de vue Félida, la retrouve mère de famille et dirigeant un magasin d’épicerie ; elle a trente-deux ans ; elle n’a que deux enfants vivants. Elle est amaigrie, sans avoir l’aspect maladif. Elle a toujours des absences de mémoire qu’elle nomme improprement des crises.
Seulement ces prétendues crises, qui ne sont, après tout, que les périodes d’état normal, sont devenues beaucoup plus rares. L’absence des souvenirs qui les caractérise lui a fait commettre de telles bévues dans ses rapports avec des voisines que Félida en a conservé le plus pénible souvenir, et craint d’être considérée comme folle. Elle est très malheureuse quand elle pense à sa condition normale, aussi parfois elle a des idées de suicide. Elle reconnaît que, dans ces moments, son caractère se modifie beaucoup : elle devient, dit-elle, méchante et provoque dans son intérieur des scènes violentes.
Elle raconte certains épisodes qui montrent bien la raison de son tourment. Un jour qu’elle revenait en fiacre des obsèques d’une dame de sa connaissance, elle sent venir la période qu’elle nomme son accès (état normal), elle s’assoupit pendant quelques secondes, sans que les dames qui étaient avec elle dans le fiacre s’en aperçoivent, et s’éveille dans l’autre état, ignorant absolument pourquoi elle était dans une voiture de deuil, avec des personnes qui, selon l’usage, vantaient les qualités d’une défunte dont elle ne savait pas le nom. Habituée à ces situations, elle attendit ; par des questions adroites, elle se fit mettre au courant, et personne ne put se douter de ce qui s’était passé.
Elle perd sa belle-sœur à la suite d’une longue maladie. Or, pendant les quelques heures de son état normal, elle a eu le chagrin d’ignorer absolument toutes les circonstances de cette mort ; à ses habits de deuil seulement, elle a reconnu que sa belle-sœur, qu’elle savait malade, avait succombé.
Ses enfants ont fait leur première communion pendant qu’elle était en condition seconde ; elle a aussi le chagrin de l’ignorer pendant la période d’état normal.
Il est survenu une certaine différence dans la situation de la malade. Autrefois Félida perdait entièrement connaissance pendant les courtes périodes de transition ; cette perte était même si complète qu’un jour, en 1859, elle tomba dans la rue et fut ramassée par des passants. Après s’être réveillée dans son autre état, elle les remercia en riant, et ceux-ci ne purent naturellement rien comprendre à cette singulière gaieté. Cette période de transition a peu à peu diminué de longueur, et bien que la perte de connaissance soit aussi complète, elle est tellement courte, que Félida peut la dissimuler en quelque lieu qu’elle se trouve. Certains signes à elle connus, tels qu’une pression aux tempes, lui indiquent la venue de ces périodes. Dès qu’elle les sent venir, elle porte la main à la tête, se plaint d’un éblouissement, et après une durée de temps insaisissable, elle passe dans l’autre état. Elle peut ainsi dissimuler ce qu’elle nomme une infirmité. Or cette dissimulation est si complète, que dans son entourage son mari seul est au courant de son état du moment.
Les variations de caractère sont très accusées. Dans la période d’accès ou de condition seconde elle est plus fière, plus insouciante, plus préoccupée de sa toilette ; de plus elle est moins laborieuse, mais beaucoup plus sensible ; il semble que dans cet état elle porte à ceux qui l’entourent une plus vive affection.
Dans son état normal, elle est d’une tristesse qui touche au désespoir. Sa situation est en effet fort triste, car tout est oublié, affaires, circonstances importantes, connaissances faites, renseignements donnés. C’est une vaste lacune impossible à combler. Le souvenir n’existe que pour les faits qui se sont passés dans les conditions semblables. Onze fois Félida a été mère. Toujours cet acte physiologique de premier ordre, complet ou non, s’est accompli pendant l’état normal. Si on lui demande à brûle-pourpoint la date de ce jour, elle cherche et se trompe de près d’un mois.
On lui avait donné un petit chien, qui s’habitua à elle et la caressait chaque jour. Après quelque temps, survient une période de vie normale ; à son réveil dans cette vie, ce chien la caresse, elle le repousse avec horreur, elle ne le connaît pas, elle ne l’a jamais vu : c’est un chien errant entré par hasard chez elle.
Les sentiments affectifs ne sont plus de la même nature dans les deux conditions. Félida est indifférente et manifeste peu d’affection pour ceux qui l’entourent ; elle se révolte devant l’autorité naturelle qu’a son mari sur elle.
« Il dit sans cesse : Je veux, dit-elle ; cela ne me convient pas, il faut que dans mon autre état je lui aie laissé prendre cette habitude. Ce qui me désole, ajoute-t-elle, c’est qu’il m’est impossible d’avoir rien de caché pour lui, quoiqu’en fait je n’aie rien à dissimuler de ma vie. Si je le voulais, je ne le pourrais pas. Il est bien certain que dans mon autre vie je lui dis tout ce que je pense. » De plus son caractère est plus hautain, plus entier.
Ce qui la touche particulièrement, c’est l’incapacité relative qu’amènent les absences de mémoire, surtout en ce qui touche son commerce. « Je fais erreur sur la valeur des denrées dont j’ignore le prix de revient, et suis contrainte à mille subterfuges, de peur de passer pour une idiote ! »
Il est plusieurs fois arrivé que, s’endormant le soir dans son état normal, elle s’est éveillée le matin dans l’accès, sans que ni elle ni son mari en aient eu connaissance ; la transition a donc eu lieu pendant le sommeil.
Félida dort comme tout le monde et au moment ordinaire, seulement son sommeil est toujours tourmenté par des rêves ou des cauchemars ; de plus il est influencé par des douleurs physiques ; ainsi elle rêve souvent d’abattoirs et d’égorgements. Souvent aussi elle se voit chargée de chaînes ou liée avec des cordes qui brisent ses membres. Ce sont ses douleurs musculaires ordinaires qui se transforment ainsi.
On sait quel rôle jouent les habitudes dans l’existence. Félida conserve-t-elle, pendant ces courtes périodes d’état normal, alors qu’elle paraît avoir tout oublié, des habitudes acquises pendant la condition seconde ? M. Azam a remarqué que pendant les courtes périodes d’état normal, Félida a oublié les heures des repas ; or, prendre sa nourriture chaque jour à la même heure, paraît être une habitude.
En 1877, Félida a trente-quatre ans. Elle vit en famille avec son mari et les deux enfants qui lui restent. À la suite de circonstances diverses, elle a repris son ancien métier de couturière et dirige un petit atelier. Sa santé générale est déplorable, car elle souffre de névralgies, d’hémorragies, de contractures, de paralysies locales, etc. ; elle est cependant fort courageuse, surtout dans la condition seconde, où ses douleurs ont, du reste, une moindre intensité.
La période de transition qui fait entrer Félida en condition seconde est de plus en plus courte. Bien que Félida soit devenue plus habile à la dissimuler, la perte de connaissance est complète. Dans ces derniers temps, dit M. Azam, sur ma demande, son mari a constaté, comme je l’avais fait antérieurement, qu’elle y était toujours absolument étrangère à toute action extérieure.
La veille et le sommeil sont normaux, et les accidents décrits surviennent indifféremment dans les deux états.
Comme la condition seconde constitue maintenant la vie presque entière de Félida, on y peut observer à loisir divers phénomènes hystériques d’une grande rareté. Ce sont des congestions spontanées et partielles. À un moment donné, sans cause appréciable, et tous les trois à quatre jours, Félida ressent une sensation de chaleur en un point quelconque du corps ; cette partie gonfle et rougit. Cela se passe souvent à la face, alors le phénomène est frappant, mais le tégument externe est trop solide pour se prêter à l’exsudation sanguine : une fois seulement, un suintement de cette nature a eu lieu pendant la nuit au travers de la peau de la région occipitale, reproduisant les stigmates saignants.
En 1878, Félida est, au premier abord, semblable à tout le monde ; cette ressemblance est si grande que, devenue très habile à dissimuler son amnésie et les troubles qui l’accompagnent, elle cache très bien une infirmité dont elle a honte. Couturière et mère de famille, elle remplit à la satisfaction de tous ses obligations et ses devoirs. D’une bonne constitution, elle n’est qu’amaigrie par des douleurs nerveuses, par de fréquentes hémorragies pulmonaires ou autres.
Dans sa condition seconde, elle est à peu près comme tout le monde. Enjouée et d’un heureux naturel, elle souffre peu ; son intelligence et toutes ses fonctions cérébrales, y compris la mémoire, sont parfaitement complètes.
Un jour, le plus souvent quand elle a eu quelque chagrin, elle éprouve à la tête une sorte de serrement, une sensation à elle connue, qui lui annonce son prochain changement d’état. Alors elle écrit ; si on lui demande l’explication de cet acte, elle répond : « Comment ferais-je, si je n’écrivais pas ce que j’aurai à faire ? Je suis couturière ; j’ai sans cesse à travailler d’après des mesures déterminées ; j’aurais l’air d’une imbécile auprès de mon entourage, si je ne savais pas les dimensions exactes des manches et des corsages que j’ai à tailler. » Bientôt, Félida est prise d’une perte de connaissance complète, mais tellement courte (une fraction de seconde) qu’elle peut la dissimuler à tous. À peine ferme-t-elle les yeux, puis elle revient à elle et continue sans mot dire l’ouvrage commencé.
Alors elle consulte son écrit pour ne pas commettre des erreurs qu’elle redoute ; mais elle est en quelque sorte une autre personne, car elle ignore absolument tout ce qu’elle dit, tout ce qu’elle fait, tout ce qui s’est passé pendant la période précédente, celle-ci eût-elle duré deux ou trois ans. Cette autre vie, c’est l’état normal, c’est la personnalité, le naturel qui caractérisaient Félida à l’âge de quatorze ans, avant toute maladie.
Cette période, qui n’occupe aujourd’hui qu’un trentième ou un quarantième de l’existence, ne diffère de ces périodes précédentes que par le caractère. Alors Félida est morose, désolée ; elle se sent atteinte d’une infirmité intellectuelle déplorable, et elle en éprouve un chagrin qui va jusqu’au désespoir et jusqu’au désir du suicide. Après quelques heures, aujourd’hui, survient une période de transition et notre jeune femme rentre dans la période seconde qui constitue presque toute son existence.
Un fait spécial, un drame intime, donne la mesure de la profondeur de la séparation que creuse l’absence de souvenir entre les deux existences de Félida, c’est comme un abîme :
Au mois d’avril 1878, étant en condition seconde, Félida croit avoir la certitude que son mari a une maîtresse ; elle se répand en menaces contre elle ; prise d’un affreux désespoir, elle se pend. Mais ses mesures sont mal prises, ses pieds renversent une table, les voisins accourent et on la rappelle à la vie. Cette épouvantable secousse n’a rien changé à son état. Elle s’est pendue en condition seconde, en condition seconde elle se retrouve. « Comme je serais heureuse, disait-elle deux jours après, si j’avais ma crise (c’est ainsi qu’elle désigne ses courtes périodes de vie normale) ; alors au moins j’ignore mon malheur. » Elle l’ignore, en effet, si bien que pendant les périodes suivantes d’état normal, rencontrant cette femme, elle la comble de prévenances et de marques d’amitié.
En 1882, Félida vit à peu près toujours en condition seconde ; la vie normale, avec sa perte de souvenir si caractéristique, n’apparaît plus qu’à des intervalles de quinze jours à trois semaines et ne dure que quelques heures ; les périodes de transition, qui ne duraient que quelques minutes, se sont réduites à quelques secondes ou à une durée si inappréciable que Félida, qui veut que son entourage ignore sa maladie, peut les dissimuler complètement. Après quinze jours, un mois, deux mois, apparaissent de courtes périodes de vie normale précédées et suivies de transitions inappréciables. Leur apparition est quelquefois spontanée, mais elle est le plus souvent provoquée par une contrariété quelconque ; les apparitions spontanées ont surtout lieu la nuit.
Dans les premières années de la maladie, la vie ordinaire de Félida était tourmentée par des manifestations douloureuses des plus pénibles, et son caractère était triste, même sombre et taciturne. Cette tristesse, à un moment, a été telle que la malade a tenté de se suicider, tandis que, par opposition, les périodes de condition seconde étaient caractérisées par l’absence des douleurs et par une grande gaieté. En un mot, Félida avait, en même temps que deux existences, deux caractères absolument différents. Petit à petit, soit sous l’influence des années et des épreuves de la vie, soit par toute autre cause, les conditions secondes, qui sont devenues la vie à peu près entière, n’ont plus présenté ni gaieté ni liberté d’esprit, mais la gravité et le sérieux de toute personne raisonnable. On peut dire que les deux caractères se sont égalisés et comme fondus l’un dans l’autre.
Enfin, en 1887, Félida a quarante-quatre ans ; son état est le même qu’en 1882, les périodes de vie normale deviennent de plus en plus rares.
On peut en résumé retenir de l’observation précédente les faits suivants : L’altération de la personnalité présentée par Félida est sous la dépendance de la névrose hystérique ; cela est incontestable ; Félida a présenté un si grand nombre de phénomènes hystériques, tels que le clou, les hémoptysies, les altérations de la sensibilité, les convulsions, les attaques de léthargie, qu’on ne saurait conserver de doute à cet égard. De temps en temps, la malade change de condition mentale, on peut même dire de personnalité ; la transition ne se fait pas insensiblement, mais toujours avec une perte de connaissance. Au début, il se produisait un sommeil profond pendant lequel la malade ne sentait aucune excitation ; ce sommeil s’est abrégé avec le temps, mais il reste toujours une perte de connaissance, qui creuse l’abîme entre les deux existences. Il est à noter qu’il n’y a jamais eu de convulsions au moment du passage, bien que Félida ait eu à d’autres occasions des attaques d’hystérie convulsive.
En se réveillant dans sa condition nouvelle, la malade est devenue une autre personne. Son caractère est changé ; il était triste, morose, pendant sa condition normale ; il devient plus tendre, plus gai, plus affectueux ; en revanche, la malade est moins active, moins travailleuse. Son intelligence est plus développée, et sa sensibilité paraît plus délicate (malheureusement, ce point important n’a pas été examiné avec un soin suffisant). À la modification du caractère s’ajoute une modification de la mémoire ; pendant la condition seconde, Félida conserve le souvenir de tous ses états, et de tous les faits appartenant aux deux existences ; c’est à ce moment que sa mémoire présente le maximum d’étendue. Puis, à un certain moment, il survient brusquement une nouvelle perte de connaissance semblable à la première ; la malade repasse dans la première condition ; elle retrouve son caractère triste et son activité, et, en même temps, elle présente une perte de mémoire bien curieuse : elle ne peut se rappeler les faits appartenant à sa condition seconde, et nous avons vu les nombreuses conséquences, si pénibles pour elle, de cette amnésie périodique.
La distinction des deux conditions mentales repose donc sur deux éléments principaux, un changement de caractère et une modification de la mémoire ; c’est ce qui fait que Félida est réellement deux personnes morales, et qu’elle a réellement deux moi ; son second moi n’est point un moi factice, inventé dans une intention purement littéraire, pour faire image ; il est parfaitement bien organisé, capable de lutter contre le premier moi, capable même de le remplacer, puisque nous voyons aujourd’hui cette malade continuer son existence avec ce second moi qui, d’abord accidentel et anormal, constitue maintenant le centre régulier de sa vie psychique.
Il nous reste, en terminant, à indiquer avec précision le problème psychologique posé par l’histoire de Félida ; voilà deux vies mentales qui se déroulent alternativement, sans se confondre ; chacune de ces existences consiste dans une série d’événements psychologiques liés les uns aux autres ; si Félida se trouve dans l’état prime, elle peut se rappeler les événements de cet état ; au contraire il lui est impossible, sans l’aide d’autrui, de retrouver le souvenir des événements appartenant à l’état second. Pourquoi ? Cette amnésie ne s’explique point psychologiquement par les lois si bien étudiées de l’association des idées. D’après ces lois, tous les souvenirs peuvent se réveiller par l’action de la ressemblance et de la contiguïté ; nous voyons ici ces deux forces d’association en défaut ; les souvenirs de la condition seconde ne reparaissent pas pendant la condition normale, alors même qu’ils pourraient être évoqués par les associations d’idées les plus efficaces ; nous n’en voulons pour preuve que ce petit chien, que Félida comble de caresses pendant la seconde vie et ne reconnaît pas pendant la première. On n’a pas suffisamment remarqué, croyons-nous, combien cette amnésie caractéristique est contraire aux idées reçues sur l’association des idées. Il est de fait qu’entre les deux synthèses mentales constituant les deux existences de Félida, l’association d’idées ne joue plus.
Nous aurons souvent l’occasion de répéter cette remarque.
M. Dufay, de Blois, a publié une observation sur une malade analogue à la précédente. Nous citerons les passages les plus intéressants de cette observation.
« C’est vers 1845 que je commençai à être témoin des accès de somnambulisme de Mlle R. L., et j’eus pendant une douzaine d’années l’occasion à peu près quotidienne d’étudier ce phénomène si bizarre. Mlle R. L. pouvait avoir alors vingt-huit ans environ. Grande, maigre, cheveux châtains, d’une bonne santé habituelle, d’une susceptibilité nerveuse excessive, Mlle R. L. était somnambule depuis son enfance. Ses premières années se passèrent à la campagne, chez ses parents ; plus tard elle entra successivement en qualité de lectrice ou demoiselle de compagnie dans plusieurs familles riches, avec lesquelles elle voyagea beaucoup ; puis enfin elle choisit un état sédentaire et se livra au travail d’aiguille.
« Une nuit, pendant qu’elle était encore chez ses parents, elle rêve qu’un de ses frères vient de tomber dans un étang du voisinage ; elle s’élance de son lit, sort de la maison et se jette à la nage pour secourir son frère. C’était au mois de février ; le froid la saisit ; elle s’éveille saisie de terreur, est prise d’un tremblement qui paralyse tous ses efforts ; elle allait périr si l’on n’était arrivé à son secours. Pendant quinze jours la fièvre la retint au lit. À la suite de cet événement, les accès de somnambulisme cessèrent pendant plusieurs années. Elle rêvait à haute voix, riait ou pleurait, mais ne quittait plus son lit. Puis, peu à peu, les pérégrinations nocturnes recommencèrent, d’abord rares, ensuite plus fréquentes, et enfin quotidiennes.
« Je remplirais un volume du récit des faits et gestes accomplis par Mlle R. L. pendant ce sommeil actif. Je me bornerai à ce qui est indispensable pour faire connaître son état.
« Je copie sur mes notes :
« Sa mère est l’objet fréquent de ses rêves. Elle veut partir pour son pays, fait ses paquets en grande hâte, « car la voiture l’attend » ; elle court faire ses adieux aux personnes de la maison, non sans verser d’abondantes larmes ; s’étonne de les trouver au lit, descend rapidement l’escalier et ne s’arrête qu’à la porte de la rue, dont on a eu soin de cacher la clé, et près de laquelle elle s’affaisse, désolée, résistant longtemps à la personne qui l’engage à remonter se coucher, et se plaignant amèrement « de la tyrannie dont elle est victime ». Elle finit, mais pas toujours, par rentrer dans son lit, le plus souvent sans s’être complètement déshabillée, et c’est ce qui lui indique, au réveil, qu’elle n’a pas dormi tranquille, car elle ne se rappelle rien de ce qui s’est passé pendant l’accès.
« Voilà le somnambulisme tel qu’on l’observe assez fréquemment. C’est un rêve en action commencé pendant le sommeil normal, et se terminant par un réveil, soit spontané, soit provoqué.
« Mais ce n’est pas ce qui arrivait le plus ordinairement pour Mlle R. L.
« Je copie encore : « Il est huit heures du soir ; plusieurs ouvrières travaillent autour d’une table sur laquelle est posée une lampe ; Mlle R. L. dirige les travaux, et y prend elle-même une part active, non sans causer avec gaieté. Tout à coup, un bruit se fait entendre ; c’est son front qui vient de tomber brusquement sur le bord de la table, le buste s’étant ployé en avant. Voilà le début de l’accès.
« Elle se redresse après quelques secondes, arrache avec dépit ses lunettes et continue le travail qu’elle avait commencé, n’ayant plus besoin des verres concaves qu’une myopie considérable lui rend nécessaires dans l’état normal, et se plaçant même de manière à ce que son ouvrage soit moins exposé à la lumière de la lampe. A-t-elle besoin d’enfiler son aiguille, elle plonge ses deux mains sous la table, cherchant l’ombre, et réussit en moins d’une seconde à introduire la soie dans le chas, ce qu’elle ne fait qu’avec difficulté lorsqu’elle est à l’état normal, aidée de ses lunettes et d’une vive lumière.
« Elle cause en travaillant, et une personne qui n’a pas été témoin du commencement de l’accès pourrait ne s’apercevoir de rien, si Mlle R. L. ne changeait de façon de parler dès qu’elle est en somnambulisme.
« Alors, elle parle nègre, remplaçant je par moi, comme les enfants ; ainsi elle dit : quand moi est bête. Cela signifie : quand je ne suis pas en somnambulisme.
« Son intelligence, déjà plus qu’ordinaire, acquiert pendant l’accès un développement remarquable ; sa mémoire devient extraordinaire, et Mlle R. L. peut raconter les moindres événements dont elle a eu connaissance à une époque quelconque, que les faits aient eu lieu pendant l’état normal ou pendant un accès de somnambulisme.
« Mais, de ces souvenirs, tous ceux relatifs aux périodes de somnambulisme se voilent complètement dès que l’accès a cessé, et il m’est souvent arrivé d’exciter chez Mlle R. L. un étonnement allant jusqu’à la stupéfaction, en lui rappelant des faits entièrement oubliés de la fille bête, suivant son expression, que la somnambule m’avait fait connaître.
« La différence de ces deux manières d’être est on ne peut plus tranchée.
« Mlle R. L. a été débarrassée de sa personnalité anormale à l’époque de la ménopause. »
On voit que Mlle R. L. a deux personnalités ; elle a même conscience de ce dualisme, car elle parle de l’autre à la troisième personne, et elle ignore dans son état premier ce que cet autre a fait dans l’état second. Le reste de l’observation n’a d’autre intérêt que d’être une répétition et par conséquent une confirmation de celle de Félida.
II
Il a été souvent question, dans ces dernières années, de Louis V…, hystérique mâle qui a présenté de curieuses successions de personnalité. Nous extrayons les renseignements suivants de l’ouvrage de MM. Bourru et Burot.
« L’histoire de Louis V…, disent-ils, est déjà connue dans la science. M. Camuset, l’a racontée le premier, et après lui, M. Ribot, M. Legrand du Saulle, M. P. Richer, en ont parlé ; M. J. Voisin a fait deux importantes communications sur ce malade.
« Né à Paris, rue Jean-Bart, no 6, le 12 février 1863, de mère hystérique et de père inconnu, il a passé une partie de son enfance à Luysan, près de Chartres ; sa mère le maltraitait et il était devenu vagabond. Il paraît avoir eu dès son bas âge des crises d’hystérie accusées par des crachements de sang et des paralysies passagères. Le 23 octobre 1871, il est condamné pour vol domestique à la détention dans une maison de correction jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Il est envoyé à la colonie des Douaires, puis dirigé sur la colonie agricole de Saint-Urbain (Haute-Marne), où il reste du 27 septembre 1873 au 23 mars 1880. Occupé plusieurs années à des travaux agricoles, il reçoit en même temps l’instruction primaire dont il profite très bien, car il est docile et intelligent. Un jour, pendant qu’il est occupé dans une vigne à ramasser des sarments, une vipère s’enroule autour de son bras gauche, sans le mordre. Il en eut une frayeur extrême et le soir, rentré à la colonie, il perdit connaissance et eut des crises. Les attaques se renouvelèrent ; il survint enfin une paralysie des membres inférieurs, l’intelligence restant intacte.
« En mars 1880, il fut transféré à l’asile de Bonneval (Eure-et-Loir). Là, on constate que le malade a la physionomie ouverte et sympathique, que son caractère est doux, qu’il se montre reconnaissant des soins qu’on a pour lui. Il raconte l’histoire de sa vie avec les détails les plus circonstanciés, même ses vols qu’il déplore, dont il est honteux ; il s’en prend à son abandon, à ses camarades qui l’entraînaient au mal. Il regrette fort ce passé et affirme qu’à l’avenir il sera plus honnête. Il sait lire, écrire à peu près. On se décide à lui apprendre un état compatible avec sa paraplégie, son infirmité. On le porte tous les matins à l’atelier des tailleurs ; on l’installe sur une table où il prend naturellement la posture classique, grâce à la position de ses membres inférieurs paralysés et contracturés. Au bout de deux mois, V… sait coudre assez bien ; il travaille avec zèle, on est satisfait de ses progrès. Un jour, il est pris d’une crise qui dure cinquante heures, à la suite de laquelle il n’est plus paralysé. Au réveil, V… veut se lever. Il demande ses habits, et il réussit à se vêtir, tout en étant fort maladroit ; puis il fait quelques pas dans la salle ; la paralysie des jambes a disparu.
« Une fois habillé, il demande à aller avec ses camarades aux travaux de culture. On s’aperçoit vite qu’il se croit encore à Saint-Urbain, et qu’il veut reprendre ses occupations habituelles. En effet, il n’a aucun souvenir de sa crise et il ne reconnaît personne, pas plus le médecin et les infirmiers que ses camarades du dortoir. Il n’admet pas avoir été paralysé et dit qu’on se moque de lui. On pense à un état vésanique passager très supposable après une forte attaque hystérique, mais le temps s’écoule et la mémoire ne revient pas. V… se rappelle bien qu’il a été envoyé à Saint-Urbain, il sait que l’autre jour, il a eu peur d’un serpent, mais à partir de ce moment il y a une lacune. Il ne se rappelle plus rien. Il n’a pas même le sentiment du temps écoulé.
« Naturellement on pense à une simulation, à un tour d’hystérique, et on emploie tous les moyens pour le mettre en contradiction avec lui-même, mais sans jamais y parvenir. Ainsi on le fait conduire sans le prévenir à l’atelier des tailleurs. On marche à côté de lui, en ayant soin de ne pas l’influencer. Quant à la direction à suivre, V… ne sait pas où il va. Arrivé à l’atelier, il a tout l’air d’ignorer l’endroit où il se trouve et il affirme qu’il y vient pour la première fois. On lui montre les vêtements dont il a fait les grosses coutures alors qu’il était paralysé ; il rit, a l’air de douter, mais enfin il se résigne à croire.
« Après un mois d’expériences, d’observations, d’épreuves de toutes sortes, on reste convaincu que V… ne se souvient de rien. Le caractère s’est aussi modifié. Ce n’est plus le même sujet, il est devenu querelleur, gourmand et il répond impoliment. Il n’aimait pas le vin et donnait le plus souvent sa ration à ses camarades, maintenant il vole la leur. Quand on lui dit qu’il a volé autrefois, mais qu’il ne devrait pas recommencer, il devient arrogant : « S’il a volé, il l’a payé puisqu’on l’a mis en prison. » On l’occupe au jardin. Un jour, il s’évade emportant des effets et soixante francs à un infirmier. Il est rattrapé à cinq lieues de Bonneval au moment où, après avoir vendu ses vêtements pour en acheter d’autres, il s’apprête à prendre le chemin de fer pour Paris. Il ne se laisse pas arrêter facilement ; il frappe et mord les gardiens envoyés à sa recherche. Ramené à l’asile, il devient furieux, il crie, se roule à terre. Il faut le mettre en cellule.
« Pendant le reste de son séjour à Bonneval, il continue à présenter quelques manifestations névrosiques, attaques convulsives, anesthésies et contractures passagères. Il sort de cet asile le 24 juin 1881 ; il paraît guéri.
« Il passe quelque temps à Chartres chez sa mère, puis on l’envoie aux environs de Mâcon, chez un grand propriétaire agricole. Il tombe malade, reste un mois à l’Hôtel-Dieu de Mâcon et est transféré à l’asile Saint-Georges, près de Bourg (Ain), le 9 septembre 1881.
« Pendant ses dix-huit mois de séjour dans cet asile, il a présenté des crises qui n’avaient aucune régularité, souvent très fortes, parfois légères, d’autres fois survenant par séries ; tantôt il était exalté comme un paralytique général, tantôt presque stupide et imbécile. Dans certains cas, il n’a reculé devant aucune responsabilité, obéissant à ses instincts et à ses impulsions les plus dangereuses, sachant habilement les couvrir de sa qualité de fou dont il se parait et de son irresponsabilité matérielle qui résultait de son internement dans un asile d’aliénés. V… est sorti de Saint-Georges, le 28 avril 1883, amélioré et muni d’un pécule pour rentrer dans son pays.
« Il arrive à Paris, on ne sait comment ; il est admis successivement dans plusieurs services, en dernier lieu à Sainte-Anne et enfin à Bicêtre où il entre le 31 août 1883 dans le service de M. J. Voisin qui le reconnaît comme étant le sujet de M. Camuset, sans savoir ce qu’il était devenu entre Bonneval et Bicêtre.
« Du mois d’août 1883 au mois de janvier 1884, ses attaques sont rares et observées seulement par les surveillants. Le 17 janvier 1884, nouvelle attaque très violente qui se répète les jours suivants avec accès de thoracalgie et alternatives de paralysies et de contractures du côté gauche et du côté droit. Le 17 avril, à la suite d’une crise légère, la contracture du côté droit a disparu. Il s’est endormi, le corps plié, les mains derrière la tête et a tranquillement sommeillé. Le matin, il se réveille et demande ses habits à l’infirmier. Il veut aller travailler. Il s’étonne que ses vêtements ne soient pas au pied de son lit ; il s’imagine qu’on vient de les lui cacher par plaisanterie. Il se croit au 26 janvier (jour d’apparition de sa contracture). On l’amène auprès du chef de son service. Il reste ébahi quand on lui fait remarquer que les feuilles sont aux arbres, que le calendrier marque 17 avril, que le personnel du service est modifié. L’élocution est normale. Il ne se souvient pas d’avoir été contracturé du côté droit. Il est faible sur ses jambes et se dandine en voulant se tenir debout. La pression dynamométrique de la main droite est plus faible que celle de la main gauche. L’hémianesthésie sensitivo-sensorielle persiste.
« Les mois suivants, il est calme et se promène dans la section. Le 10 juin, le malade a une série de crises et à leur suite la contracture du côté droit est revenue. Il est resté plusieurs jours au lit, dans l’état où il était, du mois de janvier au mois d’avril. Il se croyait au 17 avril. Il parlait impersonnellement comme alors. Le lendemain la contracture avait disparu et le sujet était revenu à son état primitif.
« Pendant les six derniers mois de l’année 1884, V… n’a présenté aucun phénomène nouveau. Son caractère est modifié. Il était doux pendant la période de contracture ; en dehors de ces périodes il est indiscipliné, taquin, voleur. Il travaille irrégulièrement. Les attaques sont toujours assez fréquentes. La contracture ne reparaît pas une seule fois, mais l’hémianesthésie conserve son caractère de stigmate indélébile. V… garde quelques idées délirantes. Le 2 janvier 1885, après une scène de somnambulisme provoqué, suivie d’une attaque, il s’évade de Bicêtre en volant des effets d’habillement et de l’argent à un infirmier, comme lors de son évasion de Bonneval.
« Il reste plusieurs semaines à Paris, en compagnie d’un ancien compagnon d’asile dont il avait fait la rencontre. Le 29 janvier 1885, il se fait engager dans l’infanterie de marine et arrive à Rochefort le 31 janvier. Pendant son séjour à la caserne il commet des vols. Envoyé devant le conseil de guerre, une ordonnance de non-lieu est prononcée le 23 mars 1885, et le 27 mars, il entre en observation. Dès son entrée, il est pris d’une série d’attaques d’hystéro-épilepsie. Le 30 mars, il présente une contracture de tout le côté droit, qui se dissipe au bout de deux jours, mais il reste paralysé et insensible de toute la moitié droite du corps. »
L’observation de Louis V… est certainement la plus complexe et la plus riche en détails que nous possédions, bien qu’elle contienne quelques parties obscures. Un premier fait s’en dégage, c’est qu’à certains moments, Louis V… perd brusquement le souvenir de périodes importantes de son existence antérieure et entre dans un nouvel état psychologique où il change totalement de caractère, et où la distribution de la sensibilité et du mouvement se fait dans son corps d’une façon tout à fait différente. L’état nouveau se distingue donc du précédent par trois signes principaux : 1o l’état de la mémoire ; 2o l’état du caractère ; 3o l’état de la sensibilité et du mouvement. Ce dernier point est un de ceux qui constituent l’originalité de l’observation de ce malade ; chez les autres hystériques dont on a rapporté l’histoire jusqu’ici, on n’a point étudié les changements de sensibilité qui se rapportent aux changements d’état psychologique. M. Azam y fait à peine allusion, en ce qui concerne Félida ; il passe rapidement, tandis qu’on aurait désiré une étude méthodique. Le cas de Louis V… remplit donc une lacune importante dans nos connaissances ; probablement, il ne présente rien d’exceptionnel à cet égard, et tous les malades qui ont des états seconds doivent présenter comme lui des modifications sensitivo-sensorielles qui sont le signal du passage dans un nouvel état. Cela est nécessaire, logique : du moment que le caractère se modifie, et que la mémoire change d’amplitude, il est naturel que la faculté de percevoir des sensations soit également atteinte ; c’est le contraire qui nous étonnerait.
Les auteurs ont profité de ces variations de la sensibilité pour faire une série de recherches expérimentales sur leur sujet ; ils sont parvenus à provoquer en quelque sorte à volonté telle ou telle des personnalités de leur malade, ce qu’on n’avait pas encore obtenu jusque-là dans la même mesure, et avec autant de méthode. C’est là en somme le grand intérêt de cette observation, et ce qu’elle nous a appris de plus nouveau. Nous y reviendrons dans la partie de ce livre qui est consacrée aux phénomènes expérimentaux.
Il reste à définir et à classer l’état pathologique de V… On a comparé ce cas à celui de Félida ; cette comparaison est justifiée par bien des faits, et les analogies sont frappantes ; il y a des changements d’état psychologique, marqués par le caractère et la mémoire ; sans doute, ces états sont plus nombreux chez V…, on en a même compté jusqu’à six, qui ont chacun leur mémoire propre, comme l’expérimentation sur le malade a permis de le montrer ; mais cette question de chiffre n’a point une importance générale, et du reste il a existé chez Félida au moins trois états distincts.
M. Proust a publié récemment un cas curieux d’automatisme ambulatoire chez un hystérique. Voici son observation :
« Émile X…, trente-trois ans ; fils d’un père original et buveur ; mère nerveuse, un frère cadet rentrant dans la catégorie des arriérés. Lui, au contraire, est d’une intelligence assez vive. Il a fait de bonnes études classiques et remporté même des succès dans les concours académiques. Après avoir étudié la médecine pendant quelques mois, il est passé à l’étude du droit, s’est fait recevoir licencié, et, depuis quelques années, il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats à Paris.
« Émile X… a présenté les signes les plus manifestes de la grande hystérie (attaques, troubles de sensibilité, de motilité, etc., etc.). Il est presque instantanément hypnotisable. Il suffit qu’il fixe un point dans l’espace, qu’il entende un bruit un peu fort, qu’il éprouve une impression vive et subite pour que, aussitôt, il tombe dans le sommeil hypnotique. Il était, un jour, au café, place de la Bourse. Il se regarde à la glace. Immédiatement il s’endort. Étonnées et effrayées les personnes avec lesquelles il se trouvait le conduisirent à l’hôpital de la Charité où on le réveilla.
« Une autre fois, au Palais, pendant qu’il plaide, le président le regarde fixement. Il s’arrête court, s’endort, et ne peut reprendre sa plaidoirie que lorsqu’un de ses confrères, qui connaît son infirmité, l’a éveillé.
« Mais ce n’est pas tout.
« À certains moments, Émile X… perd complètement la mémoire. Alors, tous ses souvenirs, les plus récents comme les plus anciens, sont abolis. Il a complètement oublié son existence passée. Il s’est oublié lui-même. Cependant, comme il n’a pas perdu la conscience, et que, pendant toute la durée de cette sorte d’état de condition seconde, — qui peut se prolonger pendant quelques jours, — il aura, comme dit Leibniz, « l’aperception de ses perceptions », une nouvelle vie, une nouvelle mémoire, un nouveau moi commencent pour lui. Alors il marche, monte en chemin de fer, fait des visites, achète, joue, etc.
« Quand, subitement, par une façon de réveil, il revient à sa condition première, il ignore ce qu’il a fait pendant les jours qui viennent de s’écouler, c’est-à-dire pendant tout le temps de sa condition seconde.