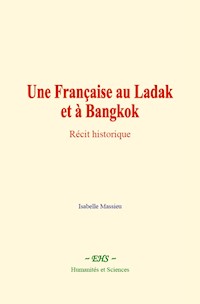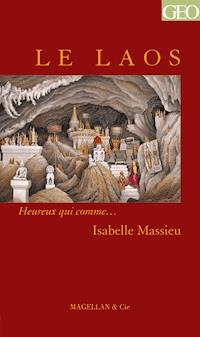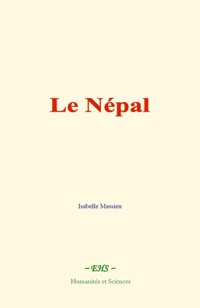
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Il est des pays qui nous hantent, nous fascinent, nous appellent. Et quand on les a une fois visités, on ne se résigne jamais sans serrement de cœur à ne plus les revoir. Leur attrait vient tantôt de la nature qui les a parés plus généreusement, tantôt des hommes qui les habitent. Les pays neufs n’ont point de secret, mais les vieilles terres d’histoire et de civilisation, où tant de générations ont senti, pensé, aimé, adoré, gardent je ne sais quoi de mystérieux et de profond qui nous enveloppe et nous captive. L’impénétrabilité des âmes ajoute encore au charme des lieux et au mystère attirant des temps évanouis.
Dix mois passés dans les Indes et dans l’Himalaya me laissaient avec la hantise du revoir, la mélancolie des choses incomplètes, le regret de ces États qu’il ne m’avait pas encore été donné de parcourir. Je me souvenais avec reconnaissance de l’accueil empressé et charmant que j’avais reçu des Anglais et, — détail pratique qui a son importance, — je savais que là, mieux peut-être qu’ailleurs, il me serait possible de décider et d’organiser rapidement une excursion intéressante. C’était la saison de la « mousson » et des pluies d’été ; il ne pouvait être question de voyager dans la péninsule. Mais, par-delà les plaines chaudes, par-delà le Téraï fiévreux, mon imagination revoyait, dans leur robe de glace, les cimes inviolées du majestueux Himalaya ; je savais par expérience qu’entre ses chaînes formidables s’ouvrent des vallées fraîches, se cachent des sanctuaires vénérés et de petits royaumes peu connus.
Le plus inaccessible est, de par la volonté de ses habitants, le Népal. Nos yeux d’enfants l’ont vu sur les vieilles cartes rudimentaires de jadis, allongé comme une étroite bande à la frontière nord des Indes : il nous paraissait juché tout au sommet de l’Himalaya, et, au-dessus du mot « Népal » ou « Népaul, » nos regards épelaient le nom prestigieux de la reine des montagnes, le Gaurisankar-Everest ! Plus tard, lorsque nous avons rêvé de l’Orient lumineux, lorsque nos esprits se sont tournés vers les civilisations asiatiques, vers le grand monde bouddhiste, vers les Indes, ses légendes, ses religions, le Népal nous est apparu comme le pays du mystère auquel les savants demandent ses secrets.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Népal
Le Népal
Chapitre I
Il est des pays qui nous hantent, nous fascinent, nous appellent. Et quand on les a une fois visités, on ne se résigne jamais sans serrement de cœur à ne plus les revoir. Leur attrait vient tantôt de la nature qui les a parés plus généreusement, tantôt des hommes qui les habitent. Les pays neufs n’ont point de secret, mais les vieilles terres d’histoire et de civilisation, où tant de générations ont senti, pensé, aimé, adoré, gardent je ne sais quoi de mystérieux et de profond qui nous enveloppe et nous captive. L’impénétrabilité des âmes ajoute encore au charme des lieux et au mystère attirant des temps évanouis.
Dix mois passés dans les Indes et dans l’Himalaya me laissaient avec la hantise du revoir, la mélancolie des choses incomplètes, le regret de ces États qu’il ne m’avait pas encore été donné de parcourir. Je me souvenais avec reconnaissance de l’accueil empressé et charmant que j’avais reçu des Anglais et, — détail pratique qui a son importance, — je savais que là, mieux peut-être qu’ailleurs, il me serait possible de décider et d’organiser rapidement une excursion intéressante. C’était la saison de la « mousson » et des pluies d’été ; il ne pouvait être question de voyager dans la péninsule. Mais, par-delà les plaines chaudes, par-delà le Téraï fiévreux, mon imagination revoyait, dans leur robe de glace, les cimes inviolées du majestueux Himalaya ; je savais par expérience qu’entre ses chaînes formidables s’ouvrent des vallées fraîches, se cachent des sanctuaires vénérés et de petits royaumes peu connus.
Le plus inaccessible est, de par la volonté de ses habitants, le Népal. Nos yeux d’enfants l’ont vu sur les vieilles cartes rudimentaires de jadis, allongé comme une étroite bande à la frontière nord des Indes : il nous paraissait juché tout au sommet de l’Himalaya, et, au-dessus du mot « Népal » ou « Népaul, » nos regards épelaient le nom prestigieux de la reine des montagnes, le Gaurisankar-Everest ! Plus tard, lorsque nous avons rêvé de l’Orient lumineux, lorsque nos esprits se sont tournés vers les civilisations asiatiques, vers le grand monde bouddhiste, vers les Indes, ses légendes, ses religions, le Népal nous est apparu comme le pays du mystère auquel les savants demandent ses secrets.
Lors de mon premier voyage aux Indes, tandis que je redescendais du Ladak et du lac Pangong, je songeais déjà au jour où je remonterais à Katmandou. Le petit Népal a su demeurer, au milieu de la poussée conquérante des nations, un des rares peuples qui aient gardé auprès des grands Empires voisins une indépendance assez réelle et qu’il défend encore jalousement. Un climat différent, une enceinte de montagnes réputées inaccessibles en ont fait un pays à part et lui ont maintenu une existence isolée, séparée de l’Inde.
C’est ainsi qu’il est resté le conservatoire du bouddhisme dans la péninsule hindoue, et bien qu’il ait été envahi par les sectes brahmanistes, c’est à lui que la science est redevable d’une grande partie de la littérature bouddhique rédigée en sanscrit. L’art lui est venu de l’Inde ; il l’a développé avec un grand sens de l’harmonie, des dons minutieux et particuliers.
Ce pays, vers lequel tant de regards se sont portés, devait particulièrement m’attirer, après deux voyages dans le grand Empire des Indes. Je le savais fermé à la curiosité des étrangers, surtout aux Anglais, quoique, seule pourtant, l’Inde Britannique ait le droit d’obtenir du Maharaja népalais, pour elle ou pour ses élus, la permission de visiter la mystérieuse vallée. Depuis un siècle, en effet, à quelques intermittences près, le gouvernement des Indes entretient à Katmandou, capitale du Népal, un fonctionnaire anglais qui porte le titre de Résident et dont les fonctions sont plutôt analogues à celles d’un ambassadeur ou d’un Consul. Ce Résident, sous la garde d’une soixantaine de cipayes, n’a avec lui, à l’heure actuelle, d’autres nationaux que deux « assistants, » plus ou moins half-castes et un docteur anglais. Il doit rester confiné dans la vallée qui a donné son nom à l’État et dont les trois vieilles capitales ont vu se dérouler toute l’histoire du pays. S’il veut sortir, il doit en informer le capitaine népalais attaché au service de la Résidence, pour qu’une escorte, ou tout au moins un cavalier d’honneur, l’accompagne. Honneur et surveillance tout à la fois.
L’autorisation de monter à Katmandou n’est accordée qu’à deux ou trois personnes chaque année, parfois quatre. Elle ne peut s’obtenir que par l’intermédiaire du Résident et est réservée, le plus souvent, à de grands personnages anglais du monde politique ou de la haute aristocratie. Le gouvernement met d’autant plus de prudence dans ses demandes qu’il ne peut, ni ne veut, s’exposer à un refus. C’est pour cette raison que, quelques mois après mon voyage, un prince de sang royal, venu d’Europe aux Indes, sollicita en vain la permission de visiter le Népal. Dans toutes les Indes et dans l’entourage du vice-roi, je n’ai rencontré qu’une seule personne, ayant été à Katmandou : le général commandant en chef, lord Kitchener, qui me déclarait d’ailleurs, en me vantant la remarquable intelligence des Népalais, que le Népal était la province la plus intéressante. C’est parce que je savais toutes ces choses et prévoyais les difficultés, qu’aussitôt le projet résolu dans mon esprit, je partis pour Londres, munie de chaleureuses recommandations près de l’India-Office, où je possédais d’ailleurs plus d’amis que je ne supposais, mes hôtes très aimables de jadis, dont j’ignorais le retour en Angleterre. L’accueil charmant du secrétaire d’Etat à la direction des Affaires des Indes, sir Richmond Ritchee, et ses bienveillantes lettres d’introduction me firent tout de suite augurer favorablement de la réponse officielle que je devais obtenir du vice-roi.
A la fin de juillet 1907, je quittais donc Paris avec cette espérance et débarquais à Bombay en pleine « mousson. » Après un court séjour à Kirkee, chez le gouverneur de Bombay, en quarante-huit heures de chemin de fer, dans une buée chaude, sous la pluie fréquente qui, depuis trois mois, s’épandait sur la péninsule, j’arrivai à Simla, résidence d’été du gouvernement général des Indes, située à 2200 mètres d’altitude, sur les pentes de l’Himalaya.
Il m’était donné de revoir le joli Simla qui rayonnera toujours pour moi dans le souvenir de gai printemps où je le vis pour la première fois, au milieu de ses forêts de rhododendrons empourprés de fleurs. Quinze fois ces fleurs se sont fanées, mais je les vois encore. Rien ne peut donner une idée de cette ville dispersée sur des collines tournantes et abruptes au-dessus de profondes vallées, de ces rhododendrons hauts comme des chênes dressant les uns sur les autres leurs millions de boules fleuries qui éclatent dans la lumière, de ces montagnes boisées qui se superposent comme des vagues jusqu’à la grande ligne des neiges de l’Himalaya, détachée sur un ciel imperturbable ment bleu. Plus nombreux que jadis et toujours noyés dans la verdure, ainsi que les ministères et les Offices gouvernementaux, de jolies villas et de rustiques bungalows, accrochés sur les crêtes et les pentes les moins accessibles, abritent pendant six mois les fonctionnaires du gouvernement général et du gouvernement de la province du Punjab. La saison d’été comporte trois mois de moussons pendant lesquels la vie mondaine bat son plein, sous les cataractes du ciel ouvertes largement. Des sentiers escarpés mènent aux habitations et seuls y accèdent les cavaliers et les infatigables coolies-ritchau menant, à quatre, la petite voiture qu’un vice-roi emprunta au Japon. Tout au contraire de nos coloniaux français qui, dans leur besoin de sociabilité et peut-être d’aide mutuelle, rapprochent leurs maisons les unes des autres en manière de village et de ville, au risque de se devenir à charge, les Anglais s’attachent à sauvegarder l’indépendance de leur « home, » à séparer les uns des autres leur nombreux personnel domestique, à se mettre le plus loin possible du bazar et de la « city » indigène. Liberté et hygiène tout à la fois.
Dans ce site merveilleux, j’avais encore la joie d’être reçue par sir Louis Dane, lieutenant gouverneur de Panjab, et lady Dane, qui m’avaient si bien accueillie à Peschawar, en 1890 De gracieuses invitations m’appellent chez le vice-roi et la vice-reine, comte et comtesse Minto, chez le colonel Dunlop Smith, secrétaire privé du vice-roi, chez M. Butler, le chef du Foreign Department, qui veut bien tout prévoir pour moi avec le Résident du Népal. Pendant quelques jours, grâce à mon hôte, je circule en voiture à chevaux le long des délicieux chemins tournants qui, N en bordure de précipice, festonnent les montagnes ; cette faveur, est réservée, par mesure de sécurité publique, à trois personnes et à leurs maisons : le vice-roi, le commandant en chef, le lieutenant-gouverneur du Punjab.
Les autorisations demandées me sont accordées : mon programme se précise, le voyage au Sikkim suivra et complétera celui du Népal. Les dernières pluies ont cessé devant les premiers froids et tandis que les sangsues rentrent en terre dans le Téraï marécageux, je fais dans la vallée du Sutledj un « raid » que je raconterai plus tard, au cours duquel je devais être le premier Européen à saluer, sur la route du Tibet, M. Sven Hedin revenant de son mémorable voyage dans l’Asie Centrale.
*
Mon « raid » dura vingt-cinq jours. Revenue à Simla, je partis pour Raxaoul, le point terminus du chemin de fer des Indes au Népal. Neuf heures de trajet de Simla à Kalka par la petite ligne qui contourne les montagnes comme le sentier des coolies. Huit trains successifs doivent, en deux jours, me conduire à la terre promise, par Moghal Saraï, près de Bénarès, et Bankipore, près de Patna, jusqu’où il me faut redescendre et où je fais une première étape confortable de vingt-quatre heures. Les six autres changements de train et la traversée du Gange en bateau, — une heure de navigation sous le ciel étoile — sont réservés à la seconde nuit de voyage. Aux embranchements de Sonepore et de Muzaflarpore je suis encore aux aguets. A l’aube de la troisième journée de route, j’arrive à Segowlie, dans le Téraï, et, vers huit heures, à Raxaoul, station frontière du territoire britannique.
Quatre ou cinq notables personnages attendent devant mon wagon, parmi lesquels l’Havildar, chef de la petite cité, entouré de tout un monde de curieux et de coolies prêts à m’emporter avec mes bagages. Un appareil est nouveau pour moi sur le quai ; je distingue, posée à terre, sur quatre pieds très courts, une grande boîte oblongue, haute d’environ un mètre, avec de vastes ouvertures coulissées sur les côtés ; c’est un palki, le palanquin qui m’est destiné pour deux nuits. Je me glisse dans la boîte tendue de rouge à l’intérieur. L’avant et l’arrière de mon appareil sont munis chacun d’un gros bâton rattaché aux quatre angles par des tiges de fer ; quatre coolies porteurs, des kahars, enlèvent prestement la boîte et son contenu. Le manque d’équilibre m’oblige à m’allonger sur le mince matelas recouvert d’une simple toile, la tête sur l’oreiller, pour me rendre au Rest-House, le bungalow du Résident du Népal, où nous serons dans dix minutes.
Le bungalow est confortablement installé dans la plaine du Téraï, longue zone marécageuse qui s’étend au Sud de l’Himalaya, sur 900 kilomètres de longueur et 50 de largeur. L’aoul, fièvre meurtrière, y sévit, redoutée des indigènes qui ne sont pas de la région, aussi bien que des Européens ; les Népalais se gardent de l’assainir parce qu’elle constitue, en quelque sorte, une première défense naturelle et dangereuse des deux passes escarpées, gardiennes gigantesques de la douce vallée qui n’est plus qu’à l’altitude de 1 200 et 1 300 mètres.
Autour du Rest-House, un petit cercle de fleurs et la fuite infinie des champs sous le soleil de flamme, dès l’heure matinale. Dans une salle à manger ouverte aux quatre points cardinaux, la table servie m’offre du thé et des œufs, spectacle plein de charme pour le voyageur qui n’a pas dîné la veille. Avant de déjeuner, je prends possession des lieux : un grand parloir avec tables et fauteuils de paresse, puis deux chambres, deux cabinets de toilette et salles de bain. Vite au tub, avant que mon estomac ne s’avise d’avoir trop faim. Mon sac-draps posé sur un tcharpaï, cadre de lit, serait tentant pour rattraper la nuit ; mais il y a 34 et 35° de chaleur à neuf heures du matin ; ce n’est plus l’instant de dormir, mieux vaut s’occuper. On me remet une lettre du colonel Macdonald, mon futur hôte, qui remplit les fonctions de Résident au Népal en l’absence de M. Manners Smith, le titulaire du poste. Il me propose de partir en palki le soir même, après dîner, pour Churia, une étape de 30 milles dans la première nuit. Le Khansamah du Rest-House m’y accompagnera et je l’y laisserai, tandis qu’un autre cuisinier viendra à ma rencontre le surlendemain, à Sissaghouri ; me plaira-t-il alors de continuer directement jusqu’à Katmandou ? Certes oui.
C’est parfait, mais je ne puis remercier le colonel par dépêche ; le gouvernement népalais est trop ombrageux pour admettre un contact avec l’administration anglaise. Les lettres circulent dans l’Etat avec les timbres indigènes et prennent à la frontière les timbres anglais. Le télégraphe n’existe pas au Népal ; lettres et messages télégraphiques sont apportés matin et soir à Raxaoul, ou bien par courrier spécial en cas d’urgence, en vingt-quatre heures de route, par le moyen de douze coureurs successifs, des oulaks qui, secouant le bâton chargé de grelots pour éloigner tout obstacle et chasser les fauves, ne s’arrêtent qu’aux relais. On raconte que les salves de canon en l’honneur du couronnement d’Edouard VII ont été tirées au jour tout d’abord fixé, bien que la maladie du Roi ait fait différer la cérémonie ; mais le Durbar n’ayant été avisé de cette remise qu’après coup, tint la politesse pour faite.
Le Maharaja s’oppose à toute mainmise de l’administration anglaise ; il ne veut pas non plus que, sous prétexte de sport et de villégiature, son pays ait le sort du Kachmir. Lorsque je suis allée à Srinagar, il y a quinze ans, sauf deux ou trois fonctionnaires attitrés dans le Protectorat et que le Maharaja logeait dans des maisons à lui, les Anglais n’avaient le droit ni de posséder un lopin de terre, ni d’avoir pignon sur rue ; ils ne pouvaient habiter sous des toits et devaient vivre en nomades, soit sous la tente, soit à bord de bateaux-maisons flottant sur le grand fleuve Djhilam, ou amarrés sur les lacs splendides qui font de ce pays une merveille sans égale. Le climat, à 1 800 mètres d’altitude, est délicieux ; aussi les Anglais sont-ils accourus nombreux. Des hôtels et des bungalows se sont maintenant construits sur les montagnes avoisinant la capitale, et Srinagar et la « Vallée heureuse » sont devenues « ville et stations de santé, » d’autant plus facilement que beaucoup de fonctionnaires de l’Inde, pour économiser la dépense, toujours à leur charge, des voyages dans la Mère patrie, passent leur congé en cure d’altitude. Le Népal leur offrirait les sites pittoresques et les nids d’aigles qu’ils affectionnent pour leur santé.
La difficulté de la langue commence à se faire sentir et complique un peu les choses. Tout le monde ne va plus parler que les langues népalaises. Seuls l’Havildar, le plus haut fonctionnaire de Raxaoul, le Khansamah du bungalow et mon bearer parlent hindoustani. Mais celui-ci ne sait pas le népalais et il embrouille tout sous prétexte de placer devant les autres des mots anglais dépourvus de leur vrai sens ou tout à fait inédits. L’hindoustani, l’ourdou, pour employer son vrai nom, la langue de la horde apportée dans les camps par les Mogols musulmans est, dans les Indes, la langue interprète par excellence. Les Anglais l’ont adoptée d’une façon générale, chaque fonctionnaire doit la savoir, sans préjudice des plus importantes langues parmi les deux cents qui se pratiquent aux Indes. Ils ont compris l’intérêt de premier ordre qu’il y a pour l’administrateur d’entrer en contact direct avec la population en se servant de sa langue. Nul fonctionnaire ne peut entrer au Civil Service sans savoir, outre l’hindoustani, deux autres langues indigènes. Espérons que, peu à peu, la même idée fera son chemin dans notre Indochine et que l’obligation pour les fonctionnaires coloniaux de connaître la langue locale sera strictement appliquée et supprimera définitivement l’ingérence et les méfaits de la classe des interprètes.
Mais revenons au bungalow de Raxaoul, dans la grande plaine chaude ; là, il faut remanier tout le bagage et emporter le moins possible, me dit-on, bien qu’une caravane importante soit commandée. Quand vient l’heure du dîner, mon journal se trouve au courant, et tout un paquet de lettres est prêt pour les Indes et pour la chère France.
J’aurais voulu partir avant la fin du jour, mais les coolies s’attardent à manger, et c’est dans la nuit noire, avec les lampes qui achèvent d’aveugler, qu’il faut organiser tout le chargement et mon palki. Pour comble de malheur, le petit matelas qui, le matin, adoucissait les planches du palanquin a disparu, et le gros de mes bagages, que le bearer a cessé de surveiller à l’un de nos nocturnes embranchements, est en souffrance avec mon bedding. Or, le nouveau palki que l’on m’amène est muni d’une traverse à la hauteur des reins dont je n’augure rien de bon. Enfin, et malgré mon serviteur, je parlemente si obstinément qu’on me rend le premier palki, un peu plus lourd sans doute, mais aussi plus hermétique à la pluie.
Les préparatifs se prolongent. Une vraie meute est autour de moi composée d’une quarantaine de coolies qui crient, se querellent et s’arrachent mes bagages, sous l’œil calme de la police népalaise et d’un cipaye de la résidence anglaise. Enfin, les kahars, — porteurs de palanquin, — qui se considèrent comme bien supérieurs aux porteurs de matériel, s’ébranlent ; huit sont affectés au portage de mon bearer, huit à celui de mon cuisinier ; cinq coolies se partagent les petits bagages et le panier de provisions, deux portent ma valise suspendue à un bâton aussi lourd qu’elle-même. Seize à vingt kahars sont affectés à mon palki qu’ils portent à quatre dans la plaine, se relayant toutes les deux, trois ou quatre minutes, sans jamais interrompre le trot ; couchée sous mes châles, de peur du froid qui me donnerait la fièvre tout comme les piqûres de moustiques, je tâche de me faire au mouvement rude de l’appareil. Tantôt sur un côté, tantôt sur l’autre, je dois encore veiller à ne pas déranger l’équilibre, et je ne change de position qu’au moment où les hommes, en se relayant, provoquent un arrêt presque imperceptible.
Nous menons un bruit d’enfer, tous les hommes crient, s’interpellent ; on nous regarde passer, et j’aperçois des lumières aux fenêtres des cases. La pleine lune s’est levée sur nos têtes et illumine les espaces découverts. Mes gens courent inlassablement, toute l’escouade les accompagne sur les flancs, et leurs élans me montrent mieux la rapidité de la marche ; mes porteurs scandent leur course d’un halètement rauque ; trois syllabes rudes lancées par un porteur d’arrière marquent la mesure qu’achève, en les répétant deux fois, un des kahars d’avant, et le rythme recommence sans cesse comme un gémissement. On se fait au mouvement, il finit même par bercer. Partis vers 7 heures et demie, les hommes ne s’arrêtent qu’à 11 heures, et la halte est d’environ une demi-heure. Toute la troupe alors, accroupie autour de moi, fume un affreux tabac qui m’empeste, parmi des lampes qui m’aveuglent. Aussi l’ai-je assez dit à l’arrêt et pendant la marche, quand le cooly-bati, le porteur du phare, me le mettait dans les yeux : « Bâti Djallo, bâti Djallo (lampe en avant) ! »