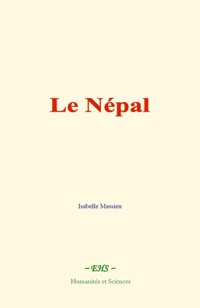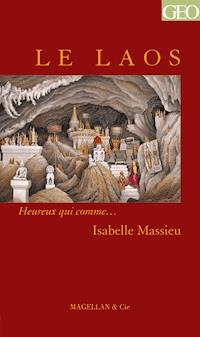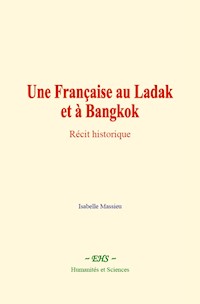
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Englisch
C’est un plaisir de repasser en son esprit les détails d’un voyage enivrant. Je voudrais ici en raconte une partie d’un voyage, celle qu’on regarderait volontiers comme la plus difficile et qui est assez aisée, on le verra, mais singulièrement pittoresque et instructive. J’étais à Srinagar, la capitale du Kachmir, avec la pensée de m’en retourner par les Pamirs et le Tïurkestan, quand le Foreign Office m’ayant définitivement interdit la route de Guilguit et du « Toit du Monde », je me décidai à aller visiter Leh, la capitale du Ladak, le Thibet anglais. Quelques jours après, ma caravane était prête et nous partions. C’est cette excursion au Ladak (puis à Bangkok) que je veux raconter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Une Française au Ladak et à Bangkok.
Une Française au Ladak et à Bangkok
Une Française au Ladak.
Par les brumeux jours d’hiver j’aime à me remémorer les dix mois de mon inoubliable voyage à travers les Indes sous les féeriques colorations tropicales. De Ceylan à Darjeeling et cet incomparable Himalaya, tout là-haut dans le ciel, à cette place où nous n’avons jamais cherché que les étoiles, jusqu’aux temples du Sud — Madura, Chillambaram et tant d’autres, — ces temples du passé, vivants encore, remplis de leur foule drapée ou nue, c’est un éblouissement de couleur et de lumière. Goa, le Nizam, les grands Rajpoutes et leurs blancs palais se mirant dans les lacs bleus, peuplés de milliers de serviteurs, les villes et les fleuves sacrés, les bûchers de Bénarès, le Tadj d’Agra, la passe du Kheiber sur la route de Kaboul, tous les peuples, toutes les religions, les mœurs et les coutumes défilant sous mes yeux dans ce merveilleux ensoleillement, quelle vision ! C’est un plaisir de repasser en son esprit les détails de ce voyage enivrant. Je voudrais ici en raconter une partie, celle qu’on regarderait volontiers comme la plus difficile et qui est assez aisée, on le verra, mais singulièrement pittoresque et instructive. J’étais à Srinagar, la capitale du Kachmir, avec la pensée de m’en retourner par les Pamirs et le Tïurkestan, quand le Foreign Office m’ayant définitivement interdit la route de Guilguit et du « Toit du Monde », je me décidai à aller visiter Leh, la capitale du Ladak, le Thibet anglais. Quelques jours après, ma caravane était prête et nous partions. C’est seulement cette excursion au Ladak que je veux raconter.
I.
Avant toute chose, je tiens à dire que les protections qui m’avaient aplani les difficultés à travers le Kashmir, me demeuraient fidèles. Quel plaisir reconnaissant n’ai-je pas à nommer en particulier Sir Denis Fitz Patrick, lieutenant-gouverneur du Punjab, un aimable Irlandais, et M. Dauvergne, membre de la Société de géographie de Paris, un Français venu au Kashmir, il y a trente ans, pour le commerce des châles et resté par amour des montagnes, de la liberté, des belles chasses, de tous les sports, et un peu des Anglais ? Sir D. Fitz Patrick, entre autres-services, m’avait rendu favorable le Maharajah du Kashmir, le prince indigène dont Srinagar est la résidence. M. Dauvergne, à qui m’avait recommandée M. Guillaume Capus, l’explorateur, faisait tant pour me faciliter toutes choses que je me plaisais à l’appeler ma providence himalayenne. Il m’accompagna à la lamaserie d’Himis.
La ville de Leh est à 420 kilomètres à l’est de Srinagar : quinze jours de marche.
A mesure que nous avançons, nous rencontrons de plus en plus des caravanes de Dras, des Baltis et des Ladakis au petit chapeau de feutre blanc-gris comme leurs chaussures, très montantes aux jambes. Ils portent la grande robe de laine croisée, maintenue par l’écharpe de couleur, le briquet pendu à la ceinture. Voici même un caravanier de Yarkand, puis les terribles chevriers, les ravageurs du pays, les barbares qui détruisent, eux et leurs chèvres, toute végétation. Quand l’herbe manque, cette herbe dont les chevaux ne veulent pas après les chèvres, ils coupent les branches des arbres, ne laissant que les troncs qui bientôt meurent, arrachant les écorces, brûlant, détruisant les bouleaux. Les Anglais, qui protègent leurs forêts et connaissent les ravages de ces chevriers, les chassent des territoires du Punjab. En vain, on a essayé de faire comprendre au médiocre Maharajah la dévastation que causent ces coudjeurs. Ils flattent son amour-propre et son sentiment religieux : « N’est-il pas un grand roi, maître de son pays ? Eux ne mangent pas de la vache sacrée, et ne sont pas exposés chez lui à se voir prendre leurs buffles comme nourriture. » Moyennant un faible tribut de six roupies par an, 8 fr., 50 pour 100 chèvres, et de 1 fr. 40 par buffle, ils auront donc détruit dans quelques années les admirables forêts du territoire de Kashmir. Elles sont d’ailleurs délicieuses, leurs chèvres, répandues dans les prés et les bois, avec leurs longues soies ondulantes d’un blanc jauni, aux dégradés de beige et de brun doré. Je les vois encore se dresser debout dans les branches des saules qu’elles dévorent lestement, ravissantes de grâce et de beauté. Et les chevriers et chevrières, une belle race du pays de Kangang : les hommes superbes de force élégante, belle barbe noire, brillante et taillée, teint assez pale, nez droit, le type grec avec de beaux yeux éclatants ; les femmes, vêtues de bleu comme les hommes, sont artistement belles avec la note bleu pâle des turquoises en colliers sous ces figures de statues. Elles portent leurs fardeaux sur la tête et s’en vont, leurs beaux bras levés, les yeux riants, l’air heureux de vivre…
Nous nous élevons au-dessus de la vallée du Sind par des pentes de prairies plus ou moins plantées, coupées de pentes blanches d’avalanches ; les chevaux n’ont plus sur le sentier que la largeur de leurs fers et leurs quatre pieds s’y placent l’un derrière l’autre. Nous arrivons à Baltal, le dernier campement avant la passe du Zodjilà, l’adieu au pays verdoyant de Kashmir. A notre gauche, à quatre ou cinq heures de marche, c’est le val d’Ambarmath que le pont de neige écroulé nous empêche de prendre ; les Caves d’Ambarmath où les Hindous vont, par le froid et la neige, faire leurs dévotions, hommes et femmes, tous dans le costume de nature, plus une feuille de vigne ou son équivalent pour les deux sexes. Et ces pauvres Hindous viennent des Indes où le thermomètre ne descend jamais au-dessous de 25° ou 30° de chaleur et monte en été jusqu’à 50°. C’est au sortir de ces régions brûlantes qu’ils affrontent les hautes altitudes, traversant les neiges pendant des jours et des jours pour atteindre Ambarmath par la route du Sud. La passe de Zodjilà est, à 3 375 mètres, comme la barrière d’un nouveau pays : plus de bois, d’immenses parois sauvages rosées par le soleil, des neiges, de grands glaciers, et au fond de la gorge que nous allons redescendre, la rivière de Dras, née au Zodjilà. L’air est léger et vivifiant, c’est du Champagne que l’on croirait boire.
Je n’ai pas encore parlé de mon personnel. Le jeune Samy, le petit Hindou de Pondichéry qui m’avait accompagnée avec tant de dévouement jusqu’à Srinagar, y grelottant sous vingt-quatre degrés, j’ai dû organiser un service mieux approprié aux conditions du voyage. Ablou, mon majordome, mon homme de confiance, est le chef des autres domestiques, qu’il m’a fournis d’ailleurs. Cette espèce de forban, grand shikari devant Allah, ce qui veut dire chasseur, un titre qui le classe assez haut dans l’échelle des castes, prend avec moi des mines d’ours apprivoisé. Il daigne me nouer et dénouer mes tchaplies, la chaussure indigène, et paraît avoir grand’peur de me casser les pieds. Il me sert à table et commande tout le service, traite avec les lambardars, chefs de villages, pour avoir les porteurs et les poneys de charge, ou tatous, s’il y en a, pour le nombre de jours nécessaires. Ablimir est mon cuisinier, turban à carreaux bleus et blancs sur la tête ; il me varie le mouton avec tout l’art dont il est capable. Subana, qui est le domestique des deux autres, m’accompagne avec le petit panier du déjeuner, hasiri-tokri, et le paquet de châles ou de fourrure, selon la température. Il doit aller quérir l’eau pour le déjeuner, et m’aider à marcher en cas de difficultés. Le quatrième, Subamalik, fait office de saïs, il tient mon cheval dès que je descends, et me l’amène au camp devant ma tente, avec sa musette pour que je surveille la nourriture de mon brave tatou. C’est le domestique de Subana. Tous ensemble plantent les tentes et requièrent les coolies, porteurs et conducteurs de chevaux, pour les y aider, plus le peuple du hameau, s’il y en a, femmes et hommes. Ceux-ci balayent la place de ma tente avec une branche d’arbre, enlèvent les pierres, aplanissent le sol, vont chercher plus ou moins loin les grosses pierres qui maintiennent les crochets de la tente, apportent le bois et l’eau et nettoient les casseroles. Ils sont les serviteurs de mes gens. En ce pays, un petit trouve toujours un plus petit pour le servir.
Le service des postes est très bien organisé entre Srinagar et Leh : les quinze jours de marche de caravane sont faits en cinq jours, par des piétons qui vont toujours courant, nuit et jour, le sac de dépêches au dos, le bâton à pique garni de grelots toujours sonnant, pour éloigner les fauves et les serpents, tout comme aux Indes. Ils sont relayés tous les cinq milles (un peu moins de deux lieues). Les maisons et les huttes de poste sont souvent des niches de pierres sèches et de branchages, des abris creusés dans la neige pour échanger les dépêches. Entre Sonamarget Baltal, une vraie maison, plus importante, exhalait une telle odeur de putréfaction que mon tatou, si doux d’ordinaire, se défendait et refusait de passer. Des gens vivaient là dedans, d’autres causaient assis devant la maison à côté de quelque charogne qu’ils n’avaient pas pris la peine d’éloigner.
Toujours délicat est le choix d’un camp. Sur les routes de caravanes, tout le monde adopte le même campement, souvent protégé d’un mur de pierres sèches. En dehors des routes parcourues, il faut d’abord trouver de l’eau, puis du bois pour faire le feu, et quelquefois le voisinage d’un hameau pour se procurer les chevaux et coolies, s’il se peut, renouveler les provisions, le lait, les œufs, les moutons, la farine et le fourrage que certain parouana, sorte de laissez-passer, permet de requérir. Autre grande question : il est indispensable de se rendre compte de la nature de la montagne qui surplombe, et de ne pas s’exposer à être englouti par une avalanche, comme il est arrivé dans le Wardwan à un chasseur anglais et à sa caravane. On doit savoir aussi que le vent remonte les vallées pendant le jour, et les descend pendant la nuit.
Il ne pleut pas dans la région où j’arrive, le Baltistan — Petit Thibet ; — la fonte des neiges, les torrents et leur canalisation y sont l’unique ressource de la végétation : la rivière de Sooroo apporte à la rivière de Dras une masse d’eau semblable à la sienne, et bientôt les deux ensemble se rendent à l’Indus. Grands flots qui se creusent de plusieurs mètres, formant des abîmes aussi terribles qu’à la mer avec leur courant effroyable et les écueils des berges et des roches éparses. Partout les mêmes rochers pâles, menaçants et déchirés, aux formes démantelées en gigantesques ruines : des tours, des aiguilles dressées ; et, près du torrent, — souvenir des grandes forêts fleuries du Kashmir, — les tamaris en fleurs à côté des cyprès nains, de jolis saules, des abricotiers, et, semés dans le chaos des pierres écroulées, d’énormes buissons de rosiers surchargés de roses épanouies. Je leur souris toute seule au passage, les remercie d’être si belles.
Le camp de Karghil, le dernier poste télégraphique, est situé dans un îlot planté d’abricotiers au milieu d’un croisement de torrents mugissants ; et tout à coup ce sable fin et granitique qui avoisine la vallée de l’indus se soulève en poussière avec la soudaineté des phénomènes atmosphériques dans ces régions : c’est un véritable cyclone, un coup de simoun brutal. On va étouffer, on se précipite à banda (fermer) la tente, et dix minutes après, tout est fini, les toiles sont relevées, je fais servir le thé.
Le Baltistan, dont je côtoie la lisière, est musulman ; à Shargol je trouve le premier monastère bouddhique, perché dans les rochers sans autre accès qu’une échelle. A Moolbeck, un peu plus loin, autre monastère, un Gompa, comme on les appelle, juché sur un des rochers les plus pointus qui dominent le village et la vallée de Walkha. Blanc monastère couronné d’une bordure quadrillée rouge et blanc, maisons aux terrasses supérieures couvertes d’un toit et abritées du vent de deux côtés seulement. Ces hauts de maisons ouverts donnent un aspect particulier à tous ces villages.
Nouvelles mœurs qui commencent : à Karghil, dans le Baltistan, c’était la polygamie ; à Moolbeck, avec les Thibétains, — les Bhotis — c’est la polyandrie. Trois ou quatre frères ont la même femme, qui est encore libre de s’adjuger un ou deux époux de choix ayant les mêmes droits et les mêmes titres que les frères. La terre ne nourrit pas ses habitants ; on craint l’augmentation de la population ; la polyandrie n’est pas fertile, donc une économie. Beaucoup d’enfants se font lamas. La misère est grande au Ladak, dont le territoire s’étend généralement, au-dessus de l’altitude de la végétation, à la hauteur des neiges éternelles. Les nuages de la mousson des Indes s’évaporent au-dessus des incandescences rocheuses qui repoussent l’humidité. Les moindres morceaux de terre irrigables sont cultivés et forment des oasis. On produit de très belle orge et beaucoup d’abricots, comme au Baltistan, qui en expédie séchés par toute l’Asie. Ces petites taches de verdure surprennent dans cette nature de pierre. On voit dans la montagne les hommes marcher tout en filant, leur paquet de laine enroulé au bras et, à la main, une longue bobine qu’ils tournent et remplissent adroitement d’un fil de laine assez grossier.