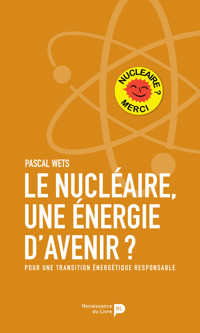
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
Les débats sur la question du nucléaire restent encore aujourd’hui très animés dans la sphère publique. C’est également le cas en politique où le sujet s’invite à tous les niveaux de pouvoir, tant nationaux qu’européens. Face aux flots d’informations souvent contradictoires, il n’est pas toujours facile de se forger sa propre opinion sur le sujet.
Dans cet ouvrage, Pascal Wets éclaire le débat sur la transition énergétique et le nucléaire en faisant un tour d’horizon honnête et objectif des possibilités énergétiques et des politiques européennes actuelles en matière d’énergie. Son constat est sans appel: pour une transition écologique durable, la solution énergétique est mixte, et nécessitera le recours à l’énergie nucléaire.
L’auteur propose un projet global pour une transition énergétique responsable d’un point de vue écologique mais aussi économique et social. Pour ce faire, il s’adresse aux hommes politiques, aux citoyens, aux consommateurs, aux entreprises et aux agriculteurs avec des recommandations spécifiques, concrètes et réalistes.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Pascal Wets est ingénieur civil, consultant en entreprise et ancien professeur à SUPELEC et à l’institut post-universitaire
de l’Université Technologique de Compiègne. Passionné par l’écologie et la transition énergétique, il est l’auteur des ouvrages "Pour une écologie pratique et rationnelle" et "Lettre ouverte à Madame Marghem, ministre (belge) de l’Énergie, de l’Environnement et du Développement durable".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Préfaces
Préface de Monsieur David Clarinval
L’énergie a toujours été au cœur de l’épanouissement de l’humanité et est, comme le démontre la crise énergétique qui a touché l’Europe en octobre 2021, plus que jamais un vecteur indispensable pour le bien-être et la prospérité de notre société.
En effet, l’énergie non seulement permet aux citoyens de se chauffer, de s’éclairer et de se déplacer, mais elle est également essentielle pour le développement de notre économie, tant pour la compétitivité de nos industries, par exemple l’industrie pétrochimique et le secteur alimentaire, que pour la survie de nos indépendants et de nos petites et moyennes entreprises fort consommatrices d’énergie, tels que les boulangers, bouchers, glaciers, etc.
La politique énergétique est donc absolument essentielle pour le continent européen, et plus particulièrement pour la Belgique et l’Union européenne, qui ne disposent que de très peu de ressources énergétiques naturelles. Les politiques énergétiques tant européennes que belges doivent garantir l’accès à une énergie réellement bon marché, accessible et durable et permettre une sécurité d’approvisionnement suffisante. La transition énergétique vers une société neutre en carbone doit donc absolument tenir compte de ces différents piliers ; négliger un pilier pour en favoriser un autre de manière idéologique mènerait inexorablement au déclin de notre pays et de notre continent européen, au détriment de nos citoyens et de nos entreprises.
Comme je l’écrivais déjà avec le philosophe Corentin de Salle en 2014 dans notre ouvrage Fiasco énergétique1, notre politique énergétique doit donc favoriser un mix énergétique diversifié, dont les énergies peu coûteuses et non intermittentes comme l’énergie nucléaire ne peuvent être exclues. La décision du gouvernement fédéral belge de prolonger deux réacteurs nucléaires pour dix années supplémentaires démontre que la raison finit toujours par l’emporter sur l’idéologie.
Il faut maintenant absolument que la Belgique ait une vision énergétique à long terme, qui apporte aux ménages la garantie de leur bien-être et à notre économie les clés de son développement. Cela passera sans aucun doute par le développement des énergies renouvelables, telles que l’éolien, le solaire, les biocarburants, l’hydrogène et d’autres, mais également par la prolongation de nos actifs nucléaires actuels et des investissements dans le nucléaire du futur.
Sans une telle vision pragmatique à long terme, nous sommes voués à subir, pendant des décennies encore, les conséquences d’une politique énergétique chaotique. Suffisamment d’exemples en témoignent aujourd’hui.
Pascal Wets, dans son livre Le nucléaire, une énergie d’avenir ?, milite activement et avec beaucoup d’à-propos dans cette direction. Je ne peux que le féliciter et l’appuyer dans ses démarches actuelles.
David Clarinval
Vice-Premier ministre et ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique
Préface de Monsieur Thierry Caminel
Nous vivons actuellement un basculement des opinions publiques en faveur de l’énergie nucléaire. Un peu partout en Europe, les sondages montrent qu’une majorité de citoyens y est favorable, y compris auprès des sympathisants écologistes.
Pourtant, l’énergie nucléaire n’a pas changé, mais l’environnement oui. Ainsi, la guerre en Ukraine a fait exploser l’idée que le gaz fossile pouvait être une « énergie de transition » acceptable, à la base de la plupart des scénarios de sortie du nucléaire. Elle a révélé à tous combien l’Europe était devenue davantage dépendante du gaz russe, et l’impact de cette dépendance sur les prix, la géopolitique et l’économie.
De même, les images de l’extension des mines de lignite à ciel ouvert en Allemagne, autorisée par une ministre écologiste aux pouvoirs étendus, ont largement écorné l’image de la « transition énergétique » dans ce pays et ont introduit des doutes sur les promesses d’un monde avec 100 % d’énergies renouvelables.
Ce basculement va de pair avec la montée de l’inquiétude concernant la catastrophe climatique, qui devient de plus en plus tangible avec l’augmentation des mégafeux, des canicules et des sécheresses. L’écoanxiété augmente, en particulier auprès des plus jeunes, qui perçoivent le risque existentiel que représente l’augmentation des émissions de CO2. Un risque qui, d’après certains scientifiques, peut aller jusqu’à la disparition de l’espèce humaine sur Terre.
Tous ces éléments conduisent à une meilleure compréhension de l’importance de l’énergie dans nos sociétés, et qu’il faut en diminuer la consommation. Mais l’énergie abondante a façonné notre société et nos modes de vie. Pourtant, cette abondance ne durera pas.
Il est donc essentiel de se tourner vers des sources d’énergie durables et sûres, telles que l’énergie nucléaire. Cette dernière, dense, contrôlable et sans émission de CO2, peut jouer un rôle clé pour nous affranchir de notre dépendance aux énergies fossiles. Les informations relatives à la sûreté, l’efficacité et l’importance fondamentale de cette énergie pour la réduction des émissions de CO2 sont de plus en plus acceptées et comprises. Par ailleurs, le discours public s’oriente progressivement vers une appréciation plus mesurée et basée sur des faits.
Ainsi, plutôt qu’un choix binaire « pour ou contre le nucléaire », la question centrale à laquelle nos sociétés sont confrontées est : comment assurer une transition vers un système énergétique décarboné qui préserve le climat tout en garantissant la prospérité et le bien-être de chacun ? Et la réponse à cette question passe nécessairement par le nucléaire.
C’est l’ensemble de ces questions, et en premier lieu celle du nucléaire, qu’il nous faudra débattre dans les années à venir. Car sans lui, les belles promesses de la transition énergétique ne seront pas tenables et nous mèneront dans le mur. Dans cette perspective, l’ouvrage de Pascal Wets, Le nucléaire, une énergie d’avenir ?, apparaît comme une lecture essentielle pour comprendre et adopter les changements nécessaires à notre avenir énergétique.
Thierry Caminel
Ingénieur passionné par l’écologie et expert en IA.
Aux décideurs, aux citoyens et à tous les écologues.
Introduction
« L’été 2022 a été ponctué, un peu partout dans le monde, de phénomènes extrêmes : feux de forêts, glaciers en voie de disparition, fleuves quasiment à sec, températures caniculaires, inondations… », écrit Michel De Muelenaere dans le quotidien belge Le Soir du 1er septembre 2022.
Les dérèglements climatiques actuels nous rappellent sans équivoque qu’il est impératif de diminuer notablement nos émissions de gaz à effet de serre (GES). Ce qui signifie pratiquement : réduire, tant que faire se peut, notre consommation d’énergie et utiliser des vecteurs énergétiques décarbonés (vent, soleil, eau, nucléaire ou tout autre vecteur non polluant).
Deux leviers d’action complémentaires sont à mettre en œuvre : le premier consiste à changer nos modes de consommation énergétique et le second, plus technique, vise à améliorer l’efficacité de nos équipements2 et à choisir le mix énergétique le moins polluant.
Face à cette situation environnementale, l’Union européenne (UE) a fixé des objectifs de réduction de nos émissions de GES : en 2030, elles doivent atteindre 55 % de nos émissions de 1990 et, en 2050, il faut arriver à la neutralité carbone3.
Chaque pays membre doit donc bâtir sa transition énergétique de manière à atteindre ces objectifs.
Mais que signifie « bâtir une transition énergétique » ?
C’est imaginer ce que sera notre mix énergétique idéal en 2050 et déterminer comment y arriver durant la période qui nous sépare de cette échéance. Et notre mix énergétique, c’est la répartition en volume entre énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon), nucléaire, biomasse, vent, soleil, eau que nous allons utiliser pour couvrir notre consommation. Il sera idéal s’il nous garantit une sécurité d’approvisionnement totale, une pollution minimale, et ce, pour le coût le plus faible possible.
Cette transition énergétique doit être échafaudée par des spécialistes capables d’en optimiser les aspects techniques, économiques, environnementaux et sociaux. Pour faire simple, si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, il faudra avoir supprimé de notre mix énergétique toutes les énergies fossiles qui, aujourd’hui, font tourner nos véhicules, nous chauffent et produisent les calories nécessaires à l’industrie. Il faudra privilégier l’électricité décarbonée4 comme vecteur énergétique et il deviendra nécessaire de développer la production et l’usage de carburants dits « verts », c’est-à-dire n’émettant pas de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Enfin, parallèlement à ces mesures techniques, il faut inciter les consommateurs à tendre vers une plus grande sobriété énergétique, comme nous le verrons par la suite.
Vu de cette manière, atteindre la neutralité carbone en 2050 est assez simple, si ce n’est qu’une question la complique : utilise-t-on le nucléaire ou les énergies renouvelables (ER) ? L’essence de cette question ne repose que sur la phobie du nucléaire créée par les écolos, entretenue par les médias et suivie avec opportunisme par les politiques. Débattre à partir d’une peur irrationnelle, émotionnelle, idéologique n’entraîne aucune conséquence positive. Nous développerons ce point au cours du premier chapitre.
Cette peur du nucléaire, qui sera analysée dans le premier chapitre, a provoqué un emballement pour les ER et en particulier pour l’éolien, à l’instar du Danemark qui l’utilise à raison de 57 % pour produire son électricité.
Cet engouement pour les énergies renouvelables est-il justifié ? Nous verrons au cours du deuxième chapitre que les conditions nécessaires au « miracle » danois sont très spécifiques et difficilement reproductibles. Leur analyse a été très sommaire et le raz-de-marée éolien résulte en partie de l’esprit grégaire de certains dirigeants qui, subjugués par l’exemple danois, ont pris leur décision en se disant un peu simplement : « Ils le font. Cela marche. Donc lançons-nous dans l’aventure. »
Et, aujourd’hui, l’éolien tant terrestre que maritime est bien présent… au point que certains le voient supplanter le nucléaire.
La question est donc : peut-on se passer du nucléaire ?
La réponse fera l’objet du troisième chapitre. Nous y examinerons le système de production électrique de onze pays d’Europe occidentale de manière à déceler le secret et les attentes des cinq d’entre eux qui sont non nucléarisés.
Puis, nous parcourrons les cinq continents pour avoir une vue globale de l’environnement nucléaire civil.
Le quatrième chapitre expliquera la méthodologie à suivre pour bâtir la transition écologique que nous avons définie en début d’introduction. Nous découvrirons également l’importance du temps, car construire une nouvelle centrale, une ferme éolienne ou un barrage est une opération qui prend du temps et implique une prise de décision anticipée souvent difficile à obtenir dans les délais voulus.
D’où l’importance de pouvoir « gagner du temps ».
Comment ?
En allongeant la durée de vie de l’équipement en place dans la mesure où la solution est techniquement possible, et ce, pour un coût de rajeunissement acceptable.
Les conséquences de cette solution ne seront pas que nationales. Elle pourra avoir un impact sur l’évolution économique de l’UE dans la mesure où, grâce à des partenariats entre différents industriels5, elle permettra la relance de la production de nouvelles centrales européennes. Ce point sera développé au cinquième chapitre.
Le sixième chapitre concrétisera l’apport de la prolongation de la durée de vie des réacteurs existants en prenant l’exemple de la Belgique.
Trois scénarios seront développés : un scénario (COOL) de référence dans lequel les tendances évolutives passées sont prolongées (tout fonctionne comme avant, sans rupture), qui respecte les dispositions légales prises concernant la fermeture de deux réacteurs en 2022 et des autres en 2025 ainsi que les investissements décidés pour l’implantation de parcs éoliens maritimes et terrestres ; un autre scénario (ÉCOLOGIQUE) dont le seul changement par rapport au premier est de continuer à exploiter les centrales nucléaires jusqu’en 2050 ; et enfin un troisième scénario (DYNAMIQUE) impliquant de nouvelles mesures gouvernementales et comportementales.
Il sera montré, sur les plans écologique et financier, la différence quantitative qu’il peut y avoir entre chacun de ces scénarios.
Le cas de la Belgique peut servir d’exemple, toutes proportions gardées, aux autres pays que nous aurons analysés dans le troisième chapitre. Il permettra d’établir une liste de mesures générales à prendre pour réussir une transition énergétique.
Cela fera l’objet du septième chapitre.
En conclusion seront résumés les objectifs poursuivis en écrivant ce livre et les espoirs qu’ils soient rencontrés.
Chapitre 1
Stop à la phobie du nucléaire
1.Petite histoire de la peur de l’électricité
Commençons par un petit retour dans le temps et retrouvons-nous dans les années 1870-1900, celles de l’avènement de la fée électricité.
Quelques années auparavant, en 1831, le Français Michel Faraday découvre le principe de l’induction électromagnétique. À partir de ce principe, Werner Siemens établit celui de la dynamo en 1866. L’Anglais Henry Wilde crée la première dynamo cette même année, mais ce n’est qu’en 1869 que le Belge Zénobe Gramme invente la dynamo industrielle, qu’il présente à l’Académie des sciences de Paris en 1871.
Le vrai départ de l’électricité industrielle a lieu en 1873, à l’Exposition universelle de Vienne, en Autriche. L’industriel français Hippolyte Fontaine y démontre la réversibilité de la machine de Gramme. Elle peut jouer le double rôle de dynamo et de moteur. L’électricité permet ainsi d’effectuer un « travail de force » : faire tourner une machine à coudre ou une meule à grains si la puissance de la dynamo est suffisante.
Une contrainte cependant : il faut que la source électrique soit voisine du moteur entraînant la meule, car le transport de l’électricité sur de longues distances est difficile. Il implique de gros câbles pour pouvoir véhiculer les ampères nécessaires et, de plus, une grande partie de l’énergie se transforme en pertes calorifiques lors de son trajet. À nouveau, ce problème est résolu par un ingénieur français, Marcel Deprez, qui découvre qu’en élevant la tension de la source, on diminue, à puissance égale, le courant à transporter et donc le diamètre des câbles et les pertes calorifiques.
Une dernière difficulté reste à résoudre : comment augmenter la tension des dynamos sans qu’elles deviennent géantes ? Fontaine les met tout simplement en série.
Toutes ces découvertes sont réalisées en Europe, ainsi que leurs applications industrielles. En 1879, à l’Exposition de Berlin, l’entreprise Siemens fait rouler un tramway (bus électrique sur rails) à 6 km/heure.
De l’autre côté de l’Atlantique, en 1882, l’Américain Thomas Edison, qui a inventé la lampe à incandescence en 1879, crée la première centrale électrique avec six dynamos « Jumbo6 » capables d’éclairer quatre-vingt-cinq maisons dans le quartier de Wall Street.
En 1903, les entreprises Edison-Sprague, Thomson-Houston et Westinghouse produisent des dizaines de milliers de moteurs afin d’équiper 50 000 km de lignes de tramway et réaliser ainsi l’électrification de 98 % du réseau.
« Pendant ce temps, la vieille Europe (à l’origine de toutes ces découvertes) discute encore », regrette l’ingénieur Édouard Hospitalier dans la revue La Nature (1889). Les Parisiens rejettent la ligne aérienne jugée inesthétique et les rails conducteurs estimés trop dangereux. En 1903, la France compte seulement 2 000 km de lignes électrifiées.
Parallèlement, la nécessité d’abaisser la haute tension de transport7 pour alimenter les ménages génère une nouvelle dynamique de recherche qui aboutit à l’utilisation du courant alternatif, de l’alternateur, du moteur asynchrone et des transformateurs.
Le choix du courant n’est pas simple. Il provoque un affrontement commercial sans merci entre Edison, qui défend le courant continu, et Westinghouse, qui milite pour l’alternatif. Le héros de cette « guerre des courants » n’est autre que Nikola Tesla, né dans l’actuelle Croatie, formé en Autriche et envoyé aux États-Unis par l’un des collaborateurs français d’Edison pour aider ce dernier dans le domaine du transport électrique.
Lors de cette guerre commerciale, Edison, abandonné par Tesla qui prône l’alternatif, parvient à convaincre l’État de New York d’utiliser de la tension alternative pour les exécutions capitales pour lui permettre de lancer une campagne ayant comme slogan : « Le courant alternatif que vous utilisez est celui du bourreau ! » La campagne n’impressionne pas fort les Américains, qui suivent Westinghouse sous la houlette de Tesla et passent au courant alternatif dès 1890.
En revanche, elle refroidit sérieusement l’Europe, effrayée par cette « diablerie électrique » et, en France, le courant continu, avec ses contraintes limitant le transport longue distance, prédominera jusqu’en 1920.
Sale coup pour l’économie européenne, qui accuse un retard de plus de vingt ans par rapport aux Américains, retard qui ne sera jamais rattrapé.
Un siècle plus tard, l’histoire se répète.
2.Petite histoire de la peur du nucléaire
La fission nucléaire est étudiée théoriquement par l’équipe italienne d’Enrico Fermi en 1934, mais ce n’est qu’en 1938 que la description d’une fission est réalisée par deux chercheurs allemands. Un an plus tard, le Danois Niels Bohr part aux États-Unis et rencontre Albert Einstein à l’Université de Princeton. Leurs échanges suscitent un intérêt croissant de la part des dirigeants américains à Washington et la prise de conscience par les scientifiques de la puissance que pourrait dégager le bombardement d’un noyau lourd fissile par des neutrons.
Washington lance en 1942, sous la direction du général Richard Groves, le projet Manhattan, dont le but est de développer une bombe A (A pour « atomique ») basée sur la fission de l’uranium 235.
Deux bombes sont lancées contre le Japon.
La peur du nucléaire naît après ce bombardement par les Américains des villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki, les 6 et 9 août 1945. Le nombre de victimes est évalué à 150 000. Le monde découvre la puissance effroyable de la fission nucléaire. La peur est entretenue par la Guerre froide et les différentes stratégies de dissuasion nucléaire imaginées par les grandes puissances.
Il faut attendre le 20 décembre 1951 pour que le premier réacteur américain expérimental, l’EBR-1, construit au laboratoire de l’Idaho aux États-Unis, soit mis en service pour produire de l’électricité. Sa puissance atteint quelques centaines de watts. L’URSS démarre une centrale nucléaire de 5 MW en 1954. En 1956, les Français, les Anglais et les Américains mettent chacun en exploitation leur propre centrale, mais ce n’est qu’à partir de 1960 que la puissance électrique nucléaire civile mondiale croît de manière significative, et ce, principalement après le premier choc pétrolier d’octobre 1973.
La peur du public face à ce mode de production est, alors, assez marginale. Mais, fin mars 1979, a lieu l’accident de la centrale américaine de Three Mile Island. Malgré son importance (fusion du cœur d’un réacteur), il n’a aucune incidence grave sur la population et l’environnement. Néanmoins, par prudence, le gouverneur de l’État de Pennsylvanie fait évacuer les enfants et les femmes enceintes à 8 km de la centrale pour leur éviter d’éventuelles échappées radioactives. Cette décision provoque le départ d’environ 90 % des habitants de la municipalité et enclenche une flambée médiatique qui affole l’Amérique et inquiète l’Europe. De plus, le président Jimmy Carter, en s’opposant à la construction de nouvelles centrales, d’une part freine fortement l’évolution mondiale du nucléaire civil (deux tiers des projets sont annulés) et d’autre part réanime, voire amplifie la peur du peuple américain face à cette technologie. Quant à l’opinion publique européenne, elle prend conscience du risque que peut présenter l’utilisation de l’énergie nucléaire civile.
Cette crainte se transforme en terreur après l’accident de la centrale russe de Tchernobyl en avril 1986. Le nombre de décès recensés et directement liés à l’accident avoisine la trentaine. Mais les estimations du nombre de cancers qui auraient été provoqués par les échappées radioactives varient, selon les sources, de 4 000 à 60 000. Cet écart est à l’image des partis pris et de l’ignorance des gens qui s’expriment.
Dans les années 1990, notamment après le sommet « Planète Terre » de Rio de Janeiro en 1992, les « Verts8 » commencent à prendre un rôle politique dans différents pays. Ils adoptent le slogan « NON au nucléaire9 » et attisent la crainte du public face à ce mode de production électrique. La sortie du nucléaire (fermeture progressive des centrales et abandon définitif de cette technologie) est débattue, voire décidée dans différents pays européens, pour diverses raisons qui vont de la crainte jusqu’à l’opportunisme électoral en passant par l’idéologie.
La Belgique prend cette décision en 1999 sous un gouvernement regroupant libéraux, socialistes et écologistes. C’est la première entrée des écologistes en politique et c’est sous leur impulsion que cette décision est prise. Beau cadeau de bienvenue !
En 2000, l’Allemagne offre le même cadeau aux Verts lors de leur entrée dans le gouvernement fédéral de Gerhard Schröder, et Angela Merkel accélère le processus après la catastrophe de Fukushima… et avant les élections de 2013. Cette décision revêt une grande importance pour les écolos, car elle représente le symbole de leur entrée en politique. De ce fait, la remettre en question peut être interprété comme un désaveu de leur doctrine.
En 2004, les écolos subissent, dans à peu près tous les pays européens occidentaux, une défaite retentissante. Leur négativisme dénué de toute base scientifique et de propositions constructives déçoit. Il met en évidence la fragilité de leur argumentaire et de leurs prises de position dogmatiques. Le nucléaire en profite pour revenir en scène sous le regard moins inquiet de la population.
En mars 2011, à Fukushima au Japon, un tsunami d’une ampleur exceptionnelle, consécutif à un séisme auquel la centrale résiste parfaitement, met hors service son circuit de refroidissement principal, ce qui entraîne la fusion du cœur de trois réacteurs et la surchauffe de la piscine de désactivation du quatrième. Le nombre de personnes exposées à des radiations mortelles est évalué à une seule selon TEPCO10, l’exploitant de la centrale. Les médecins japonais en recensent six et les médias anglo-saxons cinquante. Par ailleurs, aucune reconnaissance scientifique n’existe depuis dix ans sur un potentiel développement de cancers dus à ces radiations. En revanche, les médias décrivent, durant le mois suivant l’accident, à grand renfort de titres à sensation, les actions de dépannage exécutées en amplifiant à foison les possibles conséquences désastreuses de la catastrophe. Ce tapage médiatique augmente bien évidemment la peur du public face au nucléaire.
L’UE, avec son plan « Énergie-Climat » lancé en 2008 et renforcé en 2014, magnifie, à l’instar des pays nordiques (hors Finlande), l’utilisation des énergies renouvelables pour remplacer le nucléaire lourd à porter à cause de ses déchets dangereux difficiles à gérer et des risques d’émissions radioactives en cas d’accident.
La peur du nucléaire est ainsi officialisée, voire normalisée.





























