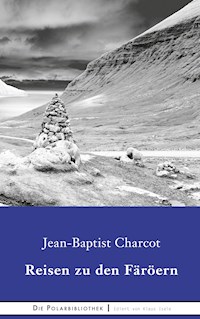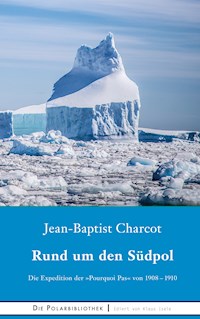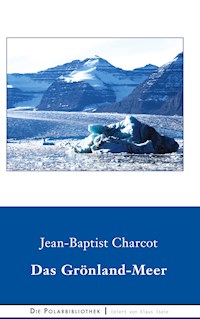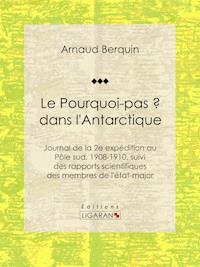
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "16 décembre 1908. — Par beau temps calme, nous appareillons de Punta-Arenas à 9 heures du soir. M. Blanchard, le si aimable consul de France, venu à bord de son launch la Laurita à 8 h. 30, amenait M. le gouverneur Chaigneau, M. Henkes, un des directeurs norvégiens de la Sociedad Ballenera Magellanes, M. Grossi, négociant italien et nos compatriotes, MM. Poivre, Beaulier, Detaille, Rocca..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 702
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335047868
©Ligaran 2015
M. le DrJean Charcot rend compte ici, pour le grand public, de sa seconde campagne dans l’Antarctique. Il exposera, en d’autres publications et avec l’aide de ses collaborateurs, quels sont les travaux poursuivis, les résultats géographiques, maritimes, scientifiques, obtenus pendant les deux années de labeur et de danger passées loin des hommes et des terres habitables.
Le présent livre est, en quelque sorte, le journal de l’expédition dans sa simplicité et sa vérité saisissantes. Il conte, au fur et à mesure qu’elles se déroulent, les péripéties de la rude existence explorateurs des régions polaires, autour desquelles la mort rôde sans cesse, les effleurant de son aile plus glacée que la glace éternelle du pôle.
La mort a épargné Charcot et ses compagnons. Elle a reculé devant la tranquille assurance, l’entrain, la bonne humeur de ces jeunes hommes qui allaient à elle avec une sérénité et une gaieté dont on aura l’exacte impression dans les pages qu’on va lire. Nous avons pu, il y a quelques semaines, les fêter tous joyeusement, au retour, comme nous les avions salués au départ. Ils étaient saufs, et l’œuvre était accomplie.
Ce qu’est cette œuvre, les savants qui compulsent les innombrables documents, les mémoires, les collections de la mission Charcot seront seuls à même de nous le dire avec certitude et précision.
Nous en savons assez, toutefois, pour être sûr que la mission a pleinement réussi, qu’elle a fait une ample moisson de choses nouvelles, qu’elle a reculé les bornes de l’inconnu qui couvre l’étendue immense desterres antarctique. Quelques-uns des voiles du grand mystère en seront levés ; la science humaine possédera un peu plus de vérité.
À quoi bon tant d’efforts, tant de dangers courus, dira-t-on, pour connaître une portion de la planète où l’homme ne saurait subsister, dont il ne tirera aucun parti ? Il n’est pas de bénéfice réel à espérer en compensation de tant de sacrifices !
Qui le sait ? qui peut dire qu’aucune richesse à jamais exploitable n’existe dans ces contrées désolées ? qui peut affirmer surtout que les observations, les découvertes faites là-bas ne seront pas fructueuses pour la science, n’auront pas des conséquentes profitables à la conquête par l’homme des forces de la nature ? Ne peut-on supposer, par exemple, que la connaissance des lois, sinon du principe même du magnétisme terrestre, résultera des études faites là où passe l’axe du monde ?
Et puis, quand-même ? quand il n’y aurait pas d’utilité pratique aux expéditions polaires, les trouverait-on pour cela sans objet ? Ce serait nier la pure science, la science désintéressée, qui poursuit la vérité partout où ses investigations peuvent s’étendre, sans savoir si l’humanité en tirera profit. Va-t-on donc tenir pour vaines et superflues les recherches de l’astronomie qui plonge dans les étendues dont nous pouvons à peine concevoir l’immensité, les mesure de son infime base terrestre, montrant l’homme si petit, et le faisant si grand !
Il est bien naturel aussi que nous entendions ne rien ignorer de la planète que nous habitons. C’est le domaine de l’humanité ; nous voulons le posséder tout entier, te faire notre jusqu’à ses limites extrêmes.
Nous le voulons, avant que d’en avoir apprécié l’intérêt pratique, par une noble curiosité, par la passion de connaître, qui est généreuse et belle entre toutes. Et nous allons ainsi à la découverte des continents jusqu’alors impénétrables, des montagnes et des plateaux inaccessibles…
Nous marchons vers tes pôles, à travers les mers inhospitalières et dangereuses, sur les terres désertes, gelées, où tout repousse l’homme et lui est ennemi.
L’Europe est dans l’hémisphère septentrional. C’est à l’inconnu le plus voisin, au pôle nord, que les Européens sont tout d’abord allés. Ilslui ont arraché, un à un, beaucoup de ses secrets, en jonchant de leurs ossements ses routes de glace.
Puis, tout récemment, ils se sont tournés vers le Sud ; ils se sont attaqués à l’immense étendue des régions polaires méridionales.
L’Europe du vingtième siècle, l’Europe maritime et scientifique, fait le siège de l’Antarctique. Anglais, Suédois, Norvégiens, Belges, Allemands, Américains, entrent successivement dans la lutte. Les Français aussi y prennent leur part. Deux fois de suite, et pendant quatre années, le pavillon tricolore a flotté dans les mers et sur les terres australes, aux mains de Charcot et de ses intrépides compagnons.
C’est grâce à eux que la France n’a pas été absente de ce combat de la civilisation. Nous leur en axons une gratitude profonde.
Le pays se doit de les en remercier, de leur témoigner la reconnaissance et l’admiration qui vont à ses fils vaillants et glorieux.
Jean Charcot, qui a conçu, organisé, conduit l’une et l’autre expéditions, tout modeste qu’il soit, est un bon et grand Français, Jeune, universellement aimé, choyé, heureux, portant un nom illustre, il pouvait jouir de l’existence facile, douce et brillante de la société parisienne où une place de choix lui appartenait. Il a quitté tout cela : il a sacrifié son temps et une bonne part de sa fortune ; il a offert sa vie pour ajouter quelque chose à la renommée de son nom, et à la gloire de son pays.
Grâces lui en soient rendue ! Saluons-le bien bas, nous qui demeurons sur cette terre de France ou il fait si bon vivre ; saluons tous ceux qui ont passé avec lui ces années d’isolement, de dangers et de misères, loin des êtres chers, loin de tout réconfort autre que la lutte incessante, le fructueux travail, le sentiment d’un haut devoir.
Ils ont fait œuvre bonne, et ils peuvent inscrire fièrement en devise à leur mission :
Pour la Science ! pour la Patrie !
PAUL DOUMER.
Tout comme l’expédition du Pourquoi-Pas ? a été la suite et le complément de l’expédition du Français, ce livre est la suite et le complément du Français au Pôle Sud, dont il constitue le second volume. Ainsi que le précédent, il n’a aucune prétention littéraire ; il n’est pas non plus l’exposé des travaux scientifiques de l’expédition ; ceux-ci, qui ont été exécutés par les membres de l’état-major, et qui constituent le véritable succès de la mission, seront publiés ultérieurement par le ministère de l’Instruction publique et formeront un ouvrage en plusieurs gros volumes. Ce livre est tout simplement mon journal de bord personnel, presque textuellement transcrit, et je ne puis répéter que ce que j’écrivais au début du premier volume, il a été écrit pour ceux qui veulent revivre au jour le jour, avec nous, les treize mois passés dans l’Antarctique. J’ai dû cependant m’efforcer d’éviter autant que possible les redites et passer ainsi volontairement sous silence, des descriptions et des détails qui se retrouveront dans le journal de l’expédition de 1903-1905.
Le « Pourquoi-Pas » dans l’Antarctique, a été rédigé rapidement dans les deux mois qui ont suivi le retour ; cette hâte nuira peut-être à la forme, mais garantira la fidélité des faits et des impressions.
Je n’ai pas cru devoir non plus consacrer un chapitre spécial à l’histoire des expéditions dans cette région de l’Antarctique, qui n’aurait été que la copie de celui qui précède le journal du Français ; cependant au cours du récit, pour la compréhension même de nos travaux, j’expose aussi longuement que je le crois nécessaire, les découvertes et les efforts de nos devanciers.
J’insiste un peu au début sur la préparation même de l’expédition, parce que je juge qu’il est indispensable au lecteur qui veut revivre notre vie de connaître les conditions dans lesquelles nous sommes partis, le but que nous nous proposions d’atteindre, les moyens dont nous disposions et le milieu dans lequel nous avons vécu, mais ceux qui voudront pénétrer plus à fond dans la préparation d’une semblable expédition, devront encore s’adresser aux publications officielles, ou tous les détails trop arides pour ta moyenne des lecteurs simplement curieux, seront minutieusement et fidèlement transcrits.
Malgré le succès des expéditions récentes, la zone d’inconnu de l’Antarctique reste et restera pendant longtemps encore très vaste, cachant de réels trésors scientifiques ; si ces récits peuvent encourager quelqu’un de mes jeunes compatriotes à se lancer dans la voie de ces explorations si fructueuses, mes efforts n’auront point été vains, et j’aurai ainsi réalisé un de mes plus chers désirs.
M. E. Flammarion a bien voulu se charger d’éditer cet ouvrage ; il a compris surtout en acceptant cette tâche, l’intérêt qu’il y avait à faire connaître une expédition maritime française ; le soin qu’il a apporté dans tous les détails de cette publication, ainsi que les sacrifices qu’il a consentis, lui donnent une valeur que je ne pouvais espérer.
L’amiral Fournier avait accepté d’écrire la préface du Français au Pôle Sud, c’est lui, dont l’affectueuse sympathie à notre œuvre ne s’est pas démentie un instant, qui nous a accueilli à notre retour par des paroles que je n’oublierai jamais ; cette fois c’est M. Paul Doumer qui a consenti à honorer notre livre d’une préface. Ce nouveau témoignage d’intérêt et d’affection, portant sa signature, est la preuve même que le but de cette expédition était essentiellement patriotique. Il a acquis un nouveau titre à une reconnaissance que je ne saurai jamais suffisamment lui exprimer.
Ce mot de reconnaissance revient fréquemment sous ma plume ; ces répétitions prouvent, non seulement la sympathie effective dont notre œuvre a bénéficié, en France et à l’étranger, tant à l’aller qu’au retour, mais encore le plaisir que je ressens à rappeler et à reconnaître les bienfaits qui m’ont permis de chercher à faire mon devoir, et qui ont récompensé mes efforts.
Il me faudrait un chapitre entier qui me serait certes le plus agréable à écrire, pour remercier tous ceux qui ont contribué à l’expédition, mais je sais que je blesserais la modestie de beaucoup et je dois me contenter de leur dire ici un seul mot qui vient du fond du cœur : « Merci ! »
J.-B. CHARCOT.
Neuilly-sur-Seine. – Août 1910.
La distance qui sépare l’Antarctique de l’Europe est la cause principale de l’indifférence manifestée pendant si longtemps à l’égard de l’exploration de ces régions, tandis qu’au contraire, les explorations s’étaient multipliées autour du Pôle Nord.
Mais, dans ces dernières années, le Pôle Sud est sorti de l’oubli, les navigateurs et les savants de ces deux derniers siècles ont compris que la connaissance des conditions physiques et naturelles du globe resterait forcément incomplète, tant qu’il persisterait une zone d’inconnu aussi considérable que celle représentée par la grande tache blanche qui recouvre l’extrémité sud du monde, plus vaste que deux fois la superficie de l’Europe.
Le public lui-même s’est ému et s’intéresse passionnément à cette question. Elle le mérite, car il n’existe pas de région dont l’étude offre plus de satisfactions aux explorateurs et également aux savants qui s’occupent des observations et des collections que ceux-ci rapportent. Tout, en effet, y est nouveau, souvent inattendu et celui qui se décide à partir est certain que ses efforts seront récompensés par des découvertes importantes.
Les voyages de circumnavigation et les expéditions des anglais J. Cook et Ross, du russe Bellingshausen, de l’américain Wilkes, du français Dumont d’Urville ; les pointes hardies des phoquiers anglais et américains Biscoe, Morrell, Weddell, Palmer, Pendleton, Balleny, de l’allemand Dallmann, des norvégiens Larsen et Evensen, ont singulièrement rétréci la limite de la grande Terra Incognita dont on supposait l’existence, et permettaient déjà de considérer que si la calotte polaire arctique est constituée par une mer glacée entourée des côtes septentrionales de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique, la calotte antarctique est au contraire une terre ou tout au moins un vaste Archipel glacé entouré de mer.
C’est au commandant belge De Gerlache, à bord de la Belgica, en 1897, que revient l’honneur d’avoir passé le premier hiver dans les glaces de l’Antarctique, accomplissant à tous points de vue une belle et remarquable exploration. Cette exploration eut également le mérite d’éveiller l’attention du public et c’est incontestablement à son initiative que l’on doit les si fructueuses odyssées antarctiques de ces dernières années. En effet, après l’hivernage de l’expédition anglo-norvégienne de Borchegrevinck sur la Terre de Ross, un siège en règle de l’Antarctique fut organisé par l’Europe. En 1902, on voit le capitaine anglais Scott, celui-là même qui vient de repartir et qui avait alors comme collaborateur Shackleton, explorer la Mer de Ross et la Terre Victoria, accomplissant un raid magnifique sur la grande barrière de glace, le professeur allemand Van Drygalski avec le Gauss hivernant dans la banquise dans le secteur si difficile au sud de Kerguelen et y découvrant de nouvelles terres, le professeur suédois Otto Nordenskjöld accompagné du capitaine norvégien Larsen hivernant dans des conditions dramatiques, mais si fructueuses pour la Science, à l’Est de la Terre de Graham, d’où il fut rapatrié par le raid audacieux du capitaine argentin Irizar, le docteur écossais W. Bruce à bord de la Scotia, découvrant dans la Mer de Weddell la Terre de Coates et accomplissant une des plus belles campagnes océanographiques, enfin, en 1904 le petit navire le Français, commandé par moi-même s’efforçant de préciser et de continuer les découvertes de De Gerlache, en hivernant sur la côte Ouest de la Terre de Graham.
Dans ce grand effort commun, on est agréablement frappé par l’entente absolue des chefs d’expédition et des savants qui ont organisé celles-ci et par l’esprit vraiment scientifique dont ils sont animés. Il est à souhaiter que dans la conquête de l’Antarctique les choses se passent toujours ainsi, pour le plus grand bien de la Science universelle, et je suis persuadé qu’à notre époque éclairée la petite gloire que les explorateurs peuvent jeter sur leur pays n’aura pas à en souffrir.
En 1908, Sir Ernest Shackleton accomplit l’audacieuse et superbe exploration, trop connue de tous pour qu’il soit nécessaire d’y insister, qui l’amena à 179 kilomètres du Pôle ! Et nous-mêmes à bord du Pourquoi-Pas ? faisions de notre mieux, sans cependant chercher à établir de comparaison, dans la région au S.-O. de l’Amérique du Sud, rapportant grâce au zèle et au travail de mes collaborateurs des résultats que le monde savant a bien voulu considérer comme importants.
L’exploration de l’Antarctique est donc mise en mouvement et ce mouvement ne semble devoir s’arrêter que lorsque les conquêtes – encore vastes et longues à accomplir – seront définitives. Le capitaine Scott, en effet, vient de repartir pour la conquête du Pôle Sud même et on parle de grandes expéditions en préparation en Allemagne et en Amérique. Enfin, la République Argentine qui, depuis plusieurs années, entretient un observatoire permanent aux Orcades, veut en établir un autre sur la côte ouest de la Terre de Graham, au point où nous avons hiverné.
C’est le journal de notre dernière expédition qui fait le sujet de ce nouveau volume, mais je crois tout d’abord devoir expliquer pourquoi j’ai choisi comme point de travail cette région inhospitalière, souvent ingrate et si éloignée du Pôle lui-même.
En longeant dans le secteur de l’Antarctique, au sud de l’Australie, une ligne de côtes se dirigeant au Sud et qu’il appela Terre Victoria, James Ross découvrit en 1841 une immense falaise de glace absolument verticale se continuant à l’Est, connue depuis sous le nom de « grande barrière ».
Borchegrevinck, en 1900, monta sur cette falaise et constata la présence d’une plaine de glace s’étendant à perte de vue. L’expédition de la Discovery enfin en 1902, après avoir longé la grande barrière, découvrit la Terre Edouard-VII qui la limitait à l’est, puis pendant l’hivernage à la Terre Victoria, s’avança sur la barrière dans un magnifique raid jusqu’au 82° 17’. Il était tout naturel que Shackleton revint vers ces mêmes régions appartenant réellement à l’exploration de son pays et il était également tout naturel, puisqu’il avait annoncé son intention de s’y rendre, que je m’abstinsse de me diriger vers cette région, quelque séduisante qu’elle apparaissait, puisque le bateau déjà vous amène à 78° de latitude et qu’une grande plaine horizontale semblait alors s’étendre jusqu’à l’axe de la terre. Mais forcément, deux expéditions de nationalité étrangère, malgré les meilleures intentions du monde, douées même du meilleur esprit, se seraient laissé entraîner à lutter pour la conquête glorieuse de la plus basse latitude et bien que cette lutte eût présenté un haut intérêt sportif, elle aurait eu lieu forcément au détriment absolu des observations et peut-être même du résultat définitif. Je m’empresse d’ailleurs d’ajouter très sincèrement que rien ne permet de supposer que nous serions parvenus au magnifique résultat de mon ami Sir Ernest Shackleton et ainsi les sacrifices pécuniers consentis par mon pays l’auraient été en pure perte.
L’Antarctique est d’ailleurs assez vaste pour permettre à de nombreuses expéditions d’y travailler ensemble et avec fruit et je résolus de retourner dans la région que j’avais commencé à parcourir avec le Français, en 1903-1905, c’est-à-dire au sud même du cap Horn, dans cette partie avancée et montagneuse qui semble avoir été la continuation de l’Amérique et qui est improprement connue sous le nom général de Terre de Graham. Là je pourrais dans toutes les branches de la Science continuer les recherches du Français, considérées comme déjà si fructueuses, les vérifier, les compléter et les amplifier. Au Sud, la Terre de Graham cessait brusquement au 67° de latitude, puis se dressait au milieu des glaces la Terre Alexandre-Ier à peine entrevue, jamais approchée, île isolée ou portion de continent ? Enfin, à l’Ouest de celle-ci une zone s’étendait avec un grand point d’interrogation jusqu’à la Terre Edouard-VII. Dans la partie Est de cette zone, la Belgica avait pu, entraînée par la dérive, faire d’intéressants sondages, mais son œuvre méritait d’être continuée et poussée aussi loin que possible vers l’Ouest, où seule une petite île mise en doute par certains géographes, avait été signalée par Bellingshausen. Avait-on le droit de continuer à désigner sous le nom de continent Antarctique cette partie de notre monde où comme toute indication de terre, on n’avait relevé que deux sommets isolés et éloignés l’un de l’autre ?
Mon but bien précis était d’étudier à tous points de vue et en détail la zone la plus étendue possible de l’Antarctique dans ce secteur, sans préoccupation de la latitude ; je savais avoir choisi la région où les glaces se dressent déjà devant le navire à 61° de latitude, où la mer est parsemée d’innombrables icebergs et où la côte est bordée de hautes montagnes d’un aspect infranchissable, je n’avais donc aucun espoir de me rapprocher du Pôle. Et cependant, je m’empresse de le dire, pour que l’on ne puisse m’accuser d’avoir trouvé les raisins trop verts, si j’avais eu la chance de tomber sur un chemin me permettant d’avancer vers ce rêve de tout explorateur polaire, je m’y serais précipité avec enthousiasme et je n’aurais certes rien ménagé pour m’en rapprocher.
Mais rien ne me permettait de prévoir ce que nous trouverions et l’inconnu même dans lequel je m’engageais en choisissant ce secteur rendait d’autant plus difficile l’organisation de l’Expédition, car il fallait être prêt à toute éventualité et il était impossible, comme d’autres qui se dirigent vers un terrain connu, de concentrer toute sa préparation pour une lutte contre des éléments prévus.
J’avais nourri ce projet d’un nouveau départ avant même la fin de ma dernière expédition et, dès mon retour en France, encouragé par les savants satisfaits des résultats acquis, je cherchai à trouver les moyens pour le réaliser.
Je présentai mon programme à l’Académie des Sciences qui réunit une Commission chargée de l’étudier et, après un examen favorable, elle décida d’accorder son haut patronage à cette nouvelle expédition et publia des instructions détaillées sur les travaux qu’elle désirait lui voir entreprendre.
Le Muséum et l’institut Océanographique lui accordèrent également leur patronage.
Avec de semblables appuis, il fallait réussir.
Cependant je mis de longs mois avant d’entrevoir la possibilité de pouvoir réunir la somme nécessaire, et pourtant ni les sympathies, ni les encouragements ne me furent ménagés. La presse parisienne ne manqua jamais de m’aider de sa voix puissante, des amis dévoués, comme MM. Joubin et Rabot, ma famille elle-même, malgré la perspective d’une longue et pénible séparation, ne me permirent pas de me décourager.
Mes efforts devaient aboutir enfin ; j’eus la chance d’intéresser à mon œuvre MM. Berteaux, Doumer et Etienne, auxquels se joignirent MM. J. Dupuy et R. Poincaré, puis M. Briand, ministre de l’instruction publique et M. G. Thomson, ministre de la Marine.
Bientôt, après un rapport favorable de la Commission des Missions, j’eus l’assurance que la Commission du budget présenterait aux Chambres la demande d’une très importante subvention.
Les Chambres en effet, sur la proposition de M. Doumer, votèrent sur le budget du ministère de l’instruction publique 600 000 francs de crédits et cette confiance de notre Gouvernement, ainsi que le patronage de nos grandes Sociétés savantes furent pour moi la plus belle récompense de mes efforts précédents. À cette somme se joignirent dans la suite 100 000 francs souscrits par de généreux donateurs, comprenant une somme de 10 000 francs de la Société de Géographie de Paris, des subventions du Muséum, du Conseil municipal de Paris, et des Chambres de Commerce des grandes villes françaises.
Le ministère de la Marine mit à la disposition de la Mission trois officiers de Marine et me promit 250 tonnes de charbon, le matériel de dragage qui avait été déjà utilisé sur le Français et tous les instruments, cartes et documents nécessaires à l’Expédition dont pouvaient disposer le service hydrographique et les arsenaux.
Le Prince de Monaco, qui a donné l’essor à l’océanographie par ses propres recherches et par sa grande générosité, offrit à la Mission un matériel océanographique des plus complets.
Le Muséum, le Bureau des longitudes, l’Observatoire de Montsouris, des observatoires particuliers, le Service météorologique, l’institut agronomique, l’institut Pasteur et quelques personnalités scientifiques enrichirent par des prêts et des dons notre arsenal scientifique, augmenté encore par des achats pris sur le budget de la Mission et qui devint ainsi un des plus complets et des plus riches emporté par une expédition polaire.
Malgré l’importance de notre budget s’élevant finalement à 800 000 francs, cette somme reste de beaucoup inférieure à celles dont ont disposé la plupart des expéditions au Pôle Sud, envoyées par les nations étrangères et cela n’est pas une de mes moindres fiertés, d’être parvenu à organiser la nôtre, dans des conditions cependant parfaites, avec une dépense aussi faible, surtout si l’on considère que le bateau qui à lui seul a coûté 400 000 francs a été ramené avec la plus grande partie du matériel en bon état. Il faut en effet envisager les dépenses nécessitées par les gages de l’équipage pendant deux années, les instruments scientifiques coûteux auxquels je viens de faire allusion, les vivres pour trois années et trente hommes et tout le matériel dont il va être question. Si j’ai pu atteindre ce résultat, c’est grâce au généreux intérêt qui m’a été témoigné par des particuliers, même étrangers, par les gouvernements du Brésil, de la République Argentine et du Chili, ainsi que par la grande majorité de nos fournisseurs nationaux et le dévouement du secrétaire de l’expédition, M. Manoury.
Dès que l’état-major scientifique fut définitivement constitué, mes futurs collaborateurs purent pendant plusieurs mois se perfectionner dans les travaux qu’ils devaient poursuivre en profitant de la large hospitalité qui leur fut offerte par le Prince de Monaco sur ses yachts, l’Observatoire de Montsouris, l’Observatoire de Paris, le Service météorologique et les laboratoires du Muséum.
Qu’il me soit permis d’insister ici tout particulièrement sur les relations excellentes qui ont toujours existé entre moi et les autres explorateurs de l’Antarctique ; voulant mettre tous les atouts dans mon jeu, j’ai fréquemment eu l’occasion de m’adresser à MM. De Gerlache, Bruce, Scott, Shackleton, Otto Nordenskjöld, Van Drygalski, et tous ont bien voulu me prodiguer largement les précieux conseils de leur expérience.
Le bateau était non seulement l’élément le plus important de l’Expédition, mais encore celui dont il fallait se préoccuper tout d’abord.
Ma première pensée avait été de tâcher de racheter mon ancien bateau le Français, et je fis faire des démarches dans ce sens auprès du gouvernement de la République Argentine. Mais il me fut répondu que cet excellent petit navire, devenu l’Austral, devait être utilisé pour le ravitaillement du poste des Orcades et pour l’installation d’un nouvel observatoire à l’île Wandel. Nous cherchâmes alors avec mon ami M. Charles Boyn, ancien commissaire de la Marine, directeur de l’Agence générale maritime, tant en Écosse qu’en Norvège, à acheter un baleinier, mais nos recherches furent vaines car tous les navires qui nous étaient présentés étaient déjà de construction ancienne et nécessitaient des réparations assez importantes. De plus, notre programme comportait un hivernage dans le bateau même, ce qui exigeait des dispositions d’aménagements spéciales, et toutes ces modifications et améliorations auraient fini par atteindre un prix très élevé qui aurait été presque équivalent à celui d’un bateau neuf.
Après avoir recueilli, dans les pays qui se sont le plus occupés d’exploration polaires et auprès des hommes compétents tous les renseignements nécessaires, nous avons décidé avec M. Boyn de soumettre nos desiderata au père Gautier, l’habile constructeur de Saint-Malo, qui avait su si bien réussir le Français. Mes exigences étaient considérables, et d’autant plus difficiles à réaliser, que mes moyens pécuniaires étaient limités. Il me fallait en effet un navire très marin pour la navigation dans les mers de l’Antarctique, assez puissant en même temps pour résister aux chocs contre les glaces et aux pressions qu’il pourrait en subir, avec des soutes pouvant contenir 250 tonnes de charbon, 100 tonnes environ de vivres et de matériel, des aménagements confortables pour les 22 hommes d’équipage et les 8 membres de l’état-major et enfin des laboratoires.
Le père Gautier, n’envisageant que l’intérêt qu’il y avait à construire un beau bateau en solutionnant un problème difficile, accepta d’enthousiasme, et nous présenta un devis des plus modestes. La construction du Pourquoi-Pas ? sous la surveillance de M. Boyn, fut donc confiée aux chantiers Gautier père et fils, de Saint-Malo, et le résultat prouve, une fois de plus, l’habileté, la conscience et le désintéressement du doyen des constructeurs français.
La machine devait être robuste, puissante et économique ; nous avons choisi une machine compound de 450 chevaux qui a été construite par la maison Labrosse et Fouché, de Nantes, sous la surveillance de M. Laubeuf, ingénieur en chef de la marine.
Le Pourquoi-Pas ? mis en chantier en septembre 1907, fut lancé le 18 mai 1908 ; la robustesse de sa construction, le soin qui y avait été apporté, ses formes puissantes et élégantes à la fois, avaient fait l’admiration de tous les connaisseurs. Le ministre de la Marine s’était fait représenter au lancement par l’amiral Nény, et le ministre de l’instruction publique par M. Rabot ; ma femme, la marraine du bateau, assistée de M. Doumer son parrain, lança la classique bouteille de Mumm sur l’étrave, et comme elle se brisa du premier coup, d’avance paraît-il, une heureuse carrière était assurée au Pourquoi-Pas ?
Quelques semaines après, la machine montée et le gréement terminé, Mgr Riou vint à Saint-Malo baptiser le Pourquoi-Pas ? comme il avait baptisé autrefois le Français.
Les dimensions de ce navire qui a obtenu les plus hautes cotes du bureau Veritas sont :
Son gréement est celui de trois-mâts barque, sa mâture solide mais courte avait été choisie à grands frais, parmi les plus belles pièces de l’arsenal de Brest ; pour les échantillons de bois, de même que pour les ancres et les chaînes tout avait été prévu environ trois fois plus robuste que pour un navire ordinaire de même tonnage. Les membrures d’une force considérable sont très rapprochées et à l’avant comme dans les petits fonds la maille est remplie de pièces de bois. Deux bordés très épais recouvrent la membrure protégés eux-mêmes contre l’usure des glaces par un soufflage extérieur. Un vaigrage intérieur calfaté et coaltaré forme pour ainsi dire une coque supplémentaire. Le bateau, sauf les petits fonds en orme est construit avec le meilleur bois de chêne.
De tous côtés il est renforcé par des dispositifs spéciaux. L’avant qui doit supporter les chocs les plus considérables, a été particulièrement soigné ; tout à fait compact dans son ensemble, il est garni à l’intérieur de puissantes guirlandes, à l’extérieur par des armatures de fer et d’épaisse tôle zinguée. Ses formes sont arrondies pour pouvoir mieux monter sur la glace et la briser par le poids du bateau.
Le Pourquoi-Pas ? forme ainsi un superbe bloc d’une robustesse remarquable, qui seule lui a permis, comme on le verra dans la suite, de sortir des rudes épreuves auxquelles il a été soumis.
La machine avait été montée avec le même soin et la même solidité que la coque, et munie de pièces de rechange nécessaires et d’un outillage complet, permettant par les moyens du bord d’exécuter toutes les réparations qui pourraient être utiles.
Un treuil-guindeau à vapeur, avait été fourni par la maison Libaudière et Mafra de Nantes, servant à la fois aux manœuvres des chaînes d’ancres et des amarres, aux dragages et aux diverses pèches.
Les aménagements devaient répondre aux nécessités du travail et de l’hivernage et assurer le maximum de confort. Je crois pouvoir dire que les dispositions adoptées ont, dans leurs grandes lignes, donné d’excellents résultats. À l’avant, sous le pont, se trouve un poste très spacieux contenant 18 couchettes, des caissons, tables, etc., la hauteur sous barrots, comme dans tous les logements d’ailleurs, est de 2 mètres. En arrière du poste et communiquant avec lui, se trouve un petit carré pour les sous-officiers dans lequel s’ouvrent les deux cabines du patron et du chef mécanicien et la cabine à deux lits du quartier-maitre et du second mécanicien.
Afin de donner le plus d’amplitude possible aux soutes, j’avais fait élever le pont de la partie centrale du bateau, qui forme ainsi une dunette. C’est sous cette dunette que se trouvent les logements de l’état-major. Sur le carré central très vaste, s’ouvrent six cabines de 2 mètres de superficie et deux autres un peu plus grandes ; celle de tribord était occupée par l’officier en second, celle de bâbord, qui fut habitée par ma femme jusqu’à Punta-Arenas, communiquait avec la mienne, et dans l’Antarctique servait à la fois de laboratoire de bactériologie, d’infirmerie et de débarras. Ma propre cabine donne sur la coursive avant, sur laquelle ouvrent également un grand laboratoire de photographie, une salle de bains et les water-closets, qui sont éclairés et aérés par un hublot percé dans la paroi antérieure de la dunette et qui même à la mer a pu rester presque constamment ouvert. En bas, deux petits escaliers de quatre marches font communiquer le carré avec le laboratoire de zoologie à tribord arrière et à bâbord avec une coursive donnant sur le pont arrière où s’ouvre le laboratoire des sciences physiques et d’hydrographie. Ces deux laboratoires sont construits comme des roofs sur le pont. Cette disposition permet à tous nos appartements d’être chauffés par un poêle unique installé dans le carré, et qui, allumé, a toujours donné une température de 12° à 14°.
Sous un roof sur le pont avant se trouvent la cuisine, l’office et un passage qui s’ouvre à tribord sur un escalier utilisé par mauvais temps à la mer qui donne sur le pont de la dunette, à bâbord par une porte facile à condamner donnant sur le pont avant, uniquement utilisée pendant l’hivernage lorsque le bateau était recouvert de son taud. Les logements de l’état-major communiquent avec l’extérieur soit par ce roof avant, soit par l’arrière et sont éclairés par une grande claire-voie et un hublot dans chaque cabine. En arrière de la machine se trouve une soute garnie de plomb, destinée aux caisses d’essence et deux soutes à voiles. Sur le pont à l’extrémité arrière, une grande tortue contenait du matériel varié et en particulier les appareils océanographiques.
Les poulaines de l’équipage se trouvent sur le pont à l’avant.
Tous les logements, tant de l’équipage que de l’état-major, ainsi que la cuisine et les laboratoires sont entièrement doublés sous le vaigrage d’une lame de feutre de 2 centimètres d’épaisseur. Ce feutrage est indispensable pour prévenir la formation de glace à l’intérieur qui, sans cette précaution, serait inévitable quelle que soit l’épaisseur des parois. Pour la même raison, tous les morceaux de métal en communication avec l’extérieur sont recouverts de peinture au liège.
Les soutes à charbon sont au nombre de trois, deux latérales de chaque côté de la chaudière, et une grande centrale en avant de celle-ci ; elles peuvent contenir 250 tonnes de charbon en briquettes bien arrimées.
La grande soute à vivres n’avait d’autre communication qu’un panneau donnant sur le carré, de sorte que rien ne pouvait en sortir sans passer sous nos yeux. Au-dessous du poste d’équipage, se trouvent les caisses à eau d’une contenance de 18 tonnes et une assez vaste soute pour du matériel.
J’avais fourni à chaque membre de l’état-major l’ameublement de sa cabine, dont les pièces principales consistaient en un lit-commode, un bureau et une toilette que chacun pouvait disposer à sa guise, étant libre également de faire faire toutes les armoires et étagères qu’il jugeait nécessaires. Partout où cela avait été possible, j’avais disposé dans le carré et dans les coursives des armoires et des caissons. En plus de deux bibliothèques montées dans le carré, une étagère courait autour de tous les logements, où nous avons pu ranger près de 2 000 livres.
Les laboratoires avaient été disposés d’après les indications de ceux qui devaient y travailler.
À l’avant de la dunette s’élève une timonerie, abritant une des deux roues du gouvernail, la table à cartes et les instruments usuels de navigation. Enfin, en haut du grand mât, se trouve la marque distinctive de tout bateau polaire, le tonneau classique et indispensable pour la navigation dans les glaces, connu sous le nom de nid de corbeau. On y parvient par une échelle de corde, partant des barres de perroquet. Généralement la voix est suffisante pour envoyer les ordres sur le pont, mais par excès de précaution, nous y avons installé un téléphone haut-parleur Le Las, aimablement offert par son inventeur, et qui a fonctionné admirablement pendant toute la durée de la campagne. Le Pourquoi-Pas ? possédait même une véritable œuvre d’art. Le Père de Guebriant, un de nos courageux missionnaires de Chine auquel j’avais autrefois rendu un service sans m’en douter, avait tenu à offrir à notre navire la devise de la marine française. Cette pièce magnifique en argent et cuivre avait été dessinée par le comte de Chabannes La Palice et exécutée par R. Linzeler (voir page 370).
L’éclairage d’une expédition appelée à passer plusieurs mois dans une nuit presque complète mérite d’appeler particulièrement l’attention. Partout à profusion, et en particulier dans chaque cabine, j’avais placé d’excellentes petites lampes à pétrole, d’une faible consommation, et enfin sur le conseil du marquis de Dion, j’avais fait installer un groupe électrogène de Dion-Bouton, actionné par un moteur de huit chevaux et des accumulateurs provenant de la même maison ; pour éviter que ceux-ci ne gèlent, ils avaient été placés sous le roof avant, contre la paroi de l’office chauffée par la cuisine. J’avais jugé au départ que cet éclairage devait être considéré comme un luxe, dont on ne profiterait que deux fois par semaine et dans des circonstances exceptionnelles. De fait, sous l’habile surveillance de Bongrain, secondé par l’ex-matelot torpilleur Lerebourg et le mécanicien de moteurs Frachat, cette installation jusqu’à présent inusitée dans les expéditions polaires, a fonctionné constamment pendant deux ans, pour ainsi dire sans un moment d’arrêt, prouvant l’excellence du moteur et des accumulateurs et je ne saurais trop insister sur les services inappréciables qu’elle nous a rendus.
Dans les régions polaires, où la plupart du temps on n’obtient d’eau douce que par la fonte de la neige ou de la glace, il faut songer aux moyens pratiques de se la procurer. Pour y parvenir, j’avais fait disposer en communication avec le fourneau de la cuisine un grand bain-marie d’une contenance de 250 litres, dans lequel on pouvait jeter des morceaux de glace par un trou percé dans le toit du roof, au fur et à mesure de la consommation. Grâce à cet appareil, nous avons eu, économiquement et sans ennui, autant d’eau que cela nous était nécessaire. Tant que la chaudière de la machine était allumée, un serpentin en communication avec elle nous permettait, de plus, de faire fondre rapidement la glace, pour l’alimentation des caisses à eau et de la chaudière elle-même.
Les embarcations étaient nombreuses, car mon expérience précédente m’avait prouvé, qu’en dehors de celles indispensables au service du bord, il pouvait être utile d’en avoir, non seulement pour les différents travaux de chacun, mais encore pour le transport sur la glace et même au besoin pour installer des postes de secours ou de ravitaillement éventuel. Toutes étaient à franc bord pour éviter que les clins ne soient arrachés par la glace. Nous avions un grand canot, un you-you, deux solides baleinières comme en emportent les phoquiers norvégiens et dont l’une avait fait sur le Français la première expédition, deux petites norvégiennes, connues sous le nom de prams, quatre doris, ces embarcations plates et légères dont se servent les pécheurs du banc de Terre-Neuve et qui se mettent les unes dans les autres, deux berthons, et une petite embarcation pliante système Williamson. Enfin, le père Gautier nous avait construit une solide vedette, spécialement adaptée à la navigation dans les glaces, avec un avant arrondi renforcé par une armature de fer. Cette excellente embarcation de mer était actionnée par un moteur de Dion-Bouton de 8 chevaux qui a admirablement bien fonctionné malgré un travail prolongé et des plus durs, rendant à l’expédition des services considérables.
En dehors des instruments et du matériel habituel à tout navire naviguant au long cours, nous emportions une dizaine de scies à glace et autant de ciseaux, douze ancres à glace petites et grandes et quantité de pieux, de gaffes à glace, de pelles, pioches, leviers et bêches.
L’excellent appareil Lucas, si peu encombrant et qui permet de sonder jusqu’à 6 000 mètres, était placé sur le gaillard arrière et actionné au début par une dynamo avantageusement remplacée dans la suite par une petite machine à vapeur.
Sur l’avant à tribord, se trouvait la bobine d’enroulement à vapeur du câble en fil d’acier de la drague que nous pouvions envoyer jusqu’à 4 000 mètres de profondeur.
J’avais préparé le matériel de raid avec le plus grand soin et prenant pour exemple l’expédition de la Discovery j’avais tout organisé pour des groupes indépendants de trois personnes. J’avais fait faire six tentes pour trois personnes, six cuisines Nansen légèrement modifiées par moi-même également pour trois, six services de gamelles, etc. ; les provisions pour ces raids dont j’aurai l’occasion de parler dans la suite comme de tout ce matériel, étaient groupés par paquets d’un repas pour trois, de sorte qu’on n’avait qu’à en verser le contenu dans la casserole, évitant ainsi une manipulation rendue pénible par les basses températures et la fatigue des marches.
Les vêtements étaient en abondance à bord, consistant surtout en lainages de toutes sortes et les tricots, bas et mitaines se comptaient par centaines. Nous nous étions précautionnés de pièces d’étoffe et d’une machine à coudre. D’importants cadeaux de MM. Linzeler, Vimont et Deniau sont venus s’ajouter aux fournitures du bord. Par précaution, au cas surtout ou un accident nous aurait obligés à hiverner sans l’abri du bateau, j’avais cru devoir emporter des vêtements en peau de renne et un lit-sac en même matière pour chaque homme. En dehors des lits-sacs indispensables pour les raids, les circonstances ne nous ont pas permis d’utiliser ces fourrures. En général, nous étions relativement peu couverts, mais une pièce de vêtement indispensable est l’anorak, sorte de surtout en toile souple mais serrée muni d’un capuchon, qui se passe par-dessus l’habillement ordinaire et garantit admirablement du froid en empêchant le vent de pénétrer ; pour le travail ordinaire une solide toile cachou était suffisante, mais pendant les raids, l’étoffe, connue sous le nom de burberry, par sa légèreté et par son imperméabilité absolue au vent et à la neige, est certainement ce que l’on peut désirer de mieux.
Ma précédente expérience m’avait fait envisager très sérieusement, la question si importante des chaussures et nous emportions un approvisionnement considérable et varié de bottes ordinaires, de bottes en cuir avec semelle de bois dont 70 paires offertes par un ami M. Perchot, de sabots munis de tiges en toile goudronnée à la mode des pêcheurs d’Islande, de fortes bottines de montagne, de chaussons de chasseurs alpins fabriqués pour nous par le tailleur d’un de ces bataillons, de linskoes et de komagers norvégiens. Ces dernières chaussures, sortes de mocassins en peau de renne, bien connues depuis les expéditions modernes et sur lesquelles je me suis déjà longuement étendu, sont les seules utilisables pour la marche dans les grands froids, dès qu’on se trouve éloigné du bateau ; leur inconvénient est d’être très glissantes sur la glace dure, créant ainsi un réel danger sur les glaciers ; pour y remédier j’avais fait faire d’après le modèle de ceux préconisés par le capitaine Scott, des espèces d’espadrilles en toile munies de forts crampons que nous pouvions passer par-dessus et qui furent extrêmement pratiques.
Pour protéger les yeux contre l’ophtalmie des neiges, j’avais fait préparer des lunettes munies de verres jaunes ou d’écrans percés d’entailles en croix ; on verra dans le récit de l’expédition que, grâce à ces précautions, il n’y a pas eu un seul cas de cette ophtalmie.
Nous emportions douze traîneaux du modèle universellement adopté par les expéditions polaires, plusieurs paires de skis pour chaque homme, devant servir non seulement aux marches, mais encore à leur amusement, ainsi que quelques luges, des raquettes et le matériel habituel de montagnes et de raids, cordes, piolets, sacs à dos, lanternes, etc., sans oublier les bouteilles thermos qui rendent les plus grands services dans ces pays, où l’on souffre de la soif presque autant que dans les pays chauds et où les gourdes sont inutilisables.
Pour toutes les fournitures venant de Norvège tant en vêtements et fourrures qu’en matériel polaire skis, traîneaux, etc., M. Crichton Somerville, résident à Christiania, a bien voulu se charger avec un soin extrême et une grande compétence de les choisir ou de les faire fabriquer.
La possibilité de rencontrer une plaine de glace, comme celle qui constitue la barrière de Ross, m’avait fait envisager l’intérêt qu’il y aurait à emporter des traîneaux automobiles. Le marquis de Dion et M. Bouton, avec leur habituelle générosité et leur enthousiasme pour toute idée nouvelle, me proposèrent de faire don à l’expédition des véhicules désirés. Le capitaine Scott travaillait la même question ; nous décidâmes de faire nos expériences en commun et je me souviendrai toujours des moments si agréables et si utiles que nous avons passés avec lui et ses collaborateurs, MM. Skelton et Barne. Elles eurent lieu en plein hiver au Lautaret avec le concours du lieutenant de La Besse qui s’occupe depuis longtemps de traîneaux automobiles. Le ministre de la Guerre le général Picquart, mit à notre disposition, pendant les huit jours qu’elles durèrent une dizaine d’hommes de nos garnisons alpines. Les résultats parurent des plus encourageants ; M. Coursier, ingénieur des Établissements de Dion-Bouton qui avait assisté aux expériences, se mit au travail avec ardeur et nous avons pu, grâce à lui, emporter trois traîneaux automobiles sur lesquels nous fondions de grandes espérances, malheureusement nous n’avons jamais rencontré dans la région parcourue, un terrain nous permettant de les utiliser. MM. de Dion, Bouton et Coursier peuvent se consoler de ce contretemps par les services que la vedette et le groupe électrogène ont rendus à l’Expédition.
Nous emportions pourprés de trois années de vivres et pour cette importante fourniture je me suis adressé à de grandes maisons françaises, anglaises, allemandes, norvégiennes et américaines. Les progrès de l’industrie des conserves ne rendent véritablement difficile l’approvisionnement d’une expédition comme la nôtre, que par le choix, non seulement au point de vue de la variété, mais encore de l’encombrement. L’énumération de ce qui a été emmagasiné dans nos soutes, tiendrait plusieurs pages de ce volume, je puis simplement indiquer ici, que nous avions à peu près tout ce qu’il est possible d’emporter et que le choix en avait été fait avec la plus scrupuleuse attention en nous limitant aux toutes premières qualités. Les conserves et les produits alimentaires qui peuvent voyager sont maintenant généralement bien connus et une description en serait fastidieuse, cependant je dois insister sur la commodité et le très bon rendement des comprimés de toutes sortes, potages, lait, viandes, etc…. Il en est de même pour les légumes desséchés, dont quelques-uns donnent de remarquables résultats, en particulier les choux et les pommes de terre. D’ailleurs forcément, dans le courant du récit, il sera fréquemment question de la nourriture. D’une façon générale, les vivres étaient divisés : en vivres journaliers, en vivres de raids, en vivres destinés à des dépôts ou devant être débarqués en cas d’urgence et enfin en vivres de luxe.
J’aurai ultérieurement l’occasion de parler des vivres de raids. Quant aux vivres de dépôts, ils consistaient surtout en caisses de biscuits légères ; en effet, on peut toujours espérer trouver dans l’Antarctique des pingouins ou des phoques, qui fournissent une excellente viande fraîche et même au besoin la graisse qui peut servir de combustible. Ce n’est pas tout à fait une plaisanterie d’assurer qu’avec du biscuit, un couteau pour tuer et dépecer les animaux, des allumettes pour allumer la graisse, on peut vivre, tout au moins sur la plupart des côtes de l’Antarctique.
Aux approvisionnements de l’Expédition même sont venus s’ajouter de très nombreux et très agréables cadeaux offerts non seulement en France, mais encore à l’étranger, à Rio de Janeiro, à Buenos-Aires, à Punta-Arenas.
Pendant toutes les escales, tant à l’aller qu’au retour, il n’était consommé que des vivres frais.
À la longue on se fatigue des conserves, même les meilleures, surtout de celles de viande, et il est fort probable que la plupart des repas composés exclusivement de celles-ci n’auront laissé dans la mémoire des membres de l’expédition qu’un médiocre souvenir. Cependant, je me crois en droit d’affirmer qu’aucune expédition n’a été mieux approvisionnée que la nôtre, tant en qualité qu’en quantité et, jamais à bord, nous n’avons manqué de quoi que ce soit.
Le vin de cambuse était en quantités telles que l’équipage, pendant toute la durée de l’expédition, a pu avoir tous les jours la ration habituelle et fréquemment la double ; au carré le même vin était à discrétion pour ceux qui en buvaient et si bon que, pendant plusieurs semaines, j’ai pu m’amuser, en le faisant servir dans des bouteilles ornées de beaux cachets verts, à le faire passer pour du vin fin. Cette innocente plaisanterie était d’ailleurs inutile, car notre cave était fournie, grâce à de très grandes générosités, des meilleurs crus, et ceux qui avaient ainsi pensé à notre bien-être auraient été récompensés s’ils avaient vu le plaisir avec lequel nous débouchions la bonne bouteille.
La question de la consommation de l’alcool dans les expéditions a été fréquemment traitée et résolue de différentes façons ; personnellement, je le crois ni plus ni moins dangereux dans une expédition polaire qu’ailleurs, à condition d’en user avec modération ; je considère même que le rhum, dans certains cas, est un médicament des plus utiles, mais dès le début, j’avais cru devoir faire une guerre acharnée à l’apéritif qui est le grand fléau de notre pays.
Nous possédions à bord une ample provision d’antiscorbutiques, choucroute, tomates, jus de citron, et qui, joints aux légumes, fruits desséchés ou en compote, etc., étaient évidemment plus que suffisants pour nous prémunir du scorbut tel qu’il se présentait dans les expéditions d’autrefois, mais on verra que ces moyens habituels étaient inefficaces contre ce que l’on pourrait appeler le scorbut moderne, ou plus exactement « la maladie des conserves. »
D’une importance presque égale au choix des vivres, se pose la question des boîtes les contenant qui, bien faites, assurent leur conservation ; j’avais formulé à ce sujet des exigences qui malheureusement ne furent pas toujours scrupuleusement remplies par nos maisons françaises ; c’est à leur propre détriment d’ailleurs car, plus tard, si des expéditions retrouvent nos dépôts, elles pourront juger du plus ou moins bon état de conservation des différentes marques. J’avais voulu en principe que tout fût contenu dans des caisses faciles manipuler, d’un poids n’excédant pas 30 kilos, mais pour beaucoup de produits, la nécessité d’emporter de grandes quantités et l’exiguïté relative des soutes, nous obligea à les arrimer en supprimant l’encombrement de l’emballage, qui avait été cependant conservé aux vivres de dépôts. Une expédition favorisée par un budget très large aurait grand avantage à faire emballer ses provisions dans des caisses en Venesta, matière solide, étanche et légère.
Les allumettes, sur l’utilité desquelles il est inutile d’insister, étaient emballées dans des petites boites zinguées commodes à ouvrir et faciles à transporter sur traîneaux et même dans des sacs d’excursion.
Je passe sous silence les objets nécessaires à la vie ordinaire, les mille petits riens cependant indispensables pour les réparations, l’entretien de notre matériel si varié, les fabrications éventuelles, etc., la pharmacie, les instruments de chirurgie ; à la vérité la suite démontra que peu de choses avaient été oubliées, puisque nous n’avons jamais manqué de rien d’essentiel.
Le véritable nerf de l’expédition était le charbon ; le ministre de la Marine nous donna 250 tonnes de briquettes au départ, à Madère, M. Gordon-Bennett, avec son habituelle générosité, télégraphia spontanément à ses correspondants de nous remplir nos soutes à ses frais ; le Gouvernement du Brésil nous donna 100 tonnes à notre passage à Rio, et à notre retour remplit nos soutes tant à Rio qu’à Pernambouc ; enfin, à notre retour, le Gouvernement chilien nous en donna 70 tonnes. J’avais fait moi-même envoyer à Punta Arenas 300 tonnes de briquettes offertes par des Sociétés minières françaises et, avec une remarquable obligeance, le Gouvernement chilien emmagasina jusqu’à notre arrivée cet important approvisionnement dans son ponton et nous aida à embarquer le nécessaire, conservant le surplus pour notre retour. Nous avons pu ainsi partir, avec nos soutes absolument pleines d’un combustible de premier choix et l’on verra comment, dans l’Antarctique même, nous avons eu la chance de pouvoir nous approvisionner de nouveau.
Nos nombreux moteurs à essence exigeaient que nous ayions à bord 11 tonnes de ce chargement, considéré comme d’un transport si dangereux. Dans ce but nous avions fait garnir de plomb une soute située à l’arrière du bateau, dans laquelle des bidons de 18 litres de Motricine, enfermés deux par deux dans des caisses de bois, furent soigneusement arrimés. Un ventilateur à main aérait le fond de cette soute pour en chasser les vapeurs dangereuses qui sont plus lourdes que l’air ; à chaque changement de quart ce ventilateur était mis en mouvement et c’est ainsi que, sans accident, nous avons pu effectuer ce délicat transport.
En ce qui concerne le choix de l’état-major du Pourquoi-Pas ? je ne puis que répéter ce que je disais à ce sujet pour le Français, il est extrêmement facile dans notre pays de réunir de savants collaborateurs disposés à donner leur temps, à exposer même leur vie sans espoir de la moindre rémunération.
Plusieurs de mes camarades de l’ancienne expédition auraient voulu de nouveau faire partie de celle-ci, et un de mes plus chers désirs aurait été ainsi réalisé ; mais, le lieutenant de vaisseau A. Matha, après sa longue absence, se devait à la confiance justifiée que lui témoignait la Marine nationale et l’ingénieur P. Pléneau à la Société industrielle qui l’avait si bien choisi pour une entreprise difficile en Sibérie et en Mongolie : mon amitié pour eux m’obligea même à leur conseiller d’abandonner pour cette fois tout projet de ce genre. J’eus cependant la chance de revoir à côté de moi l’ami dévoué et le précieux collaborateur de la première heure E. Gourdon.
L’état-major définitivement constitué se composa de trois officiers de marine, d’un géologue, de deux naturalistes, d’un physicien et de moi-même. Les différents travaux faisant partie de notre programme furent répartis entre ces messieurs de la façon suivante :
M. Bongrain, enseigne de vaisseau. Second de l’expédition. (Observations astronomiques, hydrographie, sismographie, gravitation terrestre.)
J. Bouch, enseigne de vaisseau. (Météorologie, électricité atmosphérique, océanographie physique.)
R. Godfroy, enseigne de vaisseau. (Étude des marées, chimie de l’air.)
E. Gourdon, docteur ès sciences. (Géologie et glaciologie.)
J. Liouville, docteur en médecine. (Médecin en second de l’expédition, zoologie.)
L. Gain, licencié ès sciences. (Zoologie et botanique.)
A. Senouque. (Magnétisme, actinométrie, photographie scientifique.)
J.-B. Charcot, chef de l’expédition, commandant du Pourquoi-Pas ? (Bactériologie.)
En dehors des travaux dont ils étaient chargés, les officiers de marine assuraient avec moi la navigation et le service du bord.
Je suis heureux de pouvoir affirmer que c’est grâce à l’ardeur, au travail et au savoir de mes collaborateurs, que l’expédition a pu réussir et les remerciements que je leur adresse sont d’autant plus chaleureux qu’ils m’ont permis ainsi d’affirmer notre succès, sans que je puisse être taxé de vanité personnelle.
J’ai eu pour recruter l’équipage les mêmes facilités et j’ai eu à choisir parmi plus de 250 demandes. Presque tout l’ancien équipage du Français embarqua de nouveau sur le Pourquoi-Pas ? m’assurant un noyau d’hommes aguerris et dévoués. E. Chollet naviguait sous mes ordres depuis 24 ans, J. Guegen avait fait quatre campagnes avec moi, J. Jabet et F. Libois, trois. Doués d’un excellent esprit, matelots dans toute la meilleure acception du mot et entraînés par l’exemple des anciens, les nouveaux surent montrer les mêmes qualités.
L’équipage définitif du Pourquoi-Pas ? était ainsi constitué :
Il serait difficile de trouver un meilleur équipage que le nôtre, plus énergique, plus dévoué, plus courageux, plus endurant et plus débrouillard. Tous ne demandaient qu’à bien faire et ils n’ont jamais hésité à accomplir leur devoir gaiment et avec enthousiasme. Il n’y avait pas de cahier de punition à bord et le besoin ne s’en est jamais fait sentir.
Dès que le Pourquoi-Pas ? a été lancé, état-major et équipage se sont mis au travail pour les installations définitives et pour l’embarquement et l’arrimage des vivres et du matériel. Cette dernière opération commencée pour ne pas perdre de temps à Saint-Malo, tandis qu’on montait la machine et qu’on terminait le gréement, a été achevée au Havre.
Confiante dans notre bonne volonté et notre désir de bien faire, la ville du Havre nous témoigna sa sympathie d’une façon touchante, le 15 août 1908 ; amis et parents, au milieu d’un public ému, accouru de toutes parts pour nous prouver que la France ne reste jamais insensible aux efforts de ses enfants, nous souhaitaient bon voyage et réussite, tandis que la Marseillaise répondait au salut d’adieu du Pourquoi-Pas ?
Le même jour nous arrivions à Cherbourg, où nous fûmes aimablement reçus par l’amiral Bellue, préfet maritime. Par son empressement à faciliter l’embarquement du charbon et du matériel que le ministre de la Marine mettait à notre disposition, il nous montra une fois de plus tout l’intérêt que la Marine nationale prenait à notre œuvre.
Le mauvais temps persistant, nous obligea à rester à Cherbourg jusqu’au 31 août ; impatients d’être en route, nous appareillions à la première éclaircie, mais nous lûmes assaillis à la hauteur des Casquets par une des plus fortes tempêtes de l’année qui occasionna de nombreux désastres maritimes. Le Pourquoi-Pas ? pour ses débuts fit preuve de ces excellentes qualités qui nous furent si précieuses dans la suite, mais après vingt-quatre heures de lutte, pour ne pas dépenser inutilement notre charbon et revenir sur nos pas, nous relâchions à Guernesey, d’où nous repartions le 5 septembre pour arriver en rade de Madère le 12 ; nous en repartions trois jours après et le 22 nous faisions à Porto Grande (île de Saint-Vincent), une escale de vingt-quatre heures.
Le 12 octobre nous étions à Rio de Janeiro, où un accueil inattendu nous était réservé de la part du peuple brésilien, du Gouvernement, et de la colonie française ayant à sa tête notre vice-consul M. Charlat. Le baron de Rio Branco ministre des Affaires étrangères, reçut toute la Mission au Palais d’Itamaraty et le ministre de la Marine, l’amiral Alexandrino de Aleucar, nous fit le grand honneur de venir à bord du Pourquoi-Pas ? L’arsenal fut mis entièrement à notre disposition avec une générosité telle que nous n’osions plus formuler un désir de peur de paraître indiscrets. Les cadeaux et les amabilités des particuliers affluèrent de tous côtés, se joignant aux dons du Gouvernement, Mme de Barros Cobra, la femme du capitaine de corvette qui devint et resta un des amis les plus dévoués de l’Expédition, nous fit l’honneur de nous remettre un pavillon particulier du Pourquoi-Pas ? en soie brodé de ses mains.
Le 20, nous quittions ce magnifique et prospère pays pour arriver à Buenos-Aires.
Les relations que j’avais conservées avec la République Argentine depuis l’inoubliable accueil qu’elle fit à l’expédition du Français, tant à son départ, qu’à son retour, m’avaient permis de prévoir que nous y serions les bienvenus, mais la République Argentine tenait à me prouver qu’elle est toujours capable de faire mieux. Sur la proposition du Dr Pinero, les Chambres avaient décidé de voter des crédits illimités pour subvenir aux besoins quels qu’ils soient de notre Mission. Le Pourquoi-Pas ? passa en cale sèche, subit toutes les améliorations possibles. Avec une générosité des plus larges, il lui fut donné tout le matériel qui pouvait lui manquer. J’eus l’honneur d’être présenté au Président de la République par notre Ministre, M. Thiébaut et la collectivité française lutta avec le peuple argentin pour nous rendre cette escale à la fois utile et agréable. J’y retrouvai mes amis si chers et si dévoués, le Dr Fernando Perez et son frère Manuel, le professeur Lignières, le colonel Nunez, le Dr Pinero, les amiraux Garcia et Barilari, l’ingénieur en chef Sumblad Rosetti, MM. Lainez, Py, Thays, Davis, Lahille, le Père Sola et tant d’autres dont les années passées n’avaient fait que raffermir l’amitié.
Le 23 novembre, nous quittions Buenos-Aires, et le 1er décembre nous mouillions en rade de Punta-Arenas. C’était notre dernière escale en pays civilisé, mais elle ne fut point celle où l’on nous témoigna le moins de sympathie. Le Gouvernement chilien avait mis à notre disposition toutes les ressources de cette ville et le ministre de France à Santiago, M. Desprez, par ses aimables dépêches tant au départ qu’au retour, sut nous prouver que dans ce pays avancé vers les régions où nous allions disparaître pendant de longs mois, la France veillait sur nous. La petite colonie française et les habitants nous fêtaient et nous choyaient et j’espère que je saurai, dans le récit qui va suivre, faire comprendre tout le bénéfice que l’Expédition tira de cette escale et la profonde et reconnaissante amitié qui me lie désormais à ceux de ses habitants dont j’aurai à citer les noms.
À Punta-Arenas, ma femme, qui m’avait courageusement accompagné jusque-là, me quitta, pour retourner veiller pendant mon absence sur notre foyer. Cette séparation prévue et inévitable fut néanmoins un déchirement que seule nous permit de supporter notre haute idée du devoir.
Quelques personnes ont pu sourire de la présence d’une femme à bord pendant cette traversée et chercher même à y trouver un prétexte pour diminuer le côté grave et sérieux de notre œuvre, mais d’autres, et c’est heureusement la majorité, n’y ont vu qu’une preuve touchante de tendresse, de courage et d’intérêt même pour le but que je poursuivais ; c’est l’opinion de ceux-là seuls qui m’importe. Mon unique souci était de travailler pour mon pays et pour l’honneur d’un nom illustré par mon père et qui m’était rendu encore plus cher par celle qui a voulu, en le faisant sien, m’aider à en supporter le poids.