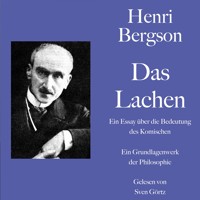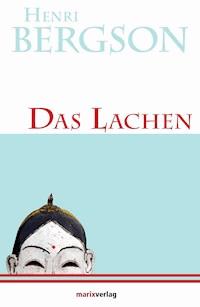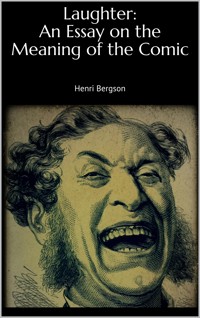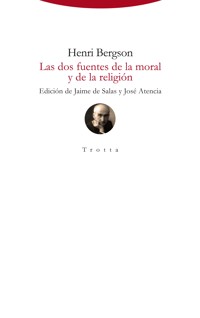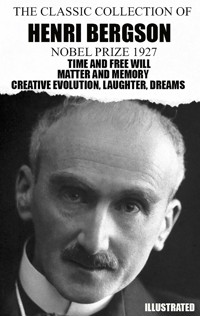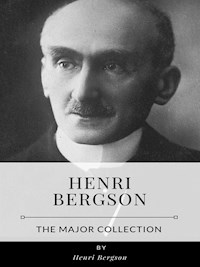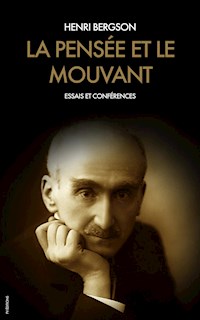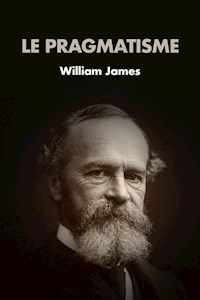
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alicia Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
*** Cet ebook est optimisé pour la lecture numérique ***
Comment parler du pragmatisme après William James ? Et que pourrions-nous en dire qui ne se trouve déjà dit, et bien mieux dit, dans le livre saisissant et charmant dont nous avons ici la traduction fidèle ? H. Bergson
William James est un psychologue et philosophe américain. Il est un des membres les plus éminents de la génération de penseurs qui ont contribué à donner à la pensée américaine sa propre tonalité. Il est non seulement un des fondateurs du pragmatisme mais également de la philosophie analytique. L'ouvrage qui suit, préfacé par Henri Bergson, est composé de huit leçons qui furent faites sous forme de conférences à Boston et à New York entre décembre 1906 et janvier 1907.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Le Pragmatisme
William James
Table des matières
Préface de M. Bergson
Préface de l’auteur
Première leçon : LE DILEMME DE LA PHILOSOPHIE MODERNE
Deuxième leçon : CE QU’EST LE PRAGMATISME
Troisième leçon : TROIS PROBLÈMES MÉTAPHYSIQUES
I
II
III
Quatrième leçon : L’UN ET LE MULTIPLE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Cinquième leçon : LE PRAGMATISME ET LE SENS COMMUN
Sixième leçon : THÉORIE PRAGMATISTE DE LA VÉRITÉ
Septième leçon : LE PRAGMATISME ET L’HUMANISME
Huitième leçon : LE PRAGMATISME ET LA RELIGION
Appendice : La notion pragmatiste de la vérité, défendue contre ceux qui ne la comprennent pas
À la Mémoire
de
JOHN STUART M1LL
qui, le premier, m'enseigna
la largeur d'esprit du pragmatiste,
et dont j'aime à me persuader
qu'il serait aujourd'hui notre chef,
s'il était encore parmi nous.
William James.
Préface de M. Bergson
Comment parler du pragmatisme après William James ? Et que pourrions-nous en dire qui ne se trouve déjà dit, et bien mieux dit, dans le livre saisissant et charmant dont nous avons ici la traduction fidèle ? Nous nous garderions de prendre la parole, si la pensée de James n'était le plus souvent diminuée, ou altérée, ou faussée, par les interprétations qu'on en donne : bien des idées circulent, qui risquent de s'interposer entre le lecteur et le livre, et de répandre une obscurité artificielle sur une œuvre qui est la clarté même.
On comprendrait mal le pragmatisme de James si l'on ne commençait par modifier l'idée qu'on se fait couramment de la réalité en général. On parle du « monde » ou du « cosmos » ; et ces mots, d'après leur origine, désignent quelque chose de simple, tout au moins de bien composé. On dit « l'univers », et le mot fait penser à une unification possible des choses. On peut être spiritualiste, matérialiste, panthéiste, comme on peut être indifférent à la philosophie et satisfait du sens commun : toujours on se représente un ou plusieurs principes simples, par lesquels s'expliquerait l'ensemble des choses matérielles et morales.
C'est que notre intelligence est éprise de simplicité. Elle économise l'effort, et veut que la nature se soit arrangée de façon à ne réclamer de nous, pour être pensée, que la plus petite somme possible de travail. Elle se donne donc juste ce qu'il faut d'éléments ou de principes pour recomposer avec eux la série indéfinie des objets et des événements.
Mais si, au lieu de reconstruire idéalement les choses pour la plus grande satisfaction de notre raison, nous nous en tenions purement et simplement à ce que l'expérience nous donne, nous penserions el nous nous exprimerions d'une tout autre manière. Tandis que notre intelligence, avec ses habitudes d'économie, se représente les effets comme strictement proportionnés à leurs causes, la nature, qui est prodigue, met dans la cause bien plus qu'il n'est requis pour produire l'effet. Tandis que notre devise à nous est Juste ce qu'il faut, celle de la nature est Plus qu'il ne faut, — trop de ceci, trop de cela, trop de tout. La réalité, telle que James la voit, est redondante et surabondante. Entre cette réalité et celle que les philosophes reconstruisent, je crois qu'il eût établi le même rapport qu'entre la vie que nous vivons tous les jours et celle que les acteurs nous représentent, le soir, sur la scène. Au théâtre, chacun ne dit que ce qu'il faut dire et ne fait que ce qu'il faut faire ; il y a des scènes bien découpées ; la pièce a un commencement, un milieu, une fin ; et tout est disposé le plus parcimonieusement du monde en vue d'un dénouement qui sera heureux ou tragique. Mais, dans la vie. il se dit une foule de choses inutiles, il se fait une foule de gestes inutiles, il n'y a guère de situations nettes ; rien ne se passe aussi simplement, ni aussi complètement, ni aussi joliment que nous le voudrions ; les scènes empiètent les unes sur les autres ; les choses ne commencent ni ne finissent ; il n'y a pas de dénouement entièrement satisfaisant, ni de geste absolument décisif, ni de ces mots qui portent et sur lesquels on reste : tous les effets sont gâtés. Telle est la vie humaine. Et telle est sans doute aussi, aux yeux de James, la réalité en général.
Certes, notre expérience n'est pas incohérente. En même temps qu'elle nous présente des choses et des faits, elle nous montre des parentés entre les choses et des rapports entre les faits : ces relations sont aussi réelles, aussi directement observables, selon William James, que les choses et les faits eux-mêmes. Mais les relations sont flottantes et les choses sont fluides. Il y a loin de là à cet univers sec, que les philosophes composent avec des éléments bien découpés, bien arrangés, et où chaque partie n'est plus seulement reliée à une autre partie, comme nous le dit l'expérience, mais encore, comme le voudrait notre raison, coordonnée au Tout.
Le « pluralisme » de William James ne signifie guère autre chose. L'antiquité s'était représenté un inonde clos, arrêté, fini : c'est une hypothèse, qui répond à certaines exigences de notre raison. Les modernes pensent plutôt à un infini : c'est une autre hypothèse, qui satisfait à d'autres besoins de notre raison. Du point de vue où .lames se place, et qui est celui de l'expérience pure ou de 1' « empirisme radical », la réalité n'apparaît plus comme finie ni comme infinie, mais simplement comme indéfinie. Elle coule, sans que nous puissions dire si c'est dans une direction unique, ni même si c'est toujours et partout la même rivière qui coule.
Notre raison est moins satisfaite. Elle se sent moins à son aise dans un inonde où elle ne retrouve plus, comme dans un miroir, sa propre image. Et, sans aucun doute, l'importance de la raison humaine est diminuée. Mais combien l'importance de l'homme lui-même, — de l'homme tout entier, volonté et sensibilité autant qu'intelligence. — va s'en trouver accrue !
L'univers que notre raison conçoit est, en effet, un univers qui dépasse infiniment l'expérience humaine, le propre de la raison étant de prolonger les données de l'expérience, de les étendre par voie de généralisation, enfin de nous faire concevoir bien plus de choses que nous n'en apercevrons jamais. Dans un pareil univers, l'homme est censé faire peu de chose et occuper peu de place : ce qu'il accorde à son intelligence, il le retire à sa volonté. Surtout, ayant attribué à sa pensée le pouvoir de tout embrasser, il est obligé de se représenter toutes choses en termes de pensée : à ses aspirations, à ses désirs, à ses enthousiasmes il ne peut demander d'éclaircissement sur un monde où tout ce qui lui est accessible a été considéré par lui, d'avance, comme traduisible en idées pures. Sa sensibilité ne saurait éclairer son intelligence, dont il a fait la lumière même.
La plupart des philosophies rétrécissent donc notre expérience du côté sentiment et volonté, en même temps qu'elles la prolongent indéfiniment du côté pensée. Ce que James nous demande, c'est de ne pas trop ajouter à l'expérience par des vues hypothétiques, c'est aussi de ne pas la mutiler dans ce qu'elle a de solide. Nous ne sommes tout à fait assurés que de ce que l'expérience nous donne ; mais nous devons accepter l'expérience intégralement, et nos sentiments en font partie au même titre que nos perceptions, au même titre par conséquent que les « choses ». Aux yeux de William James, l'homme tout entier compte.
Il compte même pour beaucoup dans un monde qui ne l'écrase plus de son immensité. On s'est étonné de l'importance que James attribue, dans un de ses livres1, à la curieuse théorie de Fechner, qui fait de la Terre un être indépendant, doué d'une âme divine. C'est qu'il voyait là un moyen commode de symboliser — peut-être même d'exprimer — sa propre pensée. Les choses et les faits dont se compose notre expérience constituent pour nous un monde humain2, relié sans doute à d'autres, mais si éloigné d'eux et si près de nous que nous devons le considérer, dans la pratique, comme suffisant à l'homme et se suffisant à lui-même. Avec ces choses et ces événements nous faisons corps, — nous, c'est-à-dire tout ce que nous avons conscience d'être, tout ce que nous éprouvons. Les sentiments puissants qui agitent l'âme à certains moments privilégiés sont des forces aussi réelles que celles dont s'occupe le physicien ; l'homme ne les crée pas plus qu'il ne crée de la chaleur ou de la lumière. Nous baignons, d'après James, dans une atmosphère que traversent de grands courants spirituels. Si beaucoup d'entre nous se raidissent, d'autres se laissent porter. Et il est des âmes qui s'ouvrent toutes grandes au souffle bienfaisant. Celles-là sont les âmes mystiques. On sait avec quelle sympathie James les a étudiées. Quand parut son livre sur L’Expérience religieuse, beaucoup n'y virent qu'une série de descriptions très vivantes et d'analyses très pénétrantes, — une psychologie, disaient-ils, du sentiment religieux. Combien c'était se méprendre sur la pensée de l'auteur ! La vérité est que James se penchait sur l'âme mystique comme nous nous penchons dehors, un jour de printemps, pour sentir la caresse do la brise, ou comme, au bord de la mer, nous surveillons les allées et venues des barques et le gonflement de leurs voiles pour savoir d'où souffle le vent. Les âmes que remplit l'enthousiasme religieux sont véritablement soulevées et transportées : comment ne nous feraient-elles pas prendre sur le vif, ainsi que dans une expérience scientifique, la force qui transporte et qui soulève ? Là est sans doute l'origine, là est l'idée inspiratrice du « pragmatisme » de William James. Celles des vérités qu'il nous importe le plus de connaître sont, pour lui, des vérités qui ont été senties et vécues avant d'être pensées3 .
De tout temps on a dit qu'il y a des vérités qui relèvent du sentiment autant que de la raison ; et de tout temps aussi on a dit qu'à côté des vérités, que nous trouvons faites il en est d'autres que nous aidons à se faire, qui dépendent en partie de notre volonté. Mais il faut remarquer que, chez James, cette idée prend une force et une signification nouvelles. Elle s'épanouit, grâce à la conception de la réalité qui est propre à ce philosophe, en une théorie générale de la vérité.
Qu'est-ce qu'un jugement vrai ? Nous appelons vraie l'affirmation qui concorde avec la réalité. Mais on quoi pont consister celle concordance ? Nous aimons à y voir quoique chose comme la ressemblance du portrait au modèle : l'affirmation vraie serait celle qui copierait la réalité. Réfléchissons-y cependant : nous verrons que c'est seulement dans des cas rares, exceptionnels, que cette définition du vrai trouve son application. Ce qui est réel, c'est tel ou tel fait déterminé s'accomplissant en tel ou tel point de l'espace et du temps, c'est du particulier, c'est du changeant. Au contraire, la plupart de nos affirmations sont générales et impliquent une certaine stabilité de leur objet. Prenons une vérité aussi voisine que possible de l'expérience, celle-ci, par exemple : « la chaleur dilate les corps ». De quoi pourrait-elle bien être la copie ? Il est possible, en un certain sens, de copier la dilatation d'un corps déterminé, à des moments déterminés, en la photographiant dans ses diverses phases. Même, par métaphore, je puis encore dire que l'affirmation « cette barre de fer se dilate » est la copie de ce qui se passe quand j'assiste à la dilatation de la barre de fer. Mais une vérité qui s'applique à tous les corps, sans concerner spécialement aucun de ceux que j'ai vus, ne copie rien, ne reproduit rien. Nous voulons cependant qu'elle copie quelque chose, et, de tout temps, la philosophie a cherché à nous donner satisfaction sur ce point. Pour les philosophes anciens, il y avait, au-dessus du temps et de l'espace, un monde où siégeaient, de toute éternité, toutes les vérités possibles : les affirmations humaines étaient, pour eux, d'autant plus vraies qu'elles copiaient plus fidèlement ces vérités éternelles. Les modernes ont l'ait descendre la vérité du ciel sur la terre ; mais ils y voient encore quelque chose qui préexisterait à nos affirmations. La vérité serait déposée dans les choses et dans les faits : notre science irait l'y chercher, la tirerait de sa cachette, l'amènerait au grand jour. Une affirmation telle que « la chaleur dilate les corps » serait une loi qui gouverne les faits, qui trône, sinon au-dessus d'eux, du moins au milieu d'eux, une loi véritablement contenue dans notre expérience et que nous nous bornerions à en extraire. Même une philosophie comme celle de Kant, qui veut que toute vérité scientifique soit relative à l'esprit humain, considère les affirmations vraies comme données par avance dans l'expérience humaine : une fois cette expérience organisée par la pensée humaine en général, tout le travail de la science consisterait à percer l'enveloppe résistante des faits à l'intérieur desquels la vérité est logée, comme une noix dans sa coquille.
Cette conception de la vérité est naturelle à notre esprit et naturelle aussi à la philosophie, parce qu'il est naturel de se représenter la réalité comme un Tout parfaitement cohérent et systématisé, que soutient une armature logique. Cette armature serait la vérité même ; notre science ne ferait que la retrouver. Mais l'expérience pure et simple ne nous dit rien de semblable, et James s'en tient à l'expérience. L'expérience nous présente un flux de phénomènes : si telle ou telle affirmation relative à l'un d'eux nous permet de maîtriser ceux qui le suivront ou même simplement de les prévoir, nous disons de cette affirmation qu'elle est vraie. Une proposition telle que « la chaleur dilate les corps », proposition suggérée par la vue de la dilatation d'un certain corps, fait que nous prévoyons comment d'autres corps se comporteront en présence de la chaleur ; elle nous aide à passer d'une expérience ancienne à des expériences nouvelles : c'est un fil conducteur, rien de plus. La réalité coule ; nous coulons avec elle ; et nous appelons vraie toute affirmation qui, en nous dirigeant à travers la réalité mouvante, nous donne prise sur elle et nous place dans de meilleures conditions pour agir.
On voit la différence entre cette conception de la vérité et la conception traditionnelle. Nous définissons d'ordinaire le vrai par sa conformité à ce qui existe déjà : James le définit par sa relation à ce qui n'existe pas encore. Le vrai, selon William James, ne copie pas quelque chose qui a été ou qui est : il annonce ce qui sera, ou plutôt il prépare notre action sur ce qui va être. La philosophie a une tendance naturelle à vouloir que la vérité regarde en arrière : pour James elle regarde en avant.
Plus précisément, les autres doctrines font de la vérité quelque chose d'antérieur à l'acte bien déterminé de l'homme qui la formule pour la première fois. Il a été le premier à la voir, disons-nous, mais elle l'attendait, comme l'Amérique attendait Christophe Colomb. Quelque chose la cachait à tous les regards et, pour ainsi dire, la couvrait : il l'a découverte. — Tout autre est la conception de William .lames. Il ne nie pas que la réalité soit indépendante, en grande partie au moins, de ce (pie nous disons ou pensons d'elle ; mais la vérité, qui ne peut s'attacher qu'à ce que nous affirmons de la réalité, lui paraît être créée par notre affirmation. Nous inventons la vérité pour utiliser la réalité, comme nous créons des dispositifs mécaniques pour utiliser les forces de la nature. On pourrait, ce me semble, résumer tout l'essentiel de la conception pragmatiste de la vérité dans une formule telle que celle-ci : tandis que pour les autres doctrines une vérité nouvelle est une découverte, pour le pragmatisme c'est une invention4 .
Il ne suit pas de là que la vérité soit arbitraire. Une invention mécanique ne vaut que par son utilité pratique. De même une affirmation, pour être vraie, doit accroître notre empire sur les choses. Elle n'en est pas moins la création d'un certain esprit individuel, et elle ne préexistait pas plus à l'effort de cet esprit que le phonographe, par exemple, ne préexistait à Edison. Sans doute l'inventeur du phonographe a dû étudier les propriétés du son, qui est une réalité. Mais son invention s'est surajoutée à cette réalité comme une chose absolument nouvelle, qui ne se serait peut-être jamais produite s'il n'avait pas existé. Ainsi une vérité, pour être viable, doit avoir sa racine dans des réalités ; mais ces réalités ne sont que le terrain sur lequel cette vérité pousse, et d'autres fleurs auraient aussi bien poussé là si le vent y avait apporté d'autres graines.
La vérité, d'après le pragmatisme, s'est donc faite peu à peu, grâce aux apports individuels d'un grand nombre d'inventeurs. Si ces inventeurs n'avaient pas existé, s'il y en avait eu d'autres à leur place, nous aurions eu un corps de vérités tout différent. La réalité fût évidemment restée ce qu'elle est, ou à peu près ; mais autres eussent été les routes que nous y aurions tracées pour la commodité de notre circulation. Et il ne s'agit pas seulement ici des vérités scientifiques. Nous ne pouvons construire une phrase, nous ne pouvons même plus aujourd'hui prononcer un mot, sans accepter certaines hypothèses qui ont été créées par nos ancêtres et qui auraient pu être très différentes de ce qu'elles sont. Quand je dis : « mon crayon vient de tomber sous la table », je n'énonce certes pas un fait d'expérience, car ce que la vue et le toucher me montrent, c'est simplement que ma main s'est ouverte et qu'elle a laissé échapper ce qu'elle tenait : le bébé attaché à sa chaise, qui voit tomber l'objet avec lequel il joue, ne se ligure probablement pas que cet objet continue d'exister ; ou plutôt il n'a pas l'idée nette d'un « objet », c'est-à-dire de quelque chose qui subsiste, invariable et indépendant, à travers la diversité et la mobilité des apparences qui passent. Le premier qui s'avisa de croire à cette invariabilité et à cet indépendance fit une hypothèse : c'est cette hypothèse que nous adoptons couramment toutes les fois que nous employons un substantif, toutes les fois que nous parlons. Notre grammaire aurait été autre, autres eussent été les articulations de notre pensée, si l'humanité, au cours de son évolution, avait préféré adopter des hypothèses d'un autre genre.
La structure de notre esprit est donc en grande partie notre œuvre, ou tout au moins l'œuvre de quelques-uns d'entre nous. Là est, ce me semble, la thèse la plus importante du pragmatisme, encore qu'elle n'ait pas été explicitement dégagée. C'est par là que le pragmatisme continue le kantisme. Kant avait dit que la vérité dépend de la structure générale de l'esprit humain. Le pragmatisme ajoute, ou tout au moins implique, que la structure de l'esprit humain est l'effet de la libre initiative d'un certain nombre d'esprits individuels.
Cela ne veut pas dire, encore une fois, que la vérité dépende de chacun de nous : autant vaudrait croire que chacun de nous pouvait inventer le phonographe. Mais cela veut dire que, des diverses espèces de vérité, celle qui est le plus près de coïncider avec son objet n'est pas la vérité scientifique, ni la vérité de sens commun, ni, plus généralement, la vérité d'ordre intellectuel. Toute vérité est une route tracée à travers la réalité ; mais, parmi ces routes, il en est auxquelles nous aurions pu donner une direction très différente si notre attention s'était orientée dans un sens différent ou si nous avions visé un autre genre d'utilité ; il en est, au contraire, dont la direction est marquée par la réalité même : il en est qui correspondent, si l’on peut dire, à des courants de réalité. Sans doute celles-ci dépendent encore de nous dans une certaine mesure, car nous sommes libres de résister au courant ou de le suivre, et, même si nous le suivons, nous pouvons l'infléchir diversement, étant associés en même temps que soumis à la force qui s'y manifeste. Il n'en est pas moins vrai que ces courants ne sont pas créés par nous ; ils font partie intégrante de la réalité. Le pragmatisme aboutit ainsi à intervertir l'ordre dans lequel nous avons coutume de placer les diverses espèces de vérité. En dehors des vérités qui traduisent des sensations brutes, ce serait les vérités de sentiment qui pousseraient dans la réalité les racines les plus profondes. Si nous convenons de dire que toute vérité est une invention, il faudra, je crois, pour rester fidèle à la pensée de William James, établir entre les vérités de sentiment et les vérités scientifiques le même genre de différence qu'entre le bateau à voiles, par exemple, et le bateau à vapeur : l'un et l'autre sont des inventions humaines ; mais le premier ne fait à l'artifice qu'une part légère, il prend la direction du vent et rend sensible aux yeux la force naturelle qu'il utilise ; dans le second, au contraire, c'est le mécanisme artificiel qui tient la plus grande place ; il recouvre la force qu'il met en jeu et lui assigne une direction que nous avons choisie nous-mêmes.
La définition que James donne de la vérité fait donc corps avec sa conception de la réalité. Si la réalité n'est pas cet univers économique et systématique que notre logique aime à se représenter, si elle n'est pas soutenue par une armature d'intellec-tualité, la vérité d'ordre intellectuel est une invention humaine qui a pour effet d'utiliser la réalité plutôt que de nous introduire en elle. Et si la réalité ne forme pas un ensemble, si elle est multiple et mobile, faite de courants qui s'entrecroisent, la vérité qui naît d'une prise de contact avec quelqu'un de ces courants, — vérité sentie avant d'être conçue. — est plus capable que la vérité simplement pensée de saisir et d'emmagasiner la réalité même.
C'est donc enfin à cette théorie delà réalité que devrait s'attaquer d'abord une critique du pragmatisme. On pourra élever des objections contre elle, — et nous ferions nous-même, en ce qui la concerne, certaines réserves : personne n'en contestera la profondeur et l'originalité. Personne non plus, après avoir examiné de près la conception de la vérité qui s'y rattache, n'en méconnaîtra l'élévation morale. On a dit que le pragmatisme de James n'était qu'une forme du scepticisme, qu'il rabaissait la vérité, qu'il la subordonnait à l'utilité matérielle, qu'il déconseillait, qu'il décourageait la recherche scientifique désintéressée. Une telle interprétation ne viendra jamais à l'esprit de ceux qui liront attentivement l'œuvre. Et elle surprendra profondément ceux qui ont eu le bonheur de connaître l'homme. Nul n'aima la vérité d'un plus ardent amour. Nul ne la chercha avec plus de passion. Une immense inquiétude le soulevait ; et, de science en science, de l’anatomie ! de la physiologie à la psychologie, de la psychologie à la philosophie, il allait, tendu sur les grands problèmes, insoucieux du reste, oublieux de lui-même. Toute sa vie il observa, il expérimenta, il médita. Et comme s'il n'eût pas assez fait, il rêvait encore, en s'endormant de son dernier sommeil, il rêvait d'expériences extraordinaires et d'efforts plus qu'humains par lesquels il pût continuer, jusque par delà la mort, à travailler avec nous pour le plus grand bien de la science, pour la plus grande gloire de la vérité.
H. Bergson.
1A Pluralistc Universe, London, 1909. Traduit en français, dans la « Bibliothèque de Philosophie scientifique », sous le titre de Philosophie de l'Expérience.
2Très ingénieusement, M. André Chaumeix a signalé des ressemblances entre la personnalité de James et celle de Socrate (Revue des Deux-Mondes, 15 octobre 1910). Le souci de ramener l'homme à la considération des choses humaines a lui-même quelque chose de socratique.
3Dans la belle étude qu'il a consacrée à William James (Revue de Métaphysique et de morale, novembre 1910), M. Émile Boutroux a fait ressortir le sens tout particulier du verbe anglais to experience, « qui veut dire, non constater froidement une chose qui se passe en dehors de nous, mais éprouver, sentir en soi, vivre soi-même telle ou telle manière d'être... »
4Je ne suis pas sûr que James ait employé le mot « invention », ni qu'il ait explicitement comparé la vérité théorique à un dispositif mécanique ; mais je crois que ce rapprochement est conforme à l'esprit de la doctrine, et qu'il peut nous aider à comprendre le pragmatisme.
Préface de l’auteur
Les leçons qui vont suivre furent faites, sous forme de conférences, à l'Institut Lowell de Boston, en novembre et décembre 1906, puis à New-York, à l'Université de Colombie, en janvier 1907. On les trouvera ici reproduites telles que je les prononçai.
Le mouvement pragmatique, — puisqu'on l'appelle ainsi et qu'il est évidemment trop tard pour lui donner un autre nom, bien que celui-ci ne me plaise pas, — le mouvement pragmatique semble s'être formé assez brusquement, à la manière d'un précipité, dans l'air ambiant. Un certain nombre de tendances, qui avaient toujours existé en philosophie, ont tout à coup et collectivement pris conscience d'elles-mêmes ainsi que de leur mission collective. Ce fait s'est produit en de si nombreux pays, à des points de vue si nombreux, qu'on l'a compris de bien des manières fort peu concordantes. J'ai voulu le représenter tel qu'il s'offre à ma vue, et cela dans un tableau tracé à grands traits, où je ramènerais à l'unité toutes ces divergences et d'où j'exclurais toutes les controverses de détails. On aurait pu, je crois, s'épargner bien des discussions futiles, si nos adversaires avaient bien voulu attendre que nous eussions nettement formulé notre message, c'est-à-dire la doctrine apportée par nous.
Si quelque lecteur, s'intéressant à cette question d'une manière générale, se trouve aussi intéressé par ces leçons, il voudra sans doute faire d'autres lectures. Voici donc plusieurs références à son usage.
En Amérique, le livre essentiel est l'ouvrage de .lohn Dewey : Studies in l.ogical Theory. Qu'on lise également les articles du môme auteur dans la Philosophical Review, dans le Mind et dans le Journal of Philosophy.
Toutefois, pour commencer, c'est sans doute dans les Études sur l’Humanisme, de S. Schiller, qu'on trouvera le meilleur exposé.
Qu'on lise en outre : Le Rationnel, par G. Milhaud ; les beaux articles de Le Roy dans la Revue de Métaphysique ; enfin, les articles de Blondel et de De Sailly dans les Annales de Philosophie chrétienne.
Pour éviter un malentendu. — sans pouvoir les empêcher tous ! — qu'on me permette de dire qu'il n'y a aucun lien logique entre le pragmatisme, tel que je le comprends, et « l'empirisme radical », doctrine récemment émise par moi. Cette doctrine a son existence propre, et l'on peut la rejeter entièrement, tout en ne cessant pas d'être un pragmatiste 1.
Université Harvard, avril 1907.
1Les lecteurs français de Pragmatisme perdent en un certain sens, plus que tous autres, par la mort de l'auteur. Il avait si particulièrement, et avec tant de joie, voulu faire de ce livre un livre pour eux ! Il m'écrivait notamment, à la date du 14 juin 1909 : « Je voudrais, pour le public français, atténuer, développer, ou, de n'importe quelle autre manière, rendre plus compréhensibles, certaines façons de m'exprimer, certains termes nouveaux. Tout d'abord, je voyais là une corvée [en français dans le texte], et je ne songeais qu'à m'y dérober. Mais je me sens tout enthousiasme à présent ». Par malheur, la santé de W. James, atteinte déjà, fut bientôt plus gravement compromise. Renonçant à remanier son livre, il me demanda d'y ajouter, en appendice, des pages que j'emprunterais à un autre de ses ouvrages, non encore traduit : The Meaning of Truth « La signification de la vérité »). Il me laissait libre de choisir. Mais le choix s'imposait de lui-même en faveur d'un article, reproduit dans ce second ouvrage, et autrefois publié pour répondre à « ceux qui se méprennent » sur le pragmatisme. On me permettra sans doute de signaler ici l'importance exceptionnelle de cet appendice. (Note du traducteur.)
Première leçon : LE DILEMME DE LA PHILOSOPHIE MODERNE
« Il y a des gens, — nous dit M. Chesterton dans la préface de cet admirable recueil d'articles qu'il intitule Les Hérétiques, — il y a des gens, — et je suis de ceux-là, — pour qui la chose de la plus grande importance pratique à connaître sur un homme, est toujours sa conception de l'univers. Pour le propriétaire d'une maison, quand il s'agit d'un locataire, il importe de savoir quel revenu il possède ; mais il importe encore davantage, croyons-nous, de savoir quelle est sa philosophie. Pour un général qui va livrer bataille, il importe de connaître le nombre des troupes ennemies ; mais il lui importe encore plus, croyons-nous, de connaître la philosophie de son adversaire. La question essentielle, croyons-nous enfin, n'est pas de savoir si notre théorie de l'univers intéresse les affaires humaines, mais bien de savoir si ce n'est pas, en fin de compte, la seule chose qui les intéresse 1. »
Je partage là-dessus l'opinion de M. Chesterton. Tous, pris ensemble ou séparément, vous avez, je le sais, une philosophie, et ce qu'il y a en vous de plus important, de plus significatif à mes yeux, c'est la manière dont elle détermine pour chacun la perspective de son univers à lui. Je suis, à vos yeux, dans le même cas.
Pourtant j'avoue que je n'aborde pas sans un certain tremblement mon audacieuse entreprise. Cette philosophie, qui a tant d'importance en chacun de nous, n'est pas une chose toute technique. Les livres ne nous l'ont donnée qu'en partie. Elle est la conscience plus ou moins sourde que nous avons du sens profond de la vie, du sens qu'il faut loyalement lui reconnaître. Notre philosophie est donc notre manière propre de sentir et de nous représenter la pression, la poussée de l'univers, — de la sentir et de nous la représenter toute. Je n'ai aucunement le droit de supposer que plus d'un parmi vous étudie l'univers comme on l'étudie dans les écoles, et pas autrement. Or, voici que je prétends vous intéresser à une philosophie dans l'exposé de laquelle un certain appareil technique tient, forcément une assez grande place ! Je nie propose d'éveiller en vous une vive sympathie pour une tendance contemporaine à laquelle je suis profondément attaché ; et cependant il me faut vous tenir le langage d'un professeur, à vous qui n'êtes pas des écoliers ! À quelque conception de l'univers qu'un professeur s'arrête, elle doit comporter un développement qui ne manque pas d'ampleur : de quoi servirait l'intelligence d'un professeur pour un univers qui se définirait en deux phrases ? Il faut payer plus cher que cela pour nous convaincre !
Oui, c'est, une entreprise bien téméraire que la mienne. Ici même, dans cette salle, j'ai entendu des amis, des collègues, qui voulaient populariser la philosophie : or, on les voyait bientôt se montrer arides, redevenir techniques, et n'obtenir que des résultats à moitié encourageants. Le fondateur même du pragmatisme2 fît naguère à l'Institut Lowell, avec ce mot de « pragmatisme » pris comme titre, une série de conférences : ce furent d'éblouissants éclairs parmi des ténèbres cimmériennes ! Aucun de nous, je crois bien, n'a vraiment compris tout ce qu'il nous a dit. Et cependant, vous me voyez affrontant le même risque en ce moment !
Si je cours un tel risque, c'est que, même à ces conférences-là, j'ai toujours vu un excellent public. On subit, avouons-le, une étrange fascination à entendre parler de choses si profondes, alors même qu'on ne les comprend pas et qu'elles ne sont pas mieux comprises de ceux qui en discutent. On y éprouve le frisson des grands problèmes ; on y sent la présence de l'infini. Qu'une controverse philosophique s'engage au fumoir, et vous voyez aussitôt les oreilles se dresser. Les résultats obtenus en philosophie ont pour nous un réel intérêt vital, et ses plus étranges discussions chatouillent agréablement notre goût pour les pensées subtiles et ingénieuses.
Ayant moi-même le culte de la philosophie, étant persuadé en outre que nous voyons, les autres philosophes et moi, se lever sur nous une sorte d'aurore nouvelle, je ne résiste pas au désir de vous renseigner, coûte que coûte, sur la situation.
La philosophie est en même temps la plus sublime cl la plus banal des occupations humaines. Elle travaille dans les coins et recoins les plus minuscules, et elle ouvre les plus vastes perspectives. Elle « ne nourrit pas son homme », comme on dit, mais elle peut nous donner le courage dont notre âme a besoin. Ses façons, sa manie de tout mettre en question, les gageures, les arguties et l'appareil dialectique où elle se complaît, ont beau rebuter le vulgaire, nul d'entre nous ne saurait s'arranger de la vie sans les lointaines lueurs qu'elle projette à l'horizon. Grâce, du moins, à ces lueurs éclatantes, grâce également aux effets de contraste que produisent les ténèbres du mystère environnant, la philosophie donne à tout ce qu'elle dit un intérêt qui ne s'adresse pas, — tant s'en faut ! — qu'aux seuls professionnels.
L'histoire de la philosophie est, dans une grande mesure, celle d'un certain conflit des tempéraments humains. Plus d'un de mes collègues trouvera probablement qu'une telle idée manque de noblesse. Ce conflit, pourtant, il me faut bien en tenir compte pour expliquer, sur de nombreux points, les divergences qui se constatent parmi les philosophes.
Certes, quand il s'agit de philosopher, un philosophe, quel que soit son tempérament, s'efforce de le réduire au silence. Comme le tempérament n'est pas une de ces raisons que la convention admette, il n'invoque que des raisons impersonnelles pour établir ses conclusions. Malgré tout, ce qui pèse sur lui et l'influence le plus lourdement, ce n'est aucune des prémisses plus rigoureusement objectives par lui adoptées : c'est son tempérament. Oui, c'est du poids de ce dernier que l'évidence est comme chargée pour s'incliner dans tel sens ou dans tel autre, — soit dans le sens d'une conception de l'univers où dominent les considérations sentimentales, soit dans le sens d'une conception toute contraire. Oui, c'est à son tempérament que notre philosophe s'en rapporte. Il lui faut un univers qui aille à son tempérament ; et, par suite, l'univers auquel il croit, est celui dont l'idée se trouve effectivement lui aller. Il sent que les hommes d'un caractère opposé au sien ne sont pas au diapason de cet univers : dans le fond de son cœur, il les juge incompétents, incapables de jamais « y être », de jamais comprendre les choses de la philosophie, alors même que ces hommes lui seraient bien supérieurs comme dialecticiens.
Dans la discussion, cependant, ce n'est évidemment pas à raison de son tempérament qu'un philosophe peut s'attribuer un plus haut degré de discernement ou d'autorité. De là résulte un certain manque de sincérité dans nos débats philosophiques : c'est justement la plus décisive de toutes nos prémisses qu'on ne voit jamais énoncer ! Convaincu, moi, que ces leçons gagneraient en clarté à ce qu'un tel usage ne fût pas observé ici, je me juge maître de m'en affranchir.
Bien entendu, les philosophes dont je parle sont des hommes ayant une physionomie très nette, une idiosyncrasie bien tranchée ; « les hommes qui mettent dans la philosophie leur empreinte et leur marque personnelles ; des hommes qui font partie de son histoire. Platon. Locke, Hegel, Spencer, sont de tels hommes : des hommes dont leur tempérament fit des penseurs. Il va de soi que, la plupart du temps, nous n'avons pas un tempérament intellectuel bien défini : nous sommes un mélange d'ingrédients divers, et même opposés, dont chacun ne figure dans ce mélange que pour une dose très médiocre. A peine savons-nous de quel côté se portent nos préférences dans les questions abstraites. Ces préférences, le moindre argument en a bientôt raison, et nous ne tardons pas à suivre la mode ou bien à nous accommoder des opinions du premier philosophe venu qui se trouve faire sur nous l'impression la plus forte. Or, nul homme n'a jamais compté en philosophie qu'à la condition d'avoir sur les choses sa vision à lui, sa vision directe, personnelle et exclusive de toute autre. Mais alors tout fait croire que cette vision, qui est le propre d'un vigoureux tempérament, ne cessera jamais de compter dans l'histoire des croyances de l'humanité.
Aussi bien, cette différence particulière des tempéraments, qui me préoccupe en ce moment, elle est toujours entrée en ligne de compte dans le domaine de la littérature, de l'art, du gouvernement et des mœurs, tout autant que dans celui de la philosophie. S'agit-il des mœurs : nous y rencontrons, d'une part, les gens qui font des façons, et de l'autre ceux qui n'en font pas. S'agit-il du gouvernement : il y a les autoritaires, et il y a les anarchistes. En littérature, il y a les puristes ou les gons épris du style académique, et il y a les réalistes. En art, il y a les classiques et les romantiques. Ces contrastes vous sont familiers.
Eh bien ! en philosophie nous voyons un contraste qui leur ressemble fort : c'est celui qu'expriment les deux mots « rationaliste » et « empiriste ». Celui-ci désigne l'homme qui goûte les faits pris dans toute leur indigeste variété ; celui-là, l'homme ayant le culte des principes éternels, tout abstraits. À vrai dire, pour vivre ne fût-ce qu'une heure, tout homme a besoin de faits et de principes en même temps. Il ne s'agit donc que d'une différence de degré. Pourtant, elle suffit a entretenir les antipathies du caractère le plus aigu entre ceux chez qui l'on voit dominer l'un de ces deux éléments, et ceux chez qui l'on voit dominer l'autre. Il nous sera donc permis et commode de parler du « tempérament rationaliste » et du « tempérament empiriste » pour exprimer une certaine opposition quant à la manière dont les hommes se représentent leur univers : la distinction est ainsi rendue très simple et très marquante.
Elle n'est pas aussi marquante, aussi simple, entre les hommes que désignent ces deux termes. Dans la nature humaine, en effet, il n'y a rien qui ne soit interchangeable et n'admette toute sorte de combinaisons. Au moment où j'entreprends de définir plus explicitement ce dont je parle en parlant de rationalistes et d'empiristes ; au moment d'ajouter à ces deux étiquettes générales certaines indications accessoires qui les précisent, je dois vous avertir qu'un tel procédé ne va pas sans quelque arbitraire. Je choisis des combinaisons typiques que la nature présente très souvent, mais qu'elle présente d'une façon qui n'a rien d'uniforme. En outre, si je les choisis, c'est uniquement à raison de la commodité qu'elles auront plus tard pour moi, quand il s'agira de définir le pragmatisme.
Historiquement, on rencontre les deux termes « intellectualisme » et « sensualisme » employés comme synonymes de « rationalisme » et « empirisme ». Or, il semble que la nature combine avec l'intellectualisme, le plus souvent, une tendance idéaliste et optimiste. Les empiristes, au contraire, sont ordinairement matérialistes, outre qu'ils sont nettement portés à ne professer qu'un optimisme plein de restrictions et qui manque d'assurance.
D'un autre côté, le rationalisme est toujours moniste ; il part des « touts », des « universaux », et attache le plus grand prix à l'unité dans les choses. C'est dans les parties, au contraire, que l'empirisme prend son point de départ, pour faire du « tout »une collection : aussi n'éprouve-t-il aucune répugnance à se qualifier de pluraliste.
De plus, le rationalisme se considère généralement comme plus religieux que l'empirisme ; mais il y aura beaucoup à dire sur cette prétention, et l'on me permettra donc de ne faire que la mentionner ici. Elle se justifie quand il s'agit de tel rationaliste se trouvant être ce qu'on appelle un « sentimental » et lorsqu'il s'agit, par contre, de tel empiriste se piquant de faire fi du sentiment. Alors aussi, le rationaliste se prononcera d'ordinaire pour ce qu'on nomme le libre arbitre, tandis que l'empiriste sera un fataliste, — en prenant ces mots dans leur acception courante.
Enfin, le rationaliste montrera dans ses affirmations le tempérament d'un dogmatique, au lieu que l'empiriste pourra se montrer plus sceptique, plus porté à discuter de tout librement.
Je vais disposer sur deux colonnes les traits ainsi constatés pour chacun des deux types de combinaison mentale distingués par moi : d'une part, ce type que j'appelle le « tendre » ou le « délicat », et d'autre part celui que j'appelle le « rustre » ou le « barbare » :
LE DÉLICAT
Rationaliste (se réglant sur les principes).Intellectualiste.Idéaliste.Optimiste.Religieux.Partisan du libre arbitre.Moniste.Dogmatique.LE BARABARE
Empiriste (se réglant sur les faits).Sensualiste.Matérialiste.Pessimiste.Irréligieux.Fataliste.Pluraliste.Sceptique.Ajournons, pour le moment, la question de savoir si chacun de ces deux types possède, ou non, une parfaite consistance, une réelle cohésion interne : sur ce point je m'étendrai prochainement. Il nous suffit, quant à présent, de les reconnaître comme existant tous deux avec les traits que je leur ai attribués.
Pour chacun vous connaissez tous, sans doute, quelque échantillon caractéristique, et vous savez ce que l'un des deux échantillons pense de l'autre, c'est-à-dire combien ils s'estiment peu ! Toutes les fois que nos deux types se sont incarnés en des individus d'un vigoureux tempérament, leur antagonisme a contribué à déterminer l'atmosphère philosophique d'une époque : il en est particulièrement ainsi pour la nôtre. Les philosophes du type « barbare » reprochent au « délicat » sa sentimentalité, son manque de vigueur intellectuelle. Le « délicat » se plaint que le « barbare » soit si peu raffiné, si peu sensible et si brutal. Leur opposition réciproque ressemble assez à celle qui se produit quand des citoyens de Boston, partis en excursion, entrent en contact avec une population comme celle de Cripple Creek : chaque type se croit supérieur à l'autre ; mais chez l'un le dédain n'empêche pas l'amusement, tandis que chez l'autre le mépris se nuance d'un soupçon de peur.
Eh bien ! j'y insiste encore : il y en a peu parmi nous qui, en philosophie, soient purement et simplement des citoyens de Boston aux pieds remarquablement sensibles, ou qui appartiennent exclusivement au rude type que l'on rencontre dans les Montagnes Rocheuses. On trace une ligne de démarcation ; mais la plupart d'entre nous ont un goût très vif pour les bonnes choses qui se trouvent des deux côtés de cette ligne. Les faits ont leur prix : nous demandons qu'on nous les donne en abondance ! Les principes, à leur tour, ont leur prix, et nous demandons qu'on nous en donne beaucoup ! Sans doute, le monde est un, si vous le considérez d'une certaine façon ; mais, sans aucun doute non plus, le monde est multiple, si vous le considérez d'une autre façon. Il est en même temps un et multiple : adoptons, par conséquent, une sorte de monisme pluraliste. — Il n'y a, bien entendu, rien qui ne soit nécessairement déterminé ; mais il est bien entendu aussi que notre volonté est libre : ce qui sera donc vraiment philosophique, ce sera d'adopter une sorte de déterminisme de la volonté libre. — Le mal apparaissant dans les diverses parties de l'univers est incontestable ; mais ce n'est pas dans le tout que le mal peut résider : le pessimisme imposé par les faits se combinera donc légitimement avec une métaphysique optimiste. C'est ainsi que nous procédons partout : en philosophie, jamais le profane n'est un radical ; jamais il ne trace géométriquement son système ; il se contente d'en habiter, d'une manière toujours provisoire et tour à tour, tel compartiment ou tel autre, qu'il juge préférable selon les séductions diverses qui se succèdent avec les heures.