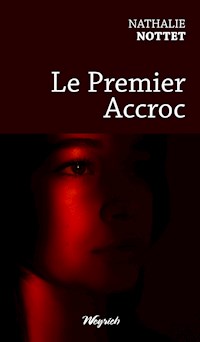
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Je suis la troisième de sept filles, l’Elsa, la silencieuse, la Triolet de la ferme crottée. « Une pour toutes, toutes pour une », c’est notre devise familiale d’après ma mère. Pourtant, le 3 décembre 1976, mes dix-sept ans en poche, je quitte mon village pour la ville, la toute grande ville…
Le Premier Accroc est un roman d’apprentissage où la solitude, l’ennui, le manque, la colère et les peurs s’entrechoquent pour donner à l’écriture de la jeune narratrice un écho tout en justesse musicale.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Nathalie Nottet est née à Namur en 1964. Psycho-criminologue de formation, elle travaille dans le secteur de l’Aide à la jeunesse. Sa pratique de l’écriture est d’abord de nature professionnelle et clinique : pigiste pour la revue Alter Echos, rédactrice à la revue Mille Lieux Ouverts… Elle a déjà publié trois romans, dont
L’Envers des pôles dans la collection « Plumes du Coq ».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À mes cousines gaumaises,
Françoise, Marianne, Maryse, Micheline, Monique, Noëlle, Pascaline.
Les secrets sont des pentes qui donnent le vertige.
Chapitre 1
Mode d’emploi de ma famillePour Elsa Triolet
J’ai quitté le village.
Le 3 décembre 1976.
Mes dix-sept ans en poche.
Sans plus de capacités.
Plus la capacité.
D’encaisser l’épais blizzard qui englue les maisons, les unes aux autres, lors des saisons sans soleil. Un village engourdi en une ligne qui descend et s’engouffre dans les eaux glacées d’un lavoir aux pierres jaunes. Laver son linge sale et suivre la route qui grimpe jusqu’à l’église, autre lieu de purification. Un slip propre pour une âme pure. Alléluia.
Une route signant une sorte de V.
Pas celui d’une victoire.
L’église assise sur le rebord du village, haut perchée près du ciel et des cieux. Pas à s’y garder au milieu, mais à en surveiller le repli de ses trois rues ainsi que les allées et venues de ses 156 habitants. Une densité de population qui frôle l’habitant au kilomètre carré.
Un record pour la région.
Plus la capacité.
D’être la fille de la première maison à gauche en descendant le village.
La fille de la ferme crottée sur le devant.
Point de repère pour randonneurs et point de fâcherie pour les bigotes froissant ce qui leur reste de fesses sur les bancs de l’église.
À y respirer de l’encens qui noircit les poumons.
Alors que Dieu n’est pas essentiel.
Plus la capacité.
D’avoir besoin de mes deux mains pour nous compter, nous, les sept filles de la ferme crottée.
Sept, ce chiffre dit magique.
Celui des jours de la semaine, de l’âge de raison et de la vie éternelle. Mais il faut ne pas le vivre pour le croire envoûtant. Et ne pas voir, dans son dessin, une faux aiguisée qui fait flipper les cœurs, car elle tutoie la mort.
Plus la capacité.
D’être l’Elsa pour la mère et la Triolet pour le père. Un truc à rendre folle malgré les prénoms qui chantent en gaumais avec un le ou la devant.
Cet article défini pour une singularité à pointer.
Ainsi à se croire unique.
Un défi irréel quand on est sept.
* * *
Il est nécessaire de connaître pour comprendre où les désastres s’enracinent.
Raison pour laquelle, Elsa1, je vais te faire un portrait de famille. La mienne. Je ne te fais pas l’affront, Elsa, de mettre un article défini devant ton prénom, tu as été singulière. Et tu l’es encore.
Je te présente les miens, de manière sommaire puisque trop n’est jamais assez, dirait le père.
La Clarisse est l’aînée et appelée comme telle par la mère. Aussi par le père, eu égard au respect pour sa mère.
Dite la Grande Clarisse. Une longue femme sèche au sourire économe accroché à de pâlottes et si peu gourmandes lèvres. Une silhouette comme une ombre d’un soleil de midi. Émincée et élaguée de toute rondeur.
Pour la mère, l’enfant qui suit se prénomme la Juliette, pour le père, la Seconde.
Un combat de prénoms contre des dénominations musicales.
Des bas de gamme. Ou des hauts.
Tout dépend d’où l’on regarde la vie.
L’ordre est utile à l’anarchie.
Cette phrase, tu aurais pu l’écrire.
Allez, Elsa, fais sonner les trompettes. Voici la cour crottée sur le devant et ses sept dauphines qui n’ont jamais vu l’océan !
Pour la mère Pour le père
La Clarisse La Clarisse
La Juliette La Seconde
L’Elsa La Triolet
La Charline La Quarte
La Marie La Quinte
La Caroline La Sixte
La Fabienne La Septième
Entre les aînées, nous avons compliqué les appellations. Tant qu’à être dans du tordu.
La Clarisse a été rebaptisée l’Unisson. Pour qu’elle ait un autre prénom et aussi souligner le seul accord parental, la Juliette Juju, la Charline Chacha, la Marie la Grosse, la Caroline Caro et Fabi pour la Fabienne.
Pour l’anecdote, la Fabienne a le privilège d’avoir pour marraine notre reine, Sa Majesté la reine Fabiola.
Sept filles, ça se couronne.
Heureusement pour elle, elle a échappé au prénom de sa si peu élégante marraine.
Je suis l’intello sur les lèvres de mes sœurs pour mon amour des livres et mes bulletins qui frôlent les sommets. Désolée, les filles, je ne souffre pas de vertige.
La mère me surnomme la Silencieuse.
Un diminutif qui te ressemble.
Peut-être même qu’il vient de toi.
* * *
Quand la mère parle de ses filles dans le village, elle cite nos prénoms comme elle épellerait des noms savants. Nos prénoms qu’elle noie dans une litanie qui fait tourner les têtes, même celles des plus érudits du village et des villages voisins, à savoir l’abbé Beauchey, l’instituteur Monsieur Gérard, le docteur Woitrin et la bibliothécaire Madame Loiseau.
Deux, trois mots pour caractériser chacune.
La Clarisse, son aînée, un mot qu’elle fait danser dans sa bouche comme un glaçon, une beauté italienne, une amoureuse rêveuse. La Juliette, un sacré caractère qui se bat à l’école pour l’honneur de la famille et collectionne les baisers des garçons. L’Elsa, la Silencieuse, le nez à se moucher dans les livres. La Charline, à grimper sur tout, une chevrette turbulente, la Marie, celle qui sera vétérinaire, dans les bêtes à suivre son père, la Caroline, la souffreteuse qui, dès qu’elle sort, s’enrhume et fait de tous les jours une histoire fantastique, dans des mots qui s’emballent et trébuchent dans leurs jambages tant elle parle vite. Dans un ton pressé et une urgence. La septième, la Fabienne, la petite dernière qui fait plus de bruit qu’un troupeau de moutons apeurés. Dans la crainte d’être oubliée. Dans une intranquillité incessante.
Inutile, Elsa, de te parler longuement de mes parents.
Mais vu que je suis habituée aux prétéritions, je vais te les présenter. Tu sais, ce truc que l’on apprend en année de poésie. Non, non, je ne vais rien te dire à propos de ce truc alors que tu n’arrêtes pas d’en parler.
Eh bien, le père palabre sur quelque chose, alors qu’il annonce, presque publiquement, qu’il ne va pas en parler. Sauf pour ce qui est de l’adultère, là, il reste coi face aux accusations de coït que déverse la mère. Face à la colère de la mère, il laisse passer l’orage.
Aucune mer ne se vante d’être salée.
Je parle alors que je dis que le silence est d’or. Le père serait heureux de constater que je suis bien sa fille.
Mais être une fille, à ses yeux, ce n’est pas grand-chose.
* * *
Mes parents sont fermiers, mais je préfère agriculteurs – c’est plus élégant.
Tout d’abord, le père.
La soi-disant supériorité masculine me fait commencer par lui. Une aberration, vu qu’il est le seul mec à la maison. Mais j’ai la sale habitude de me soumettre. À défaut de savoir me rebeller. J’ai appris que les pierres font partie du chemin. Même celles qui se glissent dans les chaussures.
Lucien Guillaume (Lucien, son prénom), un fou de musique, une radio à piles qui suit chacun de ses pas. Appelé par le village le Grand Lucien. Certains à le surnommer le barde du village. Pas un compliment.
À passer ses journées à scruter le ciel, le nez en l’air pour deviner le temps du lendemain. Un air entre les dents et du trèfle ou un brin de paille qu’il mastique depuis que le tabac tue.
Il chantonne des symphonies. Des mélodies soutirées de son internat avec l’abbé Thyse, un amoureux de musiques anciennes et organiste à la paroisse.
Une passion musicologique partagée, viscérale, vénéneuse.
Cependant vite gangrenée par l’agriculture, une transmission de père en fils. Depuis trois générations.
Le père cultive en chantonnant pour ses vaches. À ajouter fièrement que celles-ci apprécient le ton velouté de sa voix.
Un visage coupé par le vent et le soleil. Des sourcils chargés d’un regard bleu de ciel d’automne. Le corps robuste, angulaire. De longs bras aux mains tels des pains qui lèvent, l’annuaire de la main droite perdu par les travaux des champs. Des pieds, pointure 46 pour assises de longues jambes noueuses, essentielles pour parcourir les hectares. Un corps d’une cohérence frissonnante.
Organiste tous les dimanches matin sans oublier les jours noirs ou blancs, comme il les singularise. Des doigts qui valsent avec élégance, légèreté insoupçonnée de ses mains qui délient la terre. Une fluidité de danseur.
Des messes rémunérées par les offrandes.
Te dire, Elsa, que la famille se réjouit des enterrements.
Les mariages étant des denrées rares vu la densité de notre population.
La mère, l’Angèle, une littéraire comme moi, ou l’inverse.
Les chattes ne font pas des chiennes et les chiennes pas des chattes.
Fille de l’instituteur du village d’à côté et d’une mère morte en couches. Un vide qu’elle dit avoir comblé par les livres. Une désarmante magie. Une métamorphose de la douleur.
Le nez planqué dans les bouquins dès qu’elle le peut.
Mais dès qu’elle le peut, ce n’est jamais. Ou presque.
Une sorte de deuxième souffle, pourtant. Vital pour un corps qui s’agite. À la recherche de l’air et du temps.
Un corps frêle, des cheveux blond cendré en chignon, une danseuse de Degas au regard clair et lointain, à rêver d’autres lieux.
L’allure fière, dès le pas de la porte crottée dépassé.
Devenue agricultrice par contrat de mariage à l’âge de dix-neuf ans, une communauté réduite aux pâtures et aux champs, des vaches à rechercher pour la traite, des œufs à kidnapper sous les poules, dirait la Fabi, des cochons où tout est bon et des kilos de légumes à éplucher pour les neuf bouches à nourrir trois fois par jour, 365 fois par an, car jamais, nous ne mangeons dans d’autres assiettes. Ni n’allons sous d’autres cieux.
Le village en terre sacrée, celle de notre pain quotidien. Alléluia.
Des journées blafardes et pâlottes à entourer nos existences de filles d’agriculteurs.
De bouseuses, dans la bouche des autres filles.
Des charognes, ces filles de l’école qui se moquent du travail de la terre, aurait dit mon pépé parti à la guerre. Mais pas revenu.
Seul son corps entre quatre planches.
Et une médaille que ma grand-mère garde sur son cœur fatigué.
Et quelques expressions qu’elle confie. Comme des trésors.
* * *
La santé n’inquiète pas.
Il y a toujours à faire.
Sauf à être malade.
Dans un rythme suffocant des jours. Qui n’ont pas assez d’heures. Des nuits qui s’achèvent trop vite. Pas faites pour dormir son saoul. Se relever pour un vêlage. Du foin à rentrer à la lune, car la pluie s’annonce pour l’aurore.
La routine suffit au bonheur. À ne pas laisser croire que la terre puisse tourner autour de soi.
Mais à servir la terre.
Une servitude insensée. Car elle échappe.
La mère à aimer nous raconter qu’à la naissance de la Juliette, le père s’est écrié d’un ton désarmé et désarmant : « Oh, mon Dieu, une fille alors que j’en ai déjà une », qu’à ma naissance, un « Pourquoi mon Dieu, une fille alors que j’en ai déjà deux », et ainsi de suite… Cruelle progéniture pour un père qui désire tant un fils pour sa ferme (version officielle de son désarroi) et pour son honneur d’homme (version officieuse de son désarroi), incapable de faire un petit avec une floche. Flippant. Pour un homme.
Un fils auquel il aurait pu se mesurer.
Sans imaginer que celui-ci un jour l’aurait devancé.
Mes sœurs et moi, nous aimions imaginer que si les parents avaient eu ce fils tant espéré, il se serait appelé l’Octave.
Avec l’Octave, dit le huitième, nous n’aurions plus été leurs sept merveilles du monde. Ni leurs sept péchés qui n’en font qu’un, en ce qui concerne notre présence sur terre, la luxure. Ce désir désordonné des plaisirs physiques – dixit la prof de catéchisme. Une bigote d’appellation contrôlée « Vieille fille qui n’a jamais vu la mer ».
Moi non plus, je ne l’ai jamais vue.
Juste à chantonner celle de Trenet.
Et à espérer ne pas devenir vieille fille.
Pas à vouloir sentir le suret.
* * *
C’est pour ce goût de la peau, ayant reçu les honneurs de la couronne à la naissance de la Fabienne, que les parents ont décidé de faire chambre à part.
Plus juste de dire que la mère a rejoint les cadettes. À défaut d’autre chambre.
Kyusaku Ogino2 n’étant pas un mec fiable, la prudence s’est imposée. Mais l’ardeur du père pour la chair étant gourmande, comme le raille la Juliette, il entreprit quelques semaines plus tard seulement – la mère insiste fortement sur ce « seulement » lors des disputes conjugales – une relation soutenue avec la dame de compagnie du curé, l’Olga. Une Polonaise aux pommettes saillantes et aux yeux d’un bleu très clair.
Qui dès lors faussa compagnie au curé.
Oui, on peut donc penser au ciel et à soi.
Suis sauvée !
L’orgue surchauffe désormais, car il prétexte l’aventure.
Dieu peut être incroyable.
Mais pas autant que le père.
* * *
La vie à la ferme a un goût particulier.
Une sorte de putréfaction interne.
Un mal de ventre fréquent.
Mon cœur à frôler l’arythmie. De dégoût. De labeur.
Les travaux des champs, le potager, les bêtes à mener au pré, le bois à couper, le lait à réfrigérer, le beurre à baratter, les moissons, les murs à blanchir de chaux, les étables à décrotter, les betteraves à entasser, les veaux à biberonner, toute une série de tâches à partager avant et après l’école.
Les œufs le matin, les chicorées pour les lapins, les veaux à nourrir deux fois par jour. Mes tâches des jours de semaine.
Le week-end, d’autres labeurs selon les saisons.
À adorer l’hiver.
Pourtant une saison détestable.
L’été à ne pas être le temps des vacances.
Mais celui des moissons. Des récoltes. Des journées qui touchent les nuits. Se confondent. S’entremêlent.
Le père, fin de journée, à contrôler si les tâches ont été remplies par chacune, dans une cérémonie d’évaluation du travail accompli.
L’ordre patriarcal est demeuré immuable malgré l’infidélité. Je dirais qu’il a gagné le regard fier du séducteur qui le pousse à déclamer les tâches qu’il ordonne. Un sens de l’élégance disputé par celui de l’impudeur.
La Quinte, tu as oublié de fermer la barrière du potager. Comme si les légumes allaient se tirer de là.
La Quarte, combien de fois je devrai te le dire, la Mozart ne peut jamais se retrouver derrière la Schubert dans la salle de traite. Elle donne des coups de patte, la Schubert.
À parler de la terre dans tous ses mots.
À la remercier, presque une vénération, quand la générosité remplit les granges. À la maudire quand elle se laisse surprendre par le gel.
De la douceur à la haine comme avec une femme.
La peau des mains tannée comme un cuir craquelé. Des ongles noirs comme le profond de la terre.
La terre, toujours la terre.
Rien que la terre.
Tout pour elle.
Une ogresse dont le ventre n’est jamais gavé.
Un pater familias, là, pour rappeler que le dernier mot lui revient.
Pour toute question.
Le sens de la vie, le bien et le mal, le juste et l’injuste.
Mai 68 a assez éclusé ces pères experts dans l’art d’avoir toujours raison, mais cette révolution est passée trop loin de chez les Guillaume.
Jamais vu la plage.
Seulement les pavés.
Crottés.
Faire parce que le père l’a dit.
Juste à obéir.
Imiter la carpe et ses silences poissonneux.
Pourtant les limites limitent, dit Véro, mon amie.
Mais pour le père, ce ne sont pas ceux qui donnent leurs idées qui font bouger le monde.
Encore moins ceux qui rêvent.
* * *
Le père a pour usage de baptiser chaque vache du nom d’un musicien. Celles-ci ont le privilège d’être appelées par leur nom de baptême.
Parfois, à les jalouser.
Face au village qui rit des dénominations musicales qu’utilise le père pour nous héler au passage. À le détester alors autant que sa maudite musique.
À l’école primaire, la cour s’est délectée de la Sixte par ci, la Triolet par là.
Les écoles ne sont pas des lieux pour les enfants.
La case enfer de la marelle.
La colère de ces lieux me vide. Genoux au sol.
J’éclipse ma vie dans de longues siestes après l’école.
Mais le père ne supporte pas de nous voir planquées dans nos lits et raille Vous dormirez quand vous serez sur le boulevard des Allongés.
Mais merde, en attendant, je fais quoi ?
Dans une envie de fraîcheur, de glisser mes pieds dans l’eau de la rivière et d’y mettre les mains en filet.
Plutôt qu’à me casser le dos à ces tâches de bouseuse. Et des ongles dévernis et mangés par la terre.
À la maison, la mère distribue d’autres labeurs, car Quand on a une grosse famille, chacune doit mettre la main à la pâte. Sinon, c’est la folie.
Malgré cette répartition des tâches, c’est la folie.
La Clarisse, dresse la table, l’Elsa, replie les linges, s’il te plaît, allez active-toi, sors le nez de ton livre, ton père va arriver, la Juliette, tu dois mixer la soupe.
Une litanie de prénoms qui dansent au gré des assiettes, des casseroles, des kilos de linge à lessiver, des seaux de lait à baratter, du Marseillais pour les sols à briquer… le seul mec qui aide aux tâches ménagères.
La mère aime dire que l’adage des Guillaume est Un pour tous, tous pour un. Quand le père n’est pas présent, c’est Une pour toutes, toutes pour une.
À inciter une solidarité féminine qui devrait compter plus que tout.
Alors qu’un pour tous ne fait pas le compte de tous.
Même quand on féminise l’adage.
La vie de famille en un ennui glaçant.
À envier la fuite.
* * *
Les années de mon enfance ont ce goût de la ferme, un goût suri.
De lait caillé qui fait dresser les poils par son aigreur. Un lait fraîchement coagulé baignant dans du petit lait, mais ne m’imagine pas, Elsa, dans l’expression « boire du petit-lait ».
Pas à savourer cette vie.
Des jours sans saveur chaude.
Un dégoût acide au fond de la gorge.
Dans de l’habitude qui fait oublier les semaines.
Des semaines en labyrinthe où les pas se posent sans se graver.
Une impossible issue.
Des années où s’esquissent les failles.
Des années à attendre. Je ne sais quoi.
Je n’ai pas l’instinct grégaire. Pas en option dans mon acte de naissance.
Il n’y a pas de hasard.
Peut-être pas même de destin.
Vivre en troupeau de filles m’est devenu insupportable au fil du temps.
Nos différents prénoms à renforcer l’impression de troupe.
À être au moins vingt et une.
La somme n’a pas d’égal.
À me demander comment s’appartenir quand on vit à autant.
Toujours à marcher sur la pointe des pieds. Pour éviter les pierres qui roulent dans les godasses.
À murer ma voix à force de ne pas me faire entendre.
Le silence est toujours une souffrance.
Mais on s’en moque.
Puisqu’il ne fait pas de bruit.
* * *
Une horde de cheveux à tresser, des jeans dont je ne sais jamais si c’est le mien, des brosses à dents qui n’ont pas assez de couleurs pour être certaine d’avoir la bonne dans la bouche, de l’eau déjà tiédie à laisser dans la baignoire pour la suivante, des vêtements hérités de la sœur qui précède, nos coudes à se cogner à table, nos pieds à tricoter avec d’autres… jamais ou si peu un espace et une chose à soi.
Loin d’un lieu de tous les possibles.
Sans cesse à être comparée.
Alors que comparer, c’est briser.
Pourtant, la dernière vache du troupeau marche aussi vite que la première.
À être née la troisième et donc pas singulière, l’Elsa, la Triolet, l’Intello, la Silencieuse et à la recherche de qui je peux être dans ce corps unique dont la tête explose de tant de personnes.
Un monstre à quatre têtes.
« J’allai comme malgré moi inventer une femme pour me plaire3 ». Finalement, à m’habituer aux silences.
M’en accommoder.
Bien que le silence ne va pas de soi.
Ni de moi.
* * *
Petite, j’espérais naïvement rester la cadette.
Celle qui fait tourner la planète. Dans son sens.
Mais le temps de pause charnelle des parents n’a pas été éternel. Et Ogino, pour rappel, un mec plus proche du reptile que d’un mec.
Un de plus.
À partir de mes quatre ans, une nouvelle sœur est arrivée chaque année.
Nos trois mines renfrognées sous le regard sombre de la mère à nous annoncer une nouvelle grossesse.
Comme un cadeau dont on ne veut pas.
Et le reproche de ne pas partager leur bonheur.
À nous faire croire qu’avoir une sœur est une chose extraordinaire. Alors que l’on sait que c’est aussi une perte. Une dilution.
Mon statut de cadette ainsi pulvérisé à quatre reprises. Distillé.
Pour toujours dans le groupe « des grandes » mais à y être la plus jeune.
Et trop âgée pour le groupe « des petites ».
Un entre-deux bancal. Craquelé.
Une raie qui partage les cheveux, sans savoir de quel côté se mettre, en un épi rebelle, un épicentre, une épithète, une épine, une épitaphe ou un épinard. Je déteste.
Question à moi-même : une chose qui descend remonte-t-elle toujours ? Car mon moral est plus bas que haut.
Besoin de soleil. Mais le vent le fait tourner.
Et dérange les choses, dit le père quand les moissons sont maigres.
* * *
Maintenant, le tour de la maison, Elsa.
Ne t’attends pas à un riche palace russe, you are welcome à la campagne où les vies s’esseulent et sèchent en draps amidonnés et ballottés aux caprices du vent.
La partie habitat comporte trois chambres. Nous dormons les trois grandes dans une seule chambre, la Clarisse dans un lit pour elle, la Juliette et moi sur un matelas pour une personne et demie, à recueillir nos corps endormis dans le sillon du milieu.
Qui devrait être frontière. Mais nous confond.
Nos cheveux emmêlés au matin et nos lèvres moites de tant de proximité. Les nuits d’hiver à se disputer la brique chaude glissée au fond des draps rugueux.
À partager nos histoires du jour, à scruter dans le faisceau de ma lampe de poche les dernières pages d’un livre, à commenter les ragots de la rue en V, à siffler quand la Clarisse se met à ronfler, à rire étouffées sous le poids du duvet qui écrase nos pieds.
Une proximité qui s’évapore le matin sous la gourmande complicité de la Clarisse et de la Juju. Mes yeux à les envier. Qui les perforent. Dans une urgence à être complices.
Les petites à dormir dans trois lits aux places interchangeables, tantôt la Chacha avec la Marie et ses kilos de trop, tantôt avec la Fabienne ou la Caro. Sans compter la mère qui dort avec l’élue du jour, à savoir celle qui a le mieux travaillé à l’école.
Une façon de pousser à l’excellence.
Mon adage à se définir.
Ne pas avoir la famille que je voudrais.
Ne pas être dans la famille que je voudrais.
* * *
Mon besoin des livres a décuplé avec Madame Loiseau. La bibliothécaire du village d’à côté.
Une grosse femme au regard sévère qu’elle plante au-dessus de lunettes demi-lune, un regard gris foncé et un caractère déterminé à apprivoiser mes silences. Ses mains larges comme deux encyclopédies.
Avec la mère, nous nous rendons à la bibliothèque en bus ou à pied selon la météo et notre courage. Aussi, selon l’état de nos chaussures que nous devons user jusqu’à la croûte.
Car élever sept filles, ça a un coût.
Même si les mauvaises langues du village relient la raison du nombre d’enfants de notre famille au montant du chèque des allocations.
À croire que les mauvaises langues ne s’informent pas.
Car à perdre leur temps à se faufiler dans les bas-fonds des autres vies.
Au lieu de décrypter les données utiles.
À chaque visite à la bibliothèque communale, Madame Loiseau me prépare une sélection de livres. Elle les emballe de papier rose sur lequel elle inscrit d’une encre violette Pour Elsa G.
Parfois, je reste des après-midi entiers à traînailler dans les rayons, à reclasser les livres ou simplement les compter.
3 466 environ, selon les locations.
Madame Loiseau prépare souvent une tisane d’herbes fraîches et un plateau de biscuits ronds qui fondent sur la langue. Surtout quand je ferme les yeux.
Chaque visite comme une fête.
Madame Loiseau souvent à dire que Si vous ne lisez que ce que tout le monde lit, vous ne pouvez penser que ce que tout le monde pense4. Alors elle me trouve des livres qui n’ont pas la cote. Parfois ceux qui ont été à l’index.





























