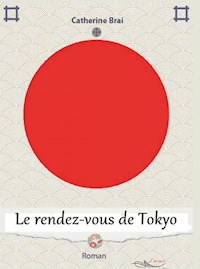
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Agnès, jeune professeur tout juste diplômée de philosophie et mariée depuis peu rejoint son mari Max au Japon après deux mois d’absence. Elle donne six heures de cours à l’Institut français de Tokyo et découvre, ébahie, une ville, un pays et des habitants dont la vie est à l’opposé de celle de la France. Nous sommes au début des années 70. Tout à Tokyo apparaît à Agnès mystérieux et longtemps incompréhensible sauf la véritable vénération que les Japonais portent à la France et aux Français. Nous avons la réputation d’être tous beaux, élégants et romantiques. Les mâles de l’Hexagone, installés au Japon en profitent. Agnès elle-même suscite beaucoup d’émois, néanmoins difficiles pour elle à deviner derrière les paupières et les têtes baissées.
Max, surchargé de travail selon ses dires, la pousse à fréquenter ses collègues masculins. Ensemble, ils forment un groupe sympathique et ils aiment échanger leurs connaissances sur le Japon. Par la différence de culture, ils sont souvent plongés dans des situations cocasses où tout est prétexte à des fous rires qui peuvent gêner les Japonais, habitués à plus de réserve. Mais au bout de quelques mois, le groupe se délite, les jeunes gens ayant pu réaliser leur rêve : trouver une compagne japonaise. À la fin de l’année scolaire, Agnès reprend seule l’avion pour la France.
Quarante-cinq ans plus tard, elle revient sur les lieux où dans le tumulte des préjugés, elle a perdu son jeune mari. Quelles surprises attendent notre voyageuse au terme de ce pèlerinage ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Catherine Brai est née au Vietnam d’un père franco-vietnamien et d’une mère vietnamienne. À l’âge de 17 ans, elle est venue en France poursuivre ses études supérieures à la Sorbonne. Philosophe de formation, elle a enseigné dans de nombreux pays, dont le Mexique, la Turquie, les Comores, l’Inde. Elle a séjourné trois ans au Japon. Actuellement, elle vit sur l’île de la Réunion. Elle a déjà publié trois romans :
Un barbare sous les Tropiques,
Une enfance à Saïgon et
La dernière fois à Pondichéry.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
Un barbare sous les tropiques, roman,
Éditions Persée, 2012
Une enfance à Saigon, roman,
Éditions L’Harmattan, Paris 2014
La dernière fois à Pondichéry, roman,
Éditions L’Harmattan, Paris 2017
Catherine Brai
Le rendez-vous de Tokyo
Les pétales tombés des cerisiers de Mai
Sont les ongles de celle que j’ai tant aimée
Guillaume Apollinaire
1
Lorsque je suis arrivée à Tokyo, au début des années 70, le Japon était devenu la deuxième puissance économique mondiale. Ainsi était-il riche et admiré de tous, surtout des grands pays industriels. Promus depuis deux ans déjà au rang de « Blancs d’honneur » par l’Afrique du Sud, les Japonais étaient fiers qu’on les ait hissés au niveau des Occidentaux qu’ils valorisaient et avec lesquels ils rivalisaient. Cette « reconnaissance » les confortait dans leur vision du monde divisé en trois parties : d’un côté le Japon, d’un autre les pays occidentaux, et le tiers méprisable, notamment les autres peuples d’Asie… Il leur semblait que la prospérité était due essentiellement à la mentalité de leurs habitants, à leur valeur psychologique et morale, à leur cohésion.
En effet, dès le petit matin du premier jour, l’énergie qui émanait de cette mégalopole m’avait frappée, alors que je prenais un verre au café du sixième étage d’un building. Pendant que des groupes de jeunes couraient en rythme jusqu’au Budokan pour s’entraîner aux arts martiaux, quelques hommes d’âge mûr, avant de se rendre au bureau, travaillaient leur swing sur le toit grillagé de leur immeuble, tandis que des chauffeurs de taxi sortaient de leur voiture pour des exercices d’élongation. Aller de l’avant, se perfectionner, devenir le meilleur dans ce qu’on fait, tous participaient à cette œuvre commune : la grandeur de la patrie. La guerre avait été perdue mais la revanche approchait, et elle se gagnerait au niveau de la paix quand le Japon devancerait les États-Unis.
À présent, me voici à l’entrée des grands magasins, nombreux à Tokyo. Plusieurs jeunes femmes portant uniforme impeccable, gants blancs et maquillage, s’y prosternent toute la journée afin de souhaiter en chœur la bienvenue à la clientèle. Un peu plus loin, une employée, habillée aux couleurs de la maison, recommande de faire attention à la marche ; une autre, en faction au pied de l’escalator, essuie la rampe mobile là où le visiteur poserait la main, et le congratule d’avoir choisi ce departo. En me retournant brusquement, je fais tomber des dizaines de boîtes de conserve agencées en une architecture complexe. Aussitôt deux jeunes femmes, exactes reproductions des autres, accourent et, avec le sourire, me supplient de les laisser ranger.
Chez le coiffeur également, je pouvais faire l’expérience du plein-emploi. Dès le seuil, une cohorte d’employées, sanglées dans une blouse d’une blancheur virginale, font une haie d’honneur qui se referme sur moi. On me change. On me shampouine. On me recouvre de crème et, en même temps, l’une d’elles me frictionne le cuir chevelu ; deux autres me massent les bras et les mains. Ensuite, les mêmes m’escortent vers la préposée au séchage des cheveux ; on me peigne et s’applique à m’assouplir le cou, détendre mes épaules jusqu’à l’arrivée du coiffeur qui enfin me parle et me demande mon avis pour le style de la coupe. Et, quelle surprise, le pourboire est interdit au Japon. On ne doit pas humilier le personnel qui, après vous avoir prodigué des soins attentionnés, vous raccompagne, s’épuise en courbettes et, vous remercie de votre visite à l’unisson.
Le lendemain, en entrant dans une administration pour authentifier ma carte de séjour, je me souviens que le « karoshi », traduit littéralement « mort par surtravail », venait d’être reconnu comme maladie professionnelle. Pourtant, je n’avais pas l’impression que, dans la vie quotidienne, les salariés étaient surmenés. Je pouvais en voir qui se déplaçaient en chaussons et bavardaient tranquillement entre eux. En chaussons ? Cela signifiait qu’ils respectaient ce lieu et le distinguaient de celui de la rue. Le bavardage ? Ils pouvaient se le permettre puisqu’ils arrivaient au bureau longtemps avant l’ouverture et repartaient bien après la fermeture. De plus, ils ne prenaient jamais les congés auxquels ils avaient droit.
J’étais sans cesse étonnée de ce que Tokyo me présentait. Certes, les transports en commun auraient permis de circuler avec aisance dans cette ville démesurée, mais l’absence de nom de rue était déconcertante ; et les bâtiments numérotés selon l’ordre de construction ajoutaient à la confusion. Il était donc impossible de localiser un endroit sans une aide extérieure. Pour cette raison, il n’était pas rare de voir aux carrefours, des égarés du système qui tentaient de trouver l’adresse utile, le plus souvent regroupés autour d’un policier assez patient pour expliquer, par dessins interposés, la route à suivre. Certains quartiers rivalisaient avec l’architecture des villes américaines mais, le plus souvent, on était en présence d’un fouillis de maisons accolées à de petits ateliers en un désordre total. Dans ces rues étroites, des fils électriques cisaillaient le ciel. Si le toit d’un immeuble était transformé en practice urbain ou en espace pour entraînement sportif, celui d’un autre devenait une entreprise de séchage au soleil de poissons ou de seiches.
Beaucoup de choses prêtaient à sourire.
Le café que je fréquentais de temps en temps s’appelait Le Saint Louis. Sur la devanture, on pouvait lire la pancarte : « Café avec air con » pour signifier qu’il y avait la climatisation. À l’intérieur, une reproduction du portrait de Louis XVI (et non de Louis IX) était censée justifier le nom de l’établissement. Mais après tout, pourquoi pas ? Louis XVI ayant été guillotiné, ne pourrait-on pas en faire un saint ? Sur les autres murs les photographies de Catherine Deneuve et d’Alain Delon. « Ce sont mes acteurs préférés, bien que je n’aie vu aucun de leurs films, m’a confié l’autre jour le gérant dans un élan d’enthousiasme. Pour nous, Japonais, ils sont les plus beaux du monde. » Sous la gare de Shinjuku, on avait bâti une ville souterraine où de nombreuses boutiques arboraient des noms français. On vendait des vins chez « Deux Cochons », de jolis corsages chez « Mode Poulette » (enseigne plutôt recommandée pour un restaurant) et des robes de mariées dans un magasin baptisé « Vierge ». Les cafés avec terrasses et parasols en sous-sol, séparés par des cloisons à claire-voie recouvertes de lierre en plastique, s’appelaient entre autres « Chez Paris », « Chez Pigalle » ou « Bonjour ! ».
Malgré toute l’agitation estudiantine, le traité pour l’occupation du sol japonais par les Américains venait d’être renouvelé, alors les Japonais ont reporté leur attirance de l’Occident sur les Français. Ainsi, au début des années 70, la France occupait-elle la place de choix parmi les grandes nations. On louait le raffinement français. On louait la gastronomie française. On louait la littérature française. On répandait l’idée que c’était le pays où la culture était la plus aboutie, d’où ma fierté d’en être une représentante au Japon.
2
L’Institut français : un lieu à part. Il réunissait dans un petit espace ceux qui, parmi les Japonais, éprouvaient une admiration sans bornes pour la France et aspiraient à cette liberté de vie et d’expression qu’elle représentait. Pour y parvenir, il fallait bien maitriser la langue et s’immerger dans la culture.
Parmi les enseignants, des professeurs japonais de renom dispensaient quelques heures de littérature française en japonais. La plupart, traducteurs des œuvres françaises, étaient très admirés car, grâce à eux, le Japon pouvait avoir accès aux plus grands : Rimbaud, Stendhal, Zola, mais aussi Camus, Céline, George Sand. Chacun, spécialiste d’un auteur, était considéré comme son représentant au Japon, jouissant du même prestige. D’ailleurs, lorsqu’on citait les livres de ces maîtres, les droits d’auteur leur revenaient, ce qui leur paraissait tout à fait normal. En effet, grâce à un travail acharné, ils avaient pu tirer ces écrivains du néant pour leur redonner vie dans cette partie du monde.
Ces célébrités ne s’attardaient guère dans la salle des professeurs, juste le temps de prendre un document dans la boîte à lettres, conscientes que la rareté faisait la valeur. Ils affichaient une certaine distance vis-à-vis des professeurs français, craignant sans doute qu’un fâcheux solécisme ne vînt ternir leur réputation. Mais ce n’était pas le cas de l’un d’eux, un ancien kamikaze, traducteur des textes littéraires et écrits militaires de Napoléon Bonaparte, et dont l’immense talent rejaillissait sur celui de notre empereur, qu’on lisait bien plus au Japon qu’en France. La personnalité de notre grand homme y était aussi pour quelque chose, elle correspondait certainement à l’idéal de beaucoup de Japonais : une âme de conquérant avec un zeste de sentimentalisme. Ainsi les lecteurs de l’Archipel ont pu apprendre que « l’Aigle » ou le « Grand Général », ainsi surnommé par ses soldats, avait commis entre autres un Dialogue sur l’Amour, grâce à la passion de ce martial lettré.
– Comment se fait-il que vous soyez encore là, alors que vous étiez un kamikaze ? lui ai-je demandé sans autre préambule, la première fois.
– Lorsque nous sommes sortis pour nous écraser sur l’un des porte-avions américains, le temps était si couvert que nous n’avions aucune chance d’atteindre notre cible. Comme vous le savez, nous ne remplissions les réservoirs que pour l’aller. Nous voulions mourir pour la patrie mais, à mi-parcours, notre chef nous a donné l’ordre de revenir à la base et nous avons fait demi-tour, la mort dans l’âme.
– « La mort dans l’âme », n’est-ce pas mieux que de disparaître corps et âme ? ai-je dit d’un air taquin.
Mais le professeur, solennel, a continué son discours. Il était comme perdu dans les brumes du passé :
– Pour nous, qu’on soit bouddhiste ou shintoïste, la mort n’est pas quelque chose de définitif, elle n’est que le prélude d’une série de résurrections, le moyen de renaître dans une existence meilleure. Les raisons de vivre valent bien plus que la vie et l’honneur est une valeur primordiale. Il régit nos actes et nous incite à la vaillance et à l’abnégation, au courage et au don de soi.
– Et donc, après ce retour forcé, vous n’avez pas renoncé, et c’est là que vous avez perdu votre bras ?
– Le bras ? Il a été écrasé par un char.
– Un char d’assaut ?
– Non ! Un char en bois de plusieurs tonnes lors d’un matsuri, une fête populaire traditionnelle au Japon. On était une centaine à le tirer à toute vitesse et, lors d’un virage, mon bras s’est retrouvé sous la roue.
– Ce n’est vraiment pas de chance.
Une collègue française, présente dans la salle, m’a regardée avec sévérité. J’étais trop gaffeuse à ses yeux, mais l’ancien kamikaze m’a souri avec une grande douceur. Et dire que, pour la génération de nos parents, c’était un ennemi cruel.
Quelques professeurs français, nommés par le ministère des Affaires étrangères, composaient également l’équipe pédagogique. Ils se considéraient comme des professeurs d’Université et réclamaient le même statut, c’est-à-dire très peu d’heures, dans la mesure où les étudiants étaient tous titulaires du bac japonais (à l’époque, déjà quatre-vingts pour cent de la population avaient le diplôme), même si parfois il s’agissait des cours de langue destinés aux débutants.
Parmi eux, Jean-Jacques Leborgne n’assurait que six heures de cours par semaine. Mais, dans le jardin ou à la cafétéria de l’école, il passait le plus clair de son temps à discuter avec de jeunes étudiantes qui levaient vers lui leurs petits yeux brillants, étonné lui-même d’être « le chéri de ces dames », lui, l’homme séduisant par excellence, simplement parce qu’il avait changé de continent. Avec son grand nez, ses cheveux rares et filasse, il n’avait rien d’un apollon, mais depuis son arrivée au Japon, il avait constaté que le regard de la gent féminine posé sur lui contrastait avec tout ce qu’il avait connu depuis le début de sa vie consciente. Il s’agissait, bien sûr, des jeunes filles de l’école, les autres Japonaises, par éducation, baissaient toujours les yeux quand elles croisaient un homme. Et si au moins il contribuait à améliorer le français de ses étudiantes. Même pas ! Cet escogriffe doué, ayant remarqué son succès chaque fois qu’il prononçait un mot japonais, avait appris en peu de temps le maniement de cette langue dans le seul but de charmer toute cette jeunesse. Il leur parlait de Stendhal et de Maupassant, rien que pour obtenir leurs faveurs et elles succombaient les unes après les autres. Vivant une existence qu’il n’aurait jamais osé imaginer, même dans ses rêves les plus fous, il avait renvoyé en France sa femme et ses deux enfants.
Rien d’exceptionnel, diront certains. N’importe quel homme se rendant dans des pays où se pratique le tourisme sexuel, la Thaïlande, Madagascar ou Cuba, peut en faire l’expérience. Après douze heures de vol, en descendant de l’avion, soudainement il devient attirant aux yeux des jeunes filles ou des jeunes gens. Ses cheveux ne sont plus gris mais s’argentent comme par miracle, et son bedon promu au rang de coffre-fort. Il se sent désirable parce que désiré. « C’est merveilleux, renchérit-il, j’ai beau savoir ce qui les appâte, je suis heureux de ressentir ce que vivent les très belles femmes : être l’objet de toutes les convoitises. » Mais voilà, au fond de lui, il a conscience qu’il y a une limite : le plafond de sa carte de crédit.
Il en était autrement pour Jean-Jacques Leborgne, ainsi que pour tous les Français de l’Institut, leur essence même suscitait la passion. Ils incarnaient cette France tant admirée, la chair de cette République des Beaux-Arts et des Belles Lettres et, les touchant, les aimant, les jeunes filles ou les jeunes gens espéraient non pas faire partie de ce beau pays mais l’approcher au plus près.
Parmi les professeurs recrutés localement, on comptait de jeunes Français venus au Japon pour se perfectionner dans les arts martiaux. Ils assuraient quelques heures de cours à l’Institut mais gagnaient plus d’argent en ville avec moins d’effort. Il leur suffisait, coiffés d’une toque blanche, d’apparaître dans un restaurant ou une pâtisserie pour surclasser ces établissements. L’un d’eux, ceinture noire de judo, me demandait souvent de traverser avec lui le hall qui conduisait jusqu’à sa salle de classe. Il avait peur. Devenu subitement une « rockstar », il maîtrisait mal ses émotions. Avec toutes ces demoiselles énamourées, il craignait, comme dans ses cauchemars, de les voir s’accrocher à lui puis déchirer sa chemise, arracher des touffes de cheveux en guise de souvenirs. Voilà du moins ce qu’il éprouvait, car de par leur éducation, rien ne transparaissait. Dès qu’elles le voyaient, elles se hâtaient d’entrer dans la salle de classe pour l’attendre.
– Tu vois, tout est bien calme, lui dis-je. Est-ce que tu ne t’inventes pas des histoires ?
– C’est ta présence qui les force à se tenir tranquilles. Tu connais le principe d’Heisenberg ?
Un autre professeur, presque quinquagénaire, m’a raconté qu’une de ses étudiantes avait sollicité une entrevue, mais c’était pour une demande en mariage.
« Mais, Mademoiselle, lui avait-il répondu, je suis trop vieux pour vous. »
Et la jeune fille, les yeux baissés a répliqué :
– L’amour n’a pas d’âge.
– Et pourquoi voulez-vous m’épouser ?
– Parce que vous êtes Français, Monsieur, et les Français sont si romantiques.
Mystère ! Les Japonaises habituellement si timides, si réservées, s’excusant sans arrêt, s’étaient métamorphosées en amazones sentimentales, guerrières du cœur, kamikazes de l’amour, au sein de l’école. De manière si discrète que cela m’a échappé. Ce n’était que par le récit de mes collègues hommes que j’accédais à ce phénomène. Mais réalité ou fantasmes ? Une seule évidence : ils se mettaient assez vite en ménage avec une Japonaise et certains se mariaient.
La plupart des classes étaient homogènes, les unes uniquement composées de jeunes gens, tandis que d’autres n’accueillaient que des jeunes filles. Des mœurs semblables à celles des pays arabes où hommes et femmes ne se mélangeaient pas, chaque sexe menant sa propre vie en dehors de la cellule familiale ? Mais une particularité de l’école sautait aux yeux : à public féminin un professeur homme, et à public masculin, une jeune femme. Puisqu’ils avaient le choix du professeur lors de leur inscription, les étudiants semblaient savoir qu’Eros et Logos étaient liés.
Les classes étaient plus hétérogènes avec des professeures d’âge mûr, telles Madame Satô et Madame Katô, deux Françaises mariées à des Japonais. Elles n’étaient pas revenues dans la mère patrie depuis longtemps et paraissaient le regretter. L’une d’elles me confia un jour : « Il y a cette discrétion, cette réserve japonaise qu’on trouve si appréciable au début, mais à la longue on se sent bien isolé. Ici, on peut avoir le sentiment d’être seule dans la foule. Aucun homme ne vous regarde ou ne vous témoigne un intérêt quelconque. J’en viens même à songer au métro parisien où l’on me pinçait les fesses ! » Mais n’avait-elle pas la nostalgie de sa jeunesse ?
Un autre professeur, un vieux prêtre, qui n’était pas retourné en France depuis une trentaine d’années, souffrait lui aussi du mal du pays. Le premier jour de classe, il s’approcha de moi : « Vous venez d’arriver, n’est-ce pas ? J’ai juste une petite question : les enfants jouent-ils encore au cerceau dans les jardins ? »
3
Je suis venue à Tokyo pour rejoindre mon mari. Max y accomplissait son VSNA (Volontaire du Service National Actif) et, pacifiste, il était ainsi heureux d’enseigner durant deux ans dans un Lycée. Parti deux mois plus tôt, soucieux d’arriver bien avant la rentrée pour trouver un logement, connaitre un peu le milieu et prendre contact avec l’administration de l’établissement. Quant à moi, il me fallait finir la rédaction de ma maîtrise de philosophie. J’avais pris du retard car je devais gagner ma vie tout en poursuivant mes études.
Ce départ revêtait à ses yeux une grande importance. C’était la première fois qu’il allait travailler, vivre loin de ses parents, deux artistes adorables, toujours aux petits soins pour lui. Fils unique, il avait été choyé, protégé. La tendresse et les attentions quotidiennes de sa maman lui manquaient beaucoup, j’en étais sûre. Certes, dans le passé, il avait voyagé mais en vacances, accompagné d’amis. S’installer seul à Tokyo, une mégalopole de plus de dix millions d’habitants, organiser son emploi du temps, découvrir un tout autre continent : une expérience grisante mêlée d’inquiétude.





























