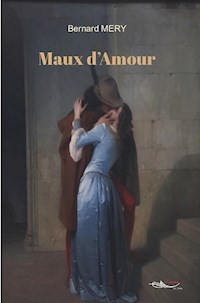Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Six personnages, autant de rencontres et d'histoires de vie à découvrir.
C’est le récit de rencontres, tant humaines qu’amoureuses qui s’adresse à ceux qui connaissent, espèrent et recherchent le pouvoir guérisseur des mots. A travers la douleur, la fuite, les voyages, puis le hasard des sites de rencontres, l’auteur use de la langue française, pour mettre en lumière les beautés et les laideurs de l’être humain. Dans un style maîtrisé, fluide et élégant, sont restitués le vécu, la magie et le relief de Marie, Athéna, Frédérique, Élodie, Éléonore... comme l’est la réincarnation de Christina, handicapée, dont la vie draine des remugles de la seconde guerre mondiale. Face à la dure réalité de la perte d'un amour les dialogues se heurtent à une solitude qui ne sera que difficilement apaisée.
Cet ouvrage est aussi le passé qui retient et revient vous harceler, c’est l'être qui se questionne, se cherche, se trouve et qui, en tout cas, ne voudrait plus s'égarer.
Il en ressort que l'écriture est un questionnement permanent où les questions sont parfois plus intéressantes que les réponses.
Découvrez ce récit fait de rencontres en tous genre, magnifiées par une langue destinée à mettre en lumière les beautés et les laideurs de l'être humain.
EXTRAIT
Tournant le dos à la cathédrale, je traversais la place d’un pas alerte, lorsque soudain me parvint son texto : « Où es-tu ? » Je lui rétorquais que j’étais sur la place de la cathédrale. Elle me répondit qu’elle était devant le vitrail qu’elle avait hésité, puis cédé, qu’elle était venue. J’acceptais de retourner. Je la vis effectivement qui occupait très exactement la chaise laissée à son attention. Son visage était blême tourné vers la lumière. Je m’assis derrière elle, en silence. Elle eut alors un geste que j’interprétais comme celui de la pitié. Je me suis alors levé d’un bond, lui dis : « Salut », puis partis sans me retourner, marchant cette fois, d’un pas rageur, vers ma voiture.
Je démarrai aussitôt puis me dirigeai hors la ville de Metz, vers Montigny, lorsqu’elle m’appela à nouveau, je ne lui laissais aucune place pour la discussion : « tu as cinq minutes pour me dire que tu viens avec moi », lui dis-je en continuant de conduire.
— Si je ne te rappelle pas dans les cinq minutes à venir, c’est que je ne viendrai pas, répondit-elle avec une lassitude dans la voix.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Bernard Méry, qui exerçait la profession d'avocat, a publié quatre livres : deux essais : Justice - franc-maçonnerie - corruption et Les nouveaux parrains, mais aussi deux récits : Je ne suis plus amoureuse et La vie une seule fois.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernard Méry
Le site de rencontres
ou
La solitude des dialogues
Récit
© Lys Bleu Éditions—Bernard Méry
ISBN : 9 782 378 773 632
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
« Maître, que dois-je faire pour gagner la vie Éternelle ?
« Avant tout, ne te mens pas à toi-même »
(Les frères Karamazov – Dostoïevski)
1
Marie avait été le cadeau offert par un ciel bienveillant.
Un jour de janvier 2016, celui-ci décida froidement de me le reprendre, non sans brutalité.
En septembre 2008, précisément, j’étais entré en contact avec Marie sur Meetic, un site de rencontres. Nos premiers échanges furent de si grandes qualités qu’ils furent suivis au Palais-Royal de la découverte des corps, un lieu digne de Marie Stuart, son aïeule en ligne directe.
Le jardin à la française enserra notre intimité dans un cadre architectural composé de bâtiments d’arts chargés de dorures, de colonnes et d’arcades, de bassins, de jets d’eaux, de fleurs multicolores, de bourdonnements d’abeilles. Le temps de cet après-midi, je m’en souviens avec une extrême précision, était sec, chaud, ensoleillé, sous un ciel bleu de perfection.
Très vite, nous décidâmes de nous adosser au plaisir de l’un à travers l’autre.
Marie fut l’égérie d’un bonheur de plus de sept années dans ce qu’elle qualifia elle-même, le jour de la rupture : un immense, tout en me plongeant, parce qu’elle ne m’aimait plus, dans une détresse extrême.
Ce jour précis, je fus brutalement séparé du miroir que l’amour m’offrait. Entre Marie et moi, les envies de partages et d’épanouissements furent soudainement inscrites, de sa seule volonté, aux « pertes et profits » de notre rencontre.
Il me revenait en mémoire cette citation : « Tu peux arracher la flèche qui t’a touché, mais les paroles restent en toi, à jamais ». L’inattendu de sa décision me fit ressentir le feu de son trait : il me laissa inerte, incapable de réactions. Je me retrouvais bloqué, étourdi, à l’arrêt, tel un âne buté qui refuse d’avancer, que l’on fouette en vain, mais qui toujours se refuse, et même, recule.
Pourquoi vouloir quitter une si grande perfection ou comment justifier un tel sacrifice ? Ces questions ne furent jamais élucidées, les réponses ne sont que supposées.
Le cinq janvier 2016 Marie téléphona à 19 heure précise, pour me dire : « je ne suis plus amoureuse », puis raccrocha, tout simplement, comme si elle venait de dire : « je ne suis plus enrhumée ». Ces quelques mots mettaient un terme à une période vécue dans l’insouciance, une vie sans âge car pendant tout le temps de l’immense, la question de l’altération des corps ne s’était pas posée. Nous formions une unité. Pourquoi donc aurions-nous eu peur de jours écoulés dans la félicité ?
À moi qui affichais un visage rongé par le désespoir, Marie, pour justifier et excuser son annonce, répétait : « je ne savais ni ne voulais nime mentir ni te mentir ». Je clamais en retour, ne rien entendre ni ne rien comprendre à ce genre d’explication et ne vouloir rester accolé qu’aux seuls jours heureux.
À présent, brisé, je me découvrais implorant, incapable d’oublier un plein bonheur qui me voyait chavirer dans un infini sans fond.
Contre un gâchis trop évident, je criais « pouce », suppliais et disais que ce n’était plus du jeu ! Je l’adjurais « Marie regardons-nous, écoutons-nous, recherchons ensemble ». Je tentais en me rebellant d’échapper à la nasse béante de malheur qui s’ouvrait comme un passage obligé.
Tout cela fut vain.
Mon récent passé me poursuit car rien ne me raccroche plus au visage aimant, sinon à des ressassements,des certitudes de jamais plus :
Jamais plus nous ne pourrons penser, concevoir, être heureux ensemble.
Jamais plus nous ne partagerons nos goûts, nos désirs ni n’échapperons à la peur paralysante des définitifs.
Désormais nous resterons, chacun de notre côté, dans l’ignorance de l’autre, à cette différence de taille : qu’elle seule, l’avait décidée ; qu’elle seule avait coupé, dans un second temps, cette fois dans un esprit de guerre ouverte, tous les moyens de contacts, d’une façon plus hermétique que la frontière qui séparait jadis les deux Allemagnes, deux idéologies.
Marie avait intercalé entre nos vies, une barrière plus étanche qu’un rideau de fer !
À ses côtés, je croyais avoir trouvé, compréhension, consolation, réconfort et force. En me rejetant, elle me replaçait dans mon cercle originel d’afflictions.
2
La rupture s’avéra n’avoir été imprévue que de moi seul. Son annonce me contraignit à supporter un monde vidé de « notre » cohérence. Il en découla chez moi, une déroute et un sauve-qui-peut, même si dans les premiers temps, j’espérais son retour.
Mon raisonnement était de pure logique : ne sachant rien des raisons exactes de la séparation, je pouvais escompter un revirement, tant les signes apparents de l’amour avaient été observés jusqu’aux extrêmes limites de notre ensemble. J’avais du mal à concevoir qu’elle ait pu simuler les gestes de l’amour et s’en extraire si facilement.
Rien de tel ne survint, le désamour était donc plus ancien. Il m’avait été livré définitif. Marie avait pris le temps de répéter la scène, à son rythme, de se préparer à la réalité de la rupture, de la mûrir sans heurt. J’aurais aimé en discuter. Mais elle m’en interdit toute possibilité. Pour moi, elle ne voulut plus exister. Plus encore, elle s’arc-bouta dans le reniement et dans l’effacement d’elle-même, à mon égard.
La réflexion me conduisit bien à envisager une possible explication, mais seulement sur son effacement du « bien après », sur l’étendue et les effets de la rupture, non sur la cause, donc rien sur l’essentiel.
Un livre, écrit à cette occasion, lui avait en effet, offert le prétexte de la coupure définitive : N’avais-je pas exprimé mes doutes sur une probable lâcheté familiale dans les causes du suicide de son frère comme dans la mort indigne de sa sœur : leurs deux aînés ?
Sa sœur, jeune femme, désespérée de vivre plus – fait peu compréhensible compte tenu de l’aisance sociale, matérielle et intellectuelle des parents – n’avait-elle pas associé, l’alcool à la drogue, pour décider d’une disparition accidentelle sur la voie publique ?
Je suggérais même, sans l’exprimer directement, une responsabilité indirecte de Marie dans le suicide de son frère, qui expliquerait l’immense meurtrissure intérieure jamais guérie, qu’elle portait en permanence.
Marie, à onze ans, n’avait certainement ni su ni pu apaiser les pulsions amoureuses exprimées très concrètement envers elle, par ce grand demi-frère de 18 ans, venu en vacances à Casablanca, ville de son enfance. En suite de quoi, ce frère avait dû, lui aussi, subir non seulement la punition paternelle mais plus encore, les rigueurs de son effacement dans le cœur de sa sœur. Ces représailles l’avaient irrémédiablement marqué dans sa chair et son âme, au point de lui interdire tout accès au pardon et lui imposer une mort différée.
Tout serait donc dans la répétition.
Marie usait – sans doute inconsciemment, ce que je voulais encore espérer – de l’arme de l’effacement, tant elle était payante d’efficacité.
Il aurait peut-être fallu que les deux enfants du premier lit de son père n’apparaissent plus comme les fruits d’une erreur contre nature ni le résultat d’une mésalliance, comme l'égarement d'un homme de la noblesse d'épée épousant une femme juive, même issue d'une famille illustre. Lors du retour à la normalité, une mission d’apaisement incombait aux puînés du deuxième lit, aux cinq autres enfants, à l’incitation du premier responsable : le père que Marie vénérait. Sur ce drame, elle n’avait su conserver que mutisme, orgueil de son sang et rage contre les outrances du destin qu’elle n’avait cessées de cumuler, sa vie durant, dans sa chair et son esprit, pour n’avoir choisi, disait-elle, que des chemins de traverse.
Qui étais-je, pour oser des intrusions dans les sinuosités d’un lignage aussi prestigieux en quartiers de noblesse et pour supputer que ses détenteurs auraient pu se rendre coupables de lâcheté ? Le mépris naturel de caste, m’avait rattrapé, repoussé, condamné, renvoyé dans la tourbe : « elle s’effaça » donc, selon sa terrible expression.
Il faudra me souvenir de l’action maléfique entreprise par une fille bien née, comtesse par son père, supposée policée et armée des principes d’une bonne éducation, tenante d’une mansuétude naturelle pour l’homme qu’elle disait avoir aimé, même si elle constatait ne plus en être amoureuse. L’objet de son amour et de sa tendresse de sept années, ne pouvait pas avoir été vil à ce point sur une si longue durée, pour qu’il lui fût nécessaire d’en effacer jusqu’au souvenir, tel un kleenex jeté après usage ou une verrue sauvage incrustée sur le front, venu de nulle part, qu’il fallait brûler pour l’éradiquer jusqu’à sa trace.
Disons-le sans ambages : je refuse d’accepter comme concevable que Marie, ma bien-aimée, se soit abaissée à s’accaparer du terme d’un dictateur et à user de l’expression « effacement », même si le mot en français est moins explicite en son articulation que le mot allemand, prononcé en pleine démence égotiste par un seul homme contre un groupe d’hommes globalisé et déshumanisé. L’effacement (masculin) a en effet pour réplique germanique le mot (féminin) « dieVernichtung ». Le vocable composé du préfixe « ver » exprime une volonté d’écrasement sauvage, colérique, tendant à l’éradication, au « nichtung », résultante qui a pour effet de rendre l’objet, moins qu’un rien (nichts), le « ung » étant l’expression de l’action entreprise dans le temps.
Cette opération est parfaitement bien illustrée par les corps brûlés dans les camps d’extermination ou de façon moins atroce, par le chiffon qui élimine la trace de la craie blanche sur le tableau noir. Dans les deux cas, l’action opère jusqu’à la suppression de l’empreinte, de son origine à son présent, et bien entendu, de « son avoir été ».
Quelle sanction pouvait être plus dure ? Pourquoi tant de haine venant d’une personne choyée, protégée car en souffrance de graves handicaps et maladies ? Qu’est-ce qui justifiait l’emploi d’une frappe si disproportionnée ?
La réalité s'imposaitavec brutalité : sans amour, l’homme n’est plus qu’un arbre sec, un mort en permission, un morceau de papier avec quelques dates et un nom... livré à l’errance du vent.
Je refusais ainsi d’envisager Marie dans sa nouvelle vie, courant après les chauves, les bedonnants, les mous, les fiers, ou même, usant de sarcasmes contre les impuissants. Je me raccrochais à l’idée qu’à la fin, elle finirait par tourner ses regards nostalgiques, perdus qu’elle serait dans le remords, lasse de devoir contempler une suite de blocs d’immeubles sans joie, des masses compactes de bétons, incapables de lui offrir l’évasion ou toutes autres illusions. Je l’imaginais, pour ne pas sombrer, ne pas me noyer dans la fadeur d’un quotidien, usant de gestes d’appels désespérés.
Mais je me dois de le répéter : tout cela le fut en vain !
3
Marie me plongea dans une tempête psychologique dont les conséquences physiques furent rapidement visibles. Elles marquèrent mon visage de leurs traces, mon dos plia sous une charge toujours plus lourde.
J’étais désormais un vieil homme délaissé, surpris par le cataclysme. Non préparé, il me fallait accepter le nouvel état dans son immédiate soudaineté. Mes forces physiques déclinant, mon corps rendait les armes, ses fonctions le désertaient, même si je savais qu’il chercherait, jusqu’à son dernier souffle, d’autres échappées. Il ne pouvait être question d’abdiquer même si j’entrevoyais en toute objectivité, les signes de la décrépitude s’installer, m’assaillir, m’affecter physiquement et psychiquement.
La méditation sur les thèmes de l’âge n’a rien de facile pour celui qui est acteur, car il est juge et partie d’un drame trop banal. La question m’intéresse cependant et se doit d’être affinée, car la prise de conscience des déchéances du corps risque d’enfermer le vivant dans ses fragilités.
Bien avant moi, Jorge Semprun – décédé depuis – écrivait dans « exercices de survie » : « La vieillesse, bien sûr, la finitude, étaient prévisibles, inscrites d’emblée dans la banalité placide ou funeste du cours des choses. »
Les atteintes au corps seraient bien sûr survenues avec ou sans Marie. Mais fallait-il pour autant qu’elle en accélérât le phénomène ?
La commune sagesse tenta de me consoler.
J’entendis même une voix me souffler :
— Dans votre cas, il y adu vieillir mais non de la vieillesse.
Le vieillir serait processuel, la vieillesse un état. Était-ce dire vrai, ou seulement désir de consolation ? Quand donc avais-je commencé à devenir vieux ? Et même si cette distinction s’avérait exacte, à partir de quel moment « la vieillesse » prendrait-elle le pas sur « le vieillir » ? Je crains de devoir répondre : lorsque rejeté du « tout amour », le corps et la tête rendent les armes et deviennent incapables de réagir contre le nouvel état imposé.
Avec l’âge, les peurs se font plus insistantes, plus difficilement supportables tant elles laissent paraître le terrible isolement qui enferme. Face à moi, la solitude ne se tenait-elle pas raide, m’épiait, m’accablait, me désignait d’un doigt accusateur?
Après chaque décès, entendez-vous un très court instant, pleurer l’humanité, au fur et à mesure de la disparition des tous premiers rôles ? Le précédent est vite oublié pour vite passer au suivant (Ce fut le cas, il y a peu, de l’écrivain académicien Jean d’Ormesson, doublé sur la ligne des obsèques par le chanteur Johny Halliday). Le phénomène mortel ne connaît pas de répit. Observons-nous en futures victimes, immobiles et livides, droites sur le fatal tapis roulant ! Regardons-nous défiler en seconds rôles, liés à un destin dont nul ne réchappe, entraînés jour après jour, par le même tapis, dans un mouvement insensible, régulier, irrésistible !
L’appel aux morts est quotidien. Nul ne s’en émeut. Les futurs défunts se succèdent en d’interminables files d’attente constituées d’âges les plus variés. Parfois même, certains affichent leur impatience, tentent de dépasser celui ou celle qui précède, mus par un appétit de réussite immédiate, dans l’ignorance de concevoir leur propre destin.
Ce sentiment de vulnérabilité m’a toujours rongé l’esprit pour ne s’être estompé que pendant l’unique moment où ma lucidité avait faibli : lors de mon vécu entrevu comme l’amour ultime. Le moment arriva pourtant où, dégradé de toutes qualités, Marie me poussa, yeux bandés, devant son poteau virtuel, pour me fusiller à bout portant. Même s’il ne s’agissait que d’une guerre privée, survenant entre un homme et une femme, je me retrouvais détruit, coq déplumé, échappé d’une rixe, avec mon poids d’années empilées en vrac, dans l’insouciance.
À ce moment où la finitude me cerne et m’empoisonne, je constate n’être rien de plus ni de moins, qu’un wagon décoré pour une fête ancienne, qui, privé de locomotive, mais plein encore de son élan, continue à rouler sans but, à glisser sur des rails sans fin, sans autre finalité que de s’arrêter en rase campagne : dans le néant.
4
Depuis, deux années se sont écoulées, se sont fracassées surdes jours de miel. Elles furent parsemées de chutes sur un chemin de croix emprunté par moi seul, suivies de sursauts, de tentatives de me relever et de gommer les effets destructeurs de la séparation.
Même si rien ne me permettait d’envisager la fin de la dégringolade ni d’arracher les interrogations qui s’accrochaient comme des teignes, l’angoisse affamait le cancer qui m’affectait en vrai et qui trouvait à se nourrir plus, de ma détresse.
Blessé par l’annonce faite par Marie, et confronté à une nécessité d’oublier, à faire le vide, je m’installais dans un monologue fait de mots capables de remédier, mon vivant restant, aux conséquences de la solitude, loin d’un vivre bien, sans elle.
Que ferions-nous à n’échanger que les mots, par désespoir ? Ils masquent les situations, transfigurent l’absente, inventent une autre histoire. Pour le « rejeté », tout est plus dur, tant il se doit de déceler le sens de la rupture et de supporter son poids d’émotions.
À vrai dire, tout cela n’appartenait-il pas déjà au passé ?
Je ne pouvais pourtant pas occulter qu’il y avait bien eu une première rupture même si elle n’avait duré que quinze jours.
Elle se situait le dimanche 11 janvier 2015, le jour précis de la très importante manifestation populaire, juste après la survenance du massacre survenu au sein du journal satirique « Charlie hebdo ».
Quelque temps après que je me sois réfugié dans un bel hôtel de Savoie, elle s’était sentie faiblir face à la réalité de mon absence, elle n’était pas encore prête, il lui fallait se donner un peu plus de temps. Elle revint donc. J’étais sans le savoir : en sursis.
Durant l’année 2015, de manière diffuse, j’avais bien ressenti une volonté d’éloignement en gestation. J’étais confronté à des sourires contraints, des regards perdus dans le vague, parfois même à une franche hostilité. Je percevais qu’elle m’observait pensive et sérieuse, à la dérobade. J’en ignorais la cause, mais ne voulais pas trop m’en inquiéter tant je croyais à l’incontournable et au définitif de notre liaison. J’étais condamné mais ne le savais pas.
Je m’obstinais à écarter toute idée de rupture. Je décidais et projetais encore, alors que je ne dirigeais plus rien, alors que j’étais tassé dans l’enfermement, repoussé au fond de son secret, laissé sans attache, ballotté, devenu pour elle, léger comme l’éther. Parfois, je sentais bien que je désertais ses pensées, commettant même l’erreur de lui reprocher ses attitudes, ses manques, ses silences, ses oublis. Tout cela explique qu’une fois sa décision prise, je sombrais, frôlant même une chute dans l’au-delà.
5
La voie de son retour m’étant fermée, je devais m’ancrer dans une nouvelle démarche, me voir tel que j’étais devenu et tenter une exfiltration du carcan imposé.
Certes, j’essayais bien de démythifier Marie, de me dire « tant pis pour elle, la qualité se mérite, » je savais qu’en réalité je me mentais, que le meilleur est rare et qu’il ne se retrouve probablement jamais. Je n’ignorais pas que tout visage aimé est embelli tout le temps de l’amour – un espace de vie exceptionnel. Je n’ignorais pas non plus que pour échapper à leurs angoisses, les êtres en souffrances se cachent dans d’autres questionnements, sollicitent des explicitations, de nouvelles recherches. Le plus souvent, les réponses sont contradictoires, opposées ou subies, elles poussent même au désir de rompre avec ce qui existait avant.
Comment donc, rester lucide après un choc de cette violence ?
« La lucidité est la capacité à prendre en compte l’expérience traversée, le plus souvent à notre détriment » écrit François JULLIEN. En pleine tourmente, je n’avais eu d’autre lucidité que la conscience de ma fragilité.
Il me fallait, à présent, prendre en compte, que le plus dur dans la séparation d’avec Marie, avait été de devoir supporter le brutal d’une décision imposée sans recours et d’avoir été abandonné à terre, chargé de ses reniements. Je me disais qu’avec le temps, sa voix finirait par s’estomper, par devenir inaudible même si ma déroute affective aspirait ma vitalité comme l’aurait fait une éponge très sèche, finalement lourdement gorgée de mal-être. Je me raccrochais aussi à l’idée de me recentrer sur quelques règles de vie essentielles.
La confusion me plaquait au sol, m’incitait à espérer d’une substitution, m’invitait à comprendre que l’amour n’était, sans doute, rien de plus qu’illusion d’un temps qui n’avait d’autre finalité que de s’arrêter.
Mais à l’évidence, la solitude nous avait saisis bien avant notre séparation.
6
Mon choix de vie m’avait conduit, jusqu’à ce jour, à concéder une place prépondérante aux femmes, façon de ne pas écrire qu’elles ont été omniprésentes et déterminantes dans ma progression. La raison de cette nécessité vient en partie, de l’absence d’empathie maternelle, plus précisément des carences affectives de ma mère, de la quasi-inexistence, chez elle, des signes élémentaires de l’amour. Il m’avait donc fallu compenser le cruel manque de féminin par une recherche constante de la féminité.
La femme est l’incontournable composante de mon humanité. Elle est la satisfaction d’une connivence à la fois intellectuelle et charnelle. Elle est révélatrice et traductrice d’émotion, génératrice de tendresse et de consolation, dispensatrice d’un « bon à vivre ». La femme est cette part secrète sans laquelle, je serais nu, sans écho, sans réflexion, en manque d’identité, de masculinité, d’unité physiologique, et plus simplement, en manque d’amour.
« La femme, symbole unique, n’existe pas » me disait l’une d’entre elles, aux confins de l’interdit imposé, comme un reproche d’une part de moi, pourtant si peu misogyne.
Je me dois donc d’insister : je me suis engagé, comme moyen de survie, dans la voie de la séduction de la femme par l’homme, au bon sens du terme. J’entends préciser que cette attirance aussi indispensable qu’irrésistible n’a rien à voir avec les seuls jeux sexuels qui, bien entendu, y participent, mais qui, en quelque sorte, se placent dans un registre secondaire.
La certitude est que sans une part de féminité, la créativité de l’homme n’existerait pas ou plus. Le phénomène constitue une qualité extatique que certains résument par le terme unique et général, « d’amour ».
Ne venais-je pas aussi de lire dans « Journalà quatre mains », un livre écrit par Benoîte Groult avec sa sœur Flora disant que le « tout amour » était une négociation sinon un combat ; que le « toute amitié » avait ses exigences, sinon ses hauts et ses bas ; et qu’à l’inverse « l’amour fraternel » était une mer étale qui interdisait toute tempête » ?
Pour combler le territoire perdu, du « tout amour », il fallait donc essayer de retrouver une sorte de joie de vivre, renouer avec son déjà vécu, entrevoir la connaissance d’autres âmes non rattachées, en leur matérialité incertaine, au sens donné par l’écrivain russe, Nicolas Gogol qui, pour augmenter la valeur de son patrimoine, s’appropriait d’âmes déjà mortes.
Dans cette quête, certains se retrouvent seuls, inutiles, bras ballants, face à des impossibilités de partage sans lequel les découvertes perdent leurs reliefs. Quel est le poids de la culture face à des volontés d’intendances qui détruisent ce que nous aurions voulu construire ? Il fallait que le temps de la destruction passe, que vienne celui qui permettrait de saisir la main nouvelle conduisant vers d’autres issues ! Il faudrait alors s’y agripper fermement !
L’écrivain allemand, Erich Maria Remarque qui connut les épreuves d’une errance obligée, souligna la fragilité de l’amour. Il se plaisait à décrire les effets mécaniques répétitifs, incontournables, désespérants qui conduisent à sa perte. Il les racontait, en usant de la forme littéraire d’un conte qui userait du rituel « il était une fois » : « une vague amoureuse pour un rocher qui émergeait fièrement dans une belle crique marine... les flots d’écume de la houle rageuse tourbillonnaient sans cesse autour de lui, lui prodiguait nuit et jour mille baisers, l’enlaçait dans ses bras blancs, pleurant et le suppliant de venir à elle. Cet amour et ces caresses minèrent finalement le rocher, si bien qu’un jour, il se rendit à son appel et s’enfonça dans ses bras... la vague n’avait plus rien à aimer, plus rien dont elle pouvait rêver, le rocher n’était plus qu’un bloc de pierre au fond de l’Océan, noyé en elle... la vague se mit alors à la recherche d’un autre rocher ».
Face à celle qui m’avait écarté sans douceur, il me fallait conserver, plus que jamais, une aisance intellectuelle. Il fallait que je concentre ma pensée sur un but précis, par exemple : le choix d’un sujet d’écriture. À défaut d’être franchement gai, le livre vérifierait le thème mystérieux, sans cesse renouvelé de « la rupture » sous ses causes diverses, ses sens cachés, mais aussi les moyens de se délester de la solitude qui, en ces moments, s’agrippe à l’âme comme à de la glu. Il relaterait les gestes nécessaires à la survie, la méthode pour s’extraire de l’amer incrusté dans la privation du corps de l’autre. La perspective d’écrire sans fin heureuse, ne me déplaisait pas même si certains préféraient armer leurs récits d’une fin riches d’enseignements salvateurs, pour insuffler au lecteur, de nouvelles forces.
Dans le journal « Le Monde », Sylvie Guillem danseuse, illustra à près de 40 ans, une critique de la vanité, en ces termes : « A 12 ans, j’ai éprouvé une vraie fureur à l’idée d’avoir 13 ans. Allez savoir pourquoi ! Je voulais rester enfant. Ce refus de grandir m’a obligé tôt à travailler la question. J’ai appris à ne pas me battre contre les choses inutiles, à arrêter de me frapper la tête contre les murs ; ça fait trop mal ! Le dalaï-lama dit que si vous avez une grave maladie que l’on peut guérir, ce n’est pas la peine de vous inquiéter, mais il n’est pas davantage nécessaire de vous inquiéter si elle est incurable, car c’est inexorable. Penser ainsi soulage, même si c’est difficile d’apprendre à ne pas laisser nos émotions nous submerger. »
Je comprenais que la souffrance pouvait n’être qu’unilatérale et s’opposer à toute prépondérance du vainqueur sur le vaincu ! Trop de mots font courir un risque de confusions. Ne dit-on pas communément que « le verbe aimer est difficile à conjuguer, que son passé n’est pas simple, son présent n’est qu’indicatif, et son futur est toujours conditionnel » ?
Le sentiment du « rejeté » nourrit la rupture. L’exercice consiste pour lui à distinguer le dérisoire de ne pas être reconnu au rang de ce qu’il aurait souhaité alors qu’il pensait valoir plus. La frustration installe alors ses acidités au fond des cœurs, au point qu’un vent de chagrin peut pousser le corps à disparaître.
Hanna Arendt écrivait sur ce thème de l’amour : il est à la fois désir et commandement divin, avant d’ajouter, orageuses et éphémères sont les passions de la chair et les folies du désir… Mais la philosophie n’écartait-elle pas les thèmes essentiels que sont « les pourquoi et les comment, la vie » ?
Et puis voici qu’un espoir insensé interroge la mémoire :
Qui sait si un jour, la langueur ne se raccrochera pas à Marie, qu’elle ne poissera pas sa vie, comme la mienne le fut ?
La crainte est que le passé ne cultive au final que des regrets. Nos corps ne trouveraient alors plus de possibilités d’associer leurs réalités, tant ils seraient devenus étrangers, volatiles, interchangeables, facétieux.
Depuis la séparation imposée par Marie, « certaines expériences » virtuelles opérées sur le site ont aidé mon esprit à s’extraire de l’absence de visibilité où je restais plongé. Mais l’expérience nouvelle dans laquelle je m’engageais pouvait soudain perdre tout intérêt, tant elle se révélait sans lien naturel avec les affinités de l’autre clavier. La nécessité voulait pourtant que nous finissions par échanger quelques mots avec une personne, sans lequel site, nous ignorerions jusqu’à l’existence. C’est là que se situe le miracle. Le dialogue peut s’installer hors tout contact visuel et physique, se construire de manière artificielle, sauf à laisser entrevoir les orages naissants, un souffle de discordance entre partenaires.
Je souhaite raconter les recherches espérées, les cruelles réalités des derniers battements de cœurs solitaires. Pour comprendre cette démarche, il me faut reproduire certains des propos recueillis sur le site. Il est, en effet, intéressant de comprendre comment une expérience pour être « vraie » devait s’installer dans la durée, en poids de ce que nous souhaitons découvrir et retenir chez l’autre. Malheureusement le plus souvent, l’expérience tournait court tant les personnalités apparaissaient disparates, inconciliables, si incompatibles, si dissonantes de l’imaginé, qu’elles nous obligent à les cataloguer de « rencontres virtuelles », donc de « non-expérience », comme d’une procédure judiciaire, qui serait décidée « irrecevable ».
En loup blessé, tétanisé, je m’entendais intérieurement supplier :
— Arrêtez de butiner sans cesse, vous, les abeilles enivrées par tant de miel et de pollen ! Arrêtez, vous qui ne faites que passer dans l’espérance que la fleur prochaine sera plus riche et plus sucrée ! En vérité je vous le dis : ne vous laissez pas abuser par le leurre de la multiplicité ni par la surabondance.
7
Quoi qu’il en soit, je pensais avoir quelques intérêts à relater un vécu, à attester de tentatives de surmonter l’épreuve, de vivre plus et de retrouver le goût. Lors des visites sur la page du site, je n’avais jamais imaginé devoir côtoyer tant de corps transis, serrés les uns contre les autres, perdus sur des îlots de désespérances, figés au milieu de terrains de chasses permanentes.
Si tous n’étaient pas atteints par l’immédiate nécessité de recourir au site, beaucoup de victimes des sentiments, mus par une pulsion vitale de survie, le seront un jour, plongés qu’ils seront dans leur volonté de fuir leur détresse en écho de leur propre vide. Nul ne peut nier qu’il suffit d’une unique fois, pour qu’une convergence fasse conjugaison, même si le brassage obligé des facteurs sociaux, peut parfois rendre l’exercice aléatoire et décevant.
Chaque quête se devait être décortiquée, par l’homme rejeté, coincé entre vide et espoir, tout à espérer encore, découvrir l’interlocutrice privilégiée. Ma solitude n’avait d’autre futur que de coller aux appels lancés sur le site, que de se raccrocher aux offres d’ouverture, que de désirer fortement entretenir un nouveau lien affectif. Pour y arriver, il me fallait, être admis dans le salon virtuel du site des rencontres afin d’accéder à la nouvelle intimité, à l’ultime chance de survivre au naufrage décidé par Marie !
Le forum rend possible l’ouverture d’une convergence, même si certains n’y voient, à première vue, qu’un inépuisable vivier de sexes à foison pour des âmes errantes trop longtemps privées, qui, subitement encanaillés dans leurs chairs, touillent librement et sans tabou, avec l’épuisette de l’écriture, dans un magma grouillant, généreusement offert.
C’est que même dans l’Eden, la chair avait fini par se retrouver fade, dans un face à face entre homme et femme bibliques : Adam, le premier homme et Ève, la première femme. Tous deux furent confrontés à des sexes trop exposés, banalisés par la vue. Le fantasme étant démythifié car trop incarné, tous deux auraient fini par perdre le désir si le démon ne s’était pas incrusté pour réintroduire la rareté par l’interdit, ni pour privilégier le plaisir par la transgression.
Sur ces sites de la dernière chance, il est impossible de ne pas décrypter que les plus âgés, tous sexes confondus, les « déclassés » physiquement et sentimentalement, s’inventent des âges pour grappiller encore un peu sur la vie et rentabiliser leurs corps fatigués. Souvent, pour leur malheur, ils se retrouvent figés, hébétés, désespérés face au peu d’engouement qu’ils suscitent malgré une façade voulue aguichante.
En vérité le chasseur sait reconnaître la désespérance qui transpire des écrits, en dépit des efforts mis à la dissimuler. Les requêtes affichées peuvent aussi être fantasmées et très éloignées des désirs de celui qui les reçoit.
Comment ne pas deviner l’erreur qui enferme au travers l’écrit d’une postulante, ni comprendre qu’affolée, elle tentera, hors tous sentiments, de vendre chèrement les derniers bijoux qui lui restent, ni que ceux-ci se révéleront hélas si vite démodés, que l’ultime « trésor » ne sera plus convoité après un premier et unique usage ?
Afin de fuir la misère affective qui les talonne, les esseulées assaillent la moindre offre, s’ébrouent pour que la solitude les lâche. Si elles ne suscitent plus l’émotion et s’agrippent de la pire façon, c’est que le désir d’être amoureux est sans limites. Dans ce cas, la candidate s’emballe, part, revient, s’obstine de façon débridée. Face aux sollicitations, elle se lamente, enrage, et au final, repousse. L’interlocuteur perd pied, disparaît sans laisser plus de traces que ne le ferait un corps qui, en plein hiver, traversant à pied un fleuve, verrait soudain en son exact milieu, la glace s’entrouvrir pour l’engloutir, là où le redoux l’aura rendue trop fragile pour supporter plus que son propre poids.
8
Étant pratiquant du site, je ne jette l’anathème sur personne. Lutter pour le maintien de la relation amoureuse oblige à une attention de défense permanente. Toute force contraire se doit être maîtrisée.
Hélas, en ce monde de fiels et de douceurs réunis, subsiste une certitude : toute démarche de vie contient en soi, un germe de rupture. Il nous épie, nous guette, nous fait avancer à vue, nul ne pouvant échapper à l’une des résultantes de la relation amoureuse : « la rupture ».
Je m’entendis pourtant rétorquer :
— Les sites de rencontres sont aussi faits pour des personnes réellement libres dans leurs têtes, en quête de rencontres sincères et pas nécessairement en conséquence d’une rupture amoureuse.
Je répondis qu’il y avait incompréhensionet même contresens sur le mot rupture, carchercher à s’extraire d’un état de manque, être en quête de nouvelle existence, est déjà action de rupture. Lorsque j’écris sur le site, c’est certes en homme blessé qui porte son poids de vie passée, de joies, de douleurs, de séparations, de manques, mais qui, néanmoins demeure plein d’espérances et mande une compagne. Plus généralement, le seul fait d’être en désir de rencontre, traduit une volonté de rompre avec une situation passée ou actuelle, même paisible, même libre de souffrances ou du fait d’autrui.
En vérité, jamais, la solitude ne nous lâche ni ne nous quittera. Chacun veille à refouler la terreur potentielle de devoir se retrouver, un jour, affectivement nu et seul. Plus généralement vouloir se départir d’une situation de blocage, traduit une volonté de rupture avec l’état insupporté du quotidien.
J’ai assurément connu cette expérience à observer une foule en attente de consolation et je veux, à présent que les jours me sont comptés, laisser trace d’un vécu chargé de ses lots de bonheurs des débuts, en forme d’apothéoses, suivis de ceux, plus ou moins rapide de leur déclin, jusqu’à leurs effacements.
9
Mais avant Marie et les sites, il nous faut nous souvenir de l’autre façon qu’il y avait de nouer une relation, car il y eut, à n’en jamais douter, un avant, d’il y a simplement quelques années.
J’ai assurément la nostalgie de ce temps où les trajectoires entre hommes et femmes se croisaient par hasard. Une époque, quasiment disparue, où les rencontres tenaient à des effets d’aubaine, où les occasions étaient commandées par le destin. Les unions appartenaient alors, à l’irrationnel ; elles étaient la conséquence d’un sort lié à des familles, à un lieu, aux circonstances, à l’influence lunaire ou astrale, en quelque sorte à la magie, à la main de Dieu, concrétisées parfois par le mariage, institué en sacrement, pour les inscrire et les fixer solidement dans l’éternité.
C’est ainsi qu’au tout début d’une nouvelle ère, du nouveau siècle, une épreuve sévère s’invita à ma table.
Ma chance voulut que c’était au temps où mon corps était fort, où la vigueur ne se mendiait pas encore, au tout début d’une histoire d’adulte, un moment de vie versée dans un temps dépassé, pas si lointain, encore tiède, si proche, si incroyable de proximité, qu’il laisse mon cœur pantois, incrédule, déconcerté.
Il m’en souvient encore, car c’était juste avant l’instant, fatidique ou heureux, selon, où l’informatique imposa son mode obligé à la vie des hommes.
10
Après le grand soleil et les premières gloires tirées du succès de la vente de mes deux premiers livres, après que la lumière ait rejailli sur celui qui avait osé révéler une vérité cachée, vinrent les jours gris, les pluies glacées, les retombées vengeresses. Elles me renvoyaient à une autre réalité, à l’opprobre que je dus supporter, à la casse rageuse de mon cabinet, à l’effacement de mon utilité professionnelle que ma vocation d’avocat avait su gérer avec passion.
Je fus lourdement attaqué, quasiment lynché dans mon cadre professionnel, pour avoir enfreint, à tort ou à raison, la loi du silence. J’avais en effet rédigé deux livres qui transgressaient l’interdit du dire et du faire connaître de ce qui devait demeurer secret et ne prospérer qu’entre initiés et profiteurs. Ceux-ci s’unirent en une croisade guerrière contre celui qui disait la vérité. Les condamnations multiples en diffamations bradaient les principes célébrés publiquement, hypocritement. Elles provoquèrent chez moi un ressenti de grande injustice.
Combien paraissait risible la règle souvent affirmée de la liberté d’expression, si peu respectée, quoique sans cesse proclamée. Elle était subitement interdite, lorsqu’elle devait contredire l’opinion officielle !
Il fallait, pour expliquer ma disgrâce, que je me souvienne du cheminement des évènements qui guidèrent mes sentiments, précédèrent le fatum du tout début de 2016 qui n’en furent que la suite. Il fallait que je raconte que bien avant Marie, la fin de l’année 2002 fut fatidique. Elle me plongea dans une catastrophe sans nom, qui devait durablement bouleverser le cours de ma vie jusque-là, bien ordinaire. Elle me ramenait au jour précis où ma fuite s’imposa, tant ma vie se trouva confrontée à la contre-attaque vengeresse, implacable avec ses menaces de mort.
Le 17 décembre 2002 fut en effet, le jour du cataclysme personnel et professionnel. Je m’entendis honteusement expulsé de la profession d’avocat. Mon éviction résultait de ma radiation (pas moins !) décidée par le conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris. Les censeurs de l’Ordre, n’avaient pas trouvé de peine plus grave que la peine infamante de la radiation tant leur fureur de francs-maçons et de profiteurs claniques, était sans limites. Combien est étrange le mot « barreau » lorsqu’il est rattaché à l’autre mot, « avocat » ! L’Ordre des avocats ne serait qu’une geôle, à l’intérieure de laquelle personne ne saurait contredire les commandements qu’il intime, sans risquer pour sa vie, pour le moins, professionnelle.
La cause en était la sortie de deux livres que j’avais eu l’impudence (imprudence ou courage ?) d’écrire. Ils traitaient de l’existence de réseaux d’influence au sein de l’institution judiciaire, de la défiance des justiciables qui en découlait. L’incompatibilité qu’il pouvait y avoir pour le juge à cumuler deux serments, celui prêté à la République et celui prononcé au profit d’une association. Je dénonçais surtout ce qui, en particulier, se passait au sein du barreau de Paris, leur acharnement à vouloir imposer la puissance du relationnel au détriment de la règle de droit.
Mes livres s’opposaient à ceux qui statuaient par préférence en faveur d’intérêts personnels. Je traitais de l’évidence, tant il semblait légitime d’exiger, dans un État de droit, qu’un juge ne puisse plus mettre en concurrence, son serment d’allégeance à la République avec l’autre serment, celui qui l’obligeait à favoriser les intérêts particuliers de ses « frères », les membres d’un groupement sectaire et fermé, au détriment du justiciable lambda et de la loi.
Globalement, je contestais une Justice partisane, inféodée ; une Justice déviante et de classe, qui impose le silence, interdit la critique et la propagation jugée sacrilège d’une parole de dénonciation dans la pratique du judiciaire. Fallait-il pour autant que j’espère l’impossible ? Je m’écrasais donc contre un mur, terriblement puissant. La corruption n’en continua pas moins à prospérer dans ses recoins dissimulés. (L’affaire Tapie rendue publique, en constitue un des exemples symboliques)
À cette époque cependant, une certitude s’ancra : l’interruption forcée de ma vie professionnelle ne pouvait être que temporaire, donc providentielle, puisque la condamnation n’avait, en droit, aucun support juridique, sinon d’être un effet du Prince induisant une décision instinctive, artificielle, illégale, injuste. Ayant ainsi toutes raisons de concevoir un dénouement heureux à mes recours, j’entrepris de faire un long voyage avec l’idée qu’il fallait me dépêcher si je voulais en profiter. Je m’y engageais comme dans un exercice de survie, une chance rare, unique qu’il me fallait saisir même si elle m’était imposée.
Je me dis que pour surnager, il me fallait profiter de ce temps de vacuité : il ne pouvait être que limité. Il me fallait tout autant cesser mes plaintes, tant elles étaient devenues inaudibles, jusqu’auprès de ma femme, qui, à bout de patience, me poussa au départ, après m’avoir lancé au visage, en présence de mes enfants :
— « Tu nous fais chier avec ta radiation ! »
La sanction devait de devenir finalement, non plus une cause de souffrance, mais un espace de liberté, un moyen de privilégier les découvertes terrestres dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation. Il fut effectivement rendu le 16 décembre 2003 : la décision cassait et annulait en son intégralité la sentence honteuse rendue par un Ordre aveuglé par la haine et la défense de ses privilèges.
Mais avant que mon échappée n’ouvre le rideau sur une félicité qui transformerait mes échecs en réussites, il y eut un temps pour l’errance, de nombreux kilomètres parcourus loin des remugles parisiens, avec, chevillée au corps, une énorme solitude.
J’aimerais en conter brièvement quelques passages, tant ils démontrent que le bonheur ne se mérite qu’arrivé au fond de la persévérance et de la disponibilité de l’esprit.
11
En deux sauts d’avion, mon échappée, me conduisit jusqu’à Nouméa en Nouvelle Calédonie, la lointaine terre d’accueil, symbole de la dissidence, des bagnards, des déportés de la Commune et des condamnés de la pensée libertaire.
Pour y arriver, il m’avait fallu passer par Tokyo, où, épuisé par le décalage horaire, je m’étais affalé sur l’herbe des pelouses qui bordent le devant le palais de l’Empereur, puis j’avais mangé une soupe « Wong ton » dans un petit restaurant. Sept heures d’attente m’avaient ramené à l’aéroport, soudain secoué par un lourd grondement de camions passant au-dessus de ma tête... en réalité un tremblement de terre accueilli dans l’indifférence par des autochtones blasés, mais qui, moi, me laissa, dans la crainte. Je repris un avion pour rejoindre la Nouvelle Calédonie. Quelques jours plus tard, je faisais un saut jusqu’à Cairns en Australie, pour, après un séjour à Sydney, me retrouver finalement en Nouvelle-Zélande, à l’un des bouts du lac Hawea, où je m’arrêtais.
Le lac est entouré de masses de terres sans arbres, juste coloriées d’ocres, parcellées de nuances verdâtres, de plaques brunes, de rocailles et d’éboulis. Une belle route m’y avait conduit : une voie uniforme de qualité. Elle perce sans fin, l’île du sud entre mer, montagne, herbages, forêts primaires luxuriantes composées d’arbres raides comme des « I », posés sur des tapis de mousse rougeâtres où dominent les hautes fougères emblématiques, lorsqu’elle ne s’enfonce pas dans un inextricable de montagnes dénudées, d’anciennes moraines ciselées. J’avais parcouru près de cent kilomètres sans apercevoir une habitation : un désert humain.
Je nourrissais pourtant le sentiment, qu’il fallait me raconter dans un changement d’échelles à hauteur de la planète.
Plein sud, je dépassais le glacier Fox, une énorme masse de glaces verdâtres frangées de blancs, criblées de tracées noires et sales. Le plus curieux était de constater qu’en raison du réchauffement terrestre, ce glacier était appelé à disparaître, ce que quantifiaient des panneaux indiquant où se situait le glacier en 1750, soit à environ trois kilomètres de son emplacement actuel.
Ma chambre donne sur une vaste étendue d’eau légèrement ondulée, ce jeudi matin 5 juin à 8 h 10. À Paris il est encore le 4 juin 22 h 10, ici, le soleil se lève. Le ciel est clair. Des nuages semblent hésiter à fleur de sommets entre les roses flamboyants et les gris foncés, jusqu’à ce qu’enfin des franges d’un soleil rougeoyant explosent dans un hymne à la joie.
Je n’oublie pas de tout inverser : dans l’hémisphère sud, le nord est signe de chaleur, le sud, celui du froid. L’eau dans le lavabo s’évacue en sens contraire d’une montre. Le soleil brille à droite et non plus à gauche, tandis que la conduite s’effectue à gauche… mais pas pour les mêmes raisons. La pointe extrême de l’île du sud de la Nouvelle Zélande, marque en son 47° parallèle, la fin d’une civilisation. Au-delà, ce ne sont que quarantièmes rugissants, frayeur des barreurs en solitaires, et à quatre mille huit cents kilomètres, plus au sud, le pôle sud, l’Antarctique, le encore glacial.
L’île du sud de la nouvelle Zélande est légèrement plus grande que celle du nord. Ensemble, elles totalisent la taille de l’Angleterre ou du Japon, mais au lieu d’avoir respectivement 80 millions et cent millions d’habitants, elles n’en ont que 4 millions. L’île du sud ne compte qu’un million d’habitants, alors que l’île du Nord en accueille 3 millions, dont un million à Auckland et la moitié à Wellington, une capitale, située au point géographique central.
J’apprends que ma fille vient d’être reçue à son concours de violon sur son interprétation d’un morceau de Kreisler. Certes ce n’est qu’une première mention, mais la fin d’un cauchemar, de l’anxiété d’un père soucieux de la réussite de sa fille, et une victoire de l’acharnement sur le relâchement.
J’écoute le concerto n° 1 de Brahms pour violon et orchestre. Il frappe l’évènement de volontarismes. En ces pays de cow-boys, la musique classique, lorsqu’elle n’est pas inconnue, est bradée : un CD s’obtient pour juste 2 $90, pour ne pas dire qu’il est offert par charité de l’ordinaire.
Ici c’est l’hiver, mais il ne fait guère moins de 11 à 15 degrés en plaine. En ce point précis du terrestre austral, on a du mal à se croire en plein hiver, tant l’air semble résolument ignorer le gel et la neige.
En ces lieux d’éloignement, toute réflexion n’est pas absente. Je ne peux oublier les images du film « à propos de M. SCHMIDT » vu dans une salle de la petite ville de Greymouth. Le premier rôle est joué par Jack Nicholson. Le film décrit l’horreur de la vieillesse naissante et de la décrépitude qui s’ensuit. Il relate le retrait du domaine de l’utile de la personne décidée « hors d’usage », exemptée de tout. Il dépeint le plongeon de l’être dans l’inactivité, sa mise de côté, sa subite transparence. La sénilité s’affiche en premier dans le regard de l’autre, du compagnon ou de la compagne, de la personne qui dans les transports, se lève spontanément pour céder sa place. Le film est impitoyable dans son énumération des défaillances de celui dépeint constamment épuisé. Ses faiblesses surgissent à chaque instant. Le corps accuse chaque avancée, chaque stigmate ancre la trace, creuse le sillon. Toutes qualités et talents antérieurs passent aux oubliettes, disparaissent en même temps que la mémoire. L’inexorable de la chute se traduit par une glissade dans un vide qui conduit à l’incontournable mort, non sans passer au préalable par les cases : dégoût du toucher, laideur, crasse, odeurs, vacuité de la vie.
Chaque conquête arrachée par l’ancien est récupérée par les plus jeunes ou les moins vieux, les « arrivés » à leur apogée, ceux qui ignorent tout de l’écoulement de leur propre temps, de leur avancée à découvert dans le no man’s land des fins de vie : les impatients de s’emparer des biens de ceux qui les précèdent, les prêts à tout absorber, à brûler leur potentiel d’énergie, à monter en grade, à devenir plus riche que leurs voisins, à susciter l’envie, avant que la poussière ne les ensevelisse !!
La jeunesse repousse la vieillesse dans l’inexistant, sans se douter qu’elle-même est reliée à la même cordée qui l’entraîne et l’inclut dans le mouvement qu’elle imprime. Elle n’aura finalement d’autre solution que de voler la place de l’éliminé puis d’être poussée, à son tour, par la génération suivante. Il en sera ainsi per omnia secula seculorum, selon la formule ecclésiale.
Je retrouvais dans cette vision filmée du drame ordinaire de la condition humaine, un sentiment exprimé par l’attitude de ma mère qui, à la fin de sa vie, se battait avec les seules armes dont elle disposait encore : son acharnement à se rendre insupportable aux yeux de sa famille et des autres, au point que leur rejet lui devenait salutaire, car il lui donnait la preuve qu’elle existait encore. En s’enfonçant, ainsi, de plus fort, dans son désespoir, elle se persuadait que la mort serait libératrice. Elle plongea ainsi, lentement, dans l’indifférence de son entourage et en secret, dans un suicide fait d’abdications, de privations et de punitions face aux fonctions élémentaires de la vie.
12
La réflexion me rattrapait en ce bout du Monde, aux antipodes de la France, en Nouvelle Zélande. Ces îles parfois fastueuses et vierges démontrent aussi que les hommes qui les habitent ne sont pas meilleurs. Elles font même parfois regretter les futiles intrigues de Paris, pour peu que l’on veuille se sentir dans le mouvement et que l’on ne veuille pas, s’en sentir exclu.
Dans ce pays de plein air, de paysages à couper le souffle, de gorges escarpées, de ravins et de rivières torrentielles, on peut ne croiser aucune voiture pendant plus de cent kilomètres, rarement une maison, même si partout le mouton est roi. Le libre espace ne pose pas problème. L’immigration est partout facilitée, dans un grand brassage des peuples. L’anglais de souche, le pur British, celui qui chôme le jour de l’anniversaire du couronnement de la vénérée Queen Élisabeth, est en voie de dilution. Les nouvelles générations faute de nouvelle guerre en Europe, perdent le lien réel avec la vieille Angleterre. Le mélange des ethnies s’impose. L’Asiatique est de tous les endroits. Ainsi hors les villes principales, l’Europe des vents pacifiques, se dissout lentement, dans un américanisme agricole primaire, fait d’habitations et de rues qui se coupent en perpendiculaires, parsemées d’échoppes westerns, aux façades de bois peints. Ici des hommes vaquent en shorts, portent le chapeau de cuir néocolonial des rangers. Leurs épouses les accompagnent, visages rugueux et rougeauds, poitrails et fesses généreuses.
Parmi ce qu’il faut quand même appeler : l’enfer d’un certain vide de l’intellect, existe un écrin, la ville récemment fortement endommagée par un récent tremblement de terre, Christchurch, située dans l’île du sud. Précieuse, elle cultive le particularisme d’une architecture anglaise de précision, forte de son centre universitaire artistique permanent, riche en évènements. On y retrouve la cocasse apparence des descendants écossais, portant Kilts et chantant à tue-tête ce que l’on chante encore à Édimbourg.
En Nouvelle-Zélande, comme ailleurs, la justice, si elle est celle du droit, reste celle des hommes, même si le principe règne, selon lequel « la justice ne doit pas seulement être rendue mais apparaître réellement avoir été rendue » règle édictée par le roi d’Angleterre, Richard cœur de Lion, en ces termes : Justice d’ont just to be done, but seem to be done. La convention européenne des droits de l’Homme, en son article 6, a repris cette norme ancienne de plusieurs siècles. Cette évidence semble encore bien étrange pour la France, les plus fermes opposants étant les juges eux-mêmes, qui voient dans ce dicton une perte de leur absolutisme, mais aussi certains avocats qui les incitent à supprimer la stricte transparence, au nom d’une communauté d’intérêts occultes.
L’exigence de l’apparence suscita un débat dans le journal « The Press » dont la devise est écrite, en français, « Dieu et mon droit ».
Il s’agissait du cas d’un jeune garçon de 19 ans d’origine chinoise qui avait tué une petite fille alors qu’il était au volant d’un véhicule qu’il conduisait sans permis. Il avait été condamné à 2 ans de prison et à 40 000 $ en réparation du préjudice moral des parents de la victime (environ 21 000 Euros). Le coupable faisait valoir en appel, qu’ayant payé sa condamnation pécuniaire, il était en droit d’obtenir une réduction de sa peine de prison. Le juge d’appel reçut favorablement sa requête et réduisit sa peine à une année en précisant que cette réduction tenait compte de la réparation pécuniaire.
Cette sentence ouvrit un débat qui fit sortir le premier juge de sa réserve. Il estima publiquement que cet arrêt était fautif sur le plan des principes. « Le paiement de la réparation en argent ne peut se substituer à la peine de prison : si on peut comprendre, exposait le premier juge, que dans un cas de vol ou de dommage matériel, cela peut être envisagé : la chose pouvant être restituée par son équivalent en argent, en revanche dès lors qu’il s’agit de la perte de la vie d’un être humain ou même d’une très grave blessure handicapante, aucune somme d’argent ne pourra réparer la peine ou la douleur. Ce serait, d’autre part, établir une distinction entre riches et pauvres et donc instituer une inégalité selon la fortune, donc la disparition de la notion d’une Justice égale pour tous ».
La décision d’appel semble avoir créé un précédent, surtout en raison de la personnalité de la petite fille décédée. On aurait pu y voir qu’un droit naturel du juge à adapter en voie d’appel, une première décision. C’est ce qui se passe habituellement. Or ici, ce qui a choqué, c’est la motivation donnée par le second juge, car elle a opacifié le sentiment que la justice était égale pour tous, mais qu’au contraire, elle était rendue en fonction d’une capacité de payer.
La question méritait d’être posée car si pour certain l’argent ne devait pas influer sur la peine, de peur de créer une discrimination, pour les autres, la justice ne devait pas plus être rendue en fonction de la qualité de la victime ni de ses origines, voire de son âge, et surtout pas de ses capacités financières ni de son appartenance à telle ou telle ethnie.
La Nouvelle Zélande ressemble encore à une Angleterre qui aurait retrouvé un nouvel espace. L’évolution semble se faire à marche forcée, vers un détachement du lien avec la mère patrie, vers des retrouvailles avec la culture Bio-Maori, des Polynésiens, venus du nord par la mer, dans des pirogues, il y a mille ans, de souche identique à celles de la Polynésie française.
La mode de la repentance a déjà atteint ces terres australes. Après les avoir dépouillés de leurs terres, avoir brûlé leurs forêts, les avoir presque anéantis physiquement, les dominateurs pouvaient introduire, à présent sans crainte, une généreuse dose d’égalité virtuelle, à défaut d’être réelle. Un traité de 1995 reconnaît sur le papier, aux Maoris, des droits égaux à ceux de leurs envahisseurs. Il n’y a donc pas de petit village qui ne porte sur sa plaque d’entrée, le nom maori d’origine, ni qui ne possède son musée vantant une culture du folklore. Il est du plus grand chic de rattacher ses origines à celle « des natifs », un terme qui désormais unit, alors qu’il séparait. Ne vante-t-on pas cet indigène qui atteint le grade de commandant dans le « natif contingent » au sein d’une armée qui savait bien, elle, faire la différence ?
Actuellement, ce sont toujours les natifs, soit 16 % de la population, qui, crânes et corps tatoués en signe de « testéronnité » affirmée et de puissances animistes triomphantes, traînent dans les rues, en SDF, occupent les postes subalternes, monopolisent les services du nettoiement ou du gardiennage, comme si ces corps professionnels subalternes leur étaient spécialement réservés. Ce qui est sûr, c’est que ce sont eux que l’on retrouve le soir désespérés, pris par l’alcool, pourchassés et lourdement condamnés en années de prison, tandis qu’à l’inverse, le blanc garanti pur posera toujours au juge blanc, un cas de conscience légaliste, longuement soupesé.
L’égalité raciale espérée semble plusvivacedans les discussions que dans les actes. Elle implique que la vieille Angleterre de souche, toujours dirigeante, abandonne ses réflexes racistes. C’est que, jusqu’à ces dernières années, le lien affectif avec l’origine lointaine des conquérants s’affichait encore aux frontons des mémoriaux aux morts de la Première Guerre mondiale. Les plaques commémoratives de début du siècle dernier éclairent avec certitude l’évolution des mentalités. On y lit par exemple : « ce sont les vainqueurs qui donnèrent leur vie, pour la paix et la liberté de leur mère patrie ».
Cettegrandiloquence n’est déjà plus de mise pour la Seconde Guerre.
13
Je veux également relater brièvement ce qui m’avait marqué en la Nouvelle Calédonie, une terre française en forme de langue émergée de 400 km de long sur 25 de large. En particulier, le jour où les enfants de Maré (l’île) furent transportés en avion vers la Grande Terre pour accueillir le Président Jacques Chirac. L’ambiance était enthousiaste, la foule nombreuse. Pourquoi pas ? C’était jour de fête dans cette île de la loyauté, belle à vous saisir, à majorité « indigène », dont on peut faire le tour en moins d’une journée en voiture.
Le soir, étendu sur un gazon taillé ras, épais et moelleux, je pus observer la lune ronde au travers de la trouée des cocotiers, puis partir à vélo sur des routes désertes, pédaler sous la seule clarté lunaire, accompagné de quelques aboiements de chiens.
Le lendemain, la tribu de Wabao était occupée à récolter des fonds pour qu’une de leur fille s’en aille en pensionnat à Grasse y suivre des études spécialisées dans les parfums. Seul « blanc », bien accueilli, j’y suis allé manger du poulet accompagné de manioc (dont le goût ressemble à de la patate douce ou à de la banane-légume de Martinique) accompagné de riz et de salade. L’eau me fut offerte avec générosité. Cette promiscuité se fit dans une gêne évidente, mais il suffisait pour en sortir, de parler à des enfants avides d’apprendre, fiers de partager une connaissance au centre culturel de « la Roche », impatients de faire de la poterie avec la terre glaise en provenance de la Grande Terre, et parlant avec passion des fouilles entreprises en recherche de leur passé.
Sur l’île, personne ne se croise sans oublier de se saluer. Chacun veille à ne pas oublier de faire le signe de l’amitié, ni de rendre hommage au « grand chef » de chaque tribu, donc de se munir d’une pièce de tissus, d’un billet, d’un signe de respect et d’hommage à la culture coutumière.
14
Après m’être rendu jusqu’au plus loin, à la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, j’abordais à présent, la seconde partie de mon évasion vers un autre lointain de la planète terre : le Brésil, l’Uruguay, l’Argentine, le Chili... hors des attentes stériles et lointaines solutions du procès.
Le mois de novembre 2003 marquait le début du printemps austral.
Pour la première fois, j’avais ressenti une brève plénitude à barrer en solitaire un voilier au milieu d’un bras du fleuve Paraná, en aval de « Tigre », cité balnéaire, située dans la banlieue chic du nord-ouest de Buenos Aires. Le bateau était simplement propulsé par un spi. La proue fendait l’eau dans le silence et le cliquetis des filins d’acier qui battaient le mât.
Je ne savais pas que dans quelques jours, ma vie basculerait.
Je n’avais d’autre idée que de poursuivre un voyage aux allures d’échappée touristique, guidé par une volonté d’user au mieux de mon temps d’errance imposée, loin d’une France qui m’avait si mal traité.
C’est dans ces conditions d’esprit et d’apaisement que j’abordais l’Argentine.
Venant de Buenos Aires, un autobus de nuit, me déposa après de multiples pannes, aux portes de la Patagonie, à Porte Madryn, une petite ville tournée vers la mer, vers le tourisme écologique, ses baleines et ses baleineaux. Composée de rues rectilignes à angles droits, elle marque les limites de la zone fortement habitée du nord avec l’autre partie, quasi désertique, du grand sud, là où le Chili et l’Argentine, deux peuples associés par une même langue, ne cessent de se disputer ni de s’observer en chiens de chicanes, allant même parfois, jusqu’à se mordre.
15
Le vingt novembre 2003, je vivais mes derniers moments en solitaire, mais je ne le savais pas encore.
Sous un vent chargé de douceurs, je marchais sur la plage à marée basse, lorsque soudain, trois cavalières, trois jeunes femmes montant à cru, déboulèrent au galop sur la plage, visages offerts, cheveux blonds aux vents. Elles me dépassèrent sans un regard. Dans un même rythme, les sabots de leurs chevaux laissaient sur le sable mouillé, des traces régulières, dessinées parallèles.
Je n’accordai pas d’importance à ce signe discret du destin et continuai ma marche jusqu’aux limites de la plage.