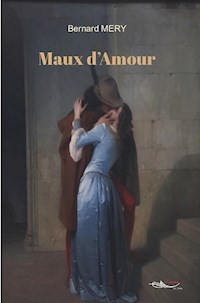
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L’écriture est un questionnement permanent où les questions sont parfois plus intéressantes que les réponses. Face à la perte d’un amour, l’auteur, creuse le passé qui le retient et le harcèle. Il est celui qui s’interroge, se cherche, se trouve et qui, en tout cas, ne voudrait plus s’égarer. Des dialogues viennent heurter une solitude pour en apaiser les effets. Au travers d’une échappée due à une persécution professionnelle, pour avoir dénoncé les réseaux, créateurs d’injustices, l’avocat un temps défroqué, use des voyages pour rebondir, et tente de mettre en lumière les beautés et les laideurs de la rencontre amoureuse. Il relate la magie que procure la femme aimée, de Marie à Athéna, à Élodie... jusqu’à l’inverse d’un possible pour Christina, l’handicapée interdite d’amour, qui draine son passé au travers sa terrible souffrance et des remugles de la seconde guerre mondiale qui, pour ne pas désespérer totalement, mise sur la réincarnation. Toute rupture amoureuse, aussi douloureuse soit-elle, ne doit jamais conduire au suicide. L’auteur constate in fine la suprématie du site des rencontres sur le hasard et la constante chez l’être d’une aptitude à aimer.
À PROPOS DE l'AUTEUR
Bernard Mery exerça la profession d’avocat jusqu’en 2016. Il fut outrageusement condamné par ses pairs après avoir dénoncé l’existence des réseaux au sein de la justice française, ceux-ci le radièrent du barreau de Paris, mais un an plus tard, la Cour de cassation le rétablit totalement au grand damne des bâtonniers. Il est l’auteur de quatre livres.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernard Mery
Maux d’amour
« Maître, que dois-je faire pour gagner la vie Éternelle ? »
« Avant tout, ne te mens pas à toi-même »
(Les frères Karamazov – Dostoïevski)
1
Il se peut qu’à la suite d’un choc ou tout naturellement, que le fil de vie, un temps égaré, se retrouve subitement, et s’ordonnance autour d’un scénario, avec un début, un avant, un après et une fin.
C’est ainsi qu’au hasard d’une pensée, des senteurs de bergamote me renvoient au soir où, enfant, je prenais un bain plongé dans l’eau trop chaude d’une vaste baignoire dans une belle demeure. À cette vision s’accolent d’autres odeurs, celles de tièdes confitures d’abricots cuites et recuites, mêlées à de la figue, tournantes et fumantes dans des marmites en cuivre. Elles-mêmes me transportent dans la fraîche humidité de l’allée centrale d’une abbatiale romane, résonnante car désertée. Le dehors de la bâtisse est bordé de noisetiers pourpres, qui la protègent des tempêtes assassines tandis que son porche donne accès à d’autres sentes de terres battues, qu’enfant solitaire, je parcourais à vélo.
Soudain des crépitements d’éclairs enflamment un ciel noir alentour qui dévoile, tantôt, des pêches, éclatantes de sucre, au goût de miel, aux peaux bistre parcheminées par le soleil, tantôt, de bruyants rassemblements d’étourneaux, réfugiés serrés pour la nuit, blottis dans un bosquet d’arbouses effrayés par les croassements d’autres oiseaux, aux plumes très noires. Plus tard, aux confins de l’aurore, dans un ciel encore incertain, j’entrevois ballottés dans le vent, des ombres de cerfs-volants déployés. Alors sans logique, je m’agrippe à des images incongrues, à des volées de tennis, à des visions de parties de croquets, dans le parc où s’alignent, figés et raides comme des généraux d’empire, prêts à la parade, des ifs centenaires et majestueux.
Pouvoir suivre ces enchaînements, frise l’exploit, car il fallait bien des efforts, en ces temps-là, pour se croire héros, capable d’atteindre, pour d’autres jeux, au pied du château, des quilles de granit grises, recouvertes de mousse vertes, posées tels des chiens de garde.
Ces représentations cumulent des réémergences de mes neuf ans, qui, à cette époque, avaient hâte d’être à demain ! Ma sœur aînée, moi (second de la fratrie) et ma sœur cadette, tous trois unis, faisions face à notre mère, belle, majestueuse, mais froide et indifférente, car inconsolable d’être si mal aimée, et pourtant, attentive à rassembler ses canetons pour qu’ils glissent en bon ordre, l’un derrière l’autre, sur l’eau tumultueuse de nos vies. Malheureusement en effet, notre père brillait par ses absences et se montra si peu présent, qu’à la fin, notre cœur se vida de tout amour pour lui, puis le déserta, comme un mollusque délaisse sa coquille ou comme un bateau, cale déchargée, poursuit imperturbable, sa traversée, vers l’autre rive.
Il est vrai que pour sa défense, le cours de la vie de ma mère, avait été trop vite réglé par des parents pressés de divorcer. Une annonce dans le « chasseur français » avait servi d’appât pour attirer le jeune capitaine qui serait mon père. On ne demanda pas l’avis de la jeune fille, ni si elle n’aurait pas préféré l’amour qu’elle nourrissait pour un jeune médecin de la bonne vieille ville épiscopale d’Autun. L’affaire fut conclue entre vrais maquignons, le montant d’une chiche dote fut arrêté entre deux hommes, le père de ma mère et le candidat, mon père. Le jeune marié avait dû vite partir pour la guerre puis fuir avec ses hommes en pleine débâcle, passer la frontière et être interné en Suisse. Ma mère, en bonne épouse, voulut le rejoindre. Or, les événements s’étaient dramatiquement précipités. Les avant-gardes allemandes n’étaient déjà plus qu’à quelques kilomètres de Montceau-les-Mines. La locomotive qui lui servit de moyen de transport devint la proie de deux rôdeurs, deux Messerschmitts qui piquèrent soudain dans un effroyable hurlement et un vacarme de mitraille. Apeurée, ma mère se recroquevilla dans un coin, ferma et serra très fort les yeux pour ne plus rien voir, récitant sans cesse pour se protéger, Jésus, Marie, Joseph comme le lui avaient appris les saintes sœurs dans son école, d’en appeler toujours à la protection de Dieu, une force suffisamment dissuasive, ici, contre les impacts des balles, contre la mort, contre l’enfer et le diable qu’elle redoutait plus que tout.
Elle arriva sur la place du marché au moment précis où le dernier autobus s’apprêtait à partir en direction de Pontarlier non loin de Vallorbe. Enfin arrivée, elle continua à pied jusqu’au poste de garde suisse, arriva face à des barrières abaissées, morte de fatigue, s’y appuya. Un jeune lieutenant s’approcha craintif et braqua suspicieux son arme sur le ventre arrondi de ma mère, lui demanda ce qu’elle voulait. Elle lui expliqua qu’elle souhaitait rejoindre son mari, capitaine de l’armée française, interné du côté de Berne. Elle était jolie, n’avait pas vingt-quatre ans, avait l’air déterminée, courageuse, faisait partie de « la famille militaire ». La Suisse aime les enfants, aime le courage, aime l’armée. Vérifications faites, la sonnerie aigrelette du téléphone grésilla. Aux réponses du jeune homme, ma mère comprit qu’elle était finalement autorisée à rejoindre mon père. De ce côté-ci de la frontière, rien n’avait changé dans les habitudes, le train était à l’heure. Il l’amena à Biel puis à Freiburg. Elle découvrit enfin sur le quai de la petite gare de Murten un mari sans problème, inconscient des risques et des difficultés qu’elle avait dû traverser pour le rejoindre. Lui, l’interné militaire, se présenta en victime de la guerre, centre unique de tout intérêt. Il abreuva sa jeune épousée du récit des difficultés qu’il rencontrait à effectuer ses recherches historiques dans des bibliothèques incomplètes. Il ignora tout de cette preuve d’amour. Jamais elle ne s’en remettrait. Ma sœur Chantal naquit quelques mois plus tard, le 7 décembre 1940 à Bern.
Malgré tout, si, dans cette enfance, il y eut des joies, les peurs sont venues bien plus tard, alors que nous avions déjà une vie derrière nous et vécu plusieurs étés mordorés. Nous partions à l’abordage d’expériences dans des trains à ciel ouvert, composés de wagons en bois, peints de jaune, de rouge et de blanc qui, en pays catalan, circulaient sur des viaducs à couper le souffle, en des tressautements de montagnes russes. Le soir de la Saint-Jean, je m’en souviens, les feux rougeoyèrent tard dans le noir de la nuit et mille étincelles rejoignirent la lune en repoussant, loin devant, nos pensées inquiètes.
C’était le temps des catéchismes, des messes du dimanche où, pour fêter l’exception, je portais un habit noir aux relents de naphtaline, un large col blanc amidonné et des souliers vernis. C’était le jour de la glace convoitée, servie rituellement en sortie d’église, dans un double cornet aux odeurs de gaufres tièdes, une pâte légèrement acidulée, jamais égalée, aussi vite engloutie qu’un paquebot, en plein naufrage.
Pourquoi l’enfance serait-elle seule autorisée à faire ressurgir ses nostalgies, comme autant de fers rouges qui torturent ? Serait-ce parce que nous sommes restés des enfants jamais libérés d’un temps pourtant révolu ? Aidé de photos, j’ai plusieurs fois eu la certitude de revivre à Nice l’été de mes neuf ans, de plonger dans une mer bordée de galets chauds, gorgés de soleil, de percevoir dans un infini, noir de nuages, des éclairs flamboyants qui s’abîmaient silencieux dans le lointain et qui désignaient à l’enfant que j’étais encore, le passage secret, vers un possible.
Sans cette enfance, j’aurais été incapable de vaincre les montagnes de doutes, qui me conduisirent à me cacher dans mes ultimes lieux de quiétude : des arbres ou une cave emplie d’objets abandonnés. Mes escapades me permirent d’ouvrir des caches qui regorgeaient de trésors entassés, oubliés, où je lisais dans des journaux d’antan, des faits très importants, forclos quoique toujours relatés au temps présent.
À mains nues, tel un orpailleur, je fouille les replis d’une enfance aux pages dépareillées, sublimées, margées de croquis délavés au fusain, de tracés incertains sur des toiles en joncs tressés. Parfois l’ouïe s’en mêle pour raviver le cadencement d’une Sardane lorsque les vigatanes martèlent le sol du son mat, en sautillements du tissu des espadrilles. Leurs lacets de toiles bariolées nouées jusqu’en haut des jambes des femmes, attirent les regards au-delà des chevilles. Ces lanières se lient et se délient, telles les destinées, tandis qu’une mélopée alliée de la tramontane, pousse vers le Canigou, se fraye un passage dans la neige des pétales de pêchers et de cerisiers. Le souffle une fois passé, restent les vestiges d’une pensée qui se moque des accablements. Ces réminiscences ponctuées de rires et de larmes, offrent de riches consolations.
La rédemption ne serait-elle rien d’autre que cela ? En réalité notre parcours n’a finalement guère plus d’effet sur le destin qu’une ronde enfantine, qu’une comptine qui répéterait « ainsi font, font… trois petites notes de musique… puis s’en vont ».
Ma prime mémoire ravive, une belle ville de Nice en sortie de guerre, Nizza la bella toujou a camea, reduzaïa au temps des colonies de vacances pour le garçon de neuf ans que j’étais encore – culotte courte, béret bleu et chemise blanche au vent – en attente sur le paillon recouvert, place Masséna, conduit sur le site dans des autocars Citroën jaunes et noirs, aux longs capots. Nos jeux de poursuites traversaient alors des blockhaus à moitié détruits, tandis qu’au sol gisaient des douilles de balles de fusils, brillantes de cuivre rouge, oubliées par la guerre, parmi la fine poussière de sable, sèche et blanche.
Le soir, devant un feu de bois, nos voix s’enflaient de murmures du chant guerrier, l’œuvre de deux résistants, Joseph Kessel et Maurice Druon, deux compagnons de la libération, accourus dès 1940 auprès d’un Général de Gaulle méconnu, résolument seul. Les paroles et la musique me reviennent :
« Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? / Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu’on enchaîne ? / Ohé ! Partisans, ouvriers et paysans, c’est l’alarme ! Ce soir l’ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. »
Depuis, le « chant des partisans » demeure lancinant dans mon esprit, en son rythme lent et cadencé et me charge en émotions. Nous ne devions pas seulement le graver en nos têtes d’enfants, mais en comprendre les paroles. Je n’en conservais qu’une sorte de concentré, chargé en « corbeaux cruels », « en cris sourds dans la plaine », « d’égorgements et de flots de sang abreuvant nos sillons ». Des lambeaux de vers avaient sauté, s’étaient entremêlés à d’autres tant ils sollicitaient une histoire vécue dans l’inconscience des premières années de vie. La plupart des acteurs de cette époque ayant disparu, seuls, les plus jeunes d’alors, dont je fais partie, gardent collé à leur vie, un fond de cette tempête. À notre manière, nous résistons à notre tour, comme à Waterloo le dernier carré des grognards de la garde impériale, arc-boutés contre les assauts répétés de forces bien supérieures : ici, celles de l’âge.
À cette époque l’amour, ses mots et maux étaient encore inexistants. Nous pouvions tout espérer de ce que nous ignorions.
2
Bien plus tard, un jour de janvier de 2016 : Marie annonce au téléphone : « je ne suis plus amoureuse » puis raccroche et disparait de notre existence après sept années communes. La foudre me frappe à l’improviste. Dans l’immédiat, je refuse ses mots, car même si subitement, pour me délaisser, elle me classifie sans valeur, hier encore, elle se laissait chérir dans mes bras. Ses cinq mots rongèrent tel un acide le cortex de ma vie d’alors, déjà bien chargée en craintes d’abandon et en poids d’années.
Pour survivre au naufrage décidé par Marie, il ne fallut pas tergiverser, mais en catastrophe me raccrocher au site. Marie, qui en était issue, me replaçait sur le marché du Net où des semblables se réfugiaient pour briser leur isolement et vivre sans contrainte. N’ayant d’autre choix, j’acceptais de partager cette foire de l’occasion, de consulter d’autres profils qui, pour inciter à de nouvelles noces, annoncent telle une quatrième de couverture de livre, leurs envies de recevoir et de faire, attentives à ce que cesse leur vacuité, sans confondre désirs et facilités.
Ainsi, tel Ulysse, yeux bandés, entravé, encordé au mât d’un vaisseau qu’emportent les ans, j’entends remonter du tréfonds, les suppliques de sirènes tournées vers des rêves de bien-être, des plaisirs ininterrompus et intenses. Il y a moi, solitaire, blessé, qui refuse de me laisser entraîner, obligé de fureter à nouveau les pages du web à la recherche d’une amoureuse disponible, prête à s’offrir tel un bouquin de brocante, pouvant être encore appréciée. N’étant ni héros, ni résistant, ni Rambo, j’égraine, sans risques, une succession de profils car contre qui ou quoi d’autre, devrions-nous encore lutter de nos jours : sinon contre le désamour, les assauts de solitude ou les craintes de maladies ? Sommes-nous même encore capables en fin de vie d’empêcher d’être parqués dans des mouroirs organisés, les EPAHD, ces lieux où les bien portants se débarrassent des inactifs qui encombrent l’espace public de leur âge et leurs handicaps ?
Sur le Net les couples ne se rencontrent plus mais se recherchent avec méthode. Les concordances ne résultent plus du hasard. Certains profils s’affichent adeptes du shopping, de plaisirs de bouche, défilent sous l’étendard du bio, du manger bien, sain, festif, tous artifices qui masquent le mal-être. Le numérique impose désormais ses vecteurs d’attitudes comme ses tuteurs de vies. En abordant le site, je ne pensais pas côtoyer autant de corps transis, frileusement serrés les uns contre les autres, sur des îlots de désespérances, ou figés dans des attitudes de chasseurs à l’affût. L’évidence voulait que pour se rencontrer, il ne restait guère plus que ce moyen, aussi naturel et festif qu’une fécondation in vitro. En ce lieu virtuel, l’impétrant peut étaler, sous le sceau de l’anonymat, ses désirs crus, vanter son corps, son esprit, ses prouesses, son tout pour tous, au-delà du vraisemblable.
Un vent nouveau traverse les murs, bannit les contrôles, célèbre un droit au libre accès du sensible, à la sexualité, valide les plaisirs physiques à volonté. Le nouvel art de vie distribue ses cartes, installe aussi son mode de déstructuration des couples, participe à la fin de la fidélité. Finalement, aussi longtemps que résistent l’esprit et le corps, retrouver un autre, reste possible. Et si tous n’y sont pas contraints, nombreux sont ceux qui finissent par y recourir. La ligne de partage s’établit, comme pour les fleuves, au hasard des pentes qu’empruntent les destinées. Si les nouvelles relations permettent de combattre le vide, que devient l’expression pour le meilleur et pour le pire ? La plupart n’aspirent à ne vivre qu’un meilleur, tant l’offre est permanente, considérable, à l’infini, en êtres disponibles, interchangeables, remplaçables.
Les freins religieux devenus obsolètes, l’harmonie ne s’espère plus du hasard des rencontres, ni d’un ciel bienveillant, ni même d’une concordance des signes astraux. Dans ce bouillonnement de corps à saisir, les tabous sexuels volent en éclats. L’ordre machiste ne se heurte plus à la pseudo faiblesse féminine des temps jadis. Dans l’immédiateté, un tout sexuel égalitaire s’installe dans le secret des demeures, des alcôves, des chambres d’hôtel. Il se dissimule derrière les dos tournés, les absences, les mensonges. La licence libertaire transgresse et magnifie les interdictions, traverse les murs, bannit les contrôles, renchérit l’immédiateté de l’acte. Le tout physique se construit au détriment du spirituel, et porte en lui, la crainte d’une fin de l’amour.
Les utopies se conjuguent au présent et futur. Nombreux sont ceux qui finissent l’expérience par ces mots : « Vivre à deux ne serait donc rien de plus ? » Mais juste à ce moment une nouvelle fenêtre s’ouvre. Elle invite à rallier une autre quête. « Une fois de plus ? » rétorquera-t-on dubitatif. L’improbable pourtant se réalise par un rapprochement qui, sans ce moyen, ne se serait jamais réalisé. Or même en ces lieux de l’urgence, les récits anatomiques d’une Catherine Millet restent étrangers aux sentiments jusqu’à l’écœurement. Ses mots ne sont que techniques corporelles, emboîtages de « lego », mises en bouche, comblements multiples, marées d’humeurs qui s’épanchent jusqu’à plus soif. Son récit est vide « d’amour » incapable de traduire le « mystère des orphelines prêtes à partager leur collection de nuages ». J’éprouve donc, par réaction, une volonté de goûter au délicat de l’« amour », à ses promesses de douceurs, à ses attentes de frissons.
Il y aurait quelques intérêts à lire les écrits de femmes adeptes du tout « tout de suite » ou d’un « pourquoi pas » résigné, si cela n’était pas trop vite fastidieux. Enigmatiques, pudiques, victorieuses ou plaintives, exigeantes, les annonces ne sont que publicités adaptées à soi-même, pour se rendre accessible, quoique dédaigneuses des seules promesses de rut. Pour obtenir plus, les candidates étalent une universalité d’aptitudes, de mensonges sur soi-même. La séduction sera l’étape suivante. Les écrits cachent leurs hérésies, imposent leurs codes, éclipsent la constance. Profil compatible à peine reconnu que déjà le doigt clique à nouveau sur le clavier et décide du « au suivant ». Face à un possible trop-plein de personnalités plus idéalisées que réelles, nombreux sont surpris de lire ce qu’ils écrivent, pensent, ressentent. Chaque candidature se pare de qualités qu’il n’a plus, mais exige en échange un exceptionnel chez l’autre. Tous appellent aux miracles quoique leur histoire stagne depuis déjà longtemps dans un fond saumâtre d’espérances, ignorant les imperfections. Tous interrogent l’avenir, comme si de la renonciation pouvait émerger le prodige alors que les plaisirs fugaces n’enclenchent rien de plus que des volontés de passer à un plus sérieux.
J’imagine ceux qui, par pudeur, se cachent et ne lancent qu’un S.O.S au hasard d’une bouteille confiée aux flots. Si tous ne sont pas atteints par la nécessité de recourir au site, nombreux sont ceux qui y accourent par réflexe de survie, et pour fuir leur détresse. Les plus âgés, tous sexes confondus, les « déclassés », s’inventent des qualités dans l’espoir de grappiller encore un peu de leur vie restante, de rentabiliser leurs corps fatigués, même si leurs vœux sont trop éloignés de ce qu’il est possible d’espérer. D’autres se lovent dans des moules de voluptés préfabriquées, avant de ne plus se satisfaire que de ce qui se présente. Nombreuses espèrent que des hommes modèles, revêtus, de toiles écrues et rêches, défileront devant elles, en signe de pénitence, cohortes serrées, longues processions, pour offrir leur reddition contre leur absolution.
Le site conduit à la fin de l’indulgence, de la patience, des devoirs d’entraide et de la compassion. En ces lieux, chacun tente dans son coin de reconstruire au plus vite, l’amour disparu, tant il craint le blanc, le vide et l’obscurité. De ces désordres reconnus se dégage une crainte, une interrogation désabusée : « et si la vie n’était que ce si peu ? » tandis qu’en écho, Léo Ferré chante « tout s’en va, tout fout le camp » et qu’au final, le cri « ainsi va la vie » s’impose.
En ce monde de fiel et de douceurs, chacun est obligé, un jour ou l’autre de traverser son champ de mines, car la relation amoureuse, en sa fragilité, oblige à une vigilance permanente. Les couples qui se cherchent, en mal d’espérance déballent sans pudeur leurs désirs, vantent ce qui leur reste d’ultime, puis faute de mieux, consentants, se laissent effeuiller, ne rassemblent que des débris d’ambitions, pour se parer de qualités qu’ils n’ont plus, ils espèrent en retour un signe de réconfort ou de connivence. Et pour ne plus être seul à affronter, tout à leur action, ils exhibent des patchworks de dialogues, propres à combler les silences ! En revanche nul ne peut nier qu’il suffit d’une fois pour qu’une convergence fasse conjugaison, même si le brassage des contraires rend l’exercice parfois décevant et « provisoire » par essence.
Et si faute de patience ou d’écoutes indulgentes, il en était fini de l’amour vrai et courtois ? Si pour s’emparer du mieux calibré, du déjà empaqueté, loin de la commune romance, et de la nécessaire tendresse, il fallait confondre inclinations et prouesses physiques ? S’il fallait opter pour un tout, dans la facilité qui oblige d’instinct à passer immédiatement à la partie anatomique, et à rendre ainsi tout avenir, impossible ? Il est vrai que certains, encanaillés dans leurs chairs par tant de liberté, confrontés à tant d’interdictions, n’y voient plus qu’un inépuisable vivier de sexe à foison, et s’empressent de touiller sans tabou dans le magma grouillant, généreusement offert. Parfois même une candidate s’emballe puis renonce, non sans avoir vendu trop vite ses derniers atours, si vite démodés qu’ils ne seront plus convoités dès le premier et unique usage.
D’autres, face à trop de vérités et au peu d’engouement suscité, se retrouvent hébétés, déçus compte tenu de la façade imparable qu’ils avaient construite et un si piètre résultat. Ils disparaissent alors sans plus laisser de traces qu’un corps qui, à la fin de l’hiver, aurait traversé en courant un fleuve, et qui, en son exact milieu, aurait vu la glace s’entrouvrir pour l’engloutir. Quoi qu’il en soit, il existe un intérêt certain à tenter de déjouer le chagrin, à retrouver le goût de vivre, car celui qui, plein d’espérances, s’expose sur le site, est souvent un être blessé qui porte son poids de vie passée, de joies et de douleurs. Contre cette fatalité, une voix ose murmurer : « Les sites de rencontres sont aussi faits pour des personnes réellement libres dans leurs têtes, en quête de rencontres sincères et pas nécessairement en conséquence d’une rupture amoureuse. » On a envie de rétorquer, qu’il y a contresens, car chercher à s’extraire d’un état de manque pour se mettre en quête d’une nouvelle rencontre, est volonté d’échapper au blocage et à l’immobilisme. Désirer rompre avec une situation antérieure atteste d’une volonté de rupture, le site n’envisageant que la recherche d’un amour, peu d’autre est à espérer. En vérité, puisque la solitude jamais ne nous lâche, le forum restitue un possible pour ceux qui se sentent perdus dans la multitude.
3
En septembre 2008, précisément, les premiers échanges sur le site avec Marie furent de si grande qualité que très vite la découverte des corps s’ensuivit au Palais-Royal, un lieu digne de Marie Stuart, son aïeule en ligne directe. Le jardin à la française enserra aussitôt notre intimité dans un cadre architectural d’art, composé de dorures, de colonnes, d’arcades, de bassins, de jets d’eaux, de fleurs multicolores, de bourdonnements d’abeilles : un étourdissement ! Je me souviens avec une extrême précision du temps qu’il faisait, cet après-midi-là, il était sec, chaud, ensoleillé, le ciel avait un bleu de la perfection.
Très vite, nous décidâmes de nous adosser au plaisir d’un ensemble. Marie fut en effet le cadeau offert par un hasard bienveillant, repris avec brutalité, début janvier 2016. Le cinq janvier, le téléphone sonne précisément à 19 heures. J’entends donc Marie déballer, au risque de me répéter : « je ne suis plus amoureuse », puis raccrocher aussi simplement que si elle venait de dire : « je ne suis plus enrhumée ». Ces quelques mots mettent fin à une période d’insouciance, à une vie sans âge, car tout le temps de notre ensemble, la question de l’altération des corps ne se posa pas : nous suivions un même rythme. Pourquoi aurions-nous eu peur de l’écoulement de jours de félicité ? Or à cette heure, et de sa seule volonté, la plénitude m’est arrachée dans la douleur, nos partages, sont inscrits aux « pertes et profits » d’une désormais vaine association.
« Tu peux arracher la flèche qui t’a touché, mais les paroles restent en toi, à jamais. » Pourquoi ces paroles si sèches ? Marie fut l’égérie d’un bonheur de plus de sept années, qu’elle qualifia elle-même le jour de la rupture : d’immense ! À quoi bon, tant elle me plongeait paradoxalement, parce qu’elle ne m’aimait plus, dans une détresse tout aussi vaste. Comment pouvait-elle décider de quitter un immense ? Pouvait-elle justifier son action ? Les réponses ne sont que supposées. L’inattendu de sa brutale disparition de ma vie me laisse inerte, étourdi, bloqué, à l’arrêt, incapable de réactions tel un âne, qui bien que fouetté, toujours se refuse. Dois-je supposer que son éducation l’empêcha d’user de propos plus directs ? Tels ces phrases « je ne peux plus voir ce corps, ni sentir sa peau », ou encore, « marre de ces nuits et de ces jours à t’observer repu de ton orgasme, tandis que tu te répands sans vergogne entre mes cuisses ». À moi qui ne peux empêcher mon désespoir, Marie répète imperturbable comme d’une excuse : « je ne savais ni ne voulais me mentir, ni te mentir ». Ne comprenant rien de ce qu’elle voulait dire, je me découvre implorant, incapable de retenir le bonheur qui chavire dans un gâchis trop évident. Je l’adjure par la seule voie qui me soit encore ouverte, celle de l’écriture : « Marie regardons-nous, écoutons-nous, recherchons ensemble ! » en vain !
Rien ne me raccroche plus au visage aimé, sinon des certitudes de jamais plus : jamais plus nous ne pourrons être heureux ensemble. Jamais plus nous ne partagerons nos plaisirs. Dans le définitif et dans l’ignorance de l’autre, nous resterons à cette différence près, qu’elle seule, l’avait décidé.
Les premiers temps, j’espère encore son retour. Le raisonnement est de pure logique : ne trouvant rien des raisons exactes de la séparation, je peux escompter un revirement, tant les signes apparents de l’amour ont été observés jusqu’en ses extrêmes limites. J’ai du mal à concevoir qu’elle ait pu simuler. Mais rien de tel ne survint, le désamour était donc ancien, raisonné et m’avait été signifié sans retour. Marie avait simplement pris son temps, s’y était préparée à son rythme, avait mûri sa rupture, répété la scène. Un livre, écrit en suite de l’évènement, lui fournit même le prétexte. En réponse, cette fois dans un esprit de guerre ouverte, elle coupe toutes communications, se rend injoignable ce qui nous sépare de façon hermétique. Marie intercale entre nos vies, une barrière plus étanche qu’un rideau de fer !
J’exprimais dans cet ouvrage, des soupçons de probable lâcheté familiale dans le suicide de son frère aîné comme dans la mort tragique et indigne de sa sœur, tous deux issus d’un premier lit. La jeune femme trentenaire désespérée de vivre plus (fait peu compréhensible compte tenu de l’aisance sociale, matérielle et intellectuelle des parents) avait associé alcool et drogue, pour aider à sa disparition accidentelle sur la voie publique. Je suggérais même, sans l’exprimer directement, une responsabilité indirecte de Marie dans le suicide de son propre frère, ce qui pouvait expliquer chez elle, la meurtrissure intérieure, jamais guérie, qu’elle soignait en secret.
À Casablanca, ville de sa naissance et de son enfance, Marie, à onze ans, n’avait ni su, ni pu apaiser les pulsions très concrètes, exprimées par ce grand demi-frère de dix-huit ans, venu en vacances. En suite de quoi, le jeune garçon avait dû subir non seulement la punition paternelle mais plus encore, les rigueurs de l’effacement dans le cœur de sa sœur. Ces représailles l’avaient irrémédiablement marqué, au point de lui interdire tout accès au pardon. Je suggérais qu’il aurait fallu faire en sorte que les deux premiers enfants de son père n’apparaissent plus comme le résultat d’une mésalliance, ni comme l’égarement d’un homme de la noblesse d’épée qui épouse une femme juive, quand bien même elle était issue d’une famille, illustre et ancienne. Sur ce drame, Marie n’avait conservé que mutisme tout le temps de notre liaison. Tout est dans la répétition. Marie usa à mon égard de l’arme de l’effacement, tant elle avait été payante d’efficacité.
Cette femme à l’apparente douceur, n’avait cessé d’endurer sa vie durant, dans sa chair et son esprit, les outrances d’un destin qui l’avait conduite à ne choisir, disait-elle, que des chemins de traverse à force de vouloir suivre l’exemple du père. Qui étais-je, pour tenter de traduire les sinuosités d’un lignage si prestigieux en quartiers de noblesse, et oser supputer que les puinés auraient pu se rendre coupables de lâcheté envers leurs aînés ? Son mépris naturel de classe, libéré de l’amour, m’avait rattrapé, repoussé, condamné : « je m’efface », furent les seuls mots qu’elle utilisa avant de disparaître totalement. Elle tint parole. Il me faudra me souvenir de cette comtesse par son père, policée et armée des principes d’une bonne éducation, à la mansuétude innée, dans son action maléfique envers l’homme qu’elle disait avoir aimé. Je ne pouvais pas avoir été vil à ce point sur une si longue durée qu’elle fut obligée d’en effacer jusqu’au souvenir, telle une verrue venue de nulle part, qu’il fallait brûler pour en éradiquer jusqu’à la trace. Je le dis certes avec trop d’emphase, mais je refuse d’accepter que Marie se soit abaissée à user d’un terme d’un dictateur : « effacement », même si le mot en français est moins explicite que le mot allemand, prononcé en pleine démence d’un seul contre un groupe d’êtres humains. L’effacement (masculin) a en effet pour réplique germanique, « die Vernichtung » (mot féminin) composée du préfixe « ver » (qui se prononce fer). Il exprime une volonté colérique d’élimination, qui tend à l’éradication, au « nichtung », une résultante qui a pour effet de rendre l’objet, moins que rien (nichts), le « ung » étant l’action vers l’anéantissement. L’expression rappelle le chiffon qui élimine la trace de craie blanche sur le tableau noir. Pourquoi tant de brutalité chez une personne que je choyais autant par amour que pour ses graves maladies ? Qu’est-ce qui justifia, chez elle, l’usage d’une frappe si disproportionnée ?
La réalité s’impose : sans amour, l’homme n’est rien de plus qu’un arbre sec, un rien, un mort en permission, un morceau de papier avec quelques dates et un nom, un fétu de paille livré à l’errance du vent.
Je refusais d’envisager Marie dans sa nouvelle vie, courant après les chauves, les bedonnants ou les fiers aux muscles saillants. Je me raccrochais à l’idée qu’à la fin, contemplant des façades d’immeubles sans joie, incapables d’offrir l’évasion, elle me retournerait ses regards nostalgiques. Mais je le répète : tout cela fut en vain !
La vie vide de « notre » cohérence, me replace sept années en arrière, me replonge dans une tempête psychologique dont les conséquences physiques furent rapidement visibles. Le visage se marqua, mon dos plia sous une charge trop lourde. J’étais désormais un vieil homme délaissé, surpris par le cataclysme. Mes forces physiques déclinèrent. Mon corps, face à plusieurs maladies déclarées, rendait les armes, et même s’il n’était pas question d’abdiquer, qui saurait trouver l’antidote ? « La vieillesse, bien sûr, la finitude, étaient prévisibles, inscrites d’emblée dans la banalité placide ou funeste du cours des choses. » (Jorge Semprun dans « Exercices de survie »)
La méditation sur le thème de l’âge n’a rien de novateur mais fallait-il pour autant que Marie en accélérât les effets ? La question m’intéresse car le refus de prendre en compte les déchéances du corps, risque d’enfermer celui qui reste, dans ses fragilités, quand bien même, les atteintes seraient, bien sûr, survenues avec ou sans Marie.
La sagesse commune tenta de me consoler.
« Dans votre cas, il y a “du vieillir” mais non de la vieillesse. »
Le vieillir est processuel, la vieillesse serait un état. Est-ce un dire vrai ou seulement vœu de consolation ? Quand donc ai-je commencé à devenir vieux ? Et si cette distinction se révèle exacte, à partir de quel moment « la vieillesse prit-elle le pas sur le vieillir » ? Je réponds qu’avec l’âge, les peurs se font plus insistantes, moins supportables. J’observe les futures victimes, droites et immobiles sur le fatal tapis roulant, entraînées par le mouvement irrésistible et régulier, tous, premiers et seconds rôles unis vers une même finitude dont nul ne réchappe ! Après chaque décès, j’entends gémir l’humanité, oh, un très court instant, rarement plus que quelques jours, l’enterrement étant l’acte final juste avant le permis d’oublier. En cas de bousculade, la précédente victime vite oubliée, chacun passe à la suivante (ce fut le cas, il y a peu, de l’écrivain académicien Jean d’Ormesson doublé sur la ligne des obsèques par le chanteur Johnny Hallyday). L’appel aux morts est quotidien. Nul ne s’en émeut vraiment, car nul n’a conscience de son propre tour.
L’annonce faite par Marie m’entraîna dans une dégringolade, qui n’est finalement que banale guerre privée entre un homme et une femme. Elle me plaqua au mur, coq déplumé, sonné, dégradé de qualités. Avec insouciance, elle me fusilla, yeux bandés, avec mon poids d’années. Mais les interrogations s’agrippent encore tel des teignes, et affament le cancer qui m’affecte en vrai. Elles me contraignent à faire le vide, à rechercher ce vivant coincé entre les résistances et les émotions. Mais face à l’incommensurable, je reste incapable de réaction, je ne suis guère plus qu’un wagon privé de locomotive, qui continue à glisser sur les rails sans but, sans autre finalité que de ne s’arrêter nulle part.
Deux années se sont écoulées, elles furent parsemées de chutes sur un chemin de croix, mais suivies de renaissances. Je m’interroge : tout cela n’appartient-il pas déjà au passé ? Que ferions-nous à ne déballer que ce qui enjolive l’histoire ? Puis-je en effet réellement occulter que le dimanche 11 janvier 2015 fut le jour de la première rupture, une semonce qui n’avait duré que quinze jours. Le jour est précis dans ma mémoire, car il fut celui de la très importante manifestation contre le massacre de sept journalistes survenu au siège du journal satirique « Charlie hebdo », le 7 janvier 2015.
L’année 2015 fut celle du sursis inconnu. Après m’être réfugié dans un bel hôtel de Savoie, Marie s’était sentie faiblir. Elle n’était pas encore prête, il lui fallait plus de temps. Quinze jours plus tard, elle revint donc, me plaça en observation sans que je le soupçonne. Je surprenais bien parfois ses gestes d’éloignement, ses sourires contraints, les regards pensifs qu’elle me lançait à la dérobade. J’en ignorais la cause ni ne m’en inquiétais trop, tant je voulais croire au définitif de notre liaison, alors que déjà j’étais tassé sans poids au fond de ses secrets. Je sentais bien que je désertais ses pensées et commis même l’erreur, de lui reprocher ses silences, ses oublis, ses ailleurs. Tout cela explique qu’à sa décision, je sombrais jusqu’à risquer un geste fatal vers l’au-delà.
J’ai, à l’évidence manqué de lucidité.
J’appris qu’il était vain d’essayer de démythifier celle qui repousse, en se disant par exemple : « Tant pis pour elle, la qualité se mérite. » À cela François Jullien rétorquerait : « La lucidité est la capacité à prendre en compte l’expérience traversée, le plus souvent à notre détriment. » Je me mentais puisque je ne pouvais ignorer que tout visage aimé est embelli par les privations, ni que pour échapper aux souvenirs d’une vie jugée exceptionnelle, les êtres en souffrance, fuient les réalités. Le plus dur, en l’espèce, était d’accepter la manière brutale d’une décision sans recours qui plaque au sol de chagrin, empêche de respirer, force à concevoir que l’amour n’est rien d’autre qu’illusion et n’a d’autre finalité que de s’arrêter. Cette certitude m’incitait à espérer d’une substitution, à me persuader qu’avec le temps, le reniement s’estomperait et qu’une autre vie s’imposerait même si l’absente aspirait tout de mon reste de vitalité telle une éponge, trop sèche, qui se gorge du mal-être de celui qui souffre.
4
Si je m’interrogeais c’est que, modestement, à l’instar de Romain Gary et de bien d’autres, la féminité a toujours été une des composantes de mes humanités, un constituant d’équilibre entre l’intellect et le charnel, une dispensatrice de « bons à vivre ». Elle est cette part secrète sans laquelle je suis nu, sans écho, sans réflexion, en manque d’identité, d’unité physiologique, plus simplement en manque d’amour. Sans elle, point de créativité, car l’homme n’existerait pas. La raison de cette prédominance tient chez moi pour partie à l’absence d’empathie maternelle, d’affectif et de tendresse. Pour compenser ce manque, j’ai constamment recherché le féminin.
Certes j’entends dire en écho : « la femme, symbole unique, n’existe pas », comme un reproche d’une part de moi, pourtant si peu misogyne. Je me dois donc de préciser : je me suis engagé dans la séduction, au bon sens du terme, et mon attirance ne concerne pas les seuls jeux sexuels qui, bien entendu, y participent, mais se placent en retrait.
Le mouvement récent « //Metoo » draine les accusations d’instigatrices d’un féminisme d’ostracisme, dur et agressif. Il installe une hostilité entre les sexes et régurgite une violence aussi injuste qu’inutile. Il renvoie les hommes à une culpabilité de simple appartenance au genre. Le mouvement est planétaire, comme si une guerre entre féminin et masculin était seulement envisageable ! Ainsi l’auteure en pointe du mouvement, Virginie Despentes, de l’Académie Goncourt, semble oublier qu’en s’attaquant de front à l’une des composantes de l’humanité, aussi essentielle que le masculin comparé au féminin, elle nie sa propre part de masculinité. Cette lutte contre nature, conduit au cloisonnement entre les sexes. Sans l’homme, la femme n’existe pas et inversement. L’art illustre bien cette exigence de partage, par exemple dans les opéras, et j’ai conscience de la fragilité et de la pauvreté de l’exemple, mais n’en est-il pas ainsi des chœurs où se mêlent pour le plaisir de l’harmonie, voix d’hommes et de femmes. Son opinion ne gênerait personne si elle n’était qu’expression personnelle. En revanche la frayeur nous saisit lorsqu’on apprend que membre de l’Académie Goncourt elle est amenée à choisir entre les écrivains. Comment une femme si définitivement partisane, pourrait-elle garantir un choix guidé par le seul talent dans l’écriture ?
Compte tenu des épreuves qu’elle a endurées, il est compréhensible qu’elle refuse sa part de féminité humiliée ou tributaire de rites qui interdisent, par exemple à une femme, d’écarter les jambes en public, même si cela favorise une meilleure assise, car, ce faisant, elle dirigerait les regards masculins sur son sexe, et cette position de confort serait jugée trop directe car trop sexuellement perturbante pour l’homme. Ce faisant, l’égérie remettrait en cause une loi très ancienne de la nature.
Dire, que l’homosexualité serait une troisième voie, ne doit pas non plus culpabiliser ceux qui aiment le sexe opposé, ni conduire à les mépriser, surtout lorsque l’opinion de l’auteure est enfermée dans des expériences malheureuses très personnelles : un viol à dix-huit ans et à vingt ans, par réaction, la décision de se prostituer volontairement, pendant plusieurs années. Cette vision personnelle des choses du sexe, est donc liée à des traumatismes dont elle n’a pas pu s’extraire. Pour autant, faut-il tout jeter de l’homme, parce qu’une femme victime d’un crime, généralise la laideur des délinquants qu’elle s’est obligée à affronter pour l’associer aux autres hommes non concernés, et aller jusqu’au bout de l’horreur, là où des créatures sans fard, sont en manque de rut. Est-ce ainsi que les hommes vivent, s’interroge le poète ? L’objection est-elle d’ailleurs suffisante pour prétendre que la perfection ne serait que féminine ? Bien sûr que non !
Virginie Despentes s’élève à juste titre contre les lois Sarkozy qui repoussent les prostitués au dehors de la ville, dans les bois, au-delà des périphériques. Elle ajoute que la symbolique de la forêt est intéressante, car pour certains censeurs, la sexualité doit s’extraire du conscient, du visible, de l’éclairé. Tandis qu’une plus grande part de l’humanité peine à savoir ce qu’elle mangera au quotidien, l’autre part, la plus faible, repue, assurée contre les aléas de la vie, n’a d’autre urgence que de craindre au quotidien, de ne plus partager les plaisirs de son corps. Le droit à l’orgasme n’est-il pas revendiqué comme un droit élémentaire ? Récemment le périodique « Elle », conseillait même à la femme de veiller à bénéficier d’une « pénétration assistée » comme pour la conduite d’un véhicule.
En somme, il est plus utile de réapprendre à ressentir qu’à aimer. L’attente et l’incertitude doivent pourtant permettre de replacer le tout-technique au centre du fait amoureux. Mais, à trop consommer sans entraves, l’Homme se trouve face à un surexposé telle « l’origine du monde » de Courbet. La vue d’un charnel, trop démystifié, ouvert, usité, offert, risque d’achopper le désir, d’effacer l’envie à un point tel, qu’il faudra à nouveau l’encourager en réintégrant le fantasme pour réinstaller le coït dans sa légitimité. La banalisation des sexes entre Adam et Ève, aurait pu finir par l’éliminer si le démon, en serpent avisé, ne l’avait interdit pour recréer la transgression.
Faut-il de plus acquiescer à son refus d’assumer une maternité jugée trop astreignante ou sexiste, parce qu’elle est une tâche que seule la femme, peut accomplir ? Ou encore, lorsqu’elle dit que la prostitution et le mariage sont deux violences faites aux femmes, y a-t-il matière à dire que ces deux fonctions lui donnent la faculté de décider de ce qui est digne pour la femme, ou ce qui ne l’est pas ? Or nul n’oblige la féminité au mariage ni plus à la maternité. N’est-ce pas que l’expression d’une femme en colère, blessée, qui exprimerait une conviction personnelle ? Virginie Despentes décrit encore l’inexpliqué de l’amour. Elle dit mépriser : « le domaine du sexe (qui est celui) de la peur, de l’humiliation, de l’étranger » mais à l’inverse, elle glorifie la masturbation, comme une panacée. On ne peut écarter que si l’auteure rejette le sexuel de l’homme, c’est d’abord pour en avoir été la victime et ensuite pour en avoir goûté plus que nécessaire. Virginie Despentes va jusqu’à rejeter le possible d’un amour entre les sexes différents, parce qu’il s’immiscerait dans un vécu charnel fait d’humiliations dégradantes, qui induisent la domination physique de l’un sur l’autre et au final une pénétration subie, caractéristique du viol. Seule l’homosexualité serait, selon elle, capable de rétablir les êtres dans leur égalité. Peu importe si cette idée n’est pas vérifiée puisque l’homosexualité semble rétablir une forme de domination d’une femme sur une autre femme ou celle d’un homme sur son compagnon, et reproduire les schémas identiques à l’hétérosexualité. Pire, cette voie signifierait la disparition de l’humanité, sauf à accepter une industrialisation de la GPA ou de la MNA, où des hommes élevés en batterie, seraient traits, puis sperme récolté, analysé, purifié, redistribué aux femmes qui refusent toute paternité. Où se situe dans ce raisonnement la grande majorité des couples qui enfantent dans l’amour et le partage ?
Rappeler que « les femmes donnent des enfants pour la guerre et que les hommes acceptent de se faire tuer pour sauver les intérêts de trois ou quatre crétins à la vue courte » est l’expression d’une femme qui n’en peut plus d’être enfermée dans sa fonction de reproduction, de mère sacralisée par l’État. Il n’est pas plus sérieux d’écrire qu’un État qui se projette en mère toute-puissante, est un État fascisant, même si Pétain favorisait la fonction reproductrice et les accouchements au même titre que les portées porcines.
Virginie Despentes s’attaque encore à une autre injustice, à la différence de considération entre les sexes, ainsi dire que l’on va aux putes ne fait pas d’un homme, un homme à part, ni ne le marque dans sa sexualité, alors qu’au contraire les putes (appelées désormais escortes girls) sont des femmes stigmatisées et marginalisées, placées au ban d’une anormalité de la féminité. Ainsi le sexuel dégraderait la femme tandis qu’il valoriserait l’homme. La reine Élisabeth première d’Angleterre, s’était fait reconnaître publiquement « vierge », pour paraître dégagée des choses du sexe, libre de toute ascendance masculine, comme si, en conservant l’intégrité de sa féminité, elle s’imposait à égalité avec l’homme. Virginie Despentes pense-t-elle, pour autant, sérieusement que toutes les femmes sont des humiliées, des bafouées du sexe. Les hommes sont-ils des rustres et des violeurs, uniquement parce que «





























