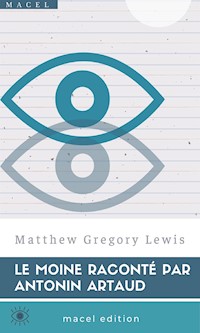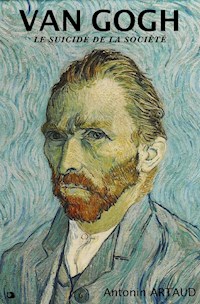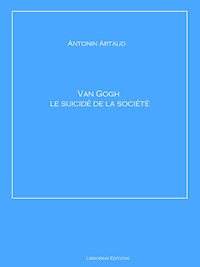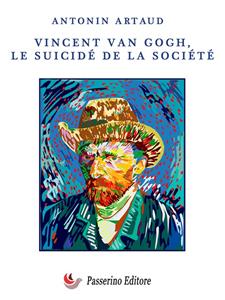Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Jamais, quand c’est la vie elle-même qui s’en va, on n’a autant parlé de civilisation et de culture. Et il y a un étrange parallélisme entre cet effondrement généralisé de la vie qui est à la base de la démoralisation actuelle et le souci d’une culture qui n’a jamais coïncidé avec la vie, et qui est faite pour régenter la vie.
Avant d’en revenir à la culture je considère que le monde a faim, et qu’il ne se soucie pas de la culture : et que c’est artificiellement que l’on veut ramener vers la culture des pensées qui ne sont tournées que vers la faim.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Antonin Artaud, né le 4 septembre 1896 à Marseille et mort le 4 mars 1948 à Ivry-sur-Seine, est un théoricien du théâtre, acteur, écrivain, essayiste, dessinateur et poète français.
La poésie, la mise en scène, la drogue, les pèlerinages, le dessin et la radio, chacune de ces activités a été un outil entre ses mains, « un moyen pour atteindre un peu de la réalité qui le fuit ».
Toute sa vie, il a lutté contre des douleurs physiques, diagnostiquées comme issues de syphilis héréditaire, avec des médicaments, des drogues. Cette omniprésence de la douleur influe sur ses relations comme sur sa création. Il subit aussi des séries d'électrochocs lors d'internements successifs, et il passe les dernières années de sa vie dans des hôpitaux psychiatriques, notamment celui de Rodez. Si ses déséquilibres mentaux ont rendu ses relations humaines difficiles, ils ont aussi contribué à alimenter sa création. Il y a d'un côté ses textes « fous de Rodez et de la fin de sa vie », de l'autre, selon Évelyne Grossmann, les textes fulgurants de ses débuts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antonin Artaud
Le théâtre et son double
– 1938 –
PRÉFACE
(Le théâtre et la culture.)
Jamais, quand c’est la vie elle-même qui s’en va, on n’a autant parlé de civilisation et de culture. Et il y a un étrange parallélisme entre cet effondrement généralisé de la vie qui est à la base de la démoralisation actuelle et le souci d’une culture qui n’a jamais coïncidé avec la vie, et qui est faite pour régenter la vie.
Avant d’en revenir à la culture je considère que le monde a faim, et qu’il ne se soucie pas de la culture : et que c’est artificiellement que l’on veut ramener vers la culture des pensées qui ne sont tournées que vers la faim.
Le plus urgent ne me paraît pas tant de défendre une culture dont l’existence n’a jamais sauvé un homme du souci de mieux vivre et d’avoir faim, que d’extraire de ce que l’on appelle la culture, des idées dont la force vivante est identique à celle de la faim.
Nous avons surtout besoin de vivre et de croire à ce qui nous fait vivre et que quelque chose nous fait vivre, — et ce qui sort du dedans mystérieux de nous-mêmes, ne doit pas perpétuellement revenir sur nous-mêmes dans un souci grossièrement digestif.
Je veux dire que s’il nous importe à tous de mangertout de suite, il nous importe encore plus de ne pas gaspiller dans l’unique souci de manger tout de suite notre simple force d’avoir faim.
Si le signe de l’époque est la confusion, je vois à la base de cette confusion une rupture entre les choses, et les paroles, les idées, les signes qui en sont la représentation.
Ce ne sont certes pas les systèmes à penser qu manquent ; leur nombre et leurs contradictions caractérisent notre vieille culture européenne et française : mais où voit-on que la vie, notre vie, ait jamais été affectée par ces systèmes ?
Je ne dirai pas que les systèmes philosophiques soient choses à appliquer directement et tout de suite ; mais de deux choses l’une :
Ou ces systèmes sont en nous et nous en sommes imprégnés au point d’en vivre, et alors qu’importent les livres ? ou nous n’en sommes pas imprégnés et alors ils ne méritaient pas de nous faire vivre ; et de toute façon qu’importe leur disparition ?
Il faut insister sur cette idée de la culture en action et qui devient en nous comme un nouvel organe, une sorte de souffle second : et la civilisation, c’est de la culture qu’on applique et qui régit jusqu’à nos actions les plus subtiles, l’esprit présent dans les choses ; et c’est artificiellement qu’on sépare la civilisation de la culture et qu’il y a deux mots pour signifier une seule et identique action.
On juge un civilisé à la façon dont il se comporte et il pense comme il se comporte ; mais déjà sur le mot de civilisé il y a confusion ; pour tout le monde un civilisé cultivé est un homme renseigné sur des systèmes, et qui pense en systèmes, en formes, en signes, en représentations.
C’est un monstre chez qui s’est développée jusqu’à l’absurde cette faculté que nous avons de tirer des penséesde nos actes, au lieu d’identifier nos actes à nos pensées.
Si notre vie manque de soufre, c’est-à-dire d’une constante magie, c’est qu’il nous plaît de regarder nos actes et de nous perdre en considérations sur les formes rêvées de nos actes, au lieu d’être poussés par eux.
Et celle faculté est humaine exclusivement. Je dirai même que c’est cette infection de l’humain qui nous gâte des idées qui auraient dû demeurer divines : car loin de croire le surnaturel, le divin inventés par l’homme je pense que c’est l’intervention millénaire de l’homme qui a finit par nous corrompre le divin.
Toutes nos idées sur la vie sont à reprendre à une époque où rien n’adhère plus à la vie. Et cette pénible scission est cause que les choses se vengent, et la poésie qui n’est plus en nous et que nous ne parvenons plus à retrouver dans les choses ressort, tout à coup, par le mauvais côté des choses ; et jamais on n’aura vu tant de crimes, dont la bizarrerie gratuite ne s’explique que par notre impuissance à posséder la vie.
St le théâtre est fait pour permettre à nos refoulements de prendre vie, une sorte d’atroce poésie s’exprime par des actes bizarres où les altérations du fait de vivre démontrent que l’intensité de la vie est intacte, et qu’il suffirait de la mieux diriger.
Mais si fort que nous réclamions la magie, nous avons peur au fond d’une vie qui se développerait tout entière sous le signe de la vraie magie.
C’est ainsi que notre absence enracinée de culture s’étonne de certaines grandioses anomalies et que par exemple dans une île sans aucun contact avec la civilisation actuelle le simple passage d’un navire qui ne contient que des gens bien portants puisse provoquer l’apparition de maladies inconnues dans cette île et qui sont une spécialité de nos pays : zona, influenza, grippe, rhumatismes, sinusite, polynévrite, etc…, etc…
Et de même si nous pensons que les nègres sententmauvais, nous ignorons que pour tout ce qui n’est pas l’Europe, c’est nous, blancs, qui sentons mauvais. Et je dirai même que nous sentons une odeur blanche, blanche comme on peut parler d’un « mal blanc ».
Comme le fer rougi à blanc on peut dire que tout ce qui est excessif est blanc ; et pour un asiatique la couleur blanche est devenue l’insigne de la plus extrême décomposition.
Ceci dit, on peut commencer à tirer une idée de la culture, une idée qui est d’abord une protestation.
Protestation contre le rétrécissement insensé que l’on impose à l’idée de culture en la réduisant à une sorte d’inconcevable Panthéon ; ce qui donne une idolâtrie de la culture, comme les religions idolâtres mettent des dieux dans leur Panthéon.
Protestation contre l’idée séparée que l’on se fait de la culture, comme s’il y avait la culture d’un côté et la vie de l’autre ; et comme si la vraie culture n’était pas un moyen raffiné de comprendre et d’exercer la vie.
On peut brûler la bibliothèque d’Alexandrie. Au-dessus et en dehors des papyrus, il y a des forces : on nous enlèvera pour quelque temps la faculté de retrouver ces forces, on ne supprimera pas leur énergie. Et il est bon que de trop grandes facilités disparaissent et que des formes tombent en oubli, et la culture sans espace ni temps et que détient notre capacité nerveuse reparaîtra avec une énergie accrue. Et il est juste que de temps en temps des cataclysmes se produisent qui nous incitent à en revenir à la nature, c’est-à-dire à retrouver la vie. Le vieux totémisme des bêtes, des pierres, des objets chargés de foudre, des costumes bestialement imprégnés, tout ce qui sert en un mot à capter, à diriger, et à dériver des forces, est pour nous une chose morte, dont nous ne savons plus tirer qu’un profit artistique et statique, un profit de jouisseur et non un profit d’acteur.
Or le totémisme est acteur car il bouge, et il est fait pour des acteurs ; et toute vraie culture s’appuie sur les moyens barbares et primitifs du totémisme, dont je veux adorer la vie sauvage, c’est-à-dire entièrement spontanée.
Ce qui nous a perdu la culture, c’est notre idée occidentale de l’art et le profit que nous en retirons. Art et culture ne peuvent aller d’accord, contrairement à l’usage qui en est fait universellement !
La vraie culture agit par son exaltation et par sa force, et l’idéal européen de l’art vise à jeter l’esprit dans une attitude séparée de la force et qui assiste à son exaltation. C’est une idée paresseuse, inutile, et qui engendre, à bref délai, la mort. Les tours multiples du Serpent Quetzalcóatl, s’ils sont harmonieux, c’est qu’ils expriment l’équilibre et les détours d’une force dormante ; et l’intensité des formes n’est là que pour séduire et capter une force qui, en musique, éveille un déchirant clavier.
Les dieux qui dorment dans les Musées : le dieu du Feu avec sa cassolette qui ressemble au trépied de l’Inquisition ; Tlaloc l’un des multiples dieux des Eaux, à la muraille de granit verte ; la Déesse Mère des Eaux, la Déesse Mère des Fleurs ; l’expression immuable et qui sonne, sous le couvert de plusieurs étages d’eau, de la Déesse à la robe de jade verte ; l’expression transportée et bienheureuse, le visage crépitant d’arômes, où les atomes du soleil tournent en rond, de la Déesse Mère des Fleurs ; cette espèce de servitude obligée d’un monde où la pierre s’anime parce qu’elle a été frappée comme il faut, le monde des civilisés organiques, je veux dire dont les organes vitaux aussi sortent de leur repos, ce monde humain entre en nous, il participe à la danse des dieux, sans se retourner ni regarder en arrière, sous peine de devenir, comme nous-mêmes, des statues effritées de sel.
Au Mexique, puisqu’il s’agit du Mexique, il n’y a pas d’art et les choses servent. Et le monde est en perpétuelle exaltation.
À notre idée inerte et désintéressée de l’art une culture authentique oppose une idée magique et violemment égoïste c’est-à-dire intéressée. Car les Mexicains captent le Manas, les forces qui dorment en toute forme, et qui ne peuvent sortir d’une contemplation des formes pour elles-mêmes, mais qui sortent d’une identification magique avec ces formes. Et les vieux Totems sont là pour hâter la communication,
Il est dur quand tout nous pousse à dormir, en regardant avec des yeux attachés et conscients, de nous éveiller et de regarder comme en rêve, avec des yeux qui ne savent plus à quoi ils servent, et dont le regard est retourné vers le dedans.
C’est ainsi que l’idée étrange d’une action désintéressée se fait jour, mais qui est action, tout de même, et plus violente de côtoyer la tentation du repos.
Toute vraie effigie a son ombre qui la double : et l’art tombe à partir du moment où le sculpteur qui modèle croit libérer une sorte d’ombre dont l’existence déchirera son repos.
Comme toute culture magique que des hiéroglyphes appropriés déversent, le vrai théâtre a aussi ses ombres ; et, de tous les langages et de tous les arts, il est le seul à avoir encore des ombres qui ont brisé leurs limitations. Et, dès l’origine, on peut dire qu’elles ne supportaient pas de limitation.
Notre idée pétrifiée du théâtre rejoint notre idée pétrifiée d’une culture sans ombres, et où de quelque côté qu’il se retourne notre esprit ne rencontre plus que le vide, alors que l’espace est plein.
Mais le vrai théâtre parce qu’il bouge et parce qu’il se sert d’instruments vivants, continue à agiter des ombres où n’a cessé de trébucher la vie. L’acteur qui nerefait pas deux fois le même geste, mais qui fait des gestes, bouge, et certes il brutalise des formes, mais derrière ces formes et, par leur destruction, il rejoint ce qui survit aux formes et produit leur continuation.
Le théâtre qui n’est dans rien mais se sert de tous les langages : gestes, sons, paroles, jeu, cris, se retrouve exactement au point où l’esprit a besoin d’un langage pour produire ses manifestations.
Et la fixation du théâtre dans un langage : paroles écrites, musique, lumières, bruits indique à bref délai sa perte, le choix d’un langage prouvant le goût que l’on a pour les facilités de ce langage : et le dessèchement du langage accompagne sa limitation.
Pour le théâtre comme pour la culture, la question reste de nommer et de diriger des ombres : et le théâtre, qui ne se fixe pas dans le langage et dans les formes, détruit par le fait les fausses ombres, mais prépare la voie à une autre naissance d’ombres autour desquelles s’agrège le vrai spectacle de la vie.
Briser le langage pour toucher la vie, c’est faire ou refaire le théâtre ; et l’important est de ne pas croire que cet acte doive demeurer sacré, c’est-à-dire réservé. Mais l’important est de croire que n’importe qui ne peut pas le faire, et qu’il y faut une préparation.
Ceci amène à rejeter les limitations habituelles de l’homme et des pouvoirs de l’homme, et à rendre infinies les frontières de ce qu’on appelle la réalité.
Il faut croire à un sens de la vie renouvelé par le théâtre, et où l’homme impavidement se rend le maître de ce qui n’est pas encore, et le fait naître. Et tout ce qui n’est pas né peut encore naître pourvu que nous ne nous contentions pas de demeurer de simples organes d’enregistrement.
Aussi bien, quand nous prononçons le mot de vie, faut-il entendre qu’il ne s’agit pas de la vie reconnue par le dehors des faits, mais de cette sorte de fragile et remuant foyer auquel ne touchent pas les formes. Et s’il est encore quelque chose d’infernal et de véritablement maudit dans ce temps, c’est de s’attarder artistiquement sur des formes, au lieu d’être comme des suppliciés que l’on brûle et qui font des signes sur leurs bûchers.
ILE THÉÂTRE ET LA PESTE
Les archives de la petite ville de Cagliari, en Sardaigne, contiennent la relation d’un fait historique et étonnant.
Une nuit de fin avril ou du début de mai 1720, vingt jours environ avant l’arrivée à Marseille du vaisseau le Grand-Saint-Antoine, dont le débarquement coïncida avec la plus merveilleuse explosion de peste qui ait fait bourgeonner les mémoires de la cité, Saint-Rémys, vice-roi de Sardaigne, que ses responsabilités réduites de monarque avaient peut-être sensibilisé aux virus les plus pernicieux, eut un rêve particulièrement affligeant : il se vit pesteux et il vit la peste ravager son minuscule état.
Sous l’action du fléau, les cadres de la société se liquéfient. L’ordre tombe. Il assiste à toutes les déroutes de la morale, à toutes les débâcles de la psychologie, il entend en lui le murmure de ses humeurs, déchirées, en pleine défaite, et qui, dans une vertigineuse déperdition de matière, deviennent lourdes et se métamorphosent peu à peu en charbon. Est-il donc trop tard pour conjurer le fléau ? Même détruit, même annihilé, et pulvérisé organiquement, et brûlé dans les moelles, il sait qu’on ne meurt pas dans les rêves, que la volonté y joue jusqu’à l’absurde, jusqu’à la négation du possible, jusqu’à une sorte de transmutation du mensonge dont on refait de la vérité.
Il se réveille. Tous ces bruits de peste qui courent et ces miasmes d’un virus venu d’Orient, il saura se montrer capable de les éloigner.
Un navire absent de Beyrouth depuis un mois, le Grand-Saint-Antoine, demande la passe et propose de débarquer. C’est alors qu’il donne l’ordre fou, l’ordre jugé délirant, absurde, imbécile et despotique par le peuple et par tout son entourage. Dare-dare, il dépêche vers le navire qu’il présume contaminé la barque du pilote et quelques hommes, avec l’ordre pour le Grand-Saint-Antoine d’avoir à virer de bord tout de suite, et de faire force de voiles hors de la ville, sous peine d’être coulé à coups de canon. La guerre contre la peste. L’autocrate n’y allait pas par quatre chemins.
Il faut en passant remarquer la force particulière de l’influence que ce rêve exerça sur lui, puisqu’elle lui permit, malgré les sarcasmes de la foule et le scepticisme de son entourage, de persévérer dans la férocité de ses ordres, passant pour cela non seulement sur le droit des gens, mais sur le plus simple respect de la vie humaine, et sur toutes sortes de conventions nationales ou internationales, qui, devant la mort, ne sont plus de saison.
Quoi qu’il en soit, le navire continua sa route, aborda à Livourne, et pénétra dans la rade de Marseille, où on lui permit de débarquer.
Ce que devint sa cargaison de pesteux, les services de la voirie à Marseille n’en ont pas conservé le souvenir. On sait à peu près ce que devinrent les matelots de son équipage, qui ne moururent pas tous de la peste et se répandirent en diverses contrées.
Le Grand-Saint-Antoine n’apporta pas la peste à Marseille. Elle était là. Et dans une période de particulière recrudescence. Mais on était parvenu à en localiser les foyers.
La peste apportée par le Grand-Saint-Antoine, était la peste orientale, le virus d’origine, et c’est de ses approches et de sa diffusion dans la ville que date le côté particulièrement atroce et le flamboiement généralisé de l’épidémie.
Et ceci inspire quelques pensées.
Cette peste, qui semble réactiver un virus, était capable toute seule d’exercer des ravages sensiblement égaux ; puisque de tout l’équipage, le capitaine fut le seul à ne pas attraper la peste, et d’autre part, il ne semble pas que les pestiférés nouveaux venus aient jamais été en contact direct avec les autres, parqués dans des quartiers fermés. Le Grand-Saint-Antoine qui passe à une portée de voix de Cagliari, en Sardaigne, n’y dépose point la peste, mais le vice-roi en recueille en rêve certaines émanations ; car on ne peut nier qu’entre la peste et lui ne se soit établie une communication pondérable, quoique subtile, et il est trop facile d’accuser dans la communication d’une maladie pareille, la contagion par simple contact.
Mais ces relations entre Saint-Rémys et la peste, assez fortes pour se libérer en images dans son rêve, ne sont tout de même pas assez fortes pour faire apparaître en lui la maladie.
Quoi qu’il en soit, la ville de Cagliari, apprenant quelque temps après que le navire chassé de ses côtes par la volonté despotique du prince, du prince miraculeusement éclairé, était à l’origine de la grande épidémie de Marseille, recueillit le fait dans ses archives, où n’importe qui peut le retrouver.
La peste de 1720 à Marseille nous a valu les seules descriptions dites cliniques que nous possédions du fléau.
Mais on peut se demander si la peste décrite par les médecins de Marseille était bien la même que celle de 1347 à Florence, d’où est sorti le Décaméron. L’histoire, les livres sacrés, dont la Bible, certains vieux traités médicaux, décrivent de l’extérieur toutes sortes de pestes, dont ils semblent avoir retenu beaucoup moins les traits morbides que l’impression démoralisante et fabuleuse qu’elles laissèrent dans les esprits. C’est probablement eux qui avaient raison. Car la médecine aurait bien de la peine à établir une différence de fond entre le virus dont mourut Périclès devant Syracuse, si tant est d’ailleurs que le mot de virus soit autre chose qu’une simple facilité verbale, et celui qui manifeste sa présence dans la peste décrite par Hippocrate, que des traités médicaux récents nous donnent comme une sorte de fausse peste. Et pour ces mêmes traités, il n’y aurait de peste authentique que la peste venue d’Égypte qui monte des cimetières découverts par le dégonflement du Nil. La Bible et Hérodote sont d’accord pour signaler l’apparition fulgurante d’une peste qui décima, en une nuit, les 180.000 hommes de l’armée assyrienne, sauvant ainsi l’empire égyptien. Si le fait est vrai, il faudrait alors considérer le fléau comme l’instrument direct ou la matérialisation d’une force intelligente en étroit rapport avec ce que nous appelons la fatalité.
Et ceci, avec ou sans l’armée de rats qui se jeta cette nuit-là sur les troupes assyriennes, dont elle rongea en quelques heures les harnais. Le fait est à rapprocher de l’épidémie qui explosa l’an 660 avant J.-C. dans la ville sacrée de Mékao au Japon, à l’occasion d’un simple changement de gouvernement.
La peste de 1502 en Provence qui fournit à Nostradamus l’occasion d’exercer pour la première fois ses facultés de guérisseur, coïncida aussi dans l’ordre politique avec les bouleversements les plus profonds, chutes ou morts de rois, disparition et destruction de provinces, séismes, phénomènes magnétiques de toutes sortes, exodes de juifs, qui précèdent ou suivent dans l’ordre politique ou cosmique, des cataclysmes et des ravages dont ceux qui les provoquent sont trop stupides pour prévoir, et ne sont pas assez pervers pour désirer réellement les effets.
Quels que soient les errements des historiens ou de la médecine sur la peste, je crois qu’on peut se mettre d’accord sur l’idée d’une maladie qui serait une sorte d’entité psychique et ne serait pas apportée par un virus. Si l’on voulait analyser de près tous les faits de contagion pesteuse que l’histoire ou les Mémoires nous présentent, on aurait du mal à isoler un seul fait véritablement avéré de contagion par contact, et l’exemple cité par Boccace de pourceaux qui seraient morts pour avoir flairé des draps dans lesquels auraient été enveloppés des pestiférés, ne vaut guère que pour démontrer une sorte d’affinité mystérieuse entre la viande de pourceau et la nature de la peste, ce qu’il faudrait encore analyser de fort près.
L’idée d’une véritable entité morbide n’existant pas, il y a des formes sur lesquelles l’esprit peut se mettre provisoirement d’accord pour caractériser certains phénomènes, et il semble que l’esprit puisse se mettre d’accord sur une peste décrite de la manière qui suit.
Avant tout malaise physique ou psychologique trop caractérisé, des taches rouges parsèment le corps, que le malade ne remarque soudainement que quand elles tournent vers le noir. Il n’a pas le temps de s’en effrayer, que sa tête se met à bouillir, à devenir gigantesque par son poids, et il tombe. C’est alors qu’une fatigue atroce, la fatigue d’une aspiration magnétique centrale, de ses molécules scindées en deux et tirées vers leur anéantissement, s’empare de lui, Ses humeurs affolées, bousculées, en désordre, lui paraissent galoper à travers son corps. Son estomac se soulève, l’intérieur de son ventre lui semble vouloir jaillir par l’orifice des dents. Son pouls qui tantôt se ralentit jusqu’à devenir une ombre, une virtualité de pouls, et tantôt galope, suit les bouillonnements de sa fièvre interne, le ruisselant égarement de son esprit. Ce pouls qui bat à coups précipités comme son cœur, qui devient intense, plein, bruyant ; cet œil rouge, incendié, puis vitreux ; cette langue qui halète, énorme et grosse, d’abord blanche, puis rouge, puis noire, et comme charbonneuse et fendillée, tout annonce un orage organique sans précédent. Bientôt les humeurs sillonnées comme une terre par la foudre, comme un volcan travaillé par des orages souterrains, cherchent leur issue à l’extérieur. Au milieu des taches, des points plus ardents se créent, autour de ces points la peau se soulève en cloques comme des bulles d’air sous l’épiderme d’une lave, et ces bulles sont entourées de cercles, dont le dernier, pareil à l’anneau de Saturne autour de l’astre en pleine incandescence, indique la limite extrême d’un bubon.
Le corps en est sillonné. Mais comme les volcans ont leurs points d’élection sur la terre, les bubons ont leurs points d’élection sur l’étendue du corps humain. À deux ou trois travers de doigt de l’aine, sous les aisselles, aux endroits précieux où des glandes actives accomplissent fidèlement leurs fonctions, des bubons apparaissent, par où l’organisme se décharge, ou de sa pourriture interne ou, suivant le cas, de sa vie. Une conflagration violente et localisée sur un point indique le plus souvent que la vie centrale n’a rien perdu de sa force, et qu’une rémission du mal, ou même la guérison est possible. Comme la colère blanche, la peste la plus terrible est celle qui ne divulgue pas ses traits.
Ouvert, le cadavre du pestiféré ne montre pas de lésions. La vésicule biliaire chargée de filtrer les déchets alourdis et inertes de l’organisme, est pleine, grosse à crever d’un liquide noir et gluant, si compact qu’il évoque une matière nouvelle. Le sang des artères, des veines est aussi noir et gluant. Le corps est dur comme de la pierre. Sur les parois de la membrane stomacale semblent s’être réveillées d’innombrables sources de sang. Tout indique un désordre fondamental des sécrétions. Mais il n’y a ni perte ni destruction de matière, comme dans la lèpre ou dans la syphilis. Les intestins eux-mêmes, qui sont le lieu des désordres les plus sanglants, où les matières parviennent à un degré inouï de putréfaction et de pétrification, les intestins ne sont pas organiquement attaqués. La vésicule biliaire, dont il faut presque arracher le pus durcifié qu’elle contient, comme dans certains sacrifices humains, avec un couteau effilé, un instrument en obsidienne, vitreux et dur, — la vésicule biliaire est hypertrophiée et cassante par places, mais intacte, sans aucune particule manquante, sans lésion visible, sans matière perdue.
Dans certains cas pourtant, les poumons et le cerveau lésés noircissent et se gangrènent. Les poumons ramollis, coupaillés, tombant en copeaux d’on ne sait quelle matière noire, le cerveau fondu, limé, pulvérisé, réduit en poudre, désagrégé en une sorte de poussière de charbon noir.