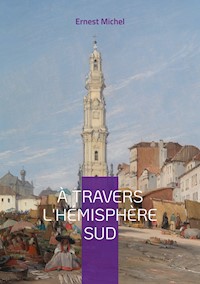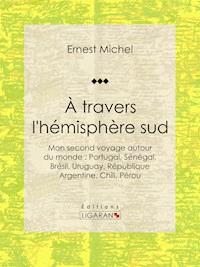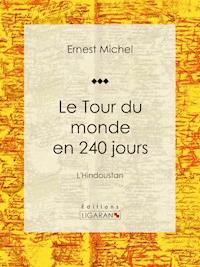
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "C'est le 12 décembre, vers deux heures du soir, que j'arrivais à Calcutta. Aussitôt que le Pilote a fixé le navire à l'endroit désigné dans la rivière, et que la douane a passé la visite des bagages, je descends à terre et me dirige vers l'hôtel de Paris, tenu par un Français, ancien cuisinier du vice-roi ; puis, je parcours la ville et fais mes visites en commençant par la Poste et le Consulat."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335041699
©Ligaran 2015
Il n’y a pas bien longtemps, pour s’instruire, on faisait le tour de France ; aujourd’hui, c’est le tour du monde qu’il faut faire pour être de son époque. Généralement, on s’imagine qu’un tel voyage demande un courage héroïque, beaucoup de temps et surtout beaucoup d’argent ; c’est une erreur. Il fallait plus de fatigue, de temps et d’argent pour faire le tour de la France, il y a 50 ans, qu’il n’en faut aujourd’hui pour faire le tour du monde. Si nous allons vers l’Ouest, la traversée de l’Atlantique demande huit jours, celle du Continent américain sept, celle du Pacifique dix-huit ; et du Japon à Marseille, on vient en 40 jours : donc en tout soixante-treize jours ; moins de deux mois et demi pour franchir les vingt-cinq mille milles ou quarante-cinq mille kilomètres.
Les dangers de la mer ou des populations plus ou moins barbares ne sont pas redoutables ; il meurt moins de voyageurs par les accidents de mer que par ceux des chemins de fer, et les populations ne sont, dangereuses que pour les imprudents qui les maltraitent.
Quant à la santé, le voyage est un excellent moyen de la fortifier.
Les navires qui sillonnent les grands Océans sont des châteaux flottants ; on y jouit de tout le confortable et de toutes les distractions : bals, concerts, jeux de société ; l’ennui y est inconnu. Les wagons américains sont des salons qu’on transforme en chambres pour la nuit ; et aux Indes, outre le panka ou éventail mécanique, la double toiture, les persiennes et les vitres de couleurs, les fenêtres sont encore garnies, l’été, de branches odoriférantes ; au moyen d’un ressort ingénieux, le mouvement des roues fait tomber sur elles une légère pluie dont l’évaporation rafraîchit et embaume. Donc, pas trop de fatigue à craindre et confortable partout.
Certes, il y a des excursions pénibles dans les montagnes du Japon, dans certaines parties de l’Himalaya et dans l’intérieur de la Chine, mais elles ne sont pas plus difficiles que celles que nous offrent nos Alpes et nos Pyrénées.
Le Français, en général, réduit encore le monde au bassin de la Méditerranée ou à l’ancien continent ; il ignore les ressources inexploitées qui, sur les divers points du globe, peuvent donner l’aisance et la richesse à de nombreuses familles. Les enfants, de leur côté, savent que le père et la mère ne sont que des usufruitiers, et qu’ils peuvent compter sur leur part de bien. Lorsqu’ils commencent à raisonner, ils font leurs calculs : J’aurai tant de milliers de francs de mon père, tant d’autres milliers de ma mère ; ce n’est pas assez : il me faut un emploi qui produise tant ; et ils entrent dans une administration.
Puisse ce livre montrer la facilité et l’utilité desvoyages ! S’ils sont faits dans un esprit sérieux, l’observation et la comparaison feront tomber les préjugés. Les hautes classes, chez nous, voient, dans le commerce et dans l’industrie, quelque chose d’inférieur, et presque de déshonorant. Lorsqu’elles ont des biens, elles se contentent de voir leurs fils, presque toujours privés de fortes études, gérer ces biens ; plus tard, ceux-ci les feront gérer par des tiers et iront en dépenser les rentes à Paris, où ils feront naufrage.
Une grande partie de la bourgeoisie pousse ses enfants dans les carrières administratives, après les études qu’exige un baccalauréat. Après trois ans de stage, un jeune homme, à 23 ans, gagnera 100 à 150 francs par mois ; il en gagnera le double à 40 ans. Esclave du travail, il le sera des opinions d’un maître qui change à tout instant ; il devra briguer sans cesse la faveur de tel député ou de tel ministre, et tout cela pour avoir, à la fin de ses jours, une pension de retraite de deux à trois mille francs. Comment s’étonner alors qu’on ne trouve presque plus d’hommes de caractères ? Si ce jeune homme, ou son père pour lui, avait connu le globe, il aurait fait comme les Anglais, comme les Allemands et les Hollandais, il aurait trouvé, dans l’industrie et dans le commerce, une occupation honorable qui lui eût donné, non l’aisance mais la richesse, non l’esclavage mais la liberté. Aux États-Unis, les emplois administratifs sont le lot des courtes intelligences qui n’ont su ou pu se créer une carrière indépendante.
Aussi, si de l’autre côté de l’Océan, on connaît d’autres plaies, on ignore celle du fonctionnarisme.
Il est temps pour nous de voir notre infériorité et d’y porter remède. Lorsqu’on parcourt la surface du globe et qu’on voit partout l’Anglais, l’Américain et l’Allemand prendre pied à notre exclusion ; lorsqu’on voit que, même là où nous étions parvenus à nous établir, nous sommes tous les jours supplantés par nos rivaux, que même, dans plusieurs de nos colonies, les affaires et le commerce sont en d’autres mains que les nôtres ; lorsqu’on voit ce que pensent de nous les autres peuples, le chauvinisme baisse pour faire place à de tristes réflexions ; les illusions disparaissent et on s’applique à l’étude des causes qui ont produit notre infériorité pour les paralyser et les détruire ; en un mot, on sonde nos plaies sociales pour les guérir.
Ce que j’écris n’est que l’ensemble des notes de voyage prises sur place, au jour le jour, et adressées à ma famille ; si l’arrangement méthodique fait défaut, l’impression du moment y est tout entière, et fait mieux ressortir la vérité des choses.
Dans trois précédents volumes, les lecteurs ont pu faire, en ma compagnie, la traversée de l’Atlantique, parcourir le Canada et les États-Unis, me suivre de San-Francisco au Japon et en Chine, étudier ces curieux pays qui s’identifient si rapidement aux mœurs de la vieille Europe.
C’est maintenant à travers l’Hindoustan que nous allons nous engager, pour achever le tour du monde et retourner ensuite vers la France.
Calcutta. – La ville et ses monuments. – Mœurs et coutumes. – Castes et religions. – Missions et Œuvres.
Sur le steamer le Singapore,
4 janvier, 1882.
C’est le 12 décembre, vers deux heures du soir, que j’arrivais à Calcutta.
Aussitôt que le Pilote a fixé le navire à l’endroit désigné dans la rivière, et que la douane a passé la visite des bagages, je descends à terre et me dirige vers l’hôtel de Paris, tenu par un Français, ancien cuisinier du vice-roi ; puis, je parcours la ville et fais mes visites en commençant par la Poste et le Consulat.
La capitale de l’Inde, siège du vice-roi, est vaste et belle, avec un million d’habitants.
Dans le quartier européen, les rues sont larges et les maisons ont presque toutes un petit jardin ; dans la ville hindoue, les rues sont plus étroites et la population est très agglomérée ; souvent, à côté d’une belle maison en pierres, ou d’un beau monument servant d’école, on voit la hutte de boue ou de feuilles de cocotiers.
Dans la partie européenne, les jardins et les squares sont ornés d’un vert gazon et de plantes des tropiques.
On arrose les rues au moyen des coolies qui répandent avec la main l’eau d’une outre en cuir portée sur le dos.
Les monuments tels que le palais du vice-roi, la Cour de justice, les banques, le Musée sont superbes. Le palais des Postes est dominé par une coupole majestueuse.
Les tramways sont dans toutes les directions et servent surtout aux indigènes ; l’Européen préfère le gkarry, voiture à un ou deux chevaux, qu’il loue au prix de trois roupies par jour.
Le soleil est si brûlant, même en hiver, qu’on ne peut s’y exposer sans danger ; on voit aussi une quantité de palanquins, portés sur les épaules de quatre coolies, deux à chaque bout d’une seule perche.
Ces palanquins consistent en une longue caisse noire, qu’on ouvre par un côté pour s’y allonger. Je les ai pris d’abord pour des cercueils.
Les Hindous ont le type parfaitement européen, excepté la couleur, qui va du brun au noir ; ils sont le plus souvent nus, sauf un morceau d’étoffe enroulé à la ceinture ; d’autres portent une longue robe blanche, légère et serrée au corps ; la tête est entourée d’un turban dont la forme et la couleur varient selon les provinces.
Les femmes ont un petit corset, qui descend des épaules sous les seins et portent, comme les hommes, un morceau d’étoffe enroulé à la ceinture, plus une longue pièce d’étoffe qui passe en bandoulière sur la poitrine et dont une partie se replie sur la tête en guise de voile. Elles tirent toujours ce voile sur la figure, dès qu’elles aperçoivent un homme.
On les voit peu dans les rues, excepté celles des castes inférieures, obligées de gagner leur vie ; garçons et filles sont nus jusqu’à huit ou dix ans ; on porte les bébés à califourchon sur la hanche gauche.
Dans les banques, dans les magasins, dans les administrations, la presque totalité des employés sont Hindous ; le gouvernement anglais en fait même des magistrats, des militaires, des conseillers.
Au Musée, je trouve, comme en Europe, une riche collection d’animaux, de minéraux, d’objets d’art de l’Inde et de tous les pays. Je remarque deux morceaux d’or pur ; l’un a été trouvé en 1858 à Ballarat (Australie), il pèse 2 166 onces, l’autre a été trouvé en 1871 à Berlin (Victoria Australie) et pèse 1 717 onces.
Le jardin zoologique possède surtout de beaux tigres. On l’illumine parfois le soir et on va assister au repas des fauves.
Le jardin botanique, à quelques mille de distance, est peut-être le plus beau du monde. On admire, à l’intérieur, un bahnian gigantesque, puis des allées de cocotiers et d’autres arbres en berceau d’une grande longueur et d’un effet merveilleux. Le directeur est si obligeant qu’il me promet une collection des principales graines.
Non loin du jardin botanique, je visite la Sibpore governmentvork-shop, école d’arts et métiers. Soixante-dix Eurasiens y reçoivent l’instruction qui les rend aptes à certains emplois de l’État.
On appelle Eurasiens les individus de sang mixte, Hindou et Européen. Leur situation est difficile ; ils ne peuvent vivre de la vie mesquine de l’Hindou, et on fait des efforts pour les instruire et les amener aux emplois.
Non loin de là, j’ai demandé à visiter la Sibpore Jute Mill, Usine à filer et à tisser le jute.
Le directeur, avec une affabilité peu ordinaire, m’a conduit lui-même dans les salles où le jute passe d’abord sous des cylindres rayés, puis il est divisé, filé et tissé comme le coton à Manchester, à Lille et à Roubaix. La toile plus ou moins fine sert surtout à faire des sacs pour le riz, le sucre, le café, le blé, etc. On en fait quinze mille par jour, et on les exporte de tous côtés, surtout en Californie. Le prix d’un sac est d’une demi-roupie.
Cette manufacture emploie deux mille ouvriers ; ils sont payés une roupie et demie la semaine ; lorsqu’ils travaillent à forfait, ils peuvent gagner le double. Les femmes, les enfants gagnent un peu moins ; on donne à une femme une demi-roupie, soit 1 fr. 05, pour coudre cent sacs. Avec une si modique paye, l’ouvrier doit pourvoir à sa nourriture et à celle de sa famille : un peu de riz et quelques légumes deux fois par jour ; aussi, ils sont faibles et il faut deux Hindous pour fournir le travail d’un Européen.
Le riz coûte deux ou trois sous le kilogramme.
Le jute est une espèce de chanvre grossier qu’on cultive dans les plaines marécageuses situées entre la mer et l’Himalaya. Le cultivateur le vend, selon la qualité, trois ou quatre roupies le maud, soit les quatre-vingts livres de seize onces, ou trente-cinq kilogrammes.
J’ai aussi voulu voir la scène hindoue.
Au théâtre royal, une troupe Parsie donnait une représentation, tirée d’un fait passé à Amber, près Jeypore.
La récitation et la mimique étaient bonnes, les costumes jolis, la mise en scène convenable ; le surnaturel : – anges, esprits malfaisants, devins, – intervenait souvent ; le chant était monotone, ainsi que la musique ; dans la salle au deuxième rang, les Hindous occupaient toutes les places ; au premier rang, moi, un Anglais, et quelques gros rats qui se promenaient en spectateurs.
Les Jésuites de Belgique ont, à Calcutta, de nombreuses écoles et le collège Saint-François Xavier, où le vice-roi préside ordinairement la distribution des prix.
Les Christian brothers irlandais sont chargés des écoles élémentaires et des orphelinats ; les Sœurs de la Croix de Belgique et les Sœurs de Lorette irlandaises ont de nombreuses écoles : externats, internats, orphelinats sur divers points de la ville.
Le nombre des catholiques s’élève à douze mille, répartis en cinq paroisses.
Les Hindous sont divisés en castes nombreuses et en religions diverses contenues dans leurs livres sacrés.
Les principaux de ces livres sont : les Védas, qui comprennent les brahamanas, les Upanishads, les Soutras, les Instituts de Manu, et les Jtihassas et Puranas. Les Védas sont les plus anciens.
Il faut des années pour mettre un peu de lumière dans cette théologie confuse qui a été remaniée à travers les siècles ; mais on peut, avec quelque attention, y découvrir les traces de la tradition primitive, qui s’accorde, sur tous les points du globe, avec la vérité.
Les castes principales sont au nombre de quatre : les Brahman, ou prêtres, les Kshattriya ou gens d’armes, les Vaïsya ou marchands, et les Soudras ou travailleurs.
Dans l’hymne de Manu, que les Hindous chantent tous les jours, voici comment est expliquée la création :
« Pour que le monde pût être peuplé, Lui, (Brahma) ou Dieu, fit sortir les Brahman, les Kshattrya, les Vaïsya et les Soudras de sa bouche, de ses bras, de ses jambes et de ses pieds. Ayant divisé son propre corps en deux parties, le Seigneur (Brahma) devint avec la moitié un homme, Purusha, et avec l’autre moitié une femme, et en elle il créa Viras. Apprends, ô homme très excellent deux fois né, que moi qui ai créé cet homme (Purusha), et cette femme (Viras), suis moi-même le créateur de tout ce monde ! »
À ces quatre castes principales sont venues s’en ajouter un grand nombre d’autres.
Même parmi les Parias, qu’on supposait sans caste, on trouve ceux dont l’occupation est d’enlever les ordures, la caste qui s’occupe de porter ou de toucher les cadavres des hommes ou des animaux, etc.
Les Brahmanes ont une vingtaine de castes diverses. Il y a souvent des castes selon les métiers, et toutes ont leurs règles dont la transgression est punie par l’exclusion des membres.
Quelquefois l’exclu peut racheter son péché par décision du Conseil avec une somme plus ou moins grande, selon sa fortune, et par de longues et nombreuses pénitences : comme d’aller se baigner dans le Gange à Bénarès ou autres lieux saints, ou d’aller voir une autre rivière dont la seule vue purifie les péchés.
Chaque caste tient pour chose impure de toucher ou de fréquenter des individus d’une autre caste, à plus forte raison de se lier à eux par le mariage.
Les Européens qui louent une maison, doivent bien veiller à ce que la partie réservée aux domestiques ait le nombre voulu de cellules nécessaires, car il ne pourra jamais faire rester un domestique d’une caste avec celui d’une caste différente.
Chaque caste ne peut manger que la nourriture préparée par un de ses membres. Le Brahmane va plus loin, et ne peut manger que la nourriture préparée par lui-même : si un Européen touche seulement à la nourriture d’un Hindou, elle devient impure et celui-ci la repoussera.
Il m’est arrivé souvent, au marché, de toucher aux légumes et autres objets que je ne connaissais pas ; aussitôt l’Hindou arrêtait ma main, ou s’il n’arrivait pas à temps, il enlevait et jetait ce que j’avais touché.
L’Hindou ne demande pas l’aumône au chrétien ; s’il est dans le besoin, il est secouru par sa caste. Les membres d’une caste supérieure peuvent recevoir des secours des membres d’une caste inférieure, mais ils ne sont jamais secourus par les membres d’une caste au-dessus de la leur.
Cet usage des castes est si enraciné dans la nation, que même les chrétiens hindous ont leurs castes et ils exigent dans les Églises des places spéciales séparées par un petit mur.
Dans certaines villes du Sud, ils sont presque en révolution, en ce moment, parce qu’on a voulu abattre quelques-uns de ces murs.
Il ne faut voir là, comme dans presque toutes les erreurs, que l’exagération d’une vérité ; la hiérarchie se trouve partout dans la nature.
En religion, les Brahmistes ou Hindous sont les plus nombreux ; leurs temples, de petite dimension, sont en général surmontés d’une ou de plusieurs coupoles ou clochetons richement sculptés. Parfois ils sont entourés de portiques ou galeries contenant chacun un autel ; partout les trois statues en marbre ou en pierre de la Trinité hindoue. Les prêtres seuls peuvent pénétrer dans l’enceinte sacrée qui entoure l’autel.
Les Hindous célèbrent sept à huit fêtes par an : quelques-unes se prolongent trois ou quatre jours.
Lorsqu’ils vont dans leurs temples pour adorer, ils offrent du riz, du blé, du millet, etc., qu’ils déposent dans une caisse à compartiments divers ; c’est leur tronc.
Comme en étudiant leur théologie on peut retrouver les traces de la trahison primitive, ainsi en interrogeant les individus, on peut facilement se convaincre qu’ils croient au vrai et unique Dieu créateur qu’ils appellent Brahma, et que les trente-trois millions d’autres Dieux qu’ils vénèrent ne sont que des personnages illustres, ou des esprits bienfaisants.
Les castes se reconnaissent à des signes divers et à des marques rouges, jaunes, bleues, rondes ou droites que les deux sexes portent sur le front et qu’ils renouvellent tous les matins au temple après la prière.
Après les Brahmistes viennent les Bouddhistes dont la religion, apportée d’Égypte, est passée ensuite en Chine et au Japon.
On trouve aussi d’autres sectes nombreuses et des tribus qui ont des usages fort curieux. Dans les montagnes des Nielgherries et à Jafna (Ceylan), on rencontre encore des tribus où la femme a la direction des affaires publiques et privées.
Après les Brahmistes et les Bouddhistes, la secte la plus nombreuse est celle des Musulmans ; ils sont quarante millions répandus sur toute la surface des Indes.
Remuants et guerriers, ils se sont imposés par la conquête, et ont été cause de plusieurs modifications dans les usages du pays.
Ainsi la femme hindoue, qui jouissait d’une liberté relative et pouvait se promener en public, a été enfermée, au moins pour les classes élevées, après la conquête musulmane, à cause des insultes auxquelles elle était exposée de la part des Mahométans.
Les Musulmans sont polygames, et la femme, chez eux, est plutôt une esclave qu’une compagne.
Chez les Hindous, la polygamie n’existe que dans la caste des Brahmes, et la femme est mieux traitée, les enfants plus soignés et surtout mieux aimés.
Les Musulmans ont construit partout de magnifiques mosquées et de superbes mausolées. Ils célèbrent une douzaine de fêtes par an.
J’ai assisté à Calcutta à leur Mohohuram, qui dura plusieurs jours.
Une longue procession parcourait la ville au son du fifre, du tambour et autres instruments. On traînait des tours illuminées, des chars de diverses formes et on balançait de grands éventails.
Anciennement, des individus, payés pour cela, se battaient entre eux durant la procession (on dit que cette fête a pour but de figurer la trahison de Judas) ; mais, depuis quelques années, ces batailles, souvent cruelles, sont défendues et empêchées par la police.
À Darjeeling, un soir d’éclipse de lune, j’ai vu les Musulmans aller de porte en porte pour recevoir une aumône en nature que chacun donnait volontiers.
Les sectateurs du Coran, ici comme partout, son fanatiques et donnent parfois de l’embarras au gouvernement.
Ils vont à la Mecque en pèlerinage et en rapportent régulièrement le choléra.
Ils sont divisés en deux grandes sectes ; les uns suivent Mahomet, les autres Ali, un de ses proches descendants, et ils ont une marque distinctive.
Après les Musulmans viennent les Juifs, qu’on retrouve dans toutes les parties du globe.
Il y a ici deux catégories de Juifs : ceux qui sont venus à l’époque de la transmigration de Babylone, et ils sont devenus noirs comme les Hindous ; et ceux qui sont venus après la destruction de Jérusalem par Titus ; ceux-ci sont simplement bruns.
Il est superflu d’entrer dans les détails en ce qui concerne les Juifs ; ils sont partout cette belle race active et intelligente, spécialement vouée au commerce, mais trop souvent dégradée par l’avarice.