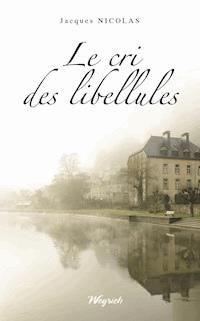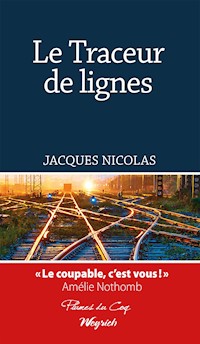
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
« Les rats glissent entre les rails, furtifs, dessinant des lignes brisées, se frôlant sans se toucher… »
Séduite par
Le Traceur de ligne, Amélie Nothomb écrit à son auteur : « Au fil de ma lecture, je commençais à distinguer les rats qui couraient le long de la voie. Comme dans votre double récit, le passé se mêlait au présent. »
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jacques Nicolas est né à Bouillon en 1943. Instituteur à Poupehan pendant plus de trente ans, il se met à écrire des romans en même temps qu’il prend sa retraite. Passionné de théâtre, comédien et metteur en scène, il a été récompensé pour sa créativité dans la réalisation du Miracle de Schwajda.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce livre est dédié à la mémoire d’Alain Bertrand, qui m’a soutenu dans cette entreprise de rénovation peu commune.
Chacun expie son premier instant.
Cioran
Préface
Cher Jacques Nicolas,
Ce matin, dans le train, j’ai lu votre livre. Pouvais-je y trouver meilleure façon d’entrer en cohérence avec votre beau texte ? Au fil de ma lecture, je commençais à distinguer les rats qui couraient le long de la voie.
Comme dans votre double récit, le passé se mêlait au présent. À l’arrivée, je ne savais pas très bien où j’étais : quelque part entre les lignes que vous aviez tracées.
Peut-être ma disparition a-t-elle été constatée.
Ma seule certitude : le coupable, c’est vous !
Merci pour votre talent !
Amélie Nothomb
1
Les rats glissent entre les rails, furtifs, dessinant des lignes brisées, se frôlant sans se toucher, comme par miracle ; répondant à je ne sais quelle préoccupation, ils se figent d’un coup, puis comme mus par un ressort, et dans un bel ensemble, ils filent à nouveau en dodelinant de la croupe dans la noirceur des bords de murs, imprévisibles et silencieux. Couché sur un banc du quai central de la gare de Toulouse, je les observe dans leur concentration appliquée à dessiner des arabesques. Des ombres inquiétantes escaladent par intermittence les métalliques sculptures vert-de-gris, charpentes d’une serre étouffante. Une voix féminine aux inflexions formatées annonce les arrivées et les départs des convois de voyageurs.
Encore une fois, le sol tremble. Les rats se réfugient dans les anfractuosités ou s’aplatissent sur le ballast. La grosse horloge soleil marque 23 h 40 et le train pour Paris est à minuit dix. Sur le quai d’en face, un couple attend dans un décor et une lumière de théâtre. L’homme est debout, les bras ballants, il bâille après le train. La femme fume un cigare, assise sur une valise.
*
Ce matin, le réveil a sonné bien plus tôt que d’habitude. Bouche sèche, en béton, langue piquante, flots d’acide à l’assaut du pharynx… et ça cognait dans le crâne, un tambourinement répété à l’infini plaqué sur neuf syllabes : con-fé-ren-ce pé-da-go-gi-que… Assis au bord du lit, je cherchais mes pantoufles qui, une fois encore, avaient dû se réfugier sous la table de nuit. Je me suis mis à tousser… une batterie de coups secs à déchirer les muqueuses. À la salle de bains, j’ai bu un grand verre d’eau pour noyer le mal et faire descendre deux Nexiam vingt milligrammes. Belle journée en perspective, je me suis dit… sur les bancs d’élèves de la petite école de Plainchamp, au bout du bout du monde, lieu de rassemblement de tous les instits du canton. Jusque-là, quarante bornes à se taper sur des routes étroites mal entretenues, avec à la sortie de Bassange, ce foutu passage à niveau souvent fermé…, l’interminable attente.
C’est au carrefour des trois tilleuls que j’ai donné un coup de volant à droite, comme ça, sans que ce fût prémédité. Point de départ d’une improbable excursion en France. L’esprit vide, anesthésié. Des centaines de kilomètres avalés sans rien voir du paysage, les yeux braqués sur le ruban qui défile. En coupant le moteur aux portes de Toulouse, je me suis demandé ce que je foutais là.
*
Le train est bondé. Je trouve refuge dans un compartiment déserté des premières classes. Abruti de fatigue, je me cale dans un coin, près de la vitre. Bercé par le doux roulement du train, je me sens mieux, comme un quidam en vacances. Mais je sais que le sommeil ne viendra pas. Les questions sont là, obsédantes. Pourquoi cette diversion, cette chevauchée en terre inconnue ? Hier devait être un jour ordinaire. Je ne me souviens de rien. Qu’ai-je fait ? Qui ai-je rencontré ? Quel temps faisait-il… hier ? Hier n’existe pas.
Clotilde au visage défait… J’entends ses souliers qui claquent sur le carrelage du salon, le silence quand elle marque un temps d’arrêt devant chaque fenêtre – chaque station – où renaît l’espoir de voir déboucher là-bas au coin de la rue, ma Subaru. Clotilde inspire profondément, et les souliers claquent à nouveau. Elle entre dans la cuisine, sans allumer le plafonnier, ferme la porte, et à tâtons se dirige vers la table où elle s’assied à sa place habituelle. Dans l’obscurité, elle se repasse le film de la veille, le peu que j’ai dit, ce à quoi je n’ai pas répondu, l’un ou l’autre de mes gestes équivoques, les coups de fils donnés ou reçus, les gens que j’aurais pu rencontrer… hier. J’entends les os de ses doigts craquer.
Elle sait qu’elle ne trouvera aucune réponse à ses questions. Pourtant, tout sera analysé, décortiqué, pesé, dans les moindres détails. Mes amis et mes collègues seront sollicités plus d’une fois… « Albert a dû laisser des traces quelque part, au moins quelques lignes dans un de ses carnets, il a dû se confier à quelqu’un, on ne fuit pas comme ça, sans explication. » Ma femme n’est pas en peine, au fil des jours, elle échafaudera les scénarios les plus sophistiqués ; là-dessus, je lui fais confiance, son imagination est sans limites.
Julien, lui, refusera de rentrer dans son jeu. Il a d’autres préoccupations, mon fils… « Fous-moi la paix, maman. Si papa s’est barré, c’est qu’il avait de bonnes raisons. Et puis, qu’est-ce que ça change, hein, qu’est-ce que ça peut foutre ? Ça fait des mois qu’il n’est plus rien pour nous. »
Demain et les jours suivants, elle traversera le salon, entrera dans la cuisine sans allumer la lampe, s’assiéra à sa place habituelle et, mains croisées sur la petite table ronde, elle se posera les mêmes questions : « Où est-il ? Pourquoi est-il parti ? »
Quand on aura identifié ma voiture dans la banlieue de Toulouse, je serai loin. Loin de Flohimont, du chemin tout tracé vers une retraite paisible, antichambre du tombeau.
*
Une vie sans problèmes, avait déclaré mon père… instituteur, une place à l’État. J’étais devenu quelqu’un pour lui qui n’avait jamais été personne, enrôlé dès l’âge de quatorze ans dans une fabrique de charnières. Six jours sur sept, dès six heures du matin, le « gueulard » déchirait l’air et le cœur des ouvriers de Flohimont pour les pousser sur le chemin des machines. De rue en rue, de quartier en quartier, des petits groupes se formaient pour faire à pied ou à vélo les deux kilomètres qui les séparaient de la boutique.
Il y avait la ville, le château comme un vieux nid d’aigle, les écoles, l’église en son centre, l’usine à la périphérie, puis tout au bout, le cimetière et la forêt. Les chemins de toute une vie.
Mon père rentrait du boulot vers 18 heures. Si éreinté qu’il n’avait jamais rien à dire. Avant de se mettre à table, il se débarbouillait dans l’évier de la cuisine, là où ma mère venait de laver les légumes pour la soupe. Torse nu, il m’apparaissait encore plus petit. Son dos était d’une blancheur froide, indécente, comme un marbre veiné, et dès qu’il levait les bras pour se frictionner les cheveux, il laissait voir aux aisselles des touffes hirsutes de poils noirs. Après le repas, il écoutait la radio, le corps penché et les bras croisés sur le rebord de l’armoire, nous tournant le dos. Ses programmes préférés étaient le journal parlé, les reportages sportifs du bouillant Luc Varenne, les « Chansonniers », le « Quitte ou double » avec la voix criarde de Zappy Max, la chronique politique de Geneviève Tabouis et ses « Attendez-vous à savoir… ». Entre deux quintes de toux, de sa voix sifflante qui me faisait penser à de l’air refoulé par un accordéon éventré, mon père réclamait le silence.
La radio et la pétanque aux beaux jours étaient ses seuls intermèdes, des tranches de petits bonheurs rendant plus supportables les heures passées à la boutique, dans le boucan, à respirer un air vicié au goût de limaille.
*
La porte du compartiment s’ouvre. Le parfum hésite, puis s’installe…
*
Toute mon enfance, je l’ai vécue dans un appartement de quatre pièces aménagé dans une longue bâtisse, ancienne caserne dessinée par Vauban. Le logement était un privilège offert par le patron de la « Flohimontoise » à ses ouvriers, à condition que leurs enfants soient inscrits à l’école du curé. Par temps de pluie, je me réfugiais dans l’interminable grenier où je passais d’un espace à l’autre, en escaladant les cloisons pour violer l’intimité des voisins. Quel plaisir de fouiller dans les caisses regorgeant de bibelots, de cartes postales jaunies et de lettres !
Ce devait être un lundi, ça sentait la lessive en tout cas… la buée comme disait si justement ma mère. Dans une boîte à biscuits à l’effigie du roi Léopold III et de la reine Astrid, je découvris une photographie en noir et blanc, un visage très pur, des yeux intelligents et profonds, une bouche à peine dessinée, un rien narquoise. Au dos du cliché, une inscription : « Margot Staquet, le jour de ses 20 ans. »
Margot, la voisine du dessous, cette montagne de graisse d’une saleté repoussante à la démarche batracienne. On l’appelait la sorcière. Dans le quartier, ils étaient nombreux capables de prononcer à son égard la sentence définitive, des salauds d’inquisiteurs qui n’auraient pas hésité une seule seconde à mettre le feu au bûcher en prétextant que les flammes nettoient tout, la laideur et la puanteur. Ainsi donc, cette vieille en tablier noir luisant, qui trimballait cahin-caha ses cent trente kilos bien pesés dans les escaliers de ma caserne, avait eu un jour vingt ans et cette face d’ange… Quels malheurs avaient donc rongé ce corps et cette âme au point de sculpter pareille monstruosité ?
Odeurs mélangées de sciures, de crottes de souris, de linges qui sèchent, de poussière, de vampires… Les chauves-souris étaient les lustres de mon grenier. Elles me donnaient la nausée, pendues en grappes aux poutres du toit. Des masses immondes de peaux ridées et de crochets, de gueules aux dents élimées. De ces agglomérats obscènes, une flèche se détachait parfois pour un court vol saccadé. Je ramassais alors un éclat de bois dans la barbaquine1 où mon père fendait au plus fin des réglettes de bouleau. Le projectile lancé avec force et adresse déchirait la masse noire provoquant débandade et cris perçants… Stoïque, je fermais les yeux, dans l’espoir d’échapper aux crochets empêtrés dans mes cheveux. L’Indien choisissait alors ce moment pour bander son arc. J’avais juste le temps de dégringoler quatre à quatre les escaliers, au risque de me casser le cou, avant de refermer vivement la porte où se fichait chaque fois la flèche du Géronimo de service.
*
Dans la semi-obscurité, je devine de longues jambes croisées.
*
Je m’étais fait oublier. Planqué sous la table de la cuisine, j’attendais que ma tante s’approchât du tiroir à couverts. Patience récompensée quand s’offraient, en contre-plongée, les bas saumon et les jarretelles…
*
Un crissement de nylon frotté, une bouffée de parfum… Le train freine, ralentit… Une gare. La lumière venant du quai éclaire la femme qui me fait face. Elle est coiffée d’un large chapeau noir d’où s’échappent des boucles claires ; son visage est blême et ses lèvres exagérément rouges ; elle porte une robe noire dans un décor verdâtre partagé entre bandes d’ombre et effets lumineux. Comme dans un tableau de Hopper.
Les jambes, les genoux, un début de cuisse et le parfum qui insiste…
*
Cette odeur piquante d’urine quand je rampais sur le carrelage de la maternelle et que la lourde robe rêche de sœur Lucie venait me gifler le visage…
*
Ma compagne de voyage lit un livre maintenant, en s’aidant d’une petite lampe de poche. Chaque fois qu’elle tourne une page, elle relève la tête et semble réfléchir. Peut-être ressent-elle le besoin d’anticiper sur le récit ? Ou alors quelque chose la chiffonne.
Elle soupire longuement. Une invitation à se laisser désirer ?
*
C’était un soir d’orage. Assise devant sa coiffeuse, Clotilde ôtait lentement les pinces de son chignon, rendant sauvages ses longs cheveux. Son visage exprimait alors une satisfaction non feinte. Formidable envie de me jeter sur elle, de déchirer sa chemise et de la violer.
« Maman viendra samedi avec Blandine. J’ai pris rendez-vous chez le coiffeur, j’aurai besoin de la voiture. »
Charme rompu.
*
« Vous allez à Paris ?
— …
— Vous avez vu tout ce monde ? »
Je fais oui de la tête.
« Curieux tout de même tous ces gens qui éprouvent le besoin de voyager la nuit…
— … »
Trois phrases, trois clichés. Puis elle reprend sa lecture en haussant les épaules. Elle se sent observée et prend des poses, tourne chaque page après avoir mouillé le majeur de la main droite, dessine un petit sourire qu’elle efface aussitôt, fronce les sourcils, fait la moue en gonflant ses lèvres d’un rouge sombre qui donne à sa peau un teint cadavérique. Des simagrées pour faire croire qu’elle est dans son livre, pleinement, loin de ce train qui file vers Paris, loin du voyageur qui lui fait face, alors qu’elle croise et décroise savamment ses jambes et que de ses longs doigts, elle ratisse sa chevelure, vaporisant l’air de son parfum envoûtant.
Cette femme qui fait son cinéma est une aventurière. La voilà qui relève la tête maintenant, ses grands yeux dans les miens. Elle se penche en avant et veut me confier d’un ton calculé qu’elle veut confidentiel : « Je vais voir mon père à l’hôpital. Un infarctus… »
*
Mes frères et moi, nous montions la garde en attendant la mort de notre père. On nous avait prévenus que c’était l’affaire de quelques heures. À l’hôpital où il avait été admis pour des problèmes respiratoires – il souffrait d’emphysème chronique depuis des années –, on lui avait coupé la jambe gauche. On n’a jamais su pourquoi. On n’a jamais rien demandé. Peur d’embêter le chirurgien qui l’avait amputé, peur de prendre sur son temps précieux, peur de ne rien comprendre à leur charabia. Et puis à quoi bon ?
Je ne pouvais détacher mon regard de cette petite touffe de cheveux collés sur son front, une houppe ridicule, dérisoire, comme l’avait été son existence. Il grattait sans cesse le drap à hauteur de sa cuisse disparue. À intervalles réguliers, maman lui humectait le front et les lèvres. Lui ne disait rien, ne laissait échapper aucun gémissement, il n’existait plus que par l’intermédiaire d’un monitoring posé sur la table de nuit, qui dispensait un sadique son et lumière. Le signal sonore se fit tout d’un coup strident, insistant, puis les dunes s’aplatirent sur l’écran. Je suis sorti fumer une cigarette dans le couloir. Une heure plus tard, j’ai regagné la chambre. Les sœurs infirmières étaient passées par là : elles avaient entouré la tête du mort d’un bandeau blanc. J’étais partagé entre l’envie irrépressible de rire et celle de pleurer : les braves sœurs avaient fait de mon père un œuf de Pâques. Ma mère, soutenue par mes frères, sanglotait. Je suis resté en retrait près de la porte. Par pudeur. Pouvais-je maintenant aller vers mon père, l’étreindre, le noyer de mes larmes ? Nous n’avions eu que peu de véritables conversations, lui et moi. À vrai dire, je l’avais presque toujours considéré comme un étranger, mettant en doute la valeur de son expérience acquise durant toutes ces années de labeur. Je me nourrirais désormais de regrets en pensant à mon père devenu œuf, bon pour la vermine.
*
Un interminable panoramique filme l’envers du décor de la capitale : murs gris et tagués, terrasses mal agencées et sales dans le clair-obscur du petit matin.
*
Fin novembre. Flohimont faisait le dos rond sous une chape de brume. Après le mélèze et la ligne d’épicéas, je contournais le chêne de Clotilde, longeais la haie du voisin où pépiaient des bandes de moineaux. Comme chaque matin, la Twingo de l’infirmière stationnait devant la maison des Bertrand. Dès le tournant, près de l’église, j’entendais des cris d’enfants. Comme d’habitude, madame Douriot, l’institutrice maternelle – elle se faisait un honneur d’être toujours la première dans la cour – était entourée de parents. On se saluait, on échangeait des banalités… Il pleuvait comme tous les 30 novembre depuis près de trente ans. Encore quatre nuits avant le week-end, trois semaines avant les vacances de Noël, dix ans avant la retraite.
En tapant dans les mains, je mettais fin aux cris et aux jeux : « Allez, on rentre ! » Immédiatement, les rangs se formaient, en silence. Les enfants défilaient devant moi en me montrant leurs mains, côté pile puis face, et chacun prenait place dans le sanctuaire : les élèves, deux par banc, bras croisés, le maître sur les hauteurs, craie en main, prêt à transmettre son savoir, à proposer les tâches, à faire les cent pas, de l’estrade au fond de la classe.
*
Sur les larges trottoirs des Grands Boulevards où il est préférable de passer inaperçu, je m’introduis dans la file du milieu et me laisse conduire. La ville excite tous mes sens : les odeurs, les bruits, les frôlements, les gens que je croise… Et l’imagination part en cavale. Je ferme les yeux, me laisse porter au plus près de celui qui me précède, encadré par ceux des autres files. Soutenu et protégé, je m’accommode des changements de direction, des variations de rythme, des attentes devant les feux, des traversées précipitées…
Le peuple de Paris me pousse, me soulève et me dépose dans une galerie marchande, sous une verrière Art nouveau. Un clarinettiste joue debout devant l’étal d’un marchand de bonbons. Je lance une pièce dans son chapeau. L’instrument de musique couine en guise de remerciement.
Je m’éloigne de quelques pas et colle mon nez à une vitrine. Au milieu d’objets hétéroclites et de livres anciens, une poupée chauve et borgne écarte les jambes en me tendant les bras. Une invitation pour danser sur Petite fleur massacré à l’autre bout de la galerie ?
*
Deux fois par jour, on calait ma grand-mère Mélina dans un fauteuil à haut dossier, face à la porte-fenêtre qui s’ouvrait sur le jardin. Elle pouvait rester là des heures, parfaitement immobile, ronde comme un sucre d’orge, les genoux serrés, les pieds vissés au sol. Ses mains posées sur les accoudoirs étaient si blanches, déformées, traversées de grosses veines, des mains mortes, comme arrachées d’un corps de cimetière et déposées là dans le prolongement des manches du chemisier noir.
C’était une belle mamie bien propre, peu dérangeante, accommodante en tout. Bien qu’elle n’eût jamais quitté son village, elle en savait des choses. Exhumées de ses lectures. On m’avait dit, on m’avait cent fois raconté…
Elle a dix ans, Mélina. Appuyée contre un pommier, elle tourne avidement les pages d’un bouquin d’aventures tout en surveillant les cinq vaches du patrimoine familial. Elle rêve d’aller au-delà de la ligne d’horizon, au-delà de la rangée de peupliers…