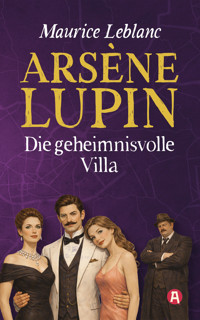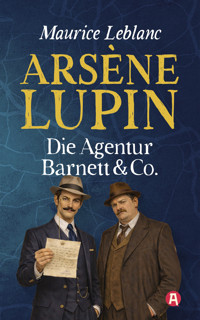0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Französisch
Un peu avant que sonnât la demie de six heures, comme les ombres du soir devenaient plus épaisses, deux soldats atteignirent le petit carrefour, planté d’arbres, que forme en face du musée Galliera la rencontre de la rue de Chaillot et de la rue Pierre-Charron.
L’un portait la capote bleu horizon du fantassin ; l’autre, un Sénégalais, ces vêtements de laine beige, à large culotte et à veston cintré, dont on a habillé, depuis la guerre, les zouaves et les troupes d’Afrique. L’un n’avait plus qu’une jambe, la gauche ; l’autre, plus qu’un bras, le droit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Maurice Leblanc
Le triangle d’or
Roman
1917
© 2021 Librorium Editions
ISBN : 9782383830597
Préface
Qui est Arsène Lupin ?
Comment est né Arsène Lupin ?
De tout un concours de circonstances. Non seulement je ne me suis pas dit un jour : je vais créer un type d’aventurier qui aura tel et tel caractère, mais je ne me suis même pas rendu compte tout de suite de l’importance qu’il pouvait prendre dans mon œuvre.
J’étais alors enfermé dans un cercle de romans de mœurs et d’aventures sentimentales qui m’avaient valu quelques succès, et je collaborais d’une manière constante au Gil Blas.
Un jour, Pierre Lafitte, avec qui j’étais très lié, me demanda une nouvelle d’aventures pour le premier numéro de Je sais tout qu’il allait lancer. Je n’avais encore rien écrit de ce genre, et cela m’embarrassait beaucoup de m’y essayer.
Enfin, au bout d’un mois, j’envoyais à Pierre Lafitte une nouvelle où le passager d’un paquebot de la ligne Le Havre-New York raconte que le navire reçoit au large, et en plein orage, un sans-fil annonçant la présence, à bord, du célèbre cambrioleur Arsène Lupin, qui voyage sous le nom de R... À ce moment, l’orage interrompt la communication. Inutile de dire que la nouvelle met tout le transatlantique sens dessus dessous. Des vols commencent à se produire. Tous les voyageurs dont le nom commence par un R sont soupçonnés. Et c’est seulement à l’arrivée qu’Arsène Lupin est identifié. Il n’était autre que le narrateur même de l’histoire, mais comme son récit était fait d’une façon tout objective, aucun des lecteurs, paraît-il, n’avait pensé un instant à porter ses soupçons sur lui.
L’histoire fit du bruit. Pourtant, lorsque Lafitte me demanda de continuer, je refusai : à ce moment-là, les romans de mystère et de police étaient fort mal classés en France.
J’ai tenu bon pendant six mois, mais, malgré tout, mon esprit travaillait. D’ailleurs, Lafitte insistait, et, lorsque je lui faisais remarquer qu’à la fin de ma nouvelle j’avais coupé court à tout développement ultérieur, en fourrant mon héros en prison, il me répondait tranquillement :
– Qu’à cela ne tienne... qu’il s’évade !
Il y eut donc un second conte, où Arsène Lupin continuait à diriger des « opérations » sans quitter sa cellule ; puis un troisième où il s’évadait.
Pour ce dernier, j’eus la conscience d’aller consulter le chef de la Sûreté. Il me reçut très aimablement et s’offrit à revoir mon manuscrit... mais il me le renvoya au bout de huit jours, avec sa carte et sans un commentaire... Il avait dû trouver cette évasion complètement impossible !...
Et, depuis, je suis le prisonnier d’Arsène Lupin ! L’Angleterre, d’abord, a traduit ses aventures, puis les États-Unis, et maintenant, elles courent le monde entier.
L’épigraphe « Arsène Lupin, gentleman cambrioleur », ne m’est venue à l’esprit qu’au moment où j’ai voulu réunir en volume les premiers contes, et qu’il m’a fallu leur trouver un titre général.
Un de mes plus efficaces éléments de renouvellement pour les aventures d’Arsène Lupin a été la lutte que je lui ai fait soutenir contre Sherlock Holmes, travesti en Herlock Sholmès. Je peux, néanmoins, dire que Conan Doyle ne m’a nullement influencé, pour la bonne raison que je n’avais encore jamais rien lu de lui, lorsque j’ai créé Arsène Lupin.
Les auteurs qui ont pu m’influencer sont plutôt ceux de mes lectures d’enfant ; Fenimore Cooper, Assolant, Gaboriau, et plus tard, Balzac, dont le Vautrin m’a beaucoup frappé. Mais celui à qui je dois le plus, et à bien des égards, c’est Edgar Poe. Ses œuvres sont, à mon sens, les classiques de l’aventure policière et de l’aventure mystérieuse. Ceux qui s’y sont consacrés depuis n’ont fait que reprendre sa formule... autant qu’il peut être question de reprendre sa formule à un génie ! Car il savait, lui, comme nul ne l’a jamais tenté depuis, créer autour de son sujet une atmosphère pathétique.
D’ailleurs, ceux qui lui ont succédé ne l’ont généralement pas suivi dans ces deux voies, mystère et police ; ils se sont orientés surtout vers la seconde. Ainsi, Gaboriau, Conan Doyle et toute la littérature qu’ils ont inspirée en France et en Angleterre.
Pour moi, je n’ai pas cherché à me spécialiser ; toutes mes œuvres policières sont des romans mystérieux, toutes mes œuvres de mystère sont des romans policiers. Je dois dire que mon personnage même m’y a conduit.
La situation n’est, en effet, pas la même suivant que le personnage central est le bandit ou le détective. Lorsque c’est le détective, cela présente cet intérêt que le lecteur ne sait jamais où il va, puisqu’il est du côté du détective qui se trouve en face de l’inconnu. Au contraire, lorsque le récit tourne autour du bandit, on connaît d’avance le coupable, puisque c’est justement lui.
D’autre part, j’ai dû faire d’Arsène Lupin un héros double, un homme qui soit à la fois un bandit et un garçon sympathique (car il ne peut y avoir de héros de roman qui ne soit sympathique). Il fallait donc ajouter à mon récit un élément humain pour faire accepter ses cambriolages comme des choses très pardonnables, sinon toutes naturelles. D’abord, il vole beaucoup plus par plaisir que par avidité. Ensuite, il ne dépouille jamais des gens sympathiques. Il se montre même parfois très généreux.
Enfin, ses exploits malhonnêtes sont souvent expliqués en partie par des entraînements sentimentaux qui lui donnent l’occasion de faire preuve de bravoure, de dévouement et d’esprit chevaleresque.
Dans Conan Doyle, Sherlock Holmes n’est animé que du désir de résoudre des énigmes, et il n’intéresse le public que par les moyens qu’il emploie pour y parvenir. Arsène Lupin, au contraire, est continuellement mêlé à des événements qui, le plus souvent, lui tombent dessus sans qu’il sache même pourquoi, et dont il doit sortir avec honneur... c’est-à-dire un peu plus riche qu’avant. Lui aussi se jette dans des aventures pour découvrir la vérité ; seulement cette vérité il l’empoche.
Cela ne signifie d’ailleurs pas qu’il se pose en ennemi de la société. Au contraire, il dit de lui-même : « Je suis un bon bourgeois... Si on me volait ma montre, je crierais au voleur. » Il est donc, par goût, sociable et conservateur. Seulement, cet ordre qu’il juge nécessaire, qu’il approuve même, son instinct le pousse sans cesse à le bouleverser. Ce sont ses remarquables dons à « barboter » qui l’amènent fatalement à être malhonnête.
Mais il est, dans ses aventures, un autre élément d’intérêt important et qui me semble avoir le mérite de l’originalité. Je ne m’en suis pas rendu compte non plus tout de suite. D’ailleurs, en littérature on ne prévoit jamais ce que l’on doit faire : ce qui vient de nous, se forme en nous et nous est souvent une révélation à nous-mêmes. Il s’agit dans le cas d’Arsène Lupin de l’intérêt que présente la liaison du présent, dans ce qu’il a de plus moderne, avec le passé, surtout historique ou même légendaire, il ne s’agit pas de reconstituer des événements d’autrefois en les romançant, comme dans Alexandre Dumas, mais de découvrir la solution de problèmes très anciens. Arsène Lupin est continuellement mêlé à de tels mystères par le goût qu’il a de ces sortes de recherches.
D’où cette série d’aventures d’Arsène Lupin où les faits sont contemporains mais où l’énigme est historique. Par exemple, dans L’Île aux trente cercueils, il s’agit d’un rocher entouré de trente écueils. On l’appelle la Pierre-des-rois-de-Bohême ; mais personne ne sait pourquoi. La tradition prétend seulement qu’autrefois on amenait des malades sur cette pierre et qu’ils guérissaient. Arsène Lupin découvre qu’un navire qui apportait ce rocher de Bohême a échoué là du temps des druides, et que les miracles dont on parlait étaient dus au radium que contenait cette pierre (on sait, en effet, que la Bohême en est la plus grande productrice).
Établir un roman d’aventures policières sur de telles données, élève forcément le sujet ; et c’est une des raisons, j’imagine, qui ont concouru à rendre populaire et attachante la personnalité de ce Don Quichotte sans vergogne qu’est Arsène Lupin.
Maurice Leblanc
Le Petit Var, samedi 11 novembre 1933
Première partie
La pluie d’étincelles
1
Maman Coralie
Un peu avant que sonnât la demie de six heures, comme les ombres du soir devenaient plus épaisses, deux soldats atteignirent le petit carrefour, planté d’arbres, que forme en face du musée Galliera la rencontre de la rue de Chaillot et de la rue Pierre-Charron.
L’un portait la capote bleu horizon du fantassin ; l’autre, un Sénégalais, ces vêtements de laine beige, à large culotte et à veston cintré, dont on a habillé, depuis la guerre, les zouaves et les troupes d’Afrique. L’un n’avait plus qu’une jambe, la gauche ; l’autre, plus qu’un bras, le droit.
Ils firent le tour de l’esplanade, au centre de laquelle se dresse un joli groupe de Silènes, et s’arrêtèrent. Le fantassin jeta sa cigarette. Le Sénégalais la ramassa, en tira vivement quelques bouffées, la pressa, pour l’éteindre, entre le pouce et l’index et la mit dans sa poche.
Tout cela sans un mot.
Presque en même temps, de la rue Galliera, débouchèrent deux autres soldats, dont il eût été impossible de dire à quelle arme ils appartenaient, leur tenue militaire se composant des effets civils les plus disparates. Cependant, l’un arborait la chéchia du zouave ; l’autre, le képi de l’artilleur. Le premier marchait avec des béquilles, le second avec des cannes.
Ceux-là se tinrent auprès du kiosque qui s’élève au bord du trottoir.
Par les rues Pierre-Charron, Brignoles et de Chaillot, il en vint encore, isolément, trois : un chasseur à pied manchot, un sapeur qui boitait, un marsouin dont une hanche était comme tordue. Ils allèrent droit, chacun vers un arbre, auquel chacun s’appuya.
Entre eux, nulle parole ne fut échangée. Aucun de ces sept mutilés ne semblait connaître ses compagnons et ne semblait s’occuper ni même s’apercevoir de leur présence.
Debout derrière leurs arbres, ou derrière le kiosque, ou derrière le groupe de Silènes, ils ne bougeaient pas. Et les rares passants qui traversaient, en cette soirée du 3 avril 1915, ce carrefour peu fréquenté, que des réverbères encapuchonnés éclairaient à peine, ne s’attardaient pas à noter leurs silhouettes immobiles.
La demie de six heures sonna.
À ce moment, la porte d’une des maisons qui ont vue sur la place s’ouvrit. Un homme sortit de cette maison, referma la porte, franchit la rue de Chaillot et contourna l’esplanade.
C’était un officier, vêtu de kaki. Sous son bonnet de police rouge, orné de trois soutaches d’or, un large bandeau de linge enveloppait sa tête, cachant son front et sa nuque. L’homme était grand et très mince. Sa jambe droite se terminait par un pilon de bois muni d’une rondelle de caoutchouc. Il s’appuyait sur une canne.
Ayant quitté la place, il descendit sur la chaussée de la rue Pierre-Charron. Là, il se retourna et regarda posément, de plusieurs endroits.
Ce minutieux examen le ramena jusqu’à l’un des arbres de l’esplanade. Du bout de sa canne, il toucha doucement un ventre qui dépassait. Le ventre se rentra. L’officier repartit.
Cette fois, il s’éloigna définitivement par la rue Pierre-Charron vers le centre de Paris. Il gagna ainsi l’avenue des Champs-Élysées, qu’il remonta sur le trottoir de gauche.
Deux cents pas plus loin, il y avait un vaste hôtel, transformé, ainsi que l’annonçait une banderole, en ambulance. L’officier se posta à quelque distance, de façon à n’être point vu de ceux qui en sortaient, et il attendit.
Les trois quarts, puis sept heures sonnèrent.
Il s’écoula encore quelques minutes.
Cinq personnes s’en allèrent de l’hôtel. Il y en eut encore deux autres. Enfin, une dame apparut au seuil du vestibule, une infirmière vêtue d’un grand manteau bleu que marquait la croix rouge.
– La voici, murmura l’officier.
Elle prit le chemin qu’il avait pris lui-même et gagna la rue Pierre-Charron, qu’elle suivit sur le trottoir de droite, se dirigeant ainsi vers le carrefour de la rue de Chaillot.
Elle avançait légèrement, le pas souple et cadencé. Le vent que heurtait sa course rapide gonflait le long voile bleu qui flottait autour de ses épaules. Malgré l’ampleur du manteau, on devinait le rythme de ses hanches et la jeunesse de son allure.
L’officier restait en arrière et marchait d’un air distrait, faisant des moulinets avec sa canne, ainsi qu’un promeneur qui flâne.
En cet instant, il n’y avait point d’autres personnes visibles, en cette partie de la rue, qu’elle et lui.
Mais, comme elle venait de traverser l’avenue Marceau, et bien avant que lui-même y parvînt, une automobile qui stationnait le long de l’avenue s’ébranla et se mit à rouler dans le même sens que la jeune femme, tout en gardant un intervalle qui ne se modifiait pas.
C’était un taxi-auto. Et l’officier remarqua deux choses : d’abord, qu’il y avait deux hommes à l’intérieur, et, ensuite, qu’un de ces hommes, dont il put distinguer un moment la figure barrée d’une forte moustache et surmontée d’un feutre gris, se tenait presque constamment penché en dehors de la portière, et s’entretenait avec le chauffeur.
L’infirmière, cependant, marchait sans se retourner. L’officier avait changé de trottoir et hâtait le pas, d’autant plus qu’il lui semblait que l’automobile accélérait sa vitesse, à mesure que la jeune femme approchait du carrefour.
De l’endroit où il se trouvait, l’officier embrassait d’un coup d’œil presque toute la petite place, et, quelle que fût l’acuité de son regard, il ne discernait rien dans l’ombre qui pût déceler la présence des sept mutilés. En outre, aucun passant. Aucune voiture. À l’horizon seulement, parmi les ténèbres des larges avenues qui se croisaient, deux tramways, leurs stores descendus, troublaient le silence.
La jeune femme, non plus, en admettant qu’elle fît attention aux spectacles de la rue, ne paraissait rien voir qui fût de nature à l’inquiéter. Elle ne donnait point le moindre signe d’hésitation. Et le manège de l’automobile qui la suivait ne devait pas l’avoir frappée davantage, car elle ne se retourna pas une seule fois.
L’auto, pourtant, gagnait du terrain. Aux abords de la place, dix à quinze mètres au plus la séparaient de l’infirmière, et lorsque celle-ci, toujours absorbée, parvint aux premiers arbres, l’auto se rapprocha d’elle encore, et, quittant le milieu de la chaussée, se mit à longer le trottoir, tandis que, du côté opposé à ce trottoir, à gauche par conséquent, celui des deux hommes qui se tenait en dehors avait ouvert la portière et descendait sur le marchepied.
L’officier traversa de nouveau, vivement, sans crainte d’être vu, tellement ces gens, au point où les choses en étaient, paraissaient insoucieux de tout ce qui n’était pas leur manœuvre. Il porta un sifflet à sa bouche. Il n’y avait point de doute que l’événement prévu ne fût près de se produire.
De fait, l’auto stoppa brusquement.
Par les deux portières, les deux hommes surgirent et bondirent sur le trottoir de la place, quelques mètres avant le kiosque.
Il y eut, en même temps, un cri de frayeur poussé par la jeune femme, et un coup de sifflet strident jeté par l’officier. Et, en même temps aussi, les deux hommes atteignaient et saisissaient leur proie, qu’ils entraînaient aussitôt vers la voiture, et les sept soldats blessés, semblant jaillir du tronc même des arbres qui les dissimulaient, couraient sus aux deux agresseurs.
La bataille dura peu. Ou plutôt, il n’y eut pas de bataille. Dès le début, le chauffeur du taxi, constatant qu’on ripostait à l’attaque, démarrait et filait au plus vite. Quant aux deux hommes, voyant leur entreprise manquée, se trouvant en face d’une levée de cannes et de béquilles menaçantes, et sous le canon d’un revolver que l’officier braquait sur eux, ils lâchèrent la jeune femme, firent quelques zigzags pour qu’on ne pût pas les viser, et se perdirent dans l’ombre de la rue Brignoles.
– Galope, Ya-Bon, commanda l’officier au Sénégalais manchot, et rapporte-m’en un par la peau du cou.
Il soutenait de son bras la jeune femme toute tremblante et qui paraissait près de s’évanouir. Il lui dit avec beaucoup de sollicitude :
– Ne craignez rien, maman Coralie, c’est moi, le capitaine Belval... Patrice Belval...
Elle balbutia :
– Ah ! c’est vous, capitaine...
– Oui, et ce sont tous vos amis réunis pour vous défendre, tous vos anciens blessés de l’ambulance que j’ai retrouvés à l’annexe des convalescents.
– Merci... merci...
Et elle ajouta, d’une voix qui frémissait :
– Les autres ? Ces deux hommes ?
– Envolés. Ya-Bon les poursuit.
– Mais que me voulaient-ils ? Et par quel miracle étiez-vous là ?
– On en causera plus tard, maman Coralie. Parlons de vous d’abord. Où faut-il vous conduire ? Tenez, vous devriez venir jusqu’ici... le temps de vous remettre et de prendre un peu de repos.
Avec l’aide d’un des soldats, il la poussait doucement vers la maison d’où lui-même était sorti trois quarts d’heure auparavant. La jeune femme s’abandonnait à sa volonté.
Ils entrèrent tous au rez-de-chaussée et passèrent dans un salon dont il alluma les lampes électriques et où brûlait un bon feu de bois.
– Asseyez-vous, dit-il.
Elle se laissa tomber sur un des sièges, et le capitaine donna des ordres.
– Toi, Poulard, va chercher un verre dans la salle à manger. Et toi, Ribrac, une carafe d’eau fraîche à la cuisine... Chatelain, tu trouveras un carafon de rhum dans le placard de l’office... Non, non, elle n’aime pas le rhum... Alors...
– Alors, dit-elle en souriant, un verre d’eau seulement.
Un peu de couleur revenait à ses joues, naturellement pâles d’ailleurs. Le sang affluait à ses lèvres, et le sourire qui animait son visage était confiant.
Ce visage, tout de charme et de douceur, avait une forme pure, des traits d’une finesse excessive, un teint mat et l’expression ingénue d’un enfant qui s’étonne et qui regarde les choses avec des yeux toujours grands ouverts. Et tout cela, qui était gracieux et délicat, donnait cependant à certains moments une impression d’énergie due sans doute au sombre éclat des yeux et aux deux bandeaux noirs et réguliers qui descendaient de la coiffe blanche sous laquelle le front était emprisonné.
– Ah ! s’écria gaiement le capitaine, quand elle eut bu le verre d’eau, il me semble que ça va mieux, maman Coralie ?
– Bien mieux !
– À la bonne heure ! Mais quelle sacrée minute nous avons passée là ! et quelle aventure ! Il va falloir s’expliquer là-dessus et faire la pleine lumière, n’est-ce pas ? En attendant, les gars, présentez vos hommages à maman Coralie. Hein, mes gaillards, qui est-ce qui aurait dit, quand elle vous dorlotait et qu’elle tapait sur l’oreiller pour que votre caboche s’y enfonce, qui est-ce qui aurait dit qu’on la soignerait à son tour, et que les enfants dorloteraient leur maman ?
Ils s’empressaient tous autour d’elle, les manchots et les boiteux, les mutilés et les infirmes, tous contents de la voir. Et elle leur serrait la main affectueusement.
– Eh bien, Ribrac, et cette jambe ?
– Je n’en souffre plus, maman Coralie.
– Et vous, Vatinel, votre épaule ?
– Plus trace de rien, maman Coralie...
– Et vous, Poulard ? Et vous, Jorisse ?...
Son émotion grandissait à les retrouver, eux qu’elle appelait ses enfants. Et Patrice Belval s’exclama :
– Ah ! maman Coralie, voilà que vous pleurez ! Maman, maman, c’est ainsi que vous nous avez pris le cœur à tous. Quand on se tenait à quatre pour ne pas crier, sur le lit de torture, on voyait de grosses larmes qui coulaient de vos yeux. Maman Coralie pleurait sur ses enfants. Alors on serrait les dents plus fort.
– Et moi, je pleurais davantage, dit-elle, justement parce que vous aviez peur de me faire de la peine.
– Et aujourd’hui, vous recommencez. Ah ! non, assez d’attendrissement ! Vous nous aimez. On vous aime. Il n’y a pas là de quoi se lamenter. Allons, maman Coralie, un sourire... Et tenez, voici Ya-Bon qui arrive, et Ya-Bon rit toujours, lui.
Elle se leva brusquement.
– Croyez-vous qu’il ait pu rejoindre un de ces deux hommes ?
– Comment, si je le crois ! J’ai dit à Ya-Bon d’en ramener un par le collet. Il n’y manquera pas. Je ne redoute qu’une chose...
Ils s’étaient dirigés vers le vestibule. Déjà le Sénégalais remontait les marches. De sa main droite, il serrait à la nuque un homme, une loque plutôt, qu’il paraissait porter à bout de bras, comme un pantin. Le capitaine ordonna :
– Lâche-le.
Ya-Bon écarta les doigts. L’homme s’écroula sur les dalles du vestibule.
– Voilà bien ce que je redoutais, murmura l’officier. Ya-Bon n’a que sa main droite, mais lorsque cette main tient quelqu’un à la gorge, c’est miracle si elle ne l’étrangle pas. Les Boches en savent quelque chose.
Ya-Bon, une sorte de colosse, couleur de charbon luisant, avec des cheveux crépus et quelques poils frisés au menton, avec une manche vide fixée à son épaule gauche et deux médailles épinglées à son dolman, Ya-Bon avait eu une joue, un côté de la mâchoire, la moitié de la bouche et le palais fracassés par un éclat d’obus. L’autre moitié de cette bouche se fendait jusqu’à l’oreille en un rire qui ne semblait jamais s’interrompre et qui étonnait d’autant plus que la partie blessée de la face, raccommodée tant bien que mal, et recouverte d’une peau greffée, demeurait impassible.
En outre, Ya-Bon avait perdu l’usage de la parole. Tout au plus pouvait-il émettre une série de grognements confus où l’on retrouvait son sobriquet de Ya-Bon éternellement répété.
Il le redit encore d’un air satisfait, en regardant tour à tour son maître et sa victime, comme un bon chien de chasse devant la pièce de gibier qu’il a rapportée.
– Bien, fit l’officier, mais, une autre fois, vas-y plus doucement.
Il se pencha sur l’homme, le palpa, et constatant qu’il n’était qu’évanoui, dit à l’infirmière :
– Vous le reconnaissez ?
– Non, affirma-t-elle.
– Vous êtes sûre ? Vous n’avez jamais vu, nulle part, cette tête-là ?
C’était une tête très grosse, à cheveux noirs et pommadés, à moustache grisonnante. Les vêtements, gros bleu, et de bonne coupe, indiquaient l’aisance.
– Jamais... jamais..., déclara la jeune femme.
Le capitaine fouilla les poches. Elles ne contenaient aucun papier.
– Soit, dit-il, en se relevant, nous attendrons qu’il se réveille pour l’interroger. Ya-Bon, attache-lui les bras et les jambes, et reste ici, dans le vestibule. Vous, les autres, les camarades, c’est l’heure de rentrer à l’annexe. Moi, j’ai la clef. Faites vos adieux à la maman, et trottez-vous.
Et lorsque les adieux furent faits, il les poussa dehors, revint vers la jeune femme, la ramena au salon, et s’écria :
– Maintenant, causons, maman Coralie. Et d’abord, avant toute explication, écoutez-moi. Ce sera bref.
Ils étaient assis devant le feu clair dont les flammes brillaient joyeusement. Patrice Belval glissa un coussin sous les pieds de maman Coralie, éteignit une ampoule électrique qui semblait la gêner, puis, certain que maman Coralie était bien à son aise, il commença tout de suite :
– Il y a, comme vous le savez, maman Coralie, huit jours que je suis sorti de l’ambulance, et que j’habite boulevard Maillot, à Neuilly, l’annexe réservée aux convalescents de cette ambulance, annexe où je me fais panser chaque matin et où je couche chaque soir. Le reste du temps, je me promène, je flâne, je déjeune et je dîne de droite et de gauche, et je rends visite à d’anciens amis. Or, ce matin, j’attendais l’un d’eux dans une salle d’un grand café-restaurant du boulevard, lorsque je surpris la fin d’une conversation... Mais il faut vous dire que cette salle est divisée en deux par une cloison qui s’élève à hauteur d’homme, et contre laquelle s’adossent, d’un côté, les consommateurs du café et, de l’autre, les clients du restaurant. J’étais encore seul, côté restaurant, et les deux consommateurs qui me tournaient le dos et que je ne voyais pas, croyaient même probablement qu’il n’y avait personne, car ils parlaient d’une voix un peu trop forte, étant données les phrases que j’ai surprises... et que, par suite, j’ai notées sur ce calepin.
Il tira le calepin de sa poche et reprit :
– Ces phrases, qui se sont imposées à mon attention pour des raisons que vous comprendrez, furent précédées de quelques autres où il était question d’étincelles, d’une pluie d’étincelles qui avait eu lieu déjà deux fois avant la guerre, une sorte de signal nocturne dont on se promettait d’épier le retour possible afin d’agir en hâte dès qu’il se produirait. Tout cela ne vous indique rien ?
– Non... Pourquoi ?
– Vous allez voir. Ah ! J’oubliais encore de vous dire que les deux interlocuteurs s’exprimaient en anglais, et d’une façon correcte, mais avec des intonations qui me permettent d’affirmer que ni l’un ni l’autre n’étaient Anglais. Leurs paroles, les voici fidèlement traduites :
« – Donc, pour conclure, fit l’un d’eux, tout est bien réglé. Vous serez, vous et lui, ce soir, un peu avant sept heures, à l’endroit désigné.
« – Nous y serons, colonel. Notre automobile est retenue.
« – Bien. Rappelez-vous que la petite sort de son ambulance à sept heures.
« – Soyez sans crainte. Aucune erreur n’est possible, puisqu’elle suit toujours le même chemin, en passant par la rue Pierre-Charron.
« – Et tout votre plan est arrêté ?
« – Point par point. La chose aura lieu sur la place où aboutit la rue de Chaillot. En admettant même qu’il y ait quelques personnes, on n’aura pas le temps de secourir la dame, tellement nous agirons avec rapidité.
« – Vous êtes sûr de votre chauffeur ?
« – Je suis sûr que nous le payons de manière qu’il nous obéisse. Cela suffit.
« – Parfait. Moi, je vous attends où vous savez, dans une automobile. Vous me passerez la petite. Dès lors, nous sommes maîtres de la situation.
« – Et vous de la petite, colonel, ce qui n’est pas désagréable, car elle est diablement jolie.
« – Diablement. Il y a longtemps que je la connais de vue, mais je n’ai jamais pu réussir à me faire présenter... Aussi je compte bien profiter de l’occasion pour mener les choses tambour battant.
« Le colonel ajouta :
« – Il y aura peut-être des pleurs, des cris, des grincements de dents. Tant mieux ! J’adore qu’on me résiste... quand je suis le plus fort.
« Il se mit à rire grossièrement. L’autre en fit autant. Comme ils payaient leurs consommations, je me levai aussitôt et me dirigeai vers la porte du boulevard, mais un seul des deux sortit par cette porte, un homme à grosse moustache tombante, et qui portait un feutre gris. L’autre s’en était allé par la porte d’une rue perpendiculaire. À ce moment, il n’y avait sur la chaussée qu’un taxi. L’homme le prit et je dus renoncer à le suivre. Seulement... seulement... comme je savais que, chaque soir, vous quittiez l’ambulance à sept heures et que vous suiviez la rue Pierre-Charron, alors, n’est-ce pas ? j’étais fondé à croire... »
Le capitaine se tut. La jeune femme réfléchissait d’un air soucieux. Au bout d’un instant, elle prononça :
– Pourquoi ne m’avez-vous pas avertie ?
Il s’écria :
– Vous avertir ! Et si, après tout, il ne s’était pas agi de vous ? Pourquoi vous inquiéter ? Et si, au contraire, il s’agissait de vous, pourquoi vous mettre en garde ? Le coup manqué, vos ennemis vous auraient tendu un autre piège, et, l’ignorant, nous n’aurions pas pu le prévenir. Non, le mieux était d’engager la lutte. J’ai enrôlé la petite bande de vos anciens malades, en traitement à l’annexe, et comme justement l’ami que j’attendais habite sur cette place, ici même, à tout hasard je l’ai prié de mettre son appartement à ma disposition, de six heures à neuf heures. Voilà ce que j’ai fait, maman Coralie. Et maintenant que vous en savez autant que moi, qu’en pensez-vous ?
Elle lui tendit la main.
– Je pense que vous m’avez sauvée d’un péril que j’ignore, mais qui semble redoutable, et je vous en remercie.
– Ah ! non, dit-il, je n’accepte pas le remerciement. C’est une telle joie pour moi d’avoir réussi ! Non, ce que je vous demande, c’est votre opinion sur l’affaire elle-même.
Elle n’hésita pas une seconde et répondit nettement :
– Je n’en ai pas. Aucun mot, aucun incident, parmi tout ce que vous me racontez, n’éveille en moi la moindre idée qui puisse nous renseigner.
– Vous ne vous connaissez pas d’ennemis ?
– Personnellement, non.
– Et cet homme à qui vos deux agresseurs devaient vous livrer, et qui prétend que vous lui êtes connue ?
Elle rougit un peu et déclara :
– Toute femme, n’est-ce pas ? a rencontré dans sa vie des hommes qui la poursuivent plus ou moins ouvertement. Je ne saurais dire de qui il s’agit.
Le capitaine garda le silence assez longtemps, puis repartit :
– En fin de compte, nous ne pouvons espérer quelque éclaircissement que par l’interrogatoire de notre prisonnier. S’il se refuse à nous répondre, tant pis pour lui... je le confie à la police, qui, elle, saura débrouiller l’affaire.
La jeune femme tressaillit.
– La police ?
– Évidemment. Que voulez-vous que je fasse de cet individu ? Il ne m’appartient pas. Il appartient à la police.
– Mais non ! mais non ! s’écria-t-elle vivement. À aucun prix ! Comment ! on entrerait dans ma vie !... Il y aurait des enquêtes !... mon nom serait mêlé à toutes ces histoires !...
– Pourtant, maman Coralie, je ne puis pas...
– Ah ! je vous en prie, je vous en supplie, mon ami, trouvez un moyen, mais qu’on ne parle pas de moi ! Je ne veux pas que l’on parle de moi !
Le capitaine l’observa, assez étonné de la voir dans une telle agitation, et il dit :
– On ne parlera pas de vous, maman Coralie, je m’y engage.
– Et alors, qu’allez-vous faire de cet homme ?
– Mon Dieu, dit-il en riant, je vais d’abord lui demander respectueusement s’il daigne répondre à mes questions, puis le remercier des attentions qu’il a eues pour vous, et, enfin, le prier de se retirer.
Il se leva.
– Vous désirez le voir, maman Coralie ?
– Non, dit-elle. Je suis si lasse ! Si vous n’avez pas besoin de moi, interrogez-le seul à seul. Vous me raconterez ensuite...
Elle semblait épuisée, en effet, par cette émotion et cette fatigue nouvelles, ajoutées à toutes celles qui déjà rendaient si pénible sa vie d’infirmière. Le capitaine n’insista pas et sortit en ramenant sur lui la porte du salon.
Elle l’entendit qui disait :
– Eh bien, Ya-Bon, tu as fait bonne garde ? Rien de nouveau ? Et ton prisonnier ? Ah ! vous voilà, camarade ? Commencez-vous à respirer ? Ah ! c’est que la main de Ya-Bon est un peu dure... Hein ? Quoi ? vous ne répondez pas... Ah ! ça ! mais, qu’est-ce qu’il a ? Il ne bouge pas... Crebleu, mais on dirait...
Il laissa échapper un cri. La jeune femme courut jusqu’au vestibule. Elle rencontra le capitaine qui essaya de lui barrer le passage, et qui, très vivement, lui dit :
– Ne venez pas. À quoi bon ?
– Mais vous êtes blessé ! s’exclama-t-elle.
– Moi ?
– Vous avez du sang, là, sur votre manchette.
– En effet, mais ce n’est rien, c’est le sang de cet homme qui m’a taché.
– Il a donc reçu une blessure ?
– Oui, ou du moins il saignait par la bouche. Quelque rupture de vaisseau...
– Comment ! Mais Ya-Bon n’avait pas serré à ce point...
– Ce n’est pas Ya-Bon.
– Qui, alors ?
– Les complices.
– Ils sont donc revenus ?
– Oui, et ils l’ont étranglé.
– Ils l’ont étranglé ! Mais non, voyons, ce n’est pas croyable.
Elle réussit à passer et s’approcha du prisonnier. Il ne bougeait plus. Son visage avait la pâleur de la mort. Une fine cordelette de soie rouge, tressée fin, munie d’une boucle à chaque extrémité, lui entourait le cou.
2
La main droite et la jambe gauche
– Un coquin de moins, maman Coralie, s’écria Patrice Belval, après avoir ramené la jeune femme dans le salon et fait une enquête rapide avec Ya-Bon. Rappelez-vous son nom, que j’ai trouvé gravé sur sa montre : « Mustapha Rovalaïoff », le nom d’un coquin.
Il prononça ces mots d’un ton allègre, où il n’y avait plus trace d’émotion, et il reprit, tout en allant et venant à travers la pièce :
– Nous qui avons assisté à tant de catastrophes et vu mourir tant de braves gens, maman Coralie, ne pleurons pas la mort de Mustapha Rovalaïoff, assassiné par ses complices. Pas même d’oraison funèbre, n’est-ce pas ? Ya-Bon l’a pris sous son bras, et profitant d’un moment où il n’y avait personne sur la place, il l’a emporté vers la rue Brignoles, avec ordre de jeter le personnage par-dessus la grille, dans le jardin du musée Galliera. La grille est haute. Mais la main droite de Ya-Bon ne connaît pas d’obstacles. Ainsi donc, maman Coralie, l’affaire est enterrée. On ne parlera pas de vous, et, pour cette fois, je réclame un remerciement.
Il se mit à rire.
– Un remerciement, mais pas de compliment. Saperlotte, quel mauvais gardien de prison je fais ! Et avec quelle dextérité les autres m’ont soufflé mon captif ! Comment n’ai-je pas prévu que le second de vos agresseurs, l’homme au feutre gris, irait avertir le troisième complice qui attendait dans son auto, et que tous deux ensemble viendraient au secours de leur compagnon ? Et voilà qu’ils sont venus. Et, tandis que vous et moi nous bavardions, ils ont forcé l’entrée de service, ont passé par la cuisine, sont arrivés devant la petite porte qui sépare l’office du vestibule et ont entrebâillé cette porte. Là, tout près d’eux, sur son canapé, le personnage est toujours évanoui, et solidement attaché. Comment faire ? Impossible de le tirer hors du vestibule sans donner l’éveil à Ya-Bon. Et pourtant, si on ne le délivre pas, il parlera, il vendra ses complices, il empêchera d’aboutir un plan soigneusement préparé. Alors ? Alors un des compagnons se penche furtivement, avance le bras, entoure de sa cordelette cette gorge que Ya-Bon a déjà rudement endommagée, ramène les boucles des deux extrémités, et serre, serre lentement, serre tranquillement, jusqu’à ce que mort s’ensuive. Aucun bruit. Pas un soupir. Tout cela s’opère dans le silence. On est venu, on tue, et l’on s’en va. Bonsoir. Le tour est joué, le camarade ne parlera pas.
La gaieté du capitaine redoubla.
– Le camarade ne parlera pas, reprit-il, et la justice, qui retrouvera son cadavre demain matin dans un jardin clôturé, ne comprendra rien à l’affaire. Et nous non plus, maman Coralie, et nous ne saurons jamais pourquoi ces gens-là voulaient vous enlever. Vrai ! si je ne vaux pas grand-chose comme gardien de prison, comme policier je suis au-dessous de tout.
Il continuait de se promener d’un bout à l’autre de la pièce. L’amputation de sa jambe, ou plutôt de son mollet, ne paraissait guère le gêner, et provoquait tout au plus à chaque pas, les articulations de la cuisse et du genou ayant gardé leur souplesse, un certain désaccord des hanches et des épaules. D’ailleurs sa haute taille corrigeait plutôt ce défaut d’harmonie, que la désinvolture de ses gestes et l’insouciance avec laquelle il avait l’air de l’accepter, réduisaient en apparence à d’insignifiantes proportions.
La figure était ouverte, assez forte en couleur, brûlée par le soleil et durcie par les intempéries, d’expression franche, enjouée, souvent gouailleuse. Le capitaine Belval devait avoir vingt-huit à trente ans. Il rappelait un peu par son allure ces officiers du Premier Empire auxquels la vie des camps donnait un air spécial, qu’ils gardaient par la suite dans les salons et près des femmes.
Il s’arrêta pour contempler Coralie dont le joli profil se détachait sur les lueurs de la cheminée, puis il revint s’asseoir à ses côtés, et il lui dit doucement :
– Je ne sais rien de vous. À l’ambulance les infirmières et les docteurs vous appellent Mme Coralie. Vos blessés prononcent maman. Quel est votre nom de femme ou de jeune fille ? Êtes-vous mariée ou veuve ? Où habitez-vous ? On l’ignore. Chaque jour, aux mêmes heures, vous arrivez et vous vous en allez par la même rue. Quelquefois, un vieux serviteur à longs cheveux gris et à barbe embroussaillée, un cache-nez autour du cou, des lunettes jaunes sur les yeux, vous accompagne ou vient vous chercher. Quelquefois aussi, il vous attend, assis sur la même chaise, dans la cour vitrée. On l’a interrogé, mais il ne répond à personne.
« Je ne sais donc rien de vous, qu’une chose, c’est que vous êtes adorablement bonne et charitable, et que vous êtes aussi, je puis le dire, n’est-ce pas ? adorablement belle. Et c’est peut-être, maman Coralie, parce que toute votre existence m’est inconnue que je me l’imagine si mystérieuse, et, en quelque sorte, si douloureuse, oui, si douloureuse ! Vous donnez l’impression de vivre dans la peine et dans l’inquiétude. On vous sent toute seule. Personne ne se dévoue à votre bonheur et à votre sécurité. Alors j’ai pensé... il y a longtemps que je pense à cela et que j’attends l’occasion de vous l’avouer... j’ai pensé que vous aviez sans doute besoin d’un ami, d’un frère qui vous guide et qui vous défende. Me suis-je trompé, maman Coralie ? »
À mesure qu’il parlait, on eût dit que la jeune femme se resserrait en elle-même et qu’elle mettait un peu plus de distance entre elle et lui, comme si elle n’eût pas voulu qu’il pénétrât dans ces régions secrètes qu’il dénonçait. Elle murmura :
– Si, vous vous êtes trompé. Ma vie est toute simple, je n’ai pas besoin d’être défendue.
– Vous n’avez pas besoin d’être défendue ! s’écria-t-il avec une animation croissante. Et alors ces hommes qui ont essayé de vous enlever ? Ce complot ourdi contre vous ? Ce complot dont vos agresseurs redoutent tellement la découverte qu’ils vont jusqu’à supprimer celui d’entre eux qui s’est laissé prendre ? Alors, quoi, ce n’est rien tout cela ? Je me trompe en affirmant que vous êtes environnée de périls ? que vous avez des ennemis d’une audace extraordinaire ? qu’il faut vous défendre contre leurs entreprises ? et que, si vous n’acceptez pas l’offre de mon assistance... eh bien... eh bien...
Elle s’obstinait dans le silence, de plus en plus lointaine, presque hostile.
L’officier frappa du poing le marbre de la cheminée et, se penchant sur la jeune femme :
– Eh bien, dit-il, achevant sa phrase d’un ton résolu, eh bien, si vous n’acceptez pas l’offre de mon assistance, moi, je vous l’impose.
Elle secoua la tête.
– Je vous l’impose, répéta-t-il fermement. C’est mon devoir et c’est mon droit.
– Non, fit-elle à demi-voix.
– Mon droit absolu, reprit le capitaine Belval, et cela pour une raison qui prime toutes les autres et qui me dispense même de vous consulter, maman Coralie.
– Laquelle ? dit la jeune femme en le regardant.
– C’est que je vous aime.
Il lui jeta ces mots nettement, non pas comme un amoureux qui risque un aveu timide, mais comme un homme fier du sentiment qu’il éprouve et heureux de le déclarer.
Elle baissa les yeux en rougissant, et il s’écria, d’une voix joyeuse :
– Je ne vous l’envoie pas dire, hein, maman ? Pas de tirades enflammées, pas de soupirs, ni de grands gestes, ni de mains jointes. Non, trois petits mots seulement que je vous adresse sans me mettre à genoux. Et cela m’est d’autant plus facile que vous le saviez. Mais oui, maman Coralie, vous avez beau prendre vos airs farouches, vous savez bien que je vous aime, et vous le savez depuis aussi longtemps que moi. Nous l’avons vu naître ensemble, ce sentiment-là, lorsque vos petites mains adorées touchaient ma tête sanglante. Les autres me torturaient. Vous, c’étaient autant de caresses. Autant de caresses aussi, vos regards de compassion. Autant de caresses, vos larmes qui tombaient parce que je souffrais. Mais, d’abord, est-ce qu’on peut vous voir sans vous aimer ? Vos sept malades de tout à l’heure sont amoureux de vous, maman Coralie. Ya-Bon vous adore. Seulement ce sont de simples soldats. Ils se taisent. Moi, je suis capitaine. Et je parle sans embarras, la tête haute, croyez-le bien.
La jeune femme avait posé ses mains sur ses joues brûlantes, et le buste incliné, elle se taisait. Il reprit, d’une voix qui sonnait clairement :
– Vous comprenez ce que je veux vous dire en déclarant que je parle sans embarras et la tête haute ? Oui, n’est-ce pas ? Si j’avais été, avant la guerre, tel que je suis aujourd’hui, mutilé, je n’aurais pas eu cette assurance, et c’est humblement, en vous demandant pardon de mon audace, que je vous aurais avoué mon amour. Mais maintenant... Ah ! croyez bien, maman Coralie, que là, en face de vous, qui êtes une femme et que j’aime passionnément, je n’y pense même pas, à mon infirmité. Pas un instant, je n’ai l’impression que je puis vous paraître ridicule ou présomptueux.
Il s’arrêta, comme pour reprendre haleine, puis, se levant, il repartit :
– Et il faut qu’il en soit ainsi. Il faut que l’on sache bien que les mutilés de cette guerre ne se considèrent pas comme des parias, des malchanceux et des disgraciés, mais comme des hommes absolument normaux. Et oui, normaux ! Une jambe de moins ? Et après ? Est-ce que cela fait qu’on n’ait point de cerveau ni de cœur ? Alors, parce que la guerre m’aura pris une jambe ou un bras, même les deux jambes ou les deux bras, je n’aurai pas le droit d’aimer, sous peine de risquer une rebuffade ou de deviner qu’on a pitié de moi ? De la pitié ? Mais nous ne voulons pas qu’on nous plaigne, ni qu’on fasse un effort pour nous aimer, ni même qu’on se croie charitable parce qu’on nous traite gentiment. Ce que nous exigeons, devant la femme comme devant la société, devant le passant qui nous croise comme devant le monde dont nous faisons partie, c’est l’égalité totale entre nous et ceux que leur bonne étoile ou que leur lâcheté auront garantis.
Le capitaine frappa de nouveau la cheminée.
– Oui, l’égalité totale. Nous tous, boiteux, manchots, borgnes, aveugles, estropiés, difformes, nous prétendons valoir, physiquement et moralement, autant, et peut-être plus que le premier venu. Comment ! ceux qui se sont servis de leurs deux jambes pour courir plus vite à l’attaque, une fois amputés, seraient distancés dans la vie par ceux qui se sont chauffés les deux pattes sur les chenets d’un bureau ? Allons donc ! Place pour nous comme pour les autres ! Et croyez que cette place, qui nous est due, nous saurons bien la prendre, et nous saurons bien la tenir. Il n’y a pas de bonheur auquel nous n’ayons le droit d’atteindre et pas de besogne dont nous ne soyons capables, avec un peu d’exercice et d’entraînement. La main droite de Ya-Bon vaut déjà toutes les paires de mains de l’univers, et la jambe gauche du capitaine Belval lui permet d’abattre ses deux lieues à l’heure, s’il le veut.
Il se mit à rire, tout en poursuivant :
– La main droite et la jambe gauche... la main gauche et la jambe droite... Qu’importe ce qui nous reste si nous savons nous en servir ? En quoi avons-nous déchu ? Qu’il s’agisse d’obtenir un poste, ou qu’il s’agisse de perpétuer la race, ne sommes-nous pas ce que nous étions auparavant ? Et, mieux encore peut-être. Je crois pouvoir dire que les enfants que nous donnerons à la patrie seront tous aussi bien bâtis, qu’ils auront bras et jambes, et le reste... sans compter un fameux héritage de cœur et d’entrain. Voilà nos prétentions, maman Coralie. Nous n’admettons pas que nos pilons de bois nous empêchent d’aller de l’avant et que, dans la vie, nous ne soyons pas d’aplomb sur nos béquilles, comme sur des jambes en chair et en os. Nous n’estimons pas que ce soit un sacrifice que de se dévouer à nous, et qu’il soit nécessaire de crier à l’héroïsme parce que telle jeune fille a l’honneur d’épouser un soldat aveugle !
« Encore une fois, nous ne sommes pas des êtres à part ! Aucune déchéance, je le répète, ne nous a frappés, et c’est là une vérité à laquelle tout le monde se pliera, durant deux ou trois générations. Vous comprenez que, dans un pays comme la France, lorsque l’on rencontrera des mutilés par centaines de mille, la conception de ce qu’est un homme complet ne sera plus aussi rigide, et que, en fin de compte, il y aura, dans cette humanité nouvelle qui se prépare, des hommes avec deux bras et des hommes avec un seul bras, comme il y a des hommes bruns et des hommes blonds, des gens qui portent la barbe et d’autres qui n’en portent pas. Et tout cela semblera très naturel. Et chacun vivra la vie qu’il lui plaira, sans avoir besoin d’être intact. Et comme ma vie est en vous, maman Coralie, et que mon bonheur dépend de vous, je n’ai pas attendu plus longtemps pour vous placer mon petit discours. Ouf ! c’est fini. J’aurais encore bien des choses à dire là-dessus, mais, n’est-ce pas, ce n’est pas en un jour... »
Il s’interrompit, intimidé malgré tout par le silence de la jeune femme.
Elle n’avait pas bougé depuis les premières paroles d’amour qu’il avait prononcées. Ses mains avaient glissé sur sa figure jusqu’à son front. Un léger frémissement secouait ses épaules. Il se courba, et, avec une douceur infinie, écartant les doigts fragiles, il découvrit le joli visage.
– Pourquoi pleures-tu, maman Coralie ?
Le tutoiement ne la troubla point. Entre l’homme et la femme qui s’est penchée sur ses plaies, il s’établit des relations d’une nature spéciale, et en particulier, le capitaine Belval avait de ces façons un peu familières, mais respectueuses, dont on ne pouvait s’offusquer. Il lui demanda :
– Est-ce moi qui les fais couler, ces larmes ?
– Non, dit-elle à voix basse, c’est votre gaieté, votre manière, non pas même de vous soumettre au destin, mais de le dominer de toute votre hauteur. Le plus humble d’entre vous s’élève sans effort au-dessus de sa nature, et je ne sais rien de plus beau et de plus émouvant que cette insouciance.
Il se rassit auprès d’elle.
– Alors vous ne m’en voulez pas de vous avoir dit... ce que je vous ai dit ?
– Vous en vouloir ? répliqua-t-elle, affectant de se tromper sur le sens de la question. Mais toutes les femmes sont d’accord avec vous ! Si la tendresse doit faire un choix entre ceux qui reviendront de la guerre, ce sera, j’en suis certaine, en faveur de ceux qui ont souffert le plus cruellement.
Il hocha la tête.
– C’est que moi, je demande autre chose que de la tendresse, et une réponse plus précise à certaines de mes paroles. Dois-je vous les rappeler ?
– Non.
– Alors la réponse...
– La réponse, mon ami, c’est que vous ne les direz plus, ces paroles.
Il prit un air solennel.
– Vous me le défendez ?
– Je vous le défends !
– En ce cas, je vous jure de me taire jusqu’à la prochaine fois où je vous verrai...
Elle murmura :
– Vous ne me verrez plus.
Cette affirmation divertit fort le capitaine Belval.
– Oh ! oh ! pourquoi ne vous verrai-je plus, maman Coralie ?
– Parce que je ne le veux pas.
– Et la raison de cette volonté ?
– La raison ?...
Elle tourna les yeux vers lui, et, lentement, prononça :
– Je suis mariée.
Cette déclaration ne parut pas déconcerter le capitaine, qui affirma le plus tranquillement du monde :
– Eh bien, vous vous marierez une seconde fois. Il est hors de doute que votre mari est vieux et que vous ne l’aimez pas. Il comprendra donc fort bien qu’étant aimée...
– Ne plaisantez pas, mon ami...
Il saisit vivement la main de la jeune femme, à l’instant où elle se levait, prête à partir.
– Vous avez raison, maman Coralie, et je m’excuse même de n’avoir pas pris un ton plus sérieux pour vous dire des choses très graves. Il s’agit de ma vie, et il s’agit de votre vie. J’ai la conviction profonde qu’elles vont l’une vers l’autre, sans que votre volonté puisse y mettre obstacle, et c’est pourquoi votre réponse est inutile. Je ne vous demande rien. J’attends tout du destin. C’est lui qui nous réunira.
– Non, dit-elle.
– Si, affirma-t-il, les choses se passeront ainsi.
– Les choses ne se passeront pas ainsi. Elles ne doivent pas se passer ainsi. Vous allez me promettre sur l’honneur de ne plus chercher à me voir ni même à connaître mon nom. J’aurais pu accorder davantage à votre amitié. L’aveu que vous m’avez fait nous éloigne l’un de l’autre. Je ne veux personne dans ma vie... personne.
Elle mit une certaine véhémence dans sa déclaration et, en même temps, elle essayait de dégager son bras de l’étreinte qui la serrait.
Patrice Belval s’y opposa en disant :
– Vous avez tort... Vous n’avez pas le droit de vous exposer ainsi... je vous en prie, réfléchissez...
Elle le repoussa. Et c’est alors qu’il se produisit par hasard un étrange incident. Dans le mouvement qu’elle fit, un petit sac qu’elle avait placé sur la cheminée fut heurté et tomba sur le tapis. Mal fermé, il s’ouvrit. Deux ou trois objets en sortirent, qu’elle ramassa, tandis que Patrice Belval se baissait rapidement.
– Tenez, dit-il, il y a encore ceci.
C’était un étui, un petit étui en paille tressée que le choc avait ouvert également et d’où s’échappaient les grains d’un chapelet.
Debout, ils se turent tous deux. Le capitaine examinait le chapelet. Et il murmura :
– Curieuse coïncidence... ces grains d’améthyste... cette monture ancienne en filigrane d’or... C’est étrange de retrouver le même travail et la même matière...
Il tressaillit, et si nettement que la jeune femme interrogea :
– Qu’y a-t-il donc ?
Il tenait entre ses doigts un des grains, plus gros que les autres et auquel se réunissaient, d’une part, le collier des dizaines et, de l’autre, la courte chaîne des prières. Or, ce grain-là était cassé par le milieu, presque au ras des griffes d’or qui l’enchâssaient.
– Il y a, dit-il, il y a que la coïncidence est si inconcevable que j’ose à peine... Cependant, je pourrais vérifier le fait sur-le-champ... Mais auparavant un mot : qui vous a donné ce chapelet ?...
– Personne ne me l’a donné, dit-elle. Je l’ai toujours eu.
– Pourtant, il appartenait à quelqu’un, avant de vous appartenir ?
– À ma mère, sans doute.
– Ah ! il vous vient de votre mère ?
– Oui, je suppose qu’il me vient d’elle, au même titre que les différents bijoux qu’elle m’a laissés.
– Vous avez perdu votre mère ?
– Oui. J’avais quatre ans à sa mort. À peine ai-je gardé d’elle un souvenir très confus. Mais pourquoi me demandez-vous cela, à propos d’un chapelet ?
– C’est à propos de ceci, dit-il, à propos de ce grain d’améthyste qui est cassé en deux...
Il ouvrit son dolman et tira sa montre de la poche de son gilet. Plusieurs breloques étaient attachées à cette montre par une petite châtelaine de cuir et d’argent.
Une de ces breloques était constituée par la moitié d’une boule d’améthyste également cassée vers sa face extérieure, également enchâssée dans des griffes de filigrane. La grosseur des deux boules semblait identique. Les améthystes étaient de même couleur, montées sur le même filigrane.
Ils se regardèrent anxieusement. La jeune femme balbutia :
– Il n’y a là qu’un hasard, pas autre chose qu’un hasard...
– Certes, dit-il, mais admettons que ces deux moitiés de boule s’adaptent exactement l’une à l’autre...
– Ce n’est pas possible, dit-elle, effrayée elle aussi à l’idée du petit geste si simple qu’il fallait faire pour avoir l’indiscutable preuve.
Ce geste, pourtant, l’officier s’y décida. Sa main droite qui tenait le grain de chapelet et sa main gauche qui tenait la breloque se rapprochèrent. La rencontre eut lieu. Les mains hésitèrent et tâtonnèrent, puis ne bougèrent plus. Le contact s’était produit.
Les inégalités de la cassure correspondaient strictement les unes aux autres. Les reliefs trouvaient des vides équivalents. Les deux moitiés d’améthyste étaient les deux moitiés de la même améthyste. Réunies, elles formaient une seule et même boule.
Il y eut un long silence chargé d’émotion et de mystère. Le capitaine Belval dit à voix basse :
– Moi non plus, je ne sais pas au juste la provenance de cette breloque. Dès mon enfance, je l’ai vue, mêlée à des objets sans grande valeur que je gardais dans un carton, des clefs de montre, des vieilles bagues, des cachets anciens, parmi lesquels j’ai choisi ces breloques, il y a deux ou trois ans. D’où vient celle-ci ? Je l’ignore. Mais ce que je sais...
Il avait séparé les deux fragments et, les examinant avec attention, il concluait :