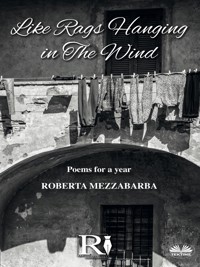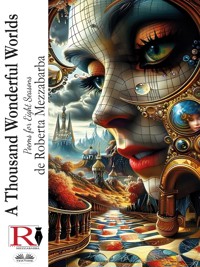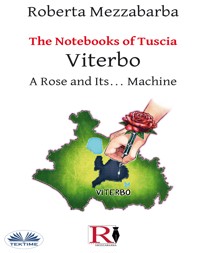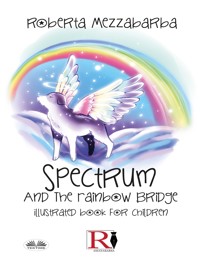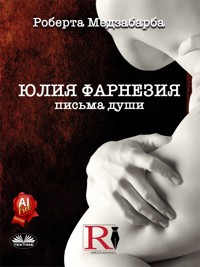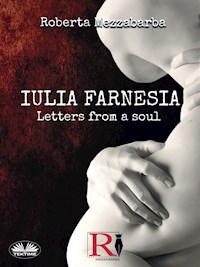4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tektime
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un jour tu seras heureuse, mais avant la vie t'apprendra à être forte
Un roman intense, chargé d'émotions fortes, au rythme cadencé. Une histoire de violence domestique, d'abus psychologiques qui vous serreront l'estomac. Misia, une jeune femme, et sa vie monochrome qui, petit à petit, se teint de plus en plus de noir, un noir qui sent la tristesse, la peur, le deuil. Et dans une escalade de violence, lorsque la situation semblera devenir irréparable, impossible à supporter, la solution semblera n'être qu'une seule... Mais la vie arrive parfois à surprendre, et bien que cela ne représente pas une juste récompense pour les maux subis, peut-être, avec le temps, cela atténuera les souvenirs, adoucira les angles vifs et ouvrira une lueur d'espoir. Chacune de nous mérite une vie en couleurs, mérite de devenir enfin l'artisan de son propre destin, sans plus succomber, pour être enfin libre d'aimer, de s'aimer.
PUBLISHER: TEKTIME
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titre | Les confessions d'une concubine
Auteur | Roberta Mezzabarba
© 2025 - Tous droits réservés à l'Auteur
L'Auteur détient tous les droits sur cette œuvre de manière exclusive.
Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable de l'Auteur.
Sur la couverture : Suspended © Francesca Cragnolini
Première édition Août 2020
Deuxième édition Septembre 2021
Roberta Mezzabarba
LES CONFESSIONS D'UNE CONCUBINE
Roman
Traduit par Elisabeth Grelaud
Je souhaite à la petite fille que j'étais
de faire la paix avec son passé.
Je souhaite à mes blessures de se cicatriser
et à mes rêves de continuer à voler haut.
Je souhaite à la femme que je suis devenue
de ne pas se rendre
et de continuer à croire en l'amour,
de se relever après chaque chute
et cesser d’avoir peur de ne pas être à la hauteur.
CHIARA TRABALZA
PREMIÈRE PARTIE
Il existe une peur subtile de la liberté,
pour laquelle tout le monde veut être esclave.
Tout le monde, bien sûr, parle de liberté,
mais personne n'a le courage d'être vraiment libre,
car quand tu es vraiment libre, tu es seul.
Et c’est seulement si tu as le courage d'être seul que tu peux être libre.
OSHO
1.
Les confessions d’une concubine
Les confessions d'une concubine.
Je ne suis rien d'autre.
Rien d'autre que la concubine de mes douleurs, de mes insatisfactions, de mes frustrations, des besoins systématiquement ignorés, négligés, piétinés, méprisés, finis sur le bûcher.
C'est moi, moquée, dépouillée de toute dignité, agenouillée sur l'autel de la volonté des autres.
Contrainte.
Forcée de rentrer dans des espaces étroits qui ne correspondent pas à mon désir de liberté.
À la fin de chaque journée, il ne reste qu'une sensation pénétrante de vide à l'intérieur, comme si l'on m'avait volé les entrailles.
Et espérer d’avoir encore l'envie de fuir et de ne plus rien entendre, d'oublier ce tourment qui ne m'abandonne jamais.
La nuit, je rêve les yeux ouverts d'être capable de me libérer des liens que j'ai laissés se nouer autour de moi, et de réussir à m'en passer. De réussir à me passer de ce peu que, en mendiante, j'arrive honteusement à obtenir.
Ma vie est un chemin à sens unique, la dichotomie entre donner et recevoir, entre le désir poignant de vivre et l’existence qui se consume instant après instant, dans la vaine tentative de récupérer ma vie, telle que je la désirais.
Et aucune réponse du vide plein de gens qui m’entoure.
Comme ça, j’ai appris à me réfugier dans l’univers solitaire de journées ternes.
Chaque fois, je le comprenais trop tard, et, piégée, je prenais conscience du rôle que je devais jouer à ce moment de ma vie, dans cette situation, tandis que la nuit, les pensées se mêlaient aux rêves et les rêves aux souvenirs.
Avec le temps, j’ai appris à suspendre à un cintre dans le placard le «moi» que j’aurais voulu être et ma vie continuait inexorablement, dans la tentative jamais réalisée d’échapper à l’inaptitude à laquelle personne n’avait jamais remédié.
2.
Souvenirs
Quand j'étais enfant, j'avais toujours une peur presque révérencieuse du jugement de ma famille, de mes parents.
Je continuais ma vie à pas incertains, avec un œil toujours fixé sur les réactions que mes actions provoquaient.
Jamais il n'a été nécessaire qu'ils me disent ce qu'ils auraient voulu que je fasse, quel choix faire, quelle décision prendre.
Un regard.
C'était suffisant pour exécuter, inconsciemment, toutes leurs volontés.
Peut-être que j'aurais pu faire des choix différents, mais cette sensation n'est jamais sortie de l'antichambre de mes pensées, donc elle n'existait pas dans ma tête.
Je voulais juste plaire, obéir, car c'est tout ce que je savais faire.
Sans m'en rendre compte, pendant ces jours-là, la petite concubine a pris forme et a commencé à faire ses premiers pas.
Je me souviens que j'adorais follement les cours de musique que je prenais avec un vieux chef d'orchestre qui, après sa retraite, s'était installé près de chez mes parents.
J'attendais avec impatience le jeudi après-midi, le jour où je me rendais chez lui : il m'accueillait dans le salon et me donnait des cours de musique en me faisant utiliser son piano.
Un jour, en revenant de l'école, alors que nous étions tous réunis autour de la table et que ma sœur Silvia faisait un vacarme infernal dans sa chaise haute avec des cuillères et des couvercles, ma mère me sourit et me dit : « Misia, ton père et moi nous avons décidé que tu ne prendras plus de leçons de musique, mais que la semaine prochaine tu commenceras les cours de gymnastique artistique à la salle de sport municipale. Ce n'est pas normal que toutes les camarades de ton âge suivent ces cours, tandis que toi, avec ta musique, tu t'isoles de plus en plus ! »
Ce fut un véritable coup de tonnerre. Rien ne m'avait laissé présager ce changement inattendu, mais bien que cela m'attristât, j'acceptai la décision de ma famille sans dire un mot.
Je n'étais pas douée pour l'activité physique, au point que l'enseignant me laissait toujours en dernier, et parfois même il ne me faisait pas faire les exercices qu'il faisait exécuter à toutes les autres.
Je n'ai jamais eu le sentiment d'être contrainte à me comporter d'une certaine manière, je crois avoir tout fait avec une extrême légèreté, guidée par la main fidèle de ceux qui m'avaient mise au monde.
S’il est juste de suivre les dictats sociaux et les comportements imposés par la famille dans laquelle on grandit, il est tout aussi juste de se poser des questions, de s'interroger avec tous les « si » et tous les « mais » qui bourdonnent dans notre tête.
Mais je n'en avais pas, tant était aveugle la confiance dans les mains qui me guidaient.
Une main sage qui exige sans demander, qui obtient sans interroger, qui s'approprie sans remercier.
Par exemple, cette fois-là, j'aurais pu dire à ma famille que je voulais continuer mes cours de musique, mais je n'avais pas l'habitude de penser de manière autonome.
Cela me semblait tellement normal, en y repensant, que si je devais prendre une décision en l'absence de mes proches à portée de vue, je mettais le monde en pause et je cherchais conseil.
Les conseils, la chose la plus stupide et arrogante qu'on puisse demander et prétendre donner.
Ma grand-mère disait : « Il y a une différence entre mourir et parler de la mort. »
Peut-être qu'elle seule n'a jamais eu la prétention de me manipuler, de me façonner à ses désirs, de me découper en morceaux pour ensuite garder ceux qu'elle appréciait et jeter ceux qu'elle n'aimait pas.
Peut-être que c'était seulement avec elle, sans m'en rendre compte, que le véritable « MOI » sortait et évoluait librement en dansant les yeux fermés.
Je me souviens que nous riions aux éclats pour les choses les plus stupides ou que nous nous émouvions en regardant, à la télévision, les films d'amour qu'elle aimait tant.
Elle me caressait les cheveux et me faisait me sentir unique au monde.
Unique... une sensation magnifique.
Mon adolescence est née et a éclos à l'ombre de règles sévères.
Je ne suis jamais sortie le soir, ni n'ai jamais demandé la permission de le faire.
Je me réfugiais dans la musique et la lecture, qui me permettaient d'échapper à ce que je ne voyais pas comme une prison, mais qui en fait en était une.
***
Je n'ai pas de souvenirs désagréables à effacer, juste une série de journées ternes, passées à rêver de vivre une vie de feuilleton télévisé.
J'étudiais par passion et aussi pour plaire à ma famille, qui semblait pourtant ne jamais être satisfaite, pensant peut-être qu'en agissant ainsi, elle me pousserait à faire mieux.
C’est comme ça que je me suis habituée à croire que je n'étais rien de spécial.
Je me regardais peu dans le miroir en pensant même que j'étais un peu moche, simplement parce qu'on m'avait appris dans la vie à ne pas avoir confiance en moi, dans mes capacités.
En repensant à mes journées, je me rends compte seulement maintenant que de moi, on attendait toujours le meilleur, mais que, une fois atteint, cela ne méritait pas d’être mentionné, ni même un compliment, pour ensuite déplacer l'objectif toujours un peu plus loin.
J'ai obtenu mon diplôme avec la mention la plus élevée, ce qui sembla une chose tout à fait normale.
Les professeurs me poussaient tous à continuer mes études, mais ma famille ne soutint pas cette initiative, au point que pour moi, il devint évident que je devais chercher un travail.
Ainsi, du futur radieux que j'imaginais chaque soir en lisant mes livres, je me suis retrouvée à accepter un poste de manutentionnaire dans un supermarché de ma ville, et à avoir un petit ami dont je ne savais même pas si je l'aimais ou non.
Filippo est entré dans ma vie à un moment où toutes les amies de mon âge étaient déjà en couple depuis longtemps, et ma mère me posait sans cesse des questions pour savoir pourquoi je n'avais toujours pas de petit ami.
Je ne l'avais pas choisi, en fait, je n’y avais même jamais pensé avant, et je n'avais pas de comparaison à faire.
Un jour, au jardin public, où nous nous réunissions les après-midis d'été, avec le chant monotone des cigales, Filippo m'a fait sa proposition, et j'ai accepté.
Je suis rentrée chez moi en courant, essoufflée, et j'ai traîné ma grand-mère dans sa petite chambre à coucher : je lui ai raconté ce qui m'était arrivé, ses joues douces rougirent et elle m'offrit un sourire plein de tendresse.
«Misia, fais attention, le monde n'est pas bon, mais tu es tellement gentille que tu mérites tout le bien de ce monde, et quels yeux brillants tu as ! »
Alors, je lui ai demandé : « Comment savoir qui est la bonne personne ? Et surtout, où la trouver et de quelle manière ? »
Alors, elle m'a patiemment raconté comment elle avait rencontré mon grand-père, ce grand-père dont je me souvenais à peine.
« Nous ne nous connaissions pas, et je dois dire, ma petite, que j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer. Mais j'ai aussi fait preuve de sagesse en baissant la tête quand la situation l'exigeait et en lui apprenant à faire de même. Il n'y a pas de personne idéale, Misia. Il faut que deux personnes deviennent celle idéale l'une pour l'autre et ensemble. »
Quelques jours plus tard, ma grand-mère eut un AVC qui lui vola l'usage de la parole, et une grande partie de son corps. Des amis de mon père la ramenèrent à la maison avec les genoux écorchés et des lunettes brisées. Elle avait eu un malaise et était tombée sur la place devant la paroisse.
Elle me regardait avec de grands yeux, comme si elle essayait de me dire quelque chose. Quand nous étions seules, je tendais la main à travers les barreaux de son lit et elle la serrait fort. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre ce que cela signifiait se sentir impuissant et seul.
J'avais mille questions dans la tête, mais je n'avais pas le courage de les poser à qui que ce soit, alors je n'ai jamais obtenu de réponses.
Ma grand-mère s'en alla un matin d'automne, en silence, et ses rires argentés ne résonnèrent plus dans les murs de la maison en laissant un vide insoutenable en moi
La vie m'avait arraché une partie importante, la seule personne qui n’ait jamais cru en moi, qui me voulait toute entière, telle que j'étais.
« Tu es imparfaite et magnifique », me disait ma grand-mère.
Depuis le jour où elle est morte, je me suis sentie uniquement imparfaite.
3.
Et me sentir transparente
Il y a des jours où je me sens belle, radieuse.
Je me regarde dans le miroir et je vois mon visage reflété, les yeux turquoise, les lèvres petites mais légèrement charnues, les taches de rousseur qui salissent à peine la peau autour du nez.
Je passe mes mains dans mes cheveux roux, soyeux en démêlant les pensées avec mes doigts.
Ce jour-là, voir que mon mari m'ignore me tue :il semble ne pas prêter attention à ce qui lui appartient par droit, par contrat, et un myope qui ne voit pas ce qui est à portée de main.
Je ne me suis jamais rendue belle pour les autres, mais être ignorée de cette manière, être transparente, insignifiante, encore moins qu'une mouche agaçante, c'est humiliant, et on ne s'y habitue jamais.
Je saisis avec colère la vielle barrette décolorée, pour toutes les fois où je l'ai utilisée, j’y emprisonne mes cheveux, et avec la morsure de ces dents en plastique, je blesse mon cœur, mon âme, ma fierté, mon amour-propre.
Et lui, il ne comprend même pas cette colère.
Il me regarde du coin de l’œil, comme s'il n'arrivait pas à saisir toute la situation, et comme toujours, je me noie dans cette incompréhension en étouffant les larmes qui voudraient se libérer, en avalant l'amertume et ce nœud dans la gorge qui refuse de descendre.
Demain tout changera, ou mieux encore, j'espère que demain je changerai.
***
«Cette nouvelle coupe de cheveux te va très bien, Misia!»
La voix de Pietro prononça ces mots, de l'huile bouillante pour mes oreilles.
Je sentis mes joues et mon cou s'enflammer, et instinctivement, je baissai les yeux en ne sachant pas exactement comment répondre.
Je n'étais pas habituée à recevoir des compliments, cela faisait tellement longtemps que... j'avais désiré entendre ces mots de la bouche de mon mari, dans trop de rêves j'avais espéré que cela se produise, et au lieu de cela, voilà qu'un homme qui ne m'appartenait pas me faisait frissonner la peau, il faisait se réaliser ce désir de plaire qui est caché au fond de chaque être humain.
Pietro était un collègue qui travaillait au service administratif du supermarché, toujours souriant, avec les cheveux bruns un peut longs, savamment ébouriffés.
À vrai dire, je ne lui avais jamais prêté attention jusqu'à ce que son regard se mette à accrocher le mien, de manière insistante. Il avait commencé à me saluer, et cherchait des occasions pour entamer une conversation avec moi. C'est alors qu’arrivèrent les premiers compliments, les premières marques d'intérêt discrètes.
Je l'écoutais, inconsciente, assoiffée, pathétiquement avide de reconnaissance.
Ce qui était étrange, car mon éducation m'a toujours empêchée desavourer la sensation, inconnue, d'être appréciée.
Dans ma famille, les compliments étaient rares, et en épousant Filippo, je n'avais pas changé la situation. Lui, c’était un homme tellement fermé que souvent j'avais l'impression qu'il ne me remarquait même pas.
Mais je l'avais épousé.
Et maintenant, il ne me restait plus qu’à accepter ce que j’avais devant moi, sans rêver à rien d’autre.
Écouter les paroles de Pietro était un jeu dangereux, j'en suis consciente, mais en écoutant ses mots, chaque ombre dans mon cœur disparaît immédiatement.
Mais cela ne dure pas : dès que l'écho de ces phrases s'éteint, dès que Pietro disparaît de ma vue, mon cœur se fige.
4.
La recherche d’une vie
Travail, maison, maison, travail.
Voici l'existence d'une trentenaire.
Ma vie.
Quand j'étais jeune, je ne pouvais jamais me permettre de grands divertissements, parce qu'il n'était pas bien de sortir seule, encore moins en compagnie de mon petit ami.
Maintenant, mon mari préfère somnoler dans le canapé du salon, plutôt que de vivre.
Bien sûr, ça n'a pas toujours été comme ça.
Nous voulions un enfant, Dieu seul sait combien je l'ai désiré.
Avant le mariage, il semblait presque que je fuyais l'idée d'un engagement aussi important, puis, au fil des mois, entre nous, un espace, un vide oserais-je dire, s'était formé, vide que je pensais pouvoir combler avec un enfant.
Filippo semblait ne pas avoir les mêmes besoins, son travail de gardien de sécurité lui suffisait.
Mon mari était une bonne personne, il ne me faisait manquer de rien, mais son manque de sensibilité et sa froideur me bouleversaient.
À la fin de chaque mois, le cycle menstruel arrivait inévitablement pour détruire mes rêves, alimentés pendant ces trois ou quatre jours de retard.
Deux, trois, quatre fois.
C'était trop.
Trop de rêves déçus.
Chacun de nous pensait que chez l'autre, probablement, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, un mécanisme qui ne fonctionnait pas bien, une étincelle qui ne s'allumait pas au bon moment.
Puis un jour, le retard arriva à dix jours : je n'en parlais pas, comme si cela pouvait rendre mon rêve indestructible, mais ce rêve n'était rien d'autre qu'une bulle de savon, belle, iridescente, transportée par les ailes du vent, mais destinée à disparaître dans un plouf.
Silencieusement, je laissais passer les minutes et les jours, et les semaines devinrent des mois.
Pendant près de deux mois, j'ai bercé avec mes pensées l'idée d'un enfant, un grain de vie qui pourrait donner un sens à la mienne et qui éclairerait l'obscurité de mon existence.
Pendant longtemps, après cette nuit-là, je n’ai plus eu de larmes à pleurer.
Je fus réveillée dans mon sommeil par des douleurs aiguës dans le bas-ventre, comme si mes entrailles allaient être déchirées.
En silence, en me traînant, je parvins à atteindre la salle de bain où, une fois la lumière allumée, une horrible découverte m’attendait.
La chemise de nuit était trempée de sang au niveau de l’aine.
Je me souviens seulement d’avoir poussé un cri.
Puis plus rien.
Et ensuite seulement le vague souvenir de mon mari essayant de me faire revenir à moi, me transportant dans la voiture, enveloppée dans une couverture, puis les médecins, les infirmières, pareilles à des abeilles affairées autour de moi, les lumières fortes au-dessus de la table d’examen, éclairant ma nudité.
Mon enfant.
Mon enfant.
Rendez-moi mon enfant.
Rendez-le-moi.
Où l’avez-vous mis ?
Où?
Où?
Où l’avez-vous caché?
Où l’avez-vous emporté?
Il était trop beau.
Je le sais, il était trop beau.
J’avais l’impression de devenir folle.
Rien n’avait plus de sens, plus rien ne me semblait suffisamment important pour vivre.
Filippo était presque toujours assis à côté de mon lit, mais il ne me regardait pas, il ne me parlait pas.
Dans ces jours de douleur, sa présence ne m’apportait aucun réconfort, un peu parce que je croyais qu’il était là seulement parce que la situation l’y obligeait, un peu parce que je me sentais forcée de supporter sa présence.
Il me semblait que les rares fois où il posait ses yeux noirs sur moi, il m’accusait, sans appel possible, de ne pas avoir su préserver la vie de notre fils.
Un matin, je me réveillai et Filippo était déjà là.
« Mais tu te rends compte que tu n’as même pas été capable de garder mon fils ? Mais quelle femme es-tu, quelle minable es-tu, si tu n’arrives même pas à mettre un enfant au monde!»
Ses yeux me foudroyèrent, au point que je ne pus soutenir son regard et que je baissai aussitôt le mien.
« Tu n’as même pas le courage de me regarder, hein ? »
Il sortit en claquant la porte, avec un bruit si fort qu’il me fit sursauter.
Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur mes joues, et le manque de ma grand-mère me frappa douloureusement.
Je fermai les yeux, pleins de larmes, et j’imaginai ses vieilles mains me caressant la nuque et les joues. Il me semblait sentir son odeur et la douceur de sa poitrine, sur laquelle j’aurais voulu poser ma tête, ne serait-ce qu’un instant.
À ce moment-là, ma mère entra.
Je n’avais pas pensé à l’appeler, mais peut-être Filippo l’avait-il fait.
« Tu as sûrement trop tiré sur la corde avec ce travail que tu fais, et te voilà ici ! »
La douceur de ma grand-mère ne s’était pas transmise, même en infime partie, à sa fille, ma mère. C’était inexplicable qu’une personne si gentille ait pu mettre au monde une femme aussi différente d’elle.
Qui sait comment aurait été mon fils !
« Tu as tout ce qu’il te faut? On te traite bien ici ? »
Ma mère était pratique et fiable, une planificatrice de vies parfaite, irréprochable, mais en ce qui concernait les sentiments, elle en était dépourvue.
Je lui répondis avec un sourire las, sans dire un mot.
« Mais enfin, ma chérie, tu n’es ni la première ni la dernière à avoir fait une fausse couche, allez, un peu de courage, ça ne sert à rien de faire cette tête-là ! »
Je rouvris les yeux pour la regarder, pour voir si je n’étais pas en train de rêver tout cela, mais non, elle était bien là, devant moi, les mains sur les hanches.
Qui sait si mon fils aurait ressemblé à elle ou à moi !
***
Les médecins répétaient que le fœtus n’avait jamais existé, que ma grossesse avait été extra-utérine, que je n’avais pas perdu la vie d’un enfant puisque cet enfant n’avait jamais existé, que j’étais si jeune et que j’avais encore bien des années devant moi pour donner naissance à un enfant, que, que, que...
Un médecin âgé, voyant l’état dans lequel je me trouvais, essaya de m’expliquer ce qui s’était passé. Il m’en parla avec des termes techniques qui me rappelèrent vaguement une leçon de sciences.