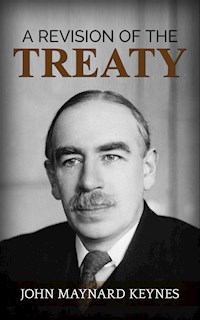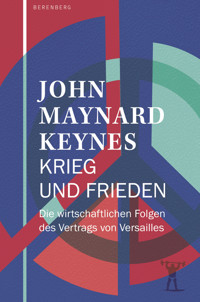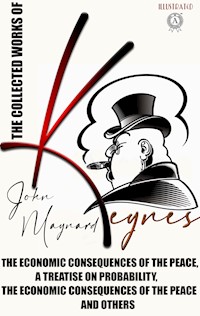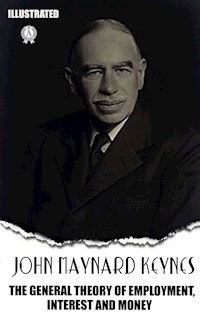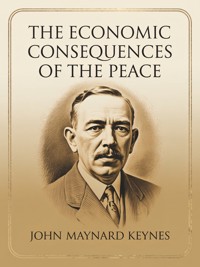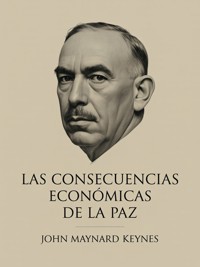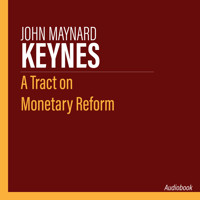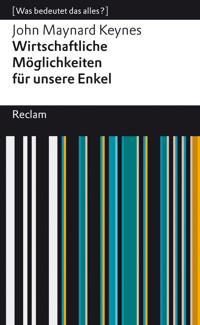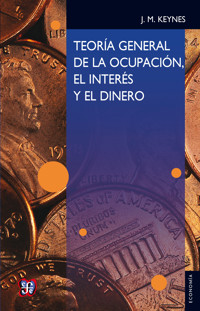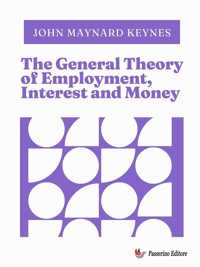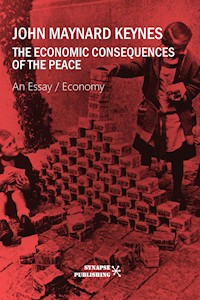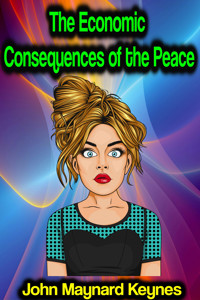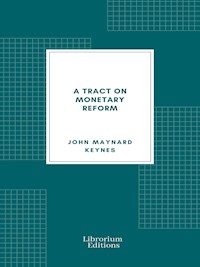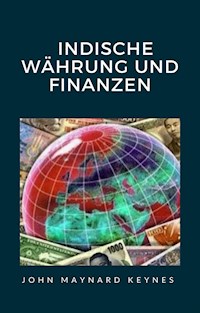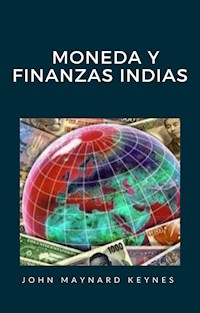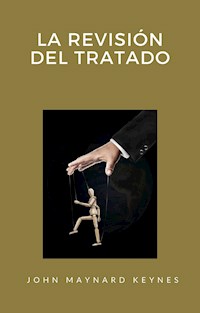1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: David De Angelis
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Les conséquences économiques de la paix a été écrit et publié par John Maynard Keynes. Après la Première Guerre mondiale, Keynes a participé à la Conférence de Versailles en tant que délégué du Trésor britannique et a plaidé en faveur d'une paix beaucoup plus généreuse. Ce livre a été un best-seller dans le monde entier et a joué un rôle déterminant dans l'établissement d'une opinion générale selon laquelle le traité de Versailles était une « paix carthaginoise ». Il a contribué à consolider l'opinion publique américaine contre le traité et l'adhésion à la Société des Nations. La perception par une grande partie de l'opinion publique britannique que l'Allemagne avait été traitée de manière injuste a été un facteur crucial dans le soutien public à la politique d'apaisement. Le succès du livre a établi la réputation de Keynes en tant qu'économiste de premier plan. Lorsque Keynes a joué un rôle clé dans la mise en place du système de Bretton Woods en 1944, il s'est souvenu des leçons tirées de Versailles ainsi que de la Grande Dépression. Le plan Marshall mis en place après la Seconde Guerre mondiale est un système similaire à celui proposé par Keynes dans Les conséquences économiques de la paix.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Table des matières
PRÉFACE
Introduction
L'Europe avant la guerre
NOTES DE BAS DE PAGE :
La conférence
NOTES DE BAS DE PAGE :
Le traité
NOTES DE BAS DE PAGE :
Réparation
I. Engagements pris avant les négociations de paix
II. La conférence et les termes du traité
III. La capacité de paiement de l'Allemagne
1. Richesse immédiatement transférable
2. Biens situés dans les territoires cédés ou abandonnés en vertu de l'armistice
3. Paiements annuels étalés sur plusieurs années
V. Les contre-propositions allemandes
NOTES DE BAS DE PAGE :
L'Europe après le traité
NOTES DE BAS DE PAGE :
Recours
1. La révision du traité
2. Le règlement des dettes entre alliés
3. Un prêt international
4. Les relations entre l'Europe centrale et la Russie
Les conséquences économiques de la paix
John Maynard Keynes
PRÉFACE
L'auteur de cet ouvrage a été temporairement attaché au Trésor britannique pendant la guerre et a été son représentant officiel à la Conférence de paix de Paris jusqu'au 7 juin 1919 ; il a également siégé en tant que suppléant du ministre des Finances au Conseil économique suprême. Il a démissionné de ces fonctions lorsqu'il est devenu évident qu'il n'y avait plus aucun espoir de modification substantielle du projet de traité de paix. Les raisons de son opposition au traité, ou plutôt à l'ensemble de la politique de la conférence à l'égard des problèmes économiques de l'Europe, apparaîtront dans les chapitres suivants. Elles sont entièrement de nature publique et reposent sur des faits connus de tous.
J.M. Keynes.
Introduction
La capacité à s'habituer à son environnement est une caractéristique marquante de l'humanité. Très peu d'entre nous réalisent avec conviction la nature extrêmement inhabituelle, instable, compliquée, peu fiable et temporaire de l'organisation économique dans laquelle l'Europe occidentale a vécu pendant le dernier demi-siècle. Nous considérons certains des avantages les plus particuliers et les plus temporaires dont nous avons bénéficié récemment comme naturels, permanents et fiables, et nous élaborons nos plans en conséquence. Sur ces fondations instables et fallacieuses, nous élaborons des plans d'amélioration sociale, nous habillons nos programmes politiques, nous poursuivons nos animosités et nos ambitions particulières, et nous estimons disposer d'une marge suffisante pour encourager, plutôt que d'apaiser, les conflits civils au sein de la famille européenne. Poussé par une illusion insensée et une estime de soi imprudente, le peuple allemand a renversé les fondations sur lesquelles nous vivions et construisions tous. Mais les porte-parole des peuples français et britannique ont pris le risque de parachever la ruine commencée par l'Allemagne, par une paix qui, si elle est mise en œuvre, ne peut qu'aggraver encore davantage, alors qu'elle aurait pu restaurer, l'organisation délicate et complexe, déjà ébranlée et brisée par la guerre, grâce à laquelle seuls les peuples européens peuvent s'employer et vivre.
En Angleterre, l'aspect extérieur de la vie ne nous apprend pas encore à sentir ou à réaliser le moins du monde qu'une époque est révolue. Nous sommes occupés à reprendre le cours de notre vie là où nous l'avons laissé, à la seule différence que beaucoup d'entre nous semblent beaucoup plus riches qu'auparavant. Alors que nous dépensions des millions avant la guerre, nous avons maintenant appris que nous pouvons dépenser des centaines de millions sans en souffrir, semble-t-il. De toute évidence, nous n'avons pas exploité au maximum les possibilités de notre vie économique. Nous espérons donc non seulement retrouver le confort de 1914, mais aussi l'élargir et l'intensifier considérablement. Toutes les classes sociales élaborent ainsi leurs projets : les riches veulent dépenser plus et épargner moins, les pauvres veulent dépenser plus et travailler moins.
Mais peut-être n'est-ce qu'en Angleterre (et en Amérique) qu'il est possible d'être aussi inconscient. En Europe continentale, la terre tremble et tout le monde est conscient des grondements. Il ne s'agit pas seulement d'extravagance ou de « conflits sociaux », mais de vie et de mort, de famine et d'existence, et des convulsions effrayantes d'une civilisation mourante.
Pour quelqu'un qui a passé la majeure partie des six mois qui ont suivi l'armistice à Paris, une visite occasionnelle à Londres était une expérience étrange. L'Angleterre reste en dehors de l'Europe. Les tremblements silencieux de l'Europe ne l'atteignent pas. L'Europe est séparée et l'Angleterre ne fait pas partie de sa chair et de son corps. Mais l'Europe est solide en elle-même. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche et la Hollande, la Russie, la Roumanie et la Pologne vibrent ensemble, et leur structure et leur civilisation ne font qu'un. Elles ont prospéré ensemble, elles ont été secouées ensemble par une guerre dont nous, malgré nos contributions et nos sacrifices énormes (bien que dans une moindre mesure que l'Amérique), sommes restés économiquement en dehors, et elles pourraient s'effondrer ensemble. C'est là que réside la signification destructrice de la paix de Paris. Si la guerre civile européenne doit se terminer par l'abus de leur pouvoir victorieux momentané par la France et l'Italie pour détruire l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie désormais prostrées, elles invitent leur propre destruction, ainsi que celle de l' , étant si profondément et inextricablement liées à leurs victimes par des liens psychiques et économiques cachés. Quoi qu'il en soit, un Anglais qui a participé à la Conférence de Paris et qui a été pendant ces mois-là membre du Conseil économique suprême des puissances alliées, était voué à devenir, pour lui une nouvelle expérience, un Européen dans ses préoccupations et sa vision du monde. Là, au centre névralgique du système européen, ses préoccupations britanniques devaient largement s'estomper et il devait être hanté par d'autres spectres plus effrayants. Paris était un cauchemar, et tout le monde y était morbide. Un sentiment de catastrophe imminente planait sur cette scène frivole ; la futilité et la petitesse de l'homme face aux grands événements auxquels il était confronté ; le caractère à la fois significatif et irréel des décisions ; la légèreté, l'aveuglement, l'insolence, les cris confus venant de l'extérieur — tous les éléments de la tragédie antique étaient réunis. Assis au milieu des décors théâtraux des salons d'État français, on pouvait se demander si les visages extraordinaires de Wilson et de Clemenceau, avec leur teinte fixe et leur caractérisation immuable, étaient vraiment des visages et non les masques tragicomiques d'un étrange drame ou d'un spectacle de marionnettes.
Les débats de Paris avaient tous cet air à la fois d'une importance extraordinaire et d'une insignifiance extraordinaire. Les décisions semblaient lourdes de conséquences pour l'avenir de la société humaine ; pourtant, l'atmosphère laissait entendre que la parole n'était pas chair, qu'elle était futile, insignifiante, sans effet, dissociée des événements ; et l'on ressentait très fortement l'impression, décrite par Tolstoï dans Guerre et Paix ou par Hardy dans Les Dynastes, d'événements marchant vers leur conclusion fatidique, sans être influencés ni affectés par les réflexions des hommes d'État en conseil :
L'esprit des années
Observez que toute la clairvoyance et la maîtrise de soi
Abandonnent ces foules désormais poussées à la démence
Par l'immanent et l'irrépressible. Il ne reste rien
Sinon la vengeance parmi les forts,
Et là, parmi les faibles, une rage impuissante.
Esprit de la Pitié
Pourquoi la Volonté incite-t-elle à une action aussi insensée ?
Esprit des années
Je t'ai dit qu'il agit sans le savoir,
Comme quelqu'un de possédé qui ne juge pas.
À Paris, où ceux qui étaient liés au Conseil économique suprême recevaient presque toutes les heures des rapports sur la misère, le désordre et la décomposition de l'organisation de toute l'Europe centrale et orientale, alliée ou ennemie, et apprenaient de la bouche des représentants financiers de l'Allemagne et de l'Autriche des preuves irréfutables de l'épuisement terrible de leurs pays, une visite occasionnelle dans la salle chaude et sèche de la maison du président, où les Quatre accomplissaient leur destin dans des intrigues vides et arides, ne faisait qu'ajouter au sentiment de cauchemar. Pourtant, à Paris, les problèmes de l'Europe étaient terribles et criants, et un retour occasionnel à la vaste indifférence de Londres était un peu déconcertant. Car à Londres, ces questions étaient très lointaines, et seuls nos propres problèmes mineurs nous préoccupaient. Londres croyait que Paris semait une grande confusion dans ses affaires, mais restait indifférente. C'est dans cet esprit que le peuple britannique a accueilli le traité sans le lire. Mais c'est sous l'influence de Paris, et non de Londres, que ce livre a été écrit par quelqu'un qui, bien qu'Anglais, se sent également Européen et qui, en raison d'une expérience récente trop vivace, ne peut se désintéresser de la suite du grand drame historique de ces jours-ci, qui détruira de grandes institutions, mais pourrait aussi créer un monde nouveau.
L'Europe avant la guerre
Avant 1870, différentes parties du petit continent européen s'étaient spécialisées dans leurs propres produits, mais dans l'ensemble, il était essentiellement autosuffisant. Et sa population s'était adaptée à cette situation.
Après 1870, une situation sans précédent s'est développée à grande échelle, et la situation économique de l'Europe est devenue instable et particulière au cours des cinquante années suivantes. La pression démographique sur l'alimentation, qui avait déjà été compensée par l'accessibilité des approvisionnements en provenance d'Amérique, s'est inversée pour la première fois dans l'histoire. À mesure que la population augmentait, il était en fait plus facile de se procurer de la nourriture. Des rendements proportionnellement plus importants grâce à une production à plus grande échelle sont devenus une réalité dans l'agriculture comme dans l'industrie. Avec la croissance de la population européenne, il y eut d'une part davantage d'émigrants pour cultiver les terres des nouveaux pays et, d'autre part, davantage d'ouvriers disponibles en Europe pour fabriquer les produits industriels et les biens d'équipement destinés à subvenir aux besoins des populations émigrées dans leurs nouveaux foyers, et pour construire les chemins de fer et les navires qui devaient permettre à l'Europe d'accéder à des denrées alimentaires et à des matières premières provenant de sources lointaines. Jusqu'en 1900 environ, une unité de travail appliquée à l'industrie produisait chaque année un pouvoir d'achat sur une quantité croissante de nourriture. Il est possible qu'à partir de 1900, ce processus ait commencé à s'inverser et que le rendement décroissant de la nature par rapport aux efforts de l'homme ait commencé à se réaffirmer. Mais la tendance à la hausse du coût réel des céréales a été compensée par d'autres améliorations ; et, parmi les nombreuses nouveautés, les ressources de l'Afrique tropicale ont alors été exploitées pour la première fois à grande échelle, et un important trafic de graines oléagineuses a commencé à apporter à la table de l'Europe, sous une forme nouvelle et moins coûteuse, l'un des aliments essentiels de l'humanité. C'est dans cet Eldorado économique, dans cette utopie économique, comme l'auraient qualifié les premiers économistes, que la plupart d'entre nous ont grandi.
Cette époque heureuse a perdu de vue une vision du monde qui remplissait de mélancolie profonde les fondateurs de notre économie politique. Avant le XVIIIe siècle, l'humanité ne nourrissait aucun faux espoir. Pour dissiper les illusions qui se sont répandues à la fin de cette époque, Malthus a révélé l'existence d'un démon. Pendant un demi-siècle, tous les écrits économiques sérieux ont maintenu ce démon clairement en perspective. Pendant le demi-siècle suivant, il a été enchaîné et mis hors de vue. Aujourd'hui, nous l'avons peut-être à nouveau libéré.
Quelle période extraordinaire dans le progrès économique de l'humanité que celle qui s'est achevée en août 1914 ! Il est vrai que la majeure partie de la population travaillait dur et vivait dans des conditions peu confortables, mais elle semblait, en apparence, raisonnablement satisfaite de son sort. Mais il était possible pour tout homme doté de capacités ou d'un caractère dépassant la moyenne de s'échapper vers les classes moyennes et supérieures, pour lesquelles la vie offrait, à moindre coût et avec le moins de difficultés, des commodités, un confort et des agréments hors de portée des monarques les plus riches et les plus puissants d'autres époques. L'habitant de Londres pouvait commander par téléphone, en sirotant son thé du matin au lit, les produits les plus divers provenant des quatre coins du monde, dans les quantités qu'il jugeait bon, et s'attendre raisonnablement à ce qu'ils lui soient livrés rapidement à sa porte ; il pouvait, au même moment et par les mêmes moyens, investir sa fortune dans les ressources naturelles et les nouvelles entreprises de n'importe quelle région du monde , et partager, sans effort ni même sans difficulté, leurs fruits et avantages potentiels ; ou il pouvait décider de coupler la sécurité de sa fortune à la bonne foi des habitants de n'importe quelle municipalité importante de n'importe quel continent que son imagination ou ses informations lui recommandaient. Il pouvait, s'il le souhaitait, se procurer immédiatement des moyens de transport bon marché et confortables vers n'importe quel pays ou climat sans passeport ni autre formalité, envoyer son domestique à l'agence bancaire voisine pour obtenir les métaux précieux qui lui semblaient utiles, puis se rendre à l'étranger, sans connaître la religion, la langue ou les coutumes des pays visités, avec sa fortune en pièces de monnaie sur lui, et se considérer comme profondément lésé et très surpris à la moindre interférence. Mais surtout, il considérait cet état de fait comme normal, certain et permanent, sauf dans le sens d'une amélioration supplémentaire, et tout écart par rapport à celui-ci comme aberrant, scandaleux et évitable. Les projets et les politiques du militarisme et de l'impérialisme, des rivalités raciales et culturelles, des monopoles, des restrictions et de l'exclusion, qui allaient jouer le rôle du serpent dans ce paradis, n'étaient guère plus que des divertissements dans son quotidien et ne semblaient exercer pratiquement aucune influence sur le cours normal de la vie sociale et économique, dont l'internationalisation était presque achevée dans la pratique.
Il nous sera utile, pour apprécier la nature et les conséquences de la paix que nous avons imposée à nos ennemis, d'éclairer un peu plus certains des principaux éléments instables déjà présents dans la vie économique de l'Europe lorsque la guerre a éclaté.
I. Population
En 1870, l'Allemagne comptait environ 40 millions d'habitants. En 1892, ce chiffre était passé à 50 millions, et au 30 juin 1914, à environ 68 millions. Dans les années qui ont immédiatement précédé la guerre, l'augmentation annuelle était d'environ 850 000 personnes, dont une proportion insignifiante a émigré[1]. Cette forte augmentation n'a été rendue possible que par une transformation profonde de la structure économique du pays. D'une économie agricole et essentiellement autosuffisante, l'Allemagne s'est transformée en une vaste et complexe machine industrielle, dont le fonctionnement dépendait de l'équilibre de nombreux facteurs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ce n'est qu'en faisant fonctionner cette machine, de manière continue et à plein régime, qu'elle pouvait trouver des emplois dans le pays pour sa population croissante et les moyens d'acheter à l'étranger de quoi subvenir à ses besoins. La machine allemande était comme une toupie qui, pour maintenir son équilibre, devait tourner de plus en plus vite.
Dans l'Empire austro-hongrois, dont la population est passée d'environ 40 millions d'habitants en 1890 à au moins 50 millions au début de la guerre, la même tendance était présente à un degré moindre, l'excédent annuel des naissances par rapport aux décès étant d'environ un demi-million, dont toutefois un quart de million de personnes émigraient chaque année.
Pour comprendre la situation actuelle, nous devons saisir avec vivacité à quel point le développement du système germanique a permis à l'Europe centrale de devenir un centre de population extraordinaire. Avant la guerre, la population de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie réunies dépassait non seulement largement celle des États-Unis, mais l' e était à peu près égale à celle de toute l'Amérique du Nord. C'est dans ces chiffres, situés sur un territoire compact, que résidait la force militaire des puissances centrales. Mais ces mêmes chiffres — car même la guerre ne les a pas sensiblement diminués[2] —, s'ils sont privés de moyens de subsistance, restent un danger à peine moindre pour l'ordre européen.
La Russie européenne a vu sa population augmenter dans une proportion encore plus grande que l'Allemagne, passant de moins de 100 millions d'habitants en 1890 à environ 150 millions au début de la guerre[3] ; et dans l'année qui a précédé 1914, l'excédent des naissances par rapport aux décès dans l'ensemble de la Russie atteignait le chiffre prodigieux de deux millions par an. Cette croissance démographique excessive en Russie, qui n'a pas été largement remarquée en Angleterre, a néanmoins été l'un des faits les plus significatifs de ces dernières années.
Les grands événements historiques sont souvent dus à des changements séculaires dans la croissance démographique et à d'autres causes économiques fondamentales qui, échappant par leur caractère progressif à l'attention des observateurs contemporains, sont attribués à la folie des hommes d'État ou au fanatisme des athées. Ainsi, les événements extraordinaires qui se sont produits ces deux dernières années en Russie, ce vaste bouleversement de la société qui a renversé ce qui semblait le plus stable – la religion, le fondement de la propriété, la propriété foncière, ainsi que les formes de gouvernement et la hiérarchie des classes – peuvent être davantage attribués à l'influence profonde de l'augmentation démographique qu'à Lénine ou à Nicolas ; et les pouvoirs perturbateurs d'une fécondité nationale excessive ont peut-être joué un rôle plus important dans la rupture des liens conventionnels que le pouvoir des idées ou les erreurs de l'autocratie.
II. Organisation
La délicate organisation selon laquelle vivaient ces peuples dépendait en partie de facteurs internes au système.
L'interférence des frontières et des tarifs douaniers était réduite au minimum, et près de trois cents millions de personnes vivaient dans les trois empires de Russie, d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie. Les différentes monnaies, qui étaient toutes maintenues sur une base stable par rapport à l'or et les unes par rapport aux autres, facilitaient la circulation des capitaux et des échanges commerciaux dans une mesure dont nous ne réalisons pleinement la valeur qu'aujourd'hui, alors que nous sommes privés de ses avantages. Sur cette vaste zone, la sécurité des biens et des personnes était presque absolue.
Ces facteurs d'ordre, de sécurité et d'uniformité, dont l'Europe n'avait jamais bénéficié auparavant sur un territoire aussi vaste et peuplé ni pendant une période aussi longue, ont préparé le terrain pour l'organisation de ce vaste mécanisme de transport, de distribution de charbon et de commerce extérieur qui a rendu possible un mode de vie industriel dans les centres urbains densément peuplés. Cela est trop bien connu pour nécessiter une justification détaillée à l'aide de chiffres. Mais cela peut être illustré par les chiffres relatifs au charbon, qui a été la clé de la croissance industrielle de l'Europe centrale presque autant que de l'Angleterre : la production allemande de charbon est passée de 30 millions de tonnes en 1871 à 70 millions de tonnes en 1890, 110 millions de tonnes en 1900 et 190 millions de tonnes en 1913.
Le reste du système économique européen s'est regroupé autour de l'Allemagne comme pilier central, et la prospérité du reste du continent dépendait principalement de la prospérité et de l'esprit d'entreprise de l'Allemagne. Le rythme croissant de l'Allemagne a donné à ses voisins un débouché pour leurs produits, en échange de quoi l'esprit d'entreprise des commerçants allemands leur fournissait leurs principaux besoins à bas prix.
Les statistiques sur l'interdépendance économique de l'Allemagne et de ses voisins sont impressionnantes. L'Allemagne était le meilleur client de la Russie, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Belgique, de la Suisse, de l'Italie et de l'Autriche-Hongrie ; elle était le deuxième meilleur client de la Grande-Bretagne, de la Suède et du Danemark ; et le troisième meilleur client de la France. Elle était la plus grande source d'approvisionnement de la Russie, de la Norvège, de la Suède, du Danemark, des Pays-Bas, de la Suisse, de l'Italie, de l'Autriche-Hongrie, de la Roumanie et de la Bulgarie ; et la deuxième plus grande source d'approvisionnement de la Grande-Bretagne, de la Belgique et de la France.
Dans notre cas, nous exportions davantage vers l'Allemagne que vers tout autre pays au monde, à l'exception de l'Inde, et nous achetions davantage à l'Allemagne que de tout autre pays au monde, à l'exception des États-Unis.
Il n'y avait aucun pays européen, à l'exception de ceux situés à l'ouest de l'Allemagne, qui ne réalisait pas plus d'un quart de son commerce total avec elle ; et dans le cas de la Russie, de l'Autriche-Hongrie et des Pays-Bas, cette proportion était bien plus importante.
L'Allemagne ne se contentait pas d'assurer le commerce de ces pays, mais fournissait également à certains d'entre eux une grande partie des capitaux nécessaires à leur propre développement. Sur les investissements étrangers de l'Allemagne avant la guerre, qui s'élevaient au total à environ 6 250 000 000 dollars, près de 2 500 000 000 dollars avaient été investis en Russie, en Autriche-Hongrie, en Bulgarie, en Roumanie et en Turquie.[4] Et grâce au système de « pénétration pacifique », elle a apporté à ces pays non seulement des capitaux, mais aussi, ce dont ils avaient tout autant besoin, une organisation. Toute l'Europe à l'est du Rhin est ainsi tombée dans l'orbite industrielle allemande, et sa vie économique s'est adaptée en conséquence.
Mais ces facteurs internes n'auraient pas suffi à permettre à la population de subvenir à ses besoins sans la coopération de facteurs externes et de certaines dispositions générales communes à toute l'Europe. Bon nombre des circonstances déjà évoquées étaient valables pour l'Europe dans son ensemble et n'étaient pas propres aux empires centraux. Mais tout ce qui suit était commun à l'ensemble du système européen.
III. La psychologie de la société
L'Europe était organisée socialement et économiquement de manière à garantir une accumulation maximale de capital. Si les conditions de vie quotidiennes de la population dans son ensemble s'amélioraient continuellement, la société était structurée de telle sorte qu'une grande partie des revenus supplémentaires était contrôlée par la classe la moins susceptible de les consommer. Les nouveaux riches du XIXe siècle n'étaient pas habitués à dépenser beaucoup et préféraient le pouvoir que leur conférait l'investissement aux plaisirs de la consommation immédiate. En fait, c'est précisément l'inégalité de la répartition des richesses qui a rendu possible, grâce à l , ces vastes accumulations de richesses fixes et d'améliorations du capital qui ont distingué cette époque de toutes les autres. C'est là que résidait, en fait, la principale justification du système capitaliste. Si les riches avaient dépensé leur nouvelle richesse pour leur propre plaisir, le monde aurait depuis longtemps trouvé un tel régime intolérable. Mais, comme des abeilles, ils ont économisé et accumulé, ce qui n'a pas nui à l'ensemble de la communauté, car ils avaient eux-mêmes des objectifs plus modestes.
Les immenses accumulations de capital fixe qui, au grand bénéfice de l'humanité, ont été constituées au cours du demi-siècle précédant la guerre, n'auraient jamais pu voir le jour dans une société où la richesse était répartie équitablement. Les chemins de fer du monde, que cette époque a construits comme un monument à la postérité, étaient, tout autant que les pyramides d'Égypte, le fruit d'un travail qui n'était pas libre de consommer dans le plaisir immédiat l'équivalent total de ses efforts.
Ainsi, ce système remarquable dépendait pour sa croissance d'un double bluff ou d'une double tromperie. D'une part, les classes laborieuses acceptaient, par ignorance ou par impuissance, ou étaient contraintes, persuadées ou amadouées par la coutume, la convention, l'autorité et l'ordre bien établi de la société, d'accepter une situation dans laquelle elles ne pouvaient s'approprier qu'une infime partie du gâteau qu'elles-mêmes, la nature et les capitalistes avaient contribué à produire. D'autre part, les classes capitalistes étaient autorisées à s'approprier la meilleure partie du gâteau et étaient théoriquement libres de la consommer, à la condition tacite qu'elles n'en consomment que très peu dans la pratique. Le devoir d'« épargner » devint les neuf dixièmes de la vertu et la croissance du gâteau l'objet de la vraie religion. Autour de la non-consommation du gâteau se développèrent tous ces instincts puritains qui, à d'autres époques, s'étaient retirés du monde et avaient négligé les arts de la production ainsi que ceux du plaisir. Et ainsi, le gâteau grossissait, mais dans quel but, cela n'était pas clairement envisagé. On exhortait les individus non pas tant à s'abstenir qu'à différer et à cultiver les plaisirs de la sécurité et de l'anticipation. L'épargne était destinée à la vieillesse ou à vos enfants, mais ce n'était qu'en théorie : la vertu du gâteau était qu'il ne devait jamais être consommé, ni par vous ni par vos enfants après vous.
En écrivant cela, je ne dénigre pas nécessairement les pratiques de cette génération. Dans les recoins inconscients de son être, la société savait ce qu'elle faisait. Le gâteau était en réalité très petit par rapport à l'appétit de consommation, et personne, s'il était partagé entre tous, ne serait beaucoup mieux loti en le coupant. La société ne travaillait pas pour les petits plaisirs du présent, mais pour la sécurité et l'amélioration futures de la race, en fait pour le « progrès ». Si seulement le gâteau n'avait pas été découpé, mais avait pu croître selon la proportion géométrique prédite par Malthus pour la population, mais tout aussi vraie pour les intérêts composés, peut-être qu'un jour serait venu où il y en aurait enfin assez pour tout le monde, et où la postérité pourrait profiter du fruit de nos labeurs. Ce jour-là, le surmenage, la surpopulation et la sous-alimentation auraient pris fin, et les hommes, assurés du confort et des nécessités du corps, pourraient se livrer à des exercices plus nobles de leurs facultés. Un rapport géométrique pouvait en annuler un autre, et le XIXe siècle a pu oublier la fertilité de l'espèce en contemplant les vertus vertigineuses des intérêts composés.
Cette perspective comportait deux écueils : que la population continue de dépasser l'accumulation, et que nos privations ne favorisent pas le bonheur mais l'augmentation du nombre ; et que le gâteau soit finalement consommé prématurément par la guerre, qui anéantit tous ces espoirs.
Mais ces réflexions m'éloignent trop de mon propos actuel. Je cherche seulement à souligner que le principe d'accumulation fondé sur l'inégalité était un élément essentiel de l'ordre social d'avant-guerre et du progrès tel que nous le comprenions alors, et à insister sur le fait que ce principe dépendait de conditions psychologiques instables, qu'il pourrait être impossible de recréer. Il n'était pas naturel pour une population dont si peu de membres jouissaient du confort de la vie d'accumuler autant. La guerre a révélé à tous la possibilité de consommer et à beaucoup la vanité de l'abstinence. Le bluff est donc découvert ; les classes laborieuses ne sont peut-être plus disposées à renoncer à autant, et les classes capitalistes, qui n'ont plus confiance en l'avenir, pourraient chercher à profiter plus pleinement de leurs libertés de consommation tant qu'elles durent, précipitant ainsi l'heure de leur confiscation.
IV. La relation entre l'Ancien Monde et le Nouveau
Les habitudes d'accumulation de l'Europe avant la guerre étaient la condition nécessaire du plus grand des facteurs externes qui maintenaient l'équilibre européen.
Une partie importante des biens d'équipement excédentaires accumulés par l'Europe a été exportée à l'étranger, où leur investissement a permis le développement de nouvelles ressources alimentaires, matérielles et de transport, tout en permettant à l'Ancien Monde de revendiquer les richesses naturelles et le potentiel vierge du Nouveau Monde. Ce dernier facteur s'est avéré d'une importance capitale. Le Vieux Monde a utilisé avec une immense prudence le tribut annuel qu'il était ainsi en droit de percevoir. Il est vrai qu'il a profité sans attendre des avantages liés à l'abondance et au faible coût des approvisionnements résultant des nouveaux développements rendus possibles par son surplus de capital. Mais la plus grande partie des intérêts financiers générés par ces investissements étrangers a été réinvestie et accumulée, comme réserve (espérait-on alors) pour les jours moins heureux où le travail industriel européen ne pourrait plus acheter à des conditions aussi avantageuses les produits d'autres continents, et où l'équilibre entre ses civilisations historiques et les races multiples d'autres climats et environnements serait menacé. Ainsi, l'ensemble des races européennes avaient tendance à bénéficier de la même manière du développement de nouvelles ressources, qu'elles poursuivent leur culture chez elles ou s'aventurent à l'étranger.
Cependant, même avant la guerre, l'équilibre ainsi établi entre les anciennes civilisations et les nouvelles ressources était menacé. La prospérité de l'Europe reposait sur le fait que, grâce à l'important excédent exportable de denrées alimentaires en Amérique, elle pouvait acheter des denrées alimentaires à un prix bon marché par rapport à la main-d'œuvre nécessaire pour produire ses propres exportations, et que, grâce à ses investissements antérieurs en capital, elle avait droit à un montant annuel substantiel sans aucun paiement en contrepartie. Le second de ces facteurs semblait alors hors de danger, mais, en raison de la croissance démographique outre-mer, principalement aux États-Unis, le premier n'était plus aussi sûr.
Lorsque les terres vierges d'Amérique ont commencé à être exploitées, la proportion de la population de ces continents, et par conséquent de leurs besoins locaux, par rapport à ceux de l'Europe était très faible. En 1890 encore, la population de l'Europe était trois fois supérieure à celle de l'Amérique du Nord et du Sud réunies. Mais en 1914, les besoins intérieurs des États-Unis en blé se rapprochaient de leur production, et la date à laquelle il n'y aurait plus d'excédent exportable que lors des années de récoltes exceptionnellement favorables était manifestement proche. En effet, les besoins intérieurs actuels des États-Unis sont estimés à plus de 90 % du rendement moyen des cinq années 1909-1913.[5] À cette époque, cependant, la tendance à la pénurie se manifestait, non pas tant par un manque d'abondance que par une augmentation constante du coût réel. Autrement dit, si l'on considère le monde dans son ensemble, il n'y avait pas de pénurie de blé, mais pour obtenir un approvisionnement suffisant, il fallait offrir un prix réel plus élevé. Le facteur le plus favorable dans cette situation était la mesure dans laquelle l'Europe centrale et occidentale était alimentée par les excédents exportables de la Russie et de la Roumanie.
En bref, la dépendance de l'Europe à l'égard des ressources du Nouveau Monde devenait précaire ; la loi des rendements décroissants se réaffirmait enfin et obligeait l'Europe à offrir chaque année une plus grande quantité d'autres produits pour obtenir la même quantité de pain ; l'Europe ne pouvait donc en aucun cas se permettre la désorganisation de l'une de ses principales sources d'approvisionnement.
On pourrait en dire long pour tenter de décrire les particularités économiques de l'Europe de 1914. J'ai choisi de mettre l'accent sur les trois ou quatre principaux facteurs d'instabilité : l'instabilité d'une population excessive dont la subsistance dépendait d'une organisation complexe et artificielle, l'instabilité psychologique des classes ouvrières et capitalistes, et l'instabilité des revendications de l'Europe, associée à sa dépendance totale à l'égard des approvisionnements alimentaires du Nouveau Monde.
La guerre avait tellement ébranlé ce système qu'elle mettait en danger la vie même de l'Europe. Une grande partie du continent était malade et mourante ; sa population dépassait largement le nombre de personnes pouvant subvenir à ses besoins ; son organisation était détruite, son système de transport rompu et ses approvisionnements alimentaires terriblement compromis.
La Conférence de paix avait pour mission d'honorer les engagements et de satisfaire la justice, mais aussi de rétablir la vie et de panser les blessures. Ces tâches étaient dictées autant par la prudence que par la magnanimité que la sagesse de l'Antiquité approuvait chez les vainqueurs. Nous examinerons dans les chapitres suivants le caractère réel de la paix.
NOTES DE BAS DE PAGE :
[1] En 1913, 25 843 personnes ont émigré d'Allemagne, dont 19 124 vers les États-Unis.
[2] La diminution nette de la population allemande à la fin de 1918, due à la baisse des naissances et à l'excès des décès par rapport au début de 1914, est estimée à environ 2 700 000 personnes.
[3] Y compris la Pologne et la Finlande, mais à l'exclusion de la Sibérie, de l'Asie centrale et du Caucase.
[4] Les sommes mentionnées dans cet ouvrage en dollars ont été converties à partir de livres sterling au taux de 5 dollars pour 1 livre.
[5] Même depuis 1914, la population des États-Unis a augmenté de sept ou huit millions d'habitants. Comme leur consommation annuelle de blé par habitant n'est pas inférieure à 6 boisseaux, le niveau de production d'avant-guerre aux États-Unis ne présenterait un excédent substantiel par rapport aux besoins intérieurs actuels qu'environ une année sur cinq. Nous avons été sauvés pour l'instant par les grandes récoltes de 1918 et 1919, qui ont été rendues possibles par le prix garanti de M. Hoover. Mais on ne peut guère s'attendre à ce que les États-Unis continuent indéfiniment à augmenter de manière substantielle le coût de la vie dans leur propre pays afin de fournir du blé à une Europe qui ne peut pas le payer.