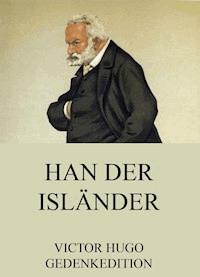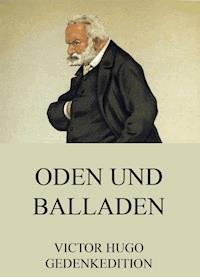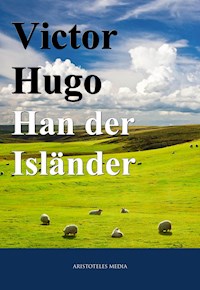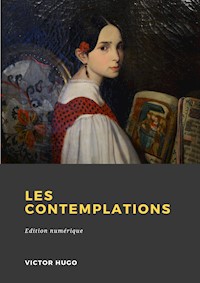
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Les Contemplations sont un recueil de poèmes, écrit par Victor Hugo, publié en 1856. Il est composé de 158 poèmes rassemblés en six livres. La plupart de ces poèmes ont été écrits entre 1841 et 1855, mais les poèmes les plus anciens de ce recueil datent de 1830.
Les Contemplations sont un recueil du souvenir, de l’amour, de la joie mais aussi de la mort, du deuil et même d'une certaine foi mystique. Le souvenir, surtout, y prend une place prépondérante, puisque Victor Hugo y expérimente le genre de l'autobiographie versifiée. Ce recueil est également un hommage à sa fille Léopoldine Hugo, morte noyée dans la Seine à Villequier.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Victor Hugo est un poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur romantique français, né le 26 février 1802 (7 ventôse an X) à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de la langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a eu un rôle idéologique majeur et occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises au XIXe siècle.
Comme romancier, il a rencontré un grand succès populaire, d'abord avec Notre-Dame de Paris en 1831, et plus encore avec Les Misérables en 1862. Son œuvre multiple comprend aussi des écrits et discours politiques, des récits de voyages, des recueils de notes et de mémoires, des commentaires littéraires, une correspondance abondante, près de quatre mille dessins dont la plupart réalisés à l'encre, ainsi que la conception de décors intérieurs et une contribution à la photographie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Victor Hugo
LES CONTEMPLATIONS
– 1856 –
PRÉFACE
Si un auteur pouvait avoir quelque droit d’influer sur la disposition d’esprit des lecteurs qui ouvrent son livre, l’auteur des Contemplations se bornerait à dire ceci : Ce livre doit être lu comme on lirait le livre d’un mort.
Vingt-cinq années sont dans ces deux volumes. Grande mortalis ævi spatium. L’auteur a laissé, pour ainsi dire, ce livre se faire en lui. La vie, en filtrant goutte à goutte à travers les événements et les souffrances, l’a déposé dans son cœur. Ceux qui s’y pencheront retrouveront leur propre image dans cette eau profonde et triste, qui s’est lentement amassée là, au fond d’une âme.
Qu’est-ce que les Contemplations ? C’est ce qu’on pourrait appeler, si le mot n’avait quelque prétention, les Mémoires d’une âme.
Ce sont, en effet, toutes les impressions, tous les souvenirs, toutes les réalités, tous les fantômes vagues, riants ou funèbres, que peut contenir une conscience, revenus et rappelés, rayon à rayon, soupir à soupir, et mêlés dans la même nuée sombre. C’est l’existence humaine sortant de l’énigme du berceau et aboutissant à l’énigme du cercueil ; c’est un esprit qui marche de lueur en lueur en laissant derrière lui la jeunesse, l’amour, l’illusion, le combat, le désespoir, et qui s’arrête éperdu « au bord de l’infini ». Cela commence par un sourire, continue par un sanglot, et finit par un bruit du clairon de l’abîme.
Une destinée est écrite là jour à jour.
Est-ce donc la vie d’un homme ? Oui, et la vie des autres hommes aussi. Nul de nous n’a l’honneur d’avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis ; la destinée est une. Prenez donc ce miroir, et regardez-vous-y. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent moi. Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas ! quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah ! insensé, qui crois que je ne suis pas toi !
Ce livre contient, nous le répétons, autant l’individualité du lecteur que celle de l’auteur. Homo sum. Traverser le tumulte, la rumeur, le rêve, la lutte, le plaisir, le travail, la douleur, le silence ; se reposer dans le sacrifice, et, là, contempler Dieu ; commencer à Foule et finir à Solitude, n’est-ce pas, les proportions individuelles réservées, l’histoire de tous ?
On ne s’étonnera donc pas de voir, nuance à nuance, ces deux volumes s’assombrir pour arriver, cependant, à l’azur d’une vie meilleure. La joie, cette fleur rapide de la jeunesse, s’effeuille page à page dans le tome premier, qui est l’espérance, et disparaît dans le tome second, qui est le deuil. Quel deuil ? Le vrai, l’unique : la mort ; la perte des être chers.
Nous venons de le dire, c’est une âme qui se raconte dans ces deux volumes. Autrefois, Aujourd’hui. Un abîme les sépare, le tombeau.
V. H.
Guernesey, mars 1856.
TOME IAUTREFOIS1830-1843
Un jour…
Un jour je vis, debout au bord des flots mouvants,
Passer, gonflant ses voiles,
Un rapide navire enveloppé de vents,
De vagues et d’étoiles ;
Et j’entendis, penché sur l’abîme des cieux,
Que l’autre abîme touche,
Me parler à l’oreille une voix dont mes yeux
Ne voyaient pas la bouche :
« Poëte, tu fais bien ! Poëte au triste front,
Tu rêves près des ondes,
Et tu tires des mers bien des choses qui sont
Sous les vagues profondes !
La mer, c’est le Seigneur, que, misère ou bonheur,
Tout destin montre et nomme ;
Le vent, c’est le Seigneur ; l’astre, c’est le Seigneur ;
Le navire, c’est l’homme. »
Juin 1839.
LIVRE PREMIERAURORE
I.À ma fille
Ô mon enfant, tu vois, je me soumets.
Fais comme moi : vis du monde éloignée ;
Heureuse ? non ; triomphante ? jamais.
– Résignée ! –
Sois bonne et douce, et lève un front pieux.
Comme le jour dans les cieux met sa flamme,
Toi, mon enfant, dans l’azur de tes yeux
Mets ton âme !
Nul n’est heureux et nul n’est triomphant.
L’heure est pour tous une chose incomplète ;
L’heure est une ombre, et notre vie, enfant,
En est faite.
Oui, de leur sort tous les hommes sont las.
Pour être heureux, à tous, – destin morose ! –
Tout a manqué. Tout, c’est-à-dire, hélas !
Peu de chose.
Ce peu de chose est ce que, pour sa part,
Dans l’univers chacun cherche et désire :
Un mot, un nom, un peu d’or, un regard,
Un sourire !
La gaîté manque au grand roi sans amours ;
La goutte d’eau manque au désert immense.
L’homme est un puits où le vide toujours
Recommence.
Vois ces penseurs que nous divinisons,
Vois ces héros dont les fronts nous dominent,
Noms dont toujours nos sombres horizons
S’illuminent !
Après avoir, comme fait un flambeau,
Ébloui tout de leurs rayons sans nombre,
Ils sont allés chercher dans le tombeau
Un peu d’ombre.
Le ciel, qui sait nos maux et nos douleurs,
Prend en pitié nos jours vains et sonores.
Chaque matin, il baigne de ses pleurs
Nos aurores.
Dieu nous éclaire, à chacun de nos pas,
Sur ce qu’il est et sur ce que nous sommes ;
Une loi sort des choses d’ici-bas,
Et des hommes !
Cette loi sainte, il faut s’y conformer.
Et la voici, toute âme y peut atteindre :
Ne rien haïr, mon enfant ; tout aimer,
Ou tout plaindre !
Paris, octobre 1842.
II.
Le poëte s’en va dans les champs ; il admire,
Il adore ; il écoute en lui-même une lyre ;
Et, le voyant venir, les fleurs, toutes les fleurs,
Celles qui des rubis font pâlir les couleurs,
Celles qui des paons même éclipseraient les queues,
Les petites fleurs d’or, les petites fleurs bleues,
Prennent, pour l’accueillir agitant leurs bouquets,
De petits airs penchés ou de grands airs coquets,
Et, familièrement, car cela sied aux belles :
« Tiens ! c’est notre amoureux qui passe ! » disent-elles.
Et, pleins de jour et d’ombre et de confuses voix,
Les grands arbres profonds qui vivent dans les bois,
Tous ces vieillards, les ifs, les tilleuls, les érables,
Les saules tout ridés, les chênes vénérables,
L’orme au branchage noir, de mousse appesanti,
Comme les ulémas quand paraît le muphti,
Lui font de grands saluts et courbent jusqu’à terre
Leurs têtes de feuillée et leurs barbes de lierre,
Contemplent de son front la sereine lueur,
Et murmurent tout bas : C’est lui ! c’est le rêveur !
Les Roches, juin 1831.
III.Mes deux filles
Dans le frais clair-obscur du soir charmant qui tombe,
L’une pareille au cygne et l’autre à la colombe,
Belles, et toutes deux joyeuses, ô douceur !
Voyez, la grande sœur et la petite sœur
Sont assises au seuil du jardin, et sur elles
Un bouquet d’œillets blancs aux longues tiges frêles,
Dans une urne de marbre agité par le vent,
Se penche, et les regarde, immobile et vivant,
Et frissonne dans l’ombre, et semble, au bord du vase,
Un vol de papillons arrêté dans l’extase.
La Terrasse, près Enghien, juin 1842.
IV.
Le firmament est plein de la vaste clarté ;
Tout est joie, innocence, espoir, bonheur, bonté.
Le beau lac brille au fond du vallon qui le mure ;
Le champ sera fécond, la vigne sera mûre ;
Tout regorge de sève et de vie et de bruit,
De rameaux verts, d’azur frissonnant, d’eau qui luit,
Et de petits oiseaux qui se cherchent querelle.
Qu’a donc le papillon ? qu’a donc la sauterelle ?
La sauterelle a l’herbe, et le papillon l’air ;
Et tous deux ont avril, qui rit dans le ciel clair.
Un refrain joyeux sort de la nature entière ;
Chanson qui doucement monte et devient prière.
Le poussin court, l’enfant joue et danse, l’agneau
Saute, et, laissant tomber goutte à goutte son eau,
Le vieux antre, attendri, pleure comme un visage ;
Le vent lit à quelqu’un d’invisible un passage
Du poëme inouï de la création ;
L’oiseau parle au parfum ; la fleur parle au rayon ;
Les pins sur les étangs dressent leur verte ombelle ;
Les nids ont chaud, l’azur trouve la terre belle,
Onde et sphère, à la fois tous les climats flottants ;
Ici l’automne, ici l’été ; là le printemps.
Ô coteaux ! ô sillons ! souffles, soupirs, haleines !
L’hosanna des forêts, des fleuves et des plaines,
S’élève gravement vers Dieu, père du jour ;
Et toutes les blancheurs sont des strophes d’amour ;
Le cygne dit : Lumière ! et le lys dit : Clémence !
Le ciel s’ouvre à ce chant comme une oreille immense.
Le soir vient ; et le globe à son tour s’éblouit,
Devient un œil énorme et regarde la nuit ;
Il savoure, éperdu, l’immensité sacrée,
La contemplation du splendide empyrée,
Les nuages de crêpe et d’argent, le zénith,
Qui, formidable, brille et flamboie et bénit,
Les constellations, ces hydres étoilées,
Les effluves du sombre et du profond, mêlées
À vos effusions, astres de diamant,
Et toute l’ombre avec tout le rayonnement !
L’infini tout entier d’extase se soulève ?
Et, pendant ce temps-là, Satan, l’envieux, rêve.
La Terrasse, avril 1840.
V.À André Chénier
Oui, mon vers croit pouvoir, sans se mésallier,
Prendre à la prose un peu de son air familier.
André, c’est vrai, je ris quelquefois sur la lyre.
Voici pourquoi. Tout jeune encor, tâchant de lire
Dans le livre effrayant des forêts et des eaux,
J’habitais un parc sombre où jasaient des oiseaux,
Où des pleurs souriaient dans l’œil bleu des pervenches ;
Un jour que je songeais seul au milieu des branches,
Un bouvreuil qui faisait le feuilleton du bois
M’a dit : « Il faut marcher à terre quelquefois.
« La nature est un peu moqueuse autour des hommes ;
« Ô poëte, tes chants, ou ce qu’ainsi tu nommes,
« Lui ressembleraient mieux si tu les dégonflais.
« Les bois ont des soupirs, mais ils ont des sifflets.
« L’azur luit, quand parfois la gaîté le déchire ;
« L’Olympe reste grand en éclatant de rire ;
« Ne crois pas que l’esprit du poëte descend
« Lorsque entre deux grands vers un mot passe en dansant.
« Ce n’est pas un pleureur que le vent en démence ;
« Le flot profond n’est pas un chanteur de romance ;
« Et la nature, au fond des siècles et des nuits,
« Accouplant Rabelais à Dante plein d’ennuis,
« Et l’Ugolin sinistre au Grandgousier difforme,
« Près de l’immense deuil montre le rire énorme. »
Les Roches, juillet 1830.
VI.La vie aux champs
Le soir, à la campagne, on sort, on se promène,
Le pauvre dans son champ, le riche en son domaine ;
Moi, je vais devant moi : le poëte en tout lieu
Se sent chez lui, sentant qu’il est partout chez Dieu.
Je vais volontiers seul. Je médite ou j’écoute.
Pourtant, si quelqu’un veut m’accompagner en route,
J’accepte. Chacun a quelque chose en l’esprit ;
Et tout homme est un livre où Dieu lui-même écrit.
Chaque fois qu’en mes mains un de ces livres tombe,
Volume où vit une âme et que scelle la tombe,
J’y lis.
Chaque soir donc, je m’en vais, j’ai congé,
Je sors. J’entre en passant chez des amis que j’ai.
On prend le frais, au fond du jardin, en famille.
Le serein mouille un peu les bancs sous la charmille ;
N’importe : je m’assieds, et je ne sais pourquoi
Tous les petits enfants viennent autour de moi.
Dès que je suis assis, les voilà tous qui viennent.
C’est qu’ils savent que j’ai leurs goûts ; ils se souviennent
Que j’aime comme eux l’air, les fleurs, les papillons
Et les bêtes qu’on voit courir dans les sillons.
Ils savent que je suis un homme qui les aime,
Un être auprès duquel on peut jouer, et même
Crier, faire du bruit, parler à haute voix ;
Que je riais comme eux et plus qu’eux autrefois.
Et aujourd’hui, sitôt qu’à leurs ébats j’assiste,
Je leur souris encor, bien que je sois plus triste ;
Ils disent, doux amis, que je ne sais jamais
Me fâcher ; qu’on s’amuse avec moi ; que je fais
Des choses en carton, des dessins à la plume ;
Que je raconte, à l’heure où la lampe s’allume,
Oh ! des contes charmants qui vous font peur la nuit ;
Et qu’enfin je suis doux, pas fier et fort instruit.
Aussi, dès qu’on m’a vu : « Le voilà ! » tous accourent.
Ils quittent jeux, cerceaux et balles ; ils m’entourent
Avec leurs beaux grands yeux d’enfants, sans peur, sans fiel,
Qui semblent toujours bleus, tant on y voit le ciel !
Les petits – quand on est petit, on est très brave –
Grimpent sur mes genoux ; les grands ont un air grave ;
Ils m’apportent des nids de merles qu’ils ont pris,
Des albums, des crayons qui viennent de Paris ;
On me consulte, on a cent choses à me dire,
On parle, on cause, on rit surtout ; – j’aime le rire,
Non le rire ironique aux sarcasmes moqueurs,
Mais le doux rire honnête ouvrant bouches et cœurs,
Qui montre en même temps des âmes et des perles.
J’admire les crayons, l’album, les nids de merles ;
Et quelquefois on dit quand j’ai bien admiré :
« Il est du même avis que monsieur le curé. »
Puis, lorsqu’ils ont jasé tous ensemble à leur aise,
Ils font soudain, les grands s’appuyant à ma chaise,
Et les petits toujours groupés sur mes genoux,
Un silence, et cela veut dire : « Parle-nous. »
Je leur parle de tout. Mes discours en eux sèment
Ou l’idée ou le fait. Comme ils m’aiment, ils aiment
Tout ce que je leur dis. Je leur montre du doigt
Le ciel, Dieu qui s’y cache, et l’astre qu’on y voit.
Tout, jusqu’à leur regard, m’écoute. Je dis comme
Il faut penser, rêver, chercher. Dieu bénit l’homme,
Non pour avoir trouvé, mais pour avoir cherché.
Je dis : Donnez l’aumône au pauvre humble et penché ;
Recevez doucement la leçon ou le blâme.
Donner et recevoir, c’est faire vivre l’âme !
Je leur conte la vie, et que, dans nos douleurs,
Il faut que la bonté soit au fond de nos pleurs,
Et que, dans nos bonheurs, et que, dans nos délires,
Il faut que la bonté soit au fond de nos rires ;
Qu’être bon, c’est bon vivre, et que l’adversité
Peut tout chasser d’une âme, excepté la bonté ;
Et qu’ainsi les méchants, dans leur haine profonde,
Ont tort d’accuser Dieu. Grand Dieu ! nul homme au monde
N’a droit, en choisissant sa route, en y marchant,
De dire que c’est toi qui l’as rendu méchant ;
Car le méchant, Seigneur, ne t’est pas nécessaire !
Je leur raconte aussi l’histoire ; la misère
Du peuple juif, maudit qu’il faut enfin bénir ;
La Grèce, rayonnant jusque dans l’avenir ;
Rome ; l’antique Égypte et ses plaines sans ombre,
Et tout ce qu’on y voit de sinistre et de sombre.
Lieux effrayants ! tout meurt ; le bruit humain finit.
Tous ces démons taillés dans des blocs de granit,
Olympe monstrueux des époques obscures,
Les Sphinxs, les Anubis, les Ammons, les Mercures,
Sont assis au désert depuis quatre mille ans ;
Autour d’eux le vent souffle, et les sables brûlants
Montent comme une mer d’où sort leur tête énorme ;
La pierre mutilée a gardé quelque forme
De statue ou de spectre, et rappelle d’abord
Les plis que fait un drap sur la face d’un mort ;
On y distingue encor le front, le nez, la bouche,
Les yeux, je ne sais quoi d’horrible et de farouche
Qui regarde et qui vit, masque vague et hideux.
Le voyageur de nuit, qui passe à côté d’eux,
S’épouvante, et croit voir, aux lueurs des étoiles,
Des géants enchaînés et muets sous des voiles.
La Terrasse, août 1840.
VII.Réponse à un acte d’accusation
Donc, c’est moi qui suis l’ogre et le bouc émissaire.
Dans ce chaos du siècle où votre cœur se serre,
J’ai foulé le bon goût et l’ancien vers françois
Sous mes pieds, et, hideux, j’ai dit à l’ombre : « Sois ! »
Et l’ombre fut. – Voilà votre réquisitoire.
Langue, tragédie, art, dogmes, conservatoire,
Toute cette clarté s’est éteinte, et je suis
Le responsable, et j’ai vidé l’urne des nuits.
De la chute de tout je suis la pioche inepte ;
C’est votre point de vue. Eh bien, soit, je l’accepte ;
C’est moi que votre prose en colère a choisi ;
Vous me criez : Racca ; moi, je vous dis : Merci !
Cette marche du temps, qui ne sort d’une église
Que pour entrer dans l’autre, et qui se civilise ;
Ces grandes questions d’art et de liberté,
Voyons-les, j’y consens, par le moindre côté,
Et par le petit bout de la lorgnette. En somme,
J’en conviens, oui, je suis cet abominable homme ;
Et, quoique, en vérité, je pense avoir commis
D’autres crimes encor que vous avez omis,
Avoir un peu touché les questions obscures,
Avoir sondé les maux, avoir cherché les cures,
De la vieille ânerie insulté les vieux bâts,
Secoué le passé du haut jusques en bas,
Et saccagé le fond tout autant que la forme,
Je me borne à ceci : je suis ce monstre énorme
Je suis le démagogue horrible et débordé,
Et le dévastateur du vieil A B C D ;
Causons.
Quand je sortis du collège, du thème,
Des vers latins, farouche, espèce d’enfant blême
Et grave, au front penchant, aux membres appauvris ;
Quand, tâchant de comprendre et de juger, j’ouvris
Les yeux sur la nature et sur l’art, l’idiome,
Peuple et noblesse, était l’image du royaume ;
La poésie était la monarchie ; un mot
Était un duc et pair, ou n’était qu’un grimaud ;
Les syllabes, pas plus que Paris et que Londres,
Ne se mêlaient ; ainsi marchent sans se confondre
Piétons et cavaliers traversant le pont Neuf ;
La langue était l’État avant quatre-vingt-neuf ;
Les mots, bien ou mal nés, vivaient parqués en castes ;
Les uns, nobles, hantant les Phèdres, les Jocastes,
Les Méropes, ayant le décorum pour loi,
Et montant à Versaille aux carrosses du roi ;
Les autres, tas de gueux, drôles patibulaires,
Habitant les patois ; quelques-uns aux galères
Dans l’argot ; dévoués à tous les genres bas,
Déchirés en haillons dans les halles ; sans bas,
Sans perruque ; créés pour la prose et la farce ;
Populace du style au fond de l’ombre éparse ;
Vilains, rustres, croquants, que Vaugelas leur chef
Dans le bagne Lexique avait marqués d’une F ;
N’exprimant que la vie abjecte et familière,
Vils, dégradés, flétris, bourgeois, bons pour Molière.
Racine regardait ces marauds de travers ;
Si Corneille en trouvait un blotti dans son vers,
Il le gardait, trop grand pour dire : Qu’il s’en aille ;
Et Voltaire criait : Corneille s’encanaille !
Le bonhomme Corneille, humble, se tenait coi.
Alors, brigand, je vins ; je m’écriai : Pourquoi
Ceux-ci toujours devant, ceux-là toujours derrière ?
Et sur l’Académie, aïeule et douairière,
Cachant sous ses jupons les tropes effarés,
Et sur les bataillons d’alexandrins carrés,
Je fis souffler un vent révolutionnaire.
Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire.
Plus de mot sénateur ! plus de mot roturier !
Je fis une tempête au fond de l’encrier,
Et je mêlai, parmi les ombres débordées,
Au peuple noir des mots l’essaim blanc des idées ;
Et je dis : Pas de mot où l’idée au vol pur
Ne puisse se poser, tout humide d’azur !
Discours affreux ! – Syllepse, hypallage, litote,
Frémirent ; je montai sur la borne Aristote,
Et déclarai les mots égaux, libres, majeurs.
Tous les envahisseurs et tous les ravageurs,
Tous ces tigres, les Huns, les Scythes et les Daces,
N’étaient que des toutous auprès de mes audaces ;
Je bondis hors du cercle et brisai le compas.
Je nommai le cochon par son nom ; pourquoi pas ?
Guichardin a nommé le Borgia ! Tacite
Le Vitellius ! Fauve, implacable, explicite,
J’ôtai du cou du chien stupéfait son collier
D’épithètes ; dans l’herbe, à l’ombre du hallier,
Je fis fraterniser la vache et la génisse,
L’une étant Margoton et l’autre Bérénice.
Alors, l’ode, embrassant Rabelais, s’enivra ;
Sur le sommet du Pinde on dansait Ça ira ;
Les neuf muses, seins nus, chantaient la Carmagnole ;
L’emphase frissonna dans sa fraise espagnole ;
Jean, l’ânier, épousa la bergère Myrtil.
On entendit un roi dire : « Quelle heure est-il ? »
Je massacrai l’albâtre, et la neige, et l’ivoire,
Je retirai le jais de la prunelle noire,
Et j’osai dire au bras : Sois blanc, tout simplement.
Je violai du vers le cadavre fumant ;
J’y fis entrer le chiffre ; ô terreur ! Mithridate
Du siège de Cyzique eût pu citer la date.
Jours d’effroi ! les Laïs devinrent des catins.
Force mots, par Restaut peignés tous les matins,
Et de Louis-Quatorze ayant gardé l’allure,
Portaient encor perruque ; à cette chevelure
La Révolution, du haut de son beffroi,
Cria : « Transforme ! c’est l’heure. Remplis-toi
De l’âme de ces mots que tu tiens prisonnière ! »
Et la perruque alors rugit, et fut crinière.
Liberté ! c’est ainsi qu’en nos rébellions,
Avec des épagneuls nous fîmes des lions,
Et que, sous l’ouragan maudit que nous soufflâmes,
Toutes sortes de mots se couvrirent de flammes.
J’affichai sur Lhomond des proclamations.
On y lisait : « Il faut que nous en finissions !
« Au panier les Bouhours, les Batteux, les Brossettes !
« À la pensée humaine ils ont mis les poucettes.
« Aux armes, prose et vers ! formez vos bataillons !
« Voyez où l’on en est : la strophe a des bâillons !
« L’ode a les fers aux pieds, le drame est en cellule.
« Sur le Racine mort le Campistron pullule ! »
Boileau grinça des dents ; je lui dis : Ci-devant,
Silence ! et je criai dans la foudre et le vent :
Guerre à la rhétorique et paix à la syntaxe !
Et tout quatre-vingt-treize éclata. Sur leur axe,
On vit trembler l’athos, l’ithos et le pathos.
Les matassins, lâchant Pourceaugnac et Cathos,
Poursuivant Dumarsais dans leur hideux bastringue,
Des ondes du Permesse emplirent leur seringue.
La syllabe, enjambant la loi qui la tria,
Le substantif manant, le verbe paria,
Accoururent. On but l’horreur jusqu’à la lie.
On les vit déterrer le songe d’Athalie ;
Ils jetèrent au vent les cendres du récit
De Théramène ; et l’astre Institut s’obscurcit.
Oui, de l’ancien régime ils ont fait tables rases,
Et j’ai battu des mains, buveur du sang des phrases,
Quand j’ai vu par la strophe écumante et disant
Les choses dans un style énorme et rugissant,
L’Art poétique pris au collet dans la rue,
Et quand j’ai vu, parmi la foule qui se rue,
Pendre, par tous les mots que le bon goût proscrit,
La lettre aristocrate à la lanterne esprit.
Oui, je suis ce Danton ! je suis ce Robespierre !
J’ai, contre le mot noble à la longue rapière,
Insurgé le vocable ignoble, son valet,
Et j’ai, sur Dangeau mort, égorgé Richelet.
Oui, c’est vrai, ce sont là quelques-uns de mes crimes.
J’ai pris et démoli la bastille des rimes.
J’ai fait plus : j’ai brisé tous les carcans de fer
Qui liaient le mot peuple, et tiré de l’enfer
Tous les vieux mots damnés, légions sépulcrales ;
J’ai de la périphrase écrasé les spirales,
Et mêlé, confondu, nivelé sous le ciel
L’alphabet, sombre tour qui naquit de Babel ;
Et je n’ignorais pas que la main courroucée
Qui délivre le mot, délivre la pensée.
L’unité, des efforts de l’homme est l’attribut.
Tout est la même flèche et frappe au même but.
Donc, j’en conviens, voilà, déduits en style honnête,
Plusieurs de mes forfaits, et j’apporte ma tête.
Vous devez être vieux, par conséquent, papa,
Pour la dixième fois j’en fais mea culpa.
Oui, si Beauzée est dieu, c’est vrai, je suis athée.
La langue était en ordre, auguste, époussetée,
Fleurs-de-lis d’or, Tristan et Boileau, plafond bleu,
Les quarante fauteuils et le trône au milieu ;
Je l’ai troublée, et j’ai, dans ce salon illustre,
Même un peu cassé tout ; le mot propre, ce rustre,
N’était que caporal : je l’ai fait colonel ;
J’ai fait un jacobin du pronom personnel,
Du participe, esclave à la tête blanchie,
Une hyène, et du verbe une hydre d’anarchie.
Vous tenez le reum confitentem. Tonnez !
J’ai dit à la narine : Eh mais ! tu n’es qu’un nez !
J’ai dit au long fruit d’or : Mais tu n’es qu’une poire !
J’ai dit à Vaugelas : Tu n’es qu’une mâchoire !
J’ai dit aux mots : Soyez république ! soyez
La fourmilière immense, et travaillez ! Croyez,
Aimez, vivez ! – J’ai mis tout en branle, et, morose,
J’ai jeté le vers noble aux chiens noirs de la prose.
Et, ce que je faisais, d’autres l’ont fait aussi ;
Mieux que moi. Calliope, Euterpe au ton transi,
Polymnie, ont perdu leur gravité postiche.
Nous faisons basculer la balance hémistiche.
C’est vrai, maudissez-nous. Le vers, qui, sur son front
Jadis portait toujours douze plumes en rond,
Et sans cesse sautait sur la double raquette
Qu’on nomme prosodie et qu’on nomme étiquette,
Rompt désormais la règle et trompe le ciseau,
Et s’échappe, volant qui se change en oiseau,
De la cage césure, et fuit vers la ravine,
Et vole dans les cieux, alouette divine.
Tous les mots à présent planent dans la clarté.
Les écrivains ont mis la langue en liberté.
Et, grâce à ces bandits, grâce à ces terroristes,
Le vrai, chassant l’essaim des pédagogues tristes,
L’imagination, tapageuse aux cent voix,
Qui casse des carreaux dans l’esprit des bourgeois ;
La poésie au front triple, qui rit, soupire
Et chante ; raille et croit ; que Plaute et que Shakspeare
Semaient, l’un sur la plèbe, et l’autre sur le mob ;
Qui verse aux nations la sagesse de Job
Et la raison d’Horace à travers sa démence ;
Qu’enivre de l’azur la frénésie immense,
Et qui, folle sacrée aux regards éclatants,
Monte à l’éternité par les degrés du temps,
La muse reparaît, nous reprend, nous ramène,
Se remet à pleurer sur la misère humaine,
Frappe et console, va du zénith au nadir,
Et fait sur tous les fronts reluire et resplendir
Son vol, tourbillon, lyre, ouragan d’étincelles,
Et ses millions d’yeux sur ses millions d’ailes.
Le mouvement complète ainsi son action.
Grâce à toi, progrès saint, la Révolution
Vibre aujourd’hui dans l’air, dans la voix, dans le livre ;
Dans le mot palpitant le lecteur la sent vivre ;
Elle crie, elle chante, elle enseigne, elle rit.
Sa langue est déliée ainsi que son esprit.
Elle est dans le roman, parlant tout bas aux femmes.
Elle ouvre maintenant deux yeux où sont deux flammes,
L’un sur le citoyen, l’autre sur le penseur.
Elle prend par la main la Liberté, sa sœur,
Et la fait dans tout homme entrer par tous les pores.
Les préjugés, formés, comme les madrépores,
Du sombre entassement des abus sous les temps,
Se dissolvent au choc de tous les mots flottants,
Pleins de sa volonté, de son but, de son âme.
Elle est la prose, elle est le vers, elle est le drame ;
Elle est l’expression, elle est le sentiment,
Lanterne dans la rue, étoile au firmament.
Elle entre aux profondeurs du langage insondable ;
Elle souffle dans l’art, porte-voix formidable ;
Et, c’est Dieu qui le veut, après avoir rempli
De ses fiertés le peuple, effacé le vieux pli
Des fronts, et relevé la foule dégradée,
Et s’être faite droit, elle se fait idée !
Paris, janvier 1834.
VIII.Suite
Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant.
La main du songeur vibre et tremble en l’écrivant ;
La plume, qui d’une aile allongeait l’envergure,
Frémit sur le papier quand sort cette figure,
Le mot, le terme, type on ne sait d’où venu,
Face de l’invisible, aspect de l’inconnu ;
Créé, par qui ? forgé, par qui ? jailli de l’ombre ;
Montant et descendant dans notre tête sombre,
Trouvant toujours le sens comme l’eau le niveau ;
Formule des lueurs flottantes du cerveau.
Oui, vous tous, comprenez que les mots sont des choses.
Ils roulent pêle-mêle au gouffre obscur des proses,
Ou font gronder le vers, orageuse forêt.
Du sphinx Esprit Humain le mot sait le secret.
Le mot veut, ne veut pas, accourt, fée ou bacchante,
S’offre, se donne ou fuit ; devant Néron qui chante
Ou Charles-Neuf qui rime, il recule hagard ;
Tel mot est un sourire, et tel autre un regard ;
De quelque mot profond tout homme est le disciple ;
Toute force ici-bas a le mot pour multiple ;
Moulé sur le cerveau, vif ou lent, grave ou bref,
Le creux du crâne humain lui donne son relief ;
La vieille empreinte y reste auprès de la nouvelle ;
Ce qu’un mot ne sait pas, un autre le révèle ;
Les mots heurtent le front comme l’eau le récif ;
Ils fourmillent, ouvrant dans notre esprit pensif
Des griffes ou des mains, et quelques-uns des ailes ;
Comme en un âtre noir errent des étincelles,
Rêveurs, tristes, joyeux, amers, sinistres, doux,
Sombre peuple, les mots vont et viennent en nous ;
Les mots sont les passants mystérieux de l’âme.
Chacun d’eux porte une ombre ou secoue une flamme ;
Chacun d’eux du cerveau garde une région ;
Pourquoi ? c’est que le mot s’appelle Légion,
C’est que chacun, selon l’éclair qui le traverse,
Dans le labeur commun fait une œuvre diverse ;
C’est que de ce troupeau de signes et de sons
Qu’écrivant ou parlant, devant nous nous chassons,
Naissent les cris, les chants, les soupirs, les harangues ;
C’est que, présent partout, nain caché sous les langues,
Le mot tient sous ses pieds le globe et l’asservit ;
Et, de même que l’homme est l’animal où vit
L’âme, clarté d’en haut par le corps possédée,
C’est que Dieu fait du mot la bête de l’idée.
Le mot fait vibrer tout au fond de nos esprits.
Il remue, en disant : Béatrix, Lycoris,
Dante au Campo-Santo, Virgile au Pausilippe.
De l’océan pensée il est noir polype.
Quand un livre jaillit d’Eschyle ou de Manou,
Quand saint Jean à Patmos écrit sur son genou,
On voit, parmi leurs vers pleins d’hydres et de stryges
Des mots monstres ramper dans ces œuvres prodiges.
Ô main de l’impalpable ! ô pouvoir surprenant !
Mets un mot sur un homme, et l’homme frissonnant
Sèche et meurt, pénétré par la force profonde ;
Attache un mot vengeur au flanc de tout un monde,
Et le monde, entraînant pavois, glaive, échafaud,
Ses lois, ses mœurs, ses dieux, s’écroule sous le mot.
Cette toute-puissance immense sort des bouches.
La terre est sous les mots comme un champ sous les mouches
Le mot dévore, et rien ne résiste à sa dent.
À son haleine, l’âme et la lumière aidant,
L’obscure énormité lentement s’exfolie.
Il met sa force sombre en ceux que rien ne plie ;
Caton a dans les reins cette syllabe : NON.
Tous les grands obstinés, Brutus, Colomb, Zénon,
Ont ce mot flamboyant qui luit sous leur paupière :
ESPÉRANCE ! – Il entr’ouvre une bouche de pierre
Dans l’enclos formidable où les morts ont leur lit,
Et voilà que don Juan pétrifié pâlit !
Il fait le marbre spectre, il fait l’homme statue.
Il frappe, il blesse, il marque, il ressuscite, il tue ;
Nemrod dit : « Guerre ! » alors, du Gange à l’Illissus,
Le fer luit, le sang coule. « Aimez-vous ! » dit Jésus.
Et ce mot à jamais brille et se réverbère
Dans le vaste univers, sur tous, sur toi, Tibère,
Dans les cieux, sur les fleurs, sur l’homme rajeuni,
Comme le flamboiement d’amour de l’infini !
Quand, aux jours où la terre entr’ouvrait sa corolle,
Le premier homme dit la première parole,
Le mot né de sa lèvre, et que tout entendit,
Rencontra dans les cieux la lumière, et lui dit :
« Ma sœur !
« Envole-toi ! plane ! sois éternelle !
« Allume l’astre ! emplis à jamais la prunelle !
« Échauffe éthers, azurs, sphères, globes ardents ;
« Claire le dehors, j’éclaire le dedans.
« Tu vas être une vie, et je vais être l’autre.
« Sois la langue de feu, ma sœur, je suis l’apôtre.
« Surgis, effare l’ombre, éblouis l’horizon,
« Sois l’aube ; je te vaux, car je suis la raison ;
« À toi les yeux, à moi les fronts. Ô ma sœur blonde,
« Sous le réseau Clarté tu vas saisir le monde ;
« Avec tes rayons d’or, tu vas lier entre eux
« Les terres, les soleils, les fleurs, les flots vitreux,
« Les champs, les cieux ; et moi, je vais lier les bouches ;
« Et sur l’homme, emporté par mille essors farouches,
« Tisser, avec des fils d’harmonie et de jour,
« Pour prendre tous les cœurs, l’immense toile Amour.
« J’existais avant l’âme, Adam n’est pas mon père.
« J’étais même avant toi ; tu n’aurais pu, lumière,
« Sortir sans moi du gouffre où tout rampe enchaîné ;
« Mon nom est FIAT LUX, et je suis ton aîné ! »
Oui, tout-puissant ! tel est le mot. Fou qui s’en joue !
Quand l’erreur fait un nœud dans l’homme, il le dénoue.
Il est foudre dans l’ombre et ver dans le fruit mûr.
Il sort d’une trompette, il tremble sur un mur,
Et Balthazar chancelle, et Jéricho s’écoule.
Il s’incorpore au peuple, étant lui-même foule.
Il est vie, esprit, germe, ouragan, vertu, feu ;
Car le mot, c’est le Verbe, et le Verbe, c’est Dieu.
Jersey, juin 1855.
IX.
Le poëme éploré se lamente ; le drame
Souffre, et par vingt acteurs répand à flots son âme ;
Et la foule accoudée un moment s’attendrit,
Puis reprend : « Bah ! l’auteur est un homme d’esprit,
« Qui, sur de faux héros lançant de faux tonnerres,
« Rit de nous voir pleurer leurs maux imaginaires.
« Ma femme, calme-toi ; sèche tes yeux, ma sœur. »
La foule a tort : l’esprit, c’est le cœur ; le penseur
Souffre de sa pensée et se brûle à sa flamme.
Le poëte a saigné le sang qui sort du drame ;
Tous ces êtres qu’il fait l’étreignent de leurs nœuds ;
Il tremble en eux, il vit en eux, il meurt en eux ;
Dans sa création le poëte tressaille ;
Il est elle, elle est lui ; quand dans l’ombre il travaille,
Il pleure, et s’arrachant les entrailles, les met
Dans son drame, et, sculpteur, seul sur son noir sommet
Pétrit sa propre chair dans l’argile sacrée ;
Il y renaît sans cesse, et ce songeur qui crée
Othello d’une larme, Alceste d’un sanglot,
Avec eux pêle-mêle en ses œuvres éclôt.
Dans sa genèse immense et vraie, une et diverse,
Lui, le souffrant du mal éternel, il se verse,
Sans épuiser son flanc d’où sort une clarté.
Ce qui fait qu’il est dieu, c’est plus d’humanité.
Il est génie, étant, plus que les autres, homme.
Corneille est à Rouen, mais son âme est à Rome ;
Son front des vieux Catons porte le mâle ennui.
Comme Shakspeare est pâle ! avant Hamlet, c’est lui
Que le fantôme attend sur l’âpre plate-forme,
Pendant qu’à l’horizon surgit la lune énorme.
Du mal dont rêve Argan, Poquelin est mourant ;
Il rit : oui, peuple, il râle ! Avec Ulysse errant,
Homère éperdu fuit dans la brume marine.
Saint Jean frissonne : au fond de sa sombre poitrine,
L’Apocalypse horrible agite son tocsin.
Eschyle ! Oreste marche et rugit dans ton sein,
Et c’est, ô noir poëte à la lèvre irritée,
Sur ton crâne géant qu’est cloué Prométhée.
Paris, janvier 1834.
X.À Madame D. G. de G.
Jadis je vous disais : – Vivez, régnez, Madame !
Le salon vous attend ! le succès vous réclame !
Le bal éblouissant pâlit quand vous partez !
Soyez illustre et belle ! aimez ! riez ! chantez !
Vous avez la splendeur des astres et des roses !
Votre regard charmant, où je lis tant de choses,
Commente vos discours légers et gracieux.
Ce que dit votre bouche étincelle en vos yeux.
Il semble, quand parfois un chagrin vous alarme,
Qu’ils versent une perle et non pas une larme.
Même quand vous rêvez, vous souriez encor.
Vivez, fêtée et fière, ô belle aux cheveux d’or !
Maintenant vous voilà pâle, grave, muette,
Morte, et transfigurée, et je vous dis : – Poëte !
Viens me chercher ! Archange ! être mystérieux !
Fais pour moi transparents et la terre et les cieux !
Révèle-moi, d’un mot de ta bouche profonde,
La grande énigme humaine et le secret du monde !
Confirme en mon esprit Descartes ou Spinosa !
Car tu sais le vrai nom de celui qui perça,
Pour que nous puissions voir sa lumière sans voiles,
Ces trous du noir plafond qu’on nomme les étoiles !
Car je te sens flotter sous mes rameaux penchants ;
Car ta lyre invisible a de sublimes chants !
Car mon sombre océan, où l’esquif s’aventure,
T’épouvante et te plaît ; car la sainte nature,
La nature éternelle, et les champs, et les bois,
Parlent à ta grande âme avec leur grande voix !
Paris, 1840. – Jersey, 1855.
XI.Lise
J’avais douze ans ; elle en avait bien seize.
Elle était grande, et, moi, j’étais petit.
Pour lui parler le soir plus à mon aise,
Moi, j’attendais que sa mère sortît ;
Puis je venais m’asseoir près de sa chaise
Pour lui parler le soir plus à mon aise.
Que de printemps passés avec leurs fleurs !
Que de feux morts, et que de tombes closes !
Se souvient-on qu’il fut jadis des cœurs ?
Se souvient-on qu’il fut jadis des roses ?
Elle m’aimait. Je l’aimais. Nous étions
Deux purs enfants, deux parfums, deux rayons.
Dieu l’avait faite ange, fée et princesse.
Comme elle était bien plus grande que moi,
Je lui faisais des questions sans cesse
Pour le plaisir de lui dire : Pourquoi ?
Et, par moments, elle évitait, craintive,
Mon œil rêveur qui la rendait pensive.
Puis j’étalais mon savoir enfantin,
Mes jeux, la balle et la toupie agile ;
J’étais tout fier d’apprendre le latin ;
Je lui montrais mon Phèdre et mon Virgile ;
Je bravais tout ; rien ne me faisait mal ;
Je lui disais : Mon père est général.
Quoiqu’on soit femme, il faut parfois qu’on lise
Dans le latin, qu’on épèle en rêvant ;
Pour lui traduire un verset, à l’église,
Je me penchais sur son livre souvent.
Un ange ouvrait sur nous son aile blanche
Quand nous étions à vêpres le dimanche.
Elle disait de moi : C’est un enfant !
Je l’appelais mademoiselle Lise ;
Pour lui traduire un psaume, bien souvent,
Je me penchais sur son livre à l’église ;
Si bien qu’un jour, vous le vîtes, mon Dieu !
Sa joue en fleur toucha ma lèvre en feu.
Jeunes amours, si vite épanouies,
Vous êtes l’aube et le matin du cœur.
Charmez l’enfant, extases inouïes !
Et, quand le soir vient avec la douleur,
Charmez encor nos âmes éblouies,
Jeunes amours, si vite évanouies !
Mai 1843.
XII.Vere novo
Comme le matin rit sur les roses en pleurs !
Oh ! les charmants petits amoureux qu’ont les fleurs !
Ce n’est dans les jasmins, ce n’est dans les pervenches
Qu’un éblouissement de folles ailes blanches
Qui vont, viennent, s’en vont, reviennent, se fermant,
Se rouvrant, dans un vaste et doux frémissement.
Ô printemps ! quand on songe à toutes les missives
Qui des amants rêveurs vont aux belles pensives,
À ces cœurs confiés au papier, à ce tas
De lettres que le feutre écrit au taffetas,
Aux messages d’amour, d’ivresse et de délire
Qu’on reçoit en avril et qu’en mai l’on déchire,
On croit voir s’envoler, au gré du vent joyeux,
Dans les prés, dans les bois, sur les eaux, dans les cieux,
Et rôder en tous lieux, cherchant partout une âme,
Et courir à la fleur en sortant de la femme,
Les petits morceaux blancs, chassés en tourbillons,
De tous les billets doux, devenus papillons.
Mai 1831.
XIII.À propos d’Horace
Marchands de grec ! marchands de latin ! cuistres ! dogues !
Philistins ! magisters ! je vous hais, pédagogues !
Car, dans votre aplomb grave, infaillible, hébété,
Vous niez l’idéal, la grâce et la beauté !
Car vos textes, vos lois, vos règles sont fossiles !
Car, avec l’air profond, vous êtes imbéciles !
Car vous enseignez tout, et vous ignorez tout !
Car vous êtes mauvais et méchants ! – Mon sang bout
Rien qu’à songer au temps où, rêveuse bourrique,
Grand diable de seize ans, j’étais en rhétorique !
Que d’ennuis ! de fureurs ! de bêtises ! – gredins ! –
Que de froids châtiments et que de chocs soudains !
« Dimanche en retenue et cinq cents vers d’Horace ! »
Je regardais le monstre aux ongles noirs de crasse,
Et je balbutiais : « Monsieur… – Pas de raisons !
« Vingt fois l’ode à Plancus et l’épître aux Pisons ! »
Or, j’avais justement, ce jour-là, – douce idée
Qui me faisait rêver d’Armide et d’Haydée, –
Un rendez-vous avec la fille du portier.
Grand Dieu ! perdre un tel jour ! le perdre tout entier !
Je devais, en parlant d’amour, extase pure !
En l’enivrant avec le ciel et la nature,
La mener, si le temps n’était pas trop mauvais,
Manger de la galette aux buttes Saint-Gervais !
Rêve heureux ! je voyais, dans ma colère bleue,
Tout cet Eden, congé, les lilas, la banlieue,
Et j’entendais, parmi le thym et le muguet,
Les vagues violons de la mère Saguet !
Ô douleur ! furieux, je montais à ma chambre,
Fournaise au mois de juin, et glacière en décembre ;
Et, là, je m’écriais :
– Horace ! ô bon garçon !
Qui vivais dans le calme et selon la raison,
Et qui t’allais poser, dans ta sagesse franche,
Sur tout, comme l’oiseau se pose sur la branche,
Sans peser, sans rester, ne demandant aux dieux
Que le temps de chanter ton chant libre et joyeux !
Tu marchais, écoutant le soir, sous les charmilles,
Les rires étouffés des folles jeunes filles,
Les doux chuchotements dans l’angle obscur du bois ;
Tu courtisais ta belle esclave quelquefois,
Myrtale aux blonds cheveux, qui s’irrite et se cabre
Comme la mer creusant les golfes de Calabre,
Ou bien tu t’accoudais à table, buvant sec
Ton vin que tu mettais toi-même en un pot grec.
Pégase te soufflait des vers de sa narine ;
Tu songeais ; tu faisais des odes à Barine,
À Mécène, à Virgile, à ton champ de Tibur,
À Chloë, qui passait le long de ton vieux mur,
Portant sur son beau front l’amphore délicate.
La nuit, lorsque Phœbé devient la sombre Hécate,
Les halliers s’emplissaient pour toi de visions ;
Tu voyais des lueurs, des formes, des rayons,
Cerbère se frotter, la queue entre les jambes,
À Bacchus, dieu des vins et père des ïambes ;
Silène digérer dans sa grotte, pensif ;
Et se glisser dans l’ombre, et s’enivrer, lascif,
Aux blanches nudités des nymphes peu vêtues,
Le faune aux pieds de chèvre, aux oreilles pointues !
Horace, quand grisé d’un petit vin sabin,
Tu surprenais Glycère ou Lycoris au bain,
Qui t’eût dit, ô Flaccus ! quand tu peignais à Rome
Les jeunes chevaliers courant dans l’hippodrome,
Comme Molière a peint en France les marquis,
Que tu faisais ces vers charmants, profonds, exquis,
Pour servir, dans le siècle odieux où nous sommes,
D’instruments de torture à d’horribles bonshommes,
Mal peignés, mal vêtus, qui mâchent, lourds pédants,
Comme un singe une fleur, ton nom entre leurs dents !
Grimauds hideux qui n’ont, tant leur tête est vidée,
Jamais eu de maîtresse et jamais eu d’idée !
Puis j’ajoutais, farouche :
– Ô cancres ! qui mettez
Une soutane aux dieux de l’éther irrités,
Un béguin à Diane, et qui de vos tricornes
Coiffez sinistrement les olympiens mornes,
Eunuques, tourmenteurs, crétins, soyez maudits !
Car vous êtes les vieux, les noirs, les engourdis,
Car vous êtes l’hiver ; car vous êtes, ô cruches !
L’ours qui va dans les bois cherchant un arbre à ruches,
L’ombre, le plomb, la mort, la tombe, le néant !
Nul ne vit près de vous dressé sur son séant ;
Et vous pétrifiez d’une haleine sordide
Le jeune homme naïf, étincelant, splendide ;
Et vous vous approchez de l’aurore, endormeurs !
À Pindare serein plein d’épiques rumeurs,
À Sophocle, à Térence, à Plaute, à l’ambroisie,
Ô traîtres, vous mêlez l’antique hypocrisie,
Vos ténèbres, vos mœurs, vos jougs, vos exeats,
Et l’assoupissement des noirs couvents béats ;
Vos coups d’ongle rayant tous les sublimes livres,
Vos préjugés qui font vos yeux de brouillard ivres,
L’horreur de l’avenir, la haine du progrès ;
Et vous faites, sans peur, sans pitié, sans regrets,
À la jeunesse, aux cœurs vierges, à l’espérance,
Boire dans votre nuit ce vieil opium rance !
Ô fermoirs de la bible humaine ! sacristains
De l’art, de la science, et des maîtres lointains,
Et de la vérité que l’homme aux cieux épèle,
Vous changez ce grand temple en petite chapelle !
Guichetiers de l’esprit, faquins dont le goût sûr
Mène en laisse le beau ; porte-clefs de l’azur,
Vous prenez Théocrite, Eschyle aux sacrés voiles,
Tibulle plein d’amour, Virgile plein d’étoiles ;
Vous faites de l’enfer avec ces paradis !
Et, ma rage croissant, je reprenais :
– Maudits,
Ces monastères sourds ! bouges ! prisons haïes !
Oh ! comme on fit jadis au pédant de Veïes,
Culotte bas, vieux tigre ! Écoliers ! écoliers !
Accourez par essaims, par bandes, par milliers,
Du gamin de Paris au grœculus de Rome,
Et coupez du bois vert, et fouaillez-moi cet homme !
Jeunes bouches, mordez le metteur de bâillons !
Le mannequin sur qui l’on drape des haillons
A tout autant d’esprit que ce cuistre en son antre,
Et tout autant de cœur ; et l’un a dans le ventre
Du latin et du grec comme l’autre a du foin.
Ah ! je prends Phyllodoce et Xanthis à témoin
Que je suis amoureux de leurs claires tuniques ;
Mais je hais l’affreux tas des vils pédants iniques !
Confier un enfant, je vous demande un peu,
À tous ces êtres noirs ! autant mettre, morbleu !
La mouche en pension chez une tarentule !
Ces moines, expliquer Platon, lire Catulle,
Tacite racontant le grand Agricola,
Lucrèce ! eux, déchiffrer Homère, ces gens-là !
Ces diacres ! ces bedeaux dont le groin renifle !
Crânes d’où sort la nuit, pattes d’où sort la gifle,
Vieux dadais à l’air rogue, au sourcil triomphant,
Qui ne savent pas même épeler un enfant !
Ils ignorent comment l’âme naît et veut croître.
Cela vous a Laharpe et Nonotte pour cloître !
Ils en sont à l’A, B, C, D, du cœur humain ;
Ils sont l’horrible Hier qui veut tuer Demain ;
Ils offrent à l’aiglon leurs règles d’écrevisses.
Et puis ces noirs tessons ont une odeur de vices.
Ô vieux pots égueulés des soifs qu’on ne dit pas !
Le pluriel met une S à leurs meas culpas,
Les boucs mystérieux, en les voyant, s’indignent,
Et, quand on dit : « Amour ! » terre et cieux ! ils se signent.
Leur vieux viscère mort insulte au cœur naissant.
Ils le prennent de haut avec l’adolescent,
Et ne tolèrent pas le jour entrant dans l’âme
Sous la forme pensée ou sous la forme femme.
Quand la muse apparaît, ces hurleurs de holà
Disent : « Qu’est-ce que c’est que cette folle-là ? »
Et, devant ses beautés, de ses rayons accrues,
Ils reprennent : « Couleurs dures, nuances crues ;
Vapeurs, illusions, rêves ; et quel travers
Avez-vous de fourrer l’arc-en-ciel dans vos vers ? »
Ils raillent les enfants, ils raillent les poëtes ;
Ils font aux rossignols leurs gros yeux de chouettes ;
L’enfant est l’ignorant, ils sont l’ignorantin ;
Ils raturent l’esprit, la splendeur, le matin ;
Ils sarclent l’idéal ainsi qu’un barbarisme,
Et ces culs de bouteille ont le dédain du prisme !
Ainsi l’on m’entendait dans ma geôle crier.
Le monologue avait le temps de varier.
Et je m’exaspérais, faisant la faute énorme,
Ayant raison au fond, d’avoir tort dans la forme.
Après l’abbé Tuet, je maudissais Bezout ;
Car, outre les pensums où l’esprit se dissout,
J’étais alors en proie à la mathématique.
Temps sombre ! enfant ému du frisson poétique,
Pauvre oiseau qui heurtais du crâne mes barreaux,
On me livrait tout vif aux chiffres, noirs bourreaux ;
On me faisait de force ingurgiter l’algèbre ;
On me liait au fond d’un Boisbertrand funèbre ;
On me tordait, depuis les ailes jusqu’au bec,
Sur l’affreux chevalet des X et des Y ;
Hélas ! on me fourrait sous les os maxillaires
Le théorème orné de tous ses corollaires ;
Et je me débattais, lugubre patient
Du diviseur prêtant main-forte au quotient.
De là mes cris.
Un jour, quand l’homme sera sage,
Lorsqu’on n’instruira plus les oiseaux par la cage,
Quand les sociétés difformes sentiront
Dans l’enfant mieux compris se redresser leur front,
Que, des libres essors ayant sondé les règles,
On connaîtra la loi de croissance des aigles,
Et que le plein midi rayonnera pour tous,
Savoir étant sublime, apprendre sera doux.
Alors, tout en laissant au sommet des études
Les grands livres latins et grecs, ces solitudes
Où l’éclair gronde, où luit la mer, où l’astre rit,
Et qu’emplissent les vents immenses de l’esprit,
C’est en les pénétrant d’explication tendre,
En les faisant aimer, qu’on les fera comprendre.
Homère emportera dans son vaste reflux
L’écolier ébloui ; l’enfant ne sera plus
Une bête de somme attelée à Virgile ;
Et l’on ne verra plus ce vif esprit agile
Devenir, sous le fouet d’un cuistre ou d’un abbé,
Le lourd cheval poussif du pensum embourbé.
Chaque village aura, dans un temple rustique,
Dans la lumière, au lieu du magister antique,
Trop noir pour que jamais le jour y pénétrât,
L’instituteur lucide et grave, magistrat
Du progrès, médecin de l’ignorance, et prêtre
De l’idée ; et dans l’ombre on verra disparaître
L’éternel écolier et l’éternel pédant.
L’aube vient en chantant, et non pas en grondant.
Nos fils riront de nous dans cette blanche sphère ;
Ils se demanderont ce que nous pouvions faire
Enseigner au moineau par le hibou hagard.
Alors, le jeune esprit et le jeune regard
Se lèveront avec une clarté sereine
Vers la science auguste, aimable et souveraine ;
Alors, plus de grimoire obscur, fade, étouffant ;
Le maître, doux apôtre incliné sur l’enfant,
Fera, lui versant Dieu, l’azur et l’harmonie,
Boire la petite âme à la coupe infinie.
Alors, tout sera vrai, lois, dogmes, droits, devoirs.
Tu laisseras passer dans tes jambages noirs
Une pure lueur, de jour en jour moins sombre,
Ô nature, alphabet des grandes lettres d’ombre !
Paris, mai 1831.
XIV.À Granville, en 1836
Voici juin. Le moineau raille
Dans les champs les amoureux ;
Le rossignol de muraille
Chante dans son nid pierreux.
Les herbes et les branchages,
Pleins de soupirs et d’abois,
Font de charmants rabâchages
Dans la profondeur des bois.
La grive et la tourterelle
Prolongent, dans les nids sourds,
La ravissante querelle
Des baisers et des amours.
Sous les treilles de la plaine,
Dans l’antre où verdit l’osier,
Virgile enivre Silène,
Et Rabelais Grandgousier.
Ô Virgile, verse à boire !
Verse à boire, ô Rabelais !
La forêt est une gloire ;
La caverne est un palais !
Il n’est pas de lac ni d’île
Qui ne nous prenne au gluau,
Qui n’improvise une idylle,
Ou qui ne chante un duo.
Car l’amour chasse aux bocages,
Et l’amour pêche aux ruisseaux,
Car les belles sont les cages
Dont nos cœurs sont les oiseaux.
De la source, sa cuvette,
La fleur, faisant son miroir,
Dit : « Bonjour », à la fauvette,
Et dit au hibou : « Bonsoir. »
Le toit espère la gerbe,
Pain d’abord et chaume après ;
La croupe du bœuf dans l’herbe
Semble un mont dans les forêts.
L’étang rit à la macreuse,
Le pré rit au loriot,
Pendant que l’ornière creuse
Gronde le lourd chariot.
L’or fleurit en giroflée ;
L’ancien zéphyr fabuleux
Souffle avec sa joue enflée
Au fond des nuages bleus.
Jersey, sur l’onde docile,
Se drape d’un beau ciel pur,
Et prend des airs de Sicile
Dans un grand haillon d’azur.
Partout l’églogue est écrite ;
Même en la froide Albion,
L’air est plein de Théocrite,
Le vent sait par cœur Bion ;
Et redit, mélancolique,
La chanson que fredonna
Moschus, grillon bucolique
De la cheminée Etna.
L’hiver tousse, vieux phthisique,
Et s’en va ; la brume fond ;
Les vagues font la musique
Des vers que les arbres font.
Toute la nature sombre
Verse un mystérieux jour ;
L’âme qui rêve a plus d’ombre
Et la fleur a plus d’amour.
L’herbe éclate en pâquerettes ;
Les parfums, qu’on croit muets,
Content les peines secrètes
Des liserons aux bleuets.
Les petites ailes blanches
Sur les eaux et les sillons
S’abattent en avalanches ;
Il neige des papillons.
Et sur la mer, qui reflète
L’aube au sourire d’émail,
La bruyère violette
Met au vieux mont un camail ;
Afin qu’il puisse, à l’abîme
Qu’il contient et qu’il bénit,
Dire sa messe sublime
Sous sa mitre de granit.
Granville, juin 1836.
XV.La coccinelle
Elle me dit : « Quelque chose
Me tourmente. » Et j’aperçus
Son cou de neige, et, dessus,
Un petit insecte rose.
J’aurais dû – mais, sage ou fou,
À seize ans, on est farouche, –
Voir le baiser sur sa bouche
Plus que l’insecte à son cou.
On eût dit un coquillage ;
Dos rose et taché de noir.
Les fauvettes pour nous voir
Se penchaient dans le feuillage.
Sa bouche fraîche était là :
Je me courbai sur la belle,
Et je pris la coccinelle ;
Mais le baiser s’envola.
« Fils, apprends comme on me nomme »,
Dit l’insecte du ciel bleu,
« Les bêtes sont au bon Dieu ;
Mais la bêtise est à l’homme. »
Paris, mai 1830.
XVI.Vers 1820
Denise, ton mari, notre vieux pédagogue,
Se promène ; il s’en va troubler la fraîche églogue
Du bel adolescent Avril dans la forêt ;
Tout tremble et tout devient pédant, dès qu’il paraît :
L’âne bougonne un thème au bœuf son camarade ;