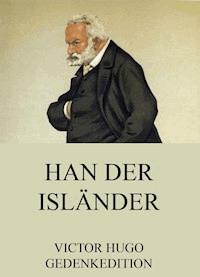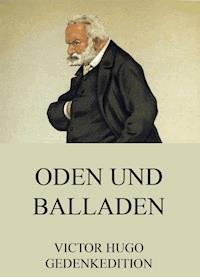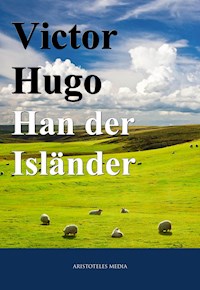2,99 €
2,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Victor Hugo
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Pure Innocence! Vertu sainte!
O les deux sommets d'ici-bas!
Où croissent, sans ombre et sans crainte,
Les deux palmes des deux combats!
Palme du combat Ignorance!
Palme du combat Vérité!
L'âme, à travers sa transparence,
Voit trembler leur double clarté.
Innocence! Vertu! sublimes
Même pour l'oeil mort du méchant!
On voit dans l'azur ces deux cimes,
L'une au levant, l'autre au couchant.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Victor Hugo
Les contemplations
UUID: cab3f1f8-8ede-11e6-81d9-0f7870795abd
Ce livre a été créé avec StreetLib Write (http://write.streetlib.com)de Simplicissimus Book Farm
table des matières
PAUCA MEÆ
EN MARCHE
AU BORD DE L'INFINI
PAUCA MEÆ
IPure Innocence! Vertu sainte!O les deux sommets d'ici-bas!Où croissent, sans ombre et sans crainte,Les deux palmes des deux combats!Palme du combat Ignorance!Palme du combat Vérité!L'âme, à travers sa transparence,Voit trembler leur double clarté.Innocence! Vertu! sublimesMême pour l'oeil mort du méchant!On voit dans l'azur ces deux cimes,L'une au levant, l'autre au couchant.Elles guident la nef qui sombre;L'une est phare, et l'autre est flambeau;L'une a le berceau dans son ombre,L'autre en son ombre a le tombeau.C'est sous la terre infortunéeQue commence, obscure à nos yeux,La ligne de la destinée;Elles l'achèvent dans les cieux.Elles montrent, malgré les voilesEt l'ombre du fatal milieu,Nos âmes touchant les étoilesEt la candeur mêlée au bleu.Elles éclairent les problèmes;Elles disent le lendemain;Elles sont les blancheurs suprêmesDe tout le sombre gouffre humain.L'archange effleure de son aileCe faîte où Jéhovah s'assied;Et sur cette neige éternelleOn voit l'empreinte d'un seul pied.Cette trace qui nous enseigne,Ce pied blanc, ce pied fait de jour,Ce pied rose, hélas! car il saigne,Ce pied nu, c'est le tien, amour!Janvier 1843.15 FÉVRIER 1843Aime celui qui t'aime, et sois heureuse en lui.--Adieu!--sois son trésor, ô toi qui fus le nôtre!Va, mon enfant béni, d'une famille à l'autre.Emporte le bonheur et laisse-nous l'ennui!Ici, l'on te retient; là-bas, on te désire.Fille, épouse, ange, enfant, fais ton double
devoir.Donne-nous un regret, donne-leur un espoir,Sors avec une larme! entre avec un sourire!Dans l'église, 15 février 1843.4 SEPTEMBRE 1843IIITROIS ANS APRÈSIl est temps que je me repose;Je suis terrassé par le sort.Ne me parlez pas d'autre choseQue des ténèbres où l'on dort!Que veut-on que je recommence?Je ne demande désormaisÀ la création immenseQu'un peu de silence et de paix!Pourquoi m'appelez-vous encore?J'ai fait ma tâche et mon devoir.Qui travaillait avant l'aurore,Peut s'en aller avant le soir.À vingt ans, deuil et solitude!Mes yeux, baissés vers le gazon,Perdirent la douce habitudeDe voir ma mère à la maison.Elle nous quitta pour la tombe;Et vous savez bien qu'aujourd'huiJe cherche, en cette nuit qui tombe,Un autre ange qui s'est enfui!Vous savez que je désespère,Que ma force en vain se défend,Et que je souffre comme père,Moi qui souffris tant comme enfant!Mon oeuvre n'est pas terminée,Dites-vous. Comme Adam banni,Je regarde ma destinée,Et je vois bien que j'ai fini.L'humble enfant que Dieu m'a ravieRien qu'en m'aimant savait m'aider;C'était le bonheur de ma vieDe voir ses yeux me regarder.Si ce Dieu n'a pas voulu cloreL'oeuvre qu'il me fit commencer,S'il veut que je travaille encore,Il n'avait qu'à me la laisser!Il n'avait qu'à me laisser vivreAvec ma fille à mes côtés,Dans cette extase où je m'enivreDe mystérieuses clartés!Ces clartés, jour d'une autre sphère,O Dieu jaloux, tu nous les vends!Pourquoi m'as-tu pris la lumièreQue j'avais parmi les vivants?As-tu donc pensé, fatal maître,Qu'à force de te contempler,Je ne voyais plus ce doux être,Et qu'il pouvait bien s'en aller!T'es-tu dit que l'homme, vaine ombre,Hélas! perd son humanitéA trop voir cette splendeur sombreQu'on appelle la vérité?Qu'on peut le frapper sans qu'il souffre,Que son coeur est mort dans l'ennui,Et qu'à force de voir le gouffre,Il n'a plus qu'un abîme en lui?Qu'il va, stoïque, où tu l'envoies,Et que désormais, endurci,N'ayant plus ici-bas de joies,Il n'a plus de douleurs aussi?As-tu pensé qu'une âme tendreS'ouvre à toi pour se mieux fermer,Et que ceux qui veulent comprendreFinissent par ne plus aimer?O Dieu! vraiment, as-tu pu croireQue je préférais, sous les cieux,L'effrayant rayon de ta gloireAux douces lueurs de ses yeux!Si j'avais su tes lois moroses,Et qu'au même esprit enchantéTu ne donnes point ces deux choses,Le bonheur et la vérité,Plutôt que de lever tes voiles,Et de chercher, coeur triste et pur,A te voir au fond des étoiles,O Dieu sombre d'un monde obscur,J'eusse aimé mieux, loin de ta face,Suivre, heureux, un étroit chemin,Et n'être qu'un homme qui passeTenant son enfant par la main!Maintenant, je veux qu'on me laisse!J'ai fini! le sort est vainqueur.Que vient-on rallumer sans cesseDans l'ombre qui m'emplit le coeur?Vous qui me parlez, vous me ditesQu'il faut, rappelant ma raison,Guider les foules décrépitesVers les lueurs de l'horizon;Qu'à l'heure où les peuples se lèventTout penseur suit un but profond;Qu'il se doit à tous ceux qui rêvent,Qu'il se doit à tous ceux qui vont!Qu'une âme, qu'un feu pur anime,Doit hâter, avec sa clarté,L'épanouissement sublimeDe la future humanité;Qu'il faut prendre part, coeurs fidèles,Sans redouter les océans,Aux fêtes des choses nouvelles,Aux combats des esprits géants!Vous voyez des pleurs sur ma joue,Et vous m'abordez mécontents,Comme par le bras on secoueUn homme qui dort trop longtemps.Mais songez à ce que vous faites!Hélas! cet ange au front si beau,Quand vous m'appelez à vos fêtes,Peut-être a froid dans son tombeau.Peut-être, livide et pâlie,Dit-elle dans son lit étroit:«Est-ce que mon père m'oublieEt n'est plus là, que j'ai si froid?»Quoi! lorsqu'à peine je résisteAux choses dont je me souviens,Quand je suis brisé, las et triste,Quand je l'entends qui me dit: «Viens!»Quoi! vous voulez que je souhaite,Moi, plié par un coup soudain,La rumeur qui suit le poëte,Le bruit que fait le paladin!Vous voulez que j'aspire encoreAux triomphes doux et dorés!Que j'annonce aux dormeurs l'aurore!Que je crie: «Allez! espérez!»Vous voulez que, dans la mêlée,Je rentre ardent parmi les forts,Les yeux à la voûte étoilée...--Oh! l'herbe épaisse où sont les morts!Novembre 1846.IVOh! je fus comme fou dans le premier moment,Hélas! et je pleurai trois jours amèrement.Vous tous à qui Dieu prit votre chère espérance,Pères, mères, dont l'âme a souffert ma souffrance.Tout ce que j'éprouvais, l'avez-vous éprouvé?Je voulais me briser le front sur le pavé;Puis je me révoltais, et, par moments, terrible,Je fixais mes regards sur cette chose horrible,Et je n'y croyais pas, et je m'écriais: Non!--Est-ce que Dieu permet de ces malheurs sans nomQui font que dans le coeur le désespoir se lève?--Il me semblait que tout n'était qu'un affreux
rêve,Qu'elle ne pouvait pas m'avoir ainsi quitté,Que je l'entendais rire en la chambre à côté,Que c'était impossible enfin qu'elle fût morte,Et que j'allais la voir entrer par cette porte!Oh! que de fois j'ai dit: Silence! elle a parlé!Tenez! voici le bruit de sa main sur la clé!Attendez! elle vient! laissez-moi, que j'écoute!Car elle est quelque part dans la maison sans
doute!Jersey, Marine-Terrace, 4 septembre 1852.VElle avait pris ce pli dans son âge enfantinDe venir dans ma chambre un peu chaque matinJe l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère;Elle entrait et disait: «Bonjour, mon petit père;»Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyaitSur mon lit, dérangeait mes papiers, et riait,Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui
passe.Alors, je reprenais, la tête un peu moins lasse,Mon oeuvre interrompue, et, tout en écrivant,Parmi mes manuscrits je rencontrais souventQuelque arabesque folle et qu'elle avait tracée,Et mainte page blanche entre ses mains froisséeOù, je ne sais comment, venaient mes plus doux
vers.Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prés
verts,Et c'était un esprit avant d'être une femme.Son regard reflétait la clarté de son âme.Elle me consultait sur tout à tous moments.Oh! que de soirs d'hiver radieux et charmants,Passés à raisonner langue, histoire et grammaire,Mes quatre enfants groupés sur mes genoux, leur
mèreTout près, quelques amis causant au coin du feu!J'appelais cette vie être content de peu!Et dire qu'elle est morte! hélas! que Dieu
m'assiste!Je n'étais jamais gai quand je la sentais triste;J'étais morne au milieu du bal le plus joyeuxSi j'avais, en partant, vu quelque ombre en ses
yeux.Novembre 1846, jour des morts.VIQuand nous habitions tous ensembleSur nos collines d'autrefois,Où l'eau court, où le buisson tremble,Dans la maison qui touche aux bois,Elle avait dix ans, et moi trente;J'étais pour elle l'univers.Oh! comme l'herbe est odoranteSous les arbres profonds et verts!Elle faisait mon sort prospère,Mon travail léger, mon ciel bleu.Lorsqu'elle me disait: Mon père,Tout mon coeur s'écriait: Mon Dieu!A travers mes songes sans nombre,J'écoutais son parler joyeux,Et mon front s'éclairait dans l'ombreA la lumière de ses yeux.Elle avait l'air d'une princesseQuand je la tenais par la main;Elle cherchait des fleurs sans cesseEt des pauvres dans le chemin.Elle donnait comme on dérobe,En se cachant aux yeux de tous.Oh! la belle petite robeQu'elle avait, vous rappelez-vous?Le soir, auprès de ma bougie,Elle jasait à petit bruit,Tandis qu'à la vitre rougieHeurtaient les papillons de nuit.Les anges se miraient en elle.Que son bonjour était charmant!Le ciel mettait dans sa prunelleCe regard qui jamais ne ment.Oh! je l'avais, si jeune encore,Vue apparaître en mon destin!C'était l'enfant de mon aurore,Et mon étoile du matin!Quand la lune claire et sereineBrillait aux cieux, dans ces beaux mois,Comme nous allions dans la plaine!Comme nous courions dans les bois!Puis, vers la lumière isoléeÉtoilant le logis obscur,Nous revenions par la valléeEn tournant le coin du vieux mur;Nous revenions, coeurs pleins de flamme,En parlant des splendeurs du ciel.Je composais cette jeune âmeComme l'abeille fait son miel.Doux ange aux candides pensées,Elle était gaie en arrivant...--Toutes ces choses sont passéesComme l'ombre et comme le vent!Villequier, 4 septembre 1844.VIIElle était pâle, et pourtant rose,Petite avec de grands cheveux.Elle disait souvent: Je n'ose,Et ne disait jamais: Je veux.Le soir, elle prenait ma BiblePour y faire épeler sa soeur,Et, comme une lampe paisible,Elle éclairait ce jeune coeur.Sur le saint livre que j'admire,Leurs yeux purs venaient se fixer;Livre où l'une apprenait à lire,Où l'autre apprenait à penser!Sur l'enfant, qui n'eût pas lu seule,Elle penchait son front charmant,Et l'on aurait dit une aïeuleTant elle parlait doucement!Elle lui disait: «Sois bien sage!»Sans jamais nommer le démon;Leurs mains erraient de page en pageSur Moïse et sur Salomon,Sur Cyrus qui vint de la Perse,Sur Moloch et Leviathan,Sur l'enfer que Jésus traverse,Sur l'éden où rampe Satan!Moi, j'écoutais...--O joie immenseDe voir la soeur près de la soeur!Mes yeux s'enivraient en silenceDe cette ineffable douceur.Et dans la chambre humble et déserteOù nous sentions, cachés tous trois,Entrer par la fenêtre ouverteLes souffles des nuits et des bois,Tandis que, dans le texte auguste,Leurs coeurs, lisant avec ferveur,Puisaient le beau, le vrai, le juste,Il me semblait, à moi, rêveur,Entendre chanter des louangesAutour de nous, comme au saint lieu,Et voir sous les doigts de ces angesTressaillir le livre de Dieu!Octobre 1846.VIIIA qui donc sommes-nous? Qui nous a? qui nous mène?Vautour fatalité, tiens-tu la race humaine?Oh! parlez, cieux vermeils,L'âme sans fond tient-elle aux étoiles sans
nombre?Chaque rayon d'en haut est-il un fil de l'ombreLiant l'homme aux soleils?Est-ce qu'en nos esprits, que l'ombre a pour
repaires,Nous allons voir rentrer les songes de nos pères?Destin, lugubre assaut!O vivants, serions-nous l'objet d'une dispute?L'un veut-il notre gloire, et l'autre notre chute?Combien sont-ils là-haut?Jadis, au fond du ciel, aux yeux du mage sombre,Deux joueurs effrayants apparaissaient dans
l'ombre.Qui craindre? qui prier?Les Manès frissonnants, les pâles ZoroastresVoyaient deux grandes mains qui déplaçaient les
astresSur le noir échiquier.Songe horrible! le bien, le mal, de cette voûtePendent-ils sur nos fronts? Dieu, tire-moi du
douteO sphinx, dis-moi le mot!Cet affreux rêve pèse à nos yeux qui sommeillent,Noirs vivants! heureux ceux qui tout à coup
s'éveillentEt meurent en sursaut!Villequier, 4 septembre 1845.IXO souvenirs! printemps! aurore!Doux rayon triste et réchauffant!--Lorsqu'elle était petite encore,Que sa soeur était tout enfant...--Connaissez-vous sur la collineQui joint Montlignon à Saint-Leu,Une terrasse qui s'inclineEntre un bois sombre et le ciel bleu?C'est là que nous vivions.--Pénètre,Mon coeur, dans ce passé charmant!--Je l'entendais sous ma fenêtreJouer le matin doucement.Elle courait dans la rosée,Sans bruit, de peur de m'éveiller;Moi, je n'ouvrais pas ma croisée,De peur de la faire envoler.Ses frères riaient...--Aube pure!Tout chantait sous ces frais berceaux,Ma famille avec la nature,Mes enfants avec les oiseaux!--Je toussais, on devenait brave;Elle montait à petits pas,Et me disait d'un air très-grave:«J'ai laissé les enfants en bas.»Qu'elle fût bien ou mal coiffée,Que mon coeur fût triste ou joyeux,Je l'admirais. C'était ma fée,Et le doux astre de mes yeux!Nous jouions toute la journée.O jeux charmants! chers entretiens!Le soir, comme elle était l'aînée,Elle me disait: «Père, viens!«Nous allons t'apporter ta chaise,Conte-nous une histoire, dis!»--Et je voyais rayonner d'aiseTous ces regards du paradis.Alors, prodiguant les carnages,J'inventais un conte profondDont je trouvais les personnagesParmi les ombres du plafond.Toujours, ces quatre douces têtesRiaient, comme à cet âge on rit,De voir d'affreux géants très-bêtesVaincus par des nains pleins d'esprit.J'étais l'Arioste et l'HomèreD'un poëme éclos d'un seul jet;Pendant que je parlais, leur mèreLes regardait rire, et songeait.Leur aïeul, qui lisait dans l'ombre,Sur eux parfois levait les yeux,Et, moi, par la fenêtre sombreJ'entrevoyais un coin des cieux!Villequier, 4 septembre 1846.XPendant que le marin, qui calcule et qui doute,Demande son chemin aux constellations;Pendant que le berger, l'oeil plein de visions,Cherche au milieu des bois son étoile et sa route;Pendant que l'astronome, inondé de rayons,Pèse un globe à travers des millions de lieues,Moi, je cherche autre chose en ce ciel vaste et
pur.Mais que ce saphir sombre est un abîme obscur!On ne peut distinguer, la nuit, les robes bleuesDes anges frissonnants qui glissent dans l'azur.Avril 1847.XIOn vit, on parle, on a le ciel et les nuagesSur la tête; on se plaît aux livres des vieux
sages;On lit Virgile et Dante; on va joyeusementEn voiture publique à quelque endroit charmant,En riant aux éclats de l'auberge et du gîte;Le regard d'une femme en passant vous agite;On aime, on est aimé, bonheur qui manque aux rois!On écoute le chant des oiseaux dans les boisLe matin, on s'éveille, et toute une familleVous embrasse, une mère, une soeur, une fille!On déjeune en lisant son journal. Tout le jourOn mêle à sa pensée espoir, travail, amour;La vie arrive avec ses passions troublées;On jette sa parole aux sombres assemblées;Devant le but qu'on veut et le sort qui vous
prend,On se sent faible et fort, on est petit et grand;On est flot dans la foule, âme dans la tempête;Tout vient et passe; on est en deuil, on est en
fête;On arrive, on recule, on lutte avec effort...--Puis, le vaste et profond silence de la mort!11 juillet 1846, en revenant du cimetière.XIIA QUOI SONGEAIENTLES DEUX CAVALIERS DANS LA FORÊTLa nuit était fort noire et la forêt très-sombre.Hermann à mes côtés me paraissait une ombre.Nos chevaux galopaient. A la garde de Dieu!Les nuages du ciel ressemblaient à des marbres.Les étoiles volaient dans les branches des arbresComme un essaim d'oiseaux de feu.Je suis plein de regrets. Brisé par la souffrance,L'esprit profond d'Hermann est vide d'espérance.Je suis plein de regrets. O mes amours, dormez!Or, tout en traversant ces solitudes vertes,Hermann me dit: «Je songe aux tombes
entr'ouvertes;»Et je lui dis: «Je pense aux tombeaux refermés.»Lui regarde eu avant: je regarde en arrière,Nos chevaux galopaient à travers la clairière;Le vent nous apportait de lointains angelus;dit: «Je songe à ceux que l'existence afflige,A ceux qui sont, à ceux qui vivent.--Moi,» lui
dis-je,«Je pense à ceux qui ne sont plus!»Les fontaines chantaient. Que disaient les
fontaines?Les chênes murmuraient. Que murmuraient les
chênes?Les buissons chuchotaient comme d'anciens amis.Hermann me dit: «Jamais les vivants ne
sommeillent.En ce moment, des yeux pleurent, d'autres yeux
veillent.»Et je lui dis: «Hélas! d'autres sont endormis!»Hermann reprit alors: «Le malheur, c'est la vie.Les morts ne souffrent plus. Ils sont heureux!
j'envieLeur fosse où l'herbe pousse, où s'effeuillent les
bois.«Car la nuit les caresse avec ses douces flammes;Car le ciel rayonnant calme toutes les âmesDans tous les tombeaux à la fois!»Et je lui dis: «Tais-toi! respect au noir mystère!Les morts gisent couchés sous nos pieds dans la
terre.Les morts, ce sont les coeurs qui t'aimaient
autrefoisC'est ton ange expiré! c'est ton père et ta mère!Ne les attristons point par l'ironie amère.Comme à travers un rêve ils entendent nos voix.»Octobre 1853.XIIIVENI, VIDI, VIXIJ'ai bien assez vécu, puisque dans mes douleursJe marche, sans trouver de bras qui me secourent,Puisque je ris à peine aux enfants qui
m'entourent,Puisque je ne suis plus réjoui par les fleurs;Puisqu'au printemps, quand Dieu met la nature en
fête,J'assiste, esprit sans joie, à ce splendide amour;Puisque je suis à l'heure où l'homme fuit le jour,Hélas! et sent de tout la tristesse secrète;Puisque l'espoir serein dans mon âme est vaincu;Puisqu'en cette saison des parfums et des roses,O ma fille! j'aspire à l'ombre où tu reposes,Puisque mon coeur est mort, j'ai bien assez vécu.Je n'ai pas refusé ma tâche sur la terre.Mon sillon? Le voilà. Ma gerbe? La voici.J'ai vécu souriant, toujours plus adouci,Debout, mais incliné du côté du mystère.J'ai fait ce que j'ai pu; j'ai servi, j'ai veillé,Et j'ai vu bien souvent qu'on riait de ma peine.Je me suis étonné d'être un objet de haine,Ayant beaucoup souffert et beaucoup travaillé.Dans ce bagne terrestre où ne s'ouvre aucune aile,Sans me plaindre, saignant, et tombant sur les
mains,Morne, épuisé, raillé par les forçats humains,J'ai porté mon chaînon de la chaîne éternelle.Maintenant, mon regard ne s'ouvre qu'à demi;Je ne me tourne plus même quand on me nomme;Je suis plein de stupeur et d'ennui, comme un
hommeQui se lève avant l'aube et qui n'a pas dormi.Je ne daigne plus même, en ma sombre paresse,Répondre à l'envieux dont la bouche me nuit.O Seigneur! ouvrez-moi les portes de la nuitAfin que je m'en aille et que je disparaisse!Avril 1848.XIVDemain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la
campagne,Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun
bruit,Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,Et, quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombeUn bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.3 Septembre 1847.XVA VILLEQUIERMaintenant que Paris, ses pavés et ses marbres,Et sa brume et ses toits sont bien loin de mes
yeux;Maintenant que je suis sous les branches des
arbres,Et que je puis songer à la beauté des cieux;Maintenant que du deuil qui m'a fait l'âme obscureJe sors, pâle et vainqueur,Et que je sens la paix de la grande natureQui m'entre dans le coeur;Maintenant que je puis, assis au bord des ondes,Ému par ce superbe et tranquille horizon,Examiner en moi les vérités profondesEt regarder les fleurs qui sont dans le gazon;Maintenant, ô mon Dieu! que j'ai ce calme sombreDe pouvoir désormaisVoir de mes yeux la pierre où je sais que dans
l'ombreElle dort pour jamais;Maintenant qu'attendri par ces divins spectacles,Plaines, forêts, rochers, vallons, fleuve argenté,Voyant ma petitesse et voyant vos miracles,Je reprends ma raison devant l'immensité;Je viens à vous, Seigneur, père auquel il faut
croire;Je vous porte, apaisé,Les morceaux de ce coeur tout plein de votre
gloireQue vous avez brisé;Je viens à vous, Seigneur! confessant que vous
êtesBon, clément, indulgent et doux, ô Dieu vivant!Je conviens que vous seul savez ce que vous
faites,Et que l'homme n'est rien qu'un jonc qui tremble au
vent;Je dis que le tombeau qui sur les morts se fermeOuvre le firmament;Et que ce qu'ici-bas nous prenons pour le termeEst le commencement;Je conviens à genoux que vous seul, père auguste,Possédez l'infini, le réel, l'absolu;Je conviens qu'il est bon, je conviens qu'il est
justeQue mon coeur ait saigné, puisque Dieu l'a voulu!Je ne résiste plus à tout ce qui m'arrivePar votre volonté.L'âme de deuils en deuils, l'homme de rive en
rive,Roule à l'éternité.Nous ne voyons jamais qu'un seul côté des choses;L'autre plonge en la nuit d'un mystère effrayant.L'homme subit le joug sans connaître les causes.Tout ce qu'il voit est court, inutile et fuyant.Vous faites revenir toujours la solitudeAutour de tous ses pas.Vous n'avez pas voulu qu'il eût la certitudeNi la joie ici-bas!Dès qu'il possède un bien, le sort le lui retire.Rien ne lui fut donné, dans ses rapides jours,Pour qu'il s'en puisse faire une demeure, et dire:C'est ici ma maison, mon champ et mes amours!Il doit voir peu de temps tout ce que ses yeux
voient;Il vieillit sans soutiens.Puisque ces choses sont, c'est qu'il faut qu'elles
soient;J'en conviens, j'en conviens!Le monde est sombre, ô Dieu! l'immuable harmonieSe compose des pleurs aussi bien que des chants;L'homme n'est qu'un atome en cette ombre infinie,Nuit où montent les bons, où tombent les méchants.Je sais que vous avez bien autre chose à faireQue de nous plaindre tous,Et qu'un enfant qui meurt, désespoir de sa mère,Ne vous fait rien, à vous!Je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue;Que l'oiseau perd sa plume et la fleur son parfum;Que la création est une grande roueQui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu'un;Les mois, les jours, les flots des mers, les yeux qui
pleurent,Passent sous le ciel bleu;Il faut que l'herbe pousse et que les enfants
meurent;Je le sais, ô mon Dieu!Dans vos cieux, au delà de la sphère des nues,Au fond de cet azur immobile et dormant,Peut-être faites-vous des choses inconnuesOù la douleur de l'homme entre comme élément.Peut-être est-il utile à vos desseins sans nombreQue des êtres charmantsS'en aillent, emportés par le tourbillon sombreDes noirs événements.Nos destins ténébreux vont sous des lois immensesQue rien ne déconcerte et que rien n'attendrit.Vous ne pouvez avoir de subites démencesQui dérangent le monde, ô Dieu, tranquille esprit!Je vous supplie, ô Dieu! de regarder mon âme,Et de considérerQu'humble comme un enfant et doux comme une femmeJe viens vous adorer!Considérez encor que j'avais, dès l'aurore,Travaillé, combattu, pensé, marché, lutté,Expliquant la nature à l'homme qui l'ignore,Éclairant toute chose avec votre clarté;Que j'avais, affrontant la haine et la colère,Fait ma tâche ici-bas,Que je ne pouvais pas m'attendre à ce salaire,Que je ne pouvais pasPrévoir que, vous aussi, sur ma tête qui ploie,Vous appesantiriez votre bras triomphant,Et que, vous qui voyiez comme j'ai peu de joie,Vous me reprendriez si vite mon enfant!Qu'une âme ainsi frappée à se plaindre est
sujette,Que j'ai pu blasphémer,Et vous jeter mes cris comme un enfant qui jetteUne pierre à la mer!Considérez qu'on doute, ô mon Dieu! quand on
souffre,Que l'oeil qui pleure trop finit par s'aveugler.Qu'un être que son deuil plonge au plus noir du
gouffre,Quand il ne vous voit plus, ne peut vous
contempler,Et qu'il ne se peut pas que l'homme, lorsqu'il
sombreDans les afflictions,Ait présente à l'esprit la sérénité sombreDes constellations!Aujourd'hui, moi qui fus faible comme une mère,Je me courbe à vos pieds devant vos cieux ouverts.Je me sens éclairé dans ma douleur amèrePar un meilleur regard jeté sur l'univers.Seigneur, je reconnais que l'homme est en délire,S'il ose murmurer;Je cesse d'accuser, je cesse de maudire,Mais laissez-moi pleurer!Hélas! laissez les pleurs couler de ma paupière,Puisque vous avez fait les hommes pour cela!Laissez-moi me pencher sur cette froide pierreEt dire à mon enfant: Sens-tu que je suis là?Laissez-moi lui parler, incliné sur ses restes,Le soir, quand tout se tait,Comme si, dans sa nuit rouvrant ses yeux célestes,Cet ange m'écoutait!Hélas! vers le pas [...]