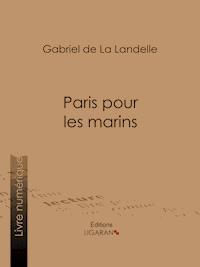Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Extrait : "La mort de la comtesse Jacintha, étouffée dans les bras du misérable Georges Barzien, l'enlèvement de la petite Olyntha par son père, le farouche serment de Braz de San-Pedro, et l'agonie du marquis son oncle, que nous avons laisse mourant chez dame Mercedem, sont des événements qui datent de 1826, c'est-à-dire de cinq ans antérieurs à l'époque où M. de Coisin reçut de Bordeaux, un beau matin, la lettre de Rodolphe Bardan..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
– Suite. –
La mort de la comtesse Jacinta, étouffée dans les bras du misérable Georges Barzien, l’enlèvement de la petite Olyntha par son père, le farouche serment de Braz de San-Pedro, et l’agonie du marquis son oncle, que nous avons laissé mourant chez dame Mercedem, sont des évènements qui datent de 1826, c’est-à-dire de cinq ans antérieurs à l’époque où M. de Coisin reçut de Bordeaux, un beau matin, la lettre de Rodolphe Bardan, s’intitulant toujours comte Do Moëlho.
Grandes aventures à part, cette lettre fit faire à Paul d’Herbilliers les plus sérieuses réflexions :
– Encore une lettre de Bordeaux ! pensa-t-il, encore une communication de M. le baron de Coisin !… Je ne suis pas superstitieux, mais je suis bien forcé de me souvenir qu’Anna pourrait être aujourd’hui ma fiancée ou même ma femme sans la lettre qui a précédé ici MM. de Coisin père et fils !… M. le comte Do Moëlho, puisque comte il y a, continuait Paul, a cinquante-quatre ans aujourd’hui ; sa petite Olyntha n’en a que douze ou treize, au plus. Un barbon et une fillette ne peuvent raisonnablement m’inspirer d’inquiétudes pour l’amour de Clotilde… Malgré cela, je redoute ce Rodolphe Bardan, j’ai peur ; je ne sais pas trop pourquoi… ou plutôt je sais trop pourquoi… Le proverbe populaire dit que Chat échaudé craint l’eau froide ; j’ai peur de l’ombre d’un danger ; mon imagination galope, je bats la campagne ; je suis amoureux, voilà le fait ! La visite du baron de Coisin m’a fait perdre la main d’Anna ; si notre coureur d’aventures, qui nous tombera ici au premier jour allait, par un enchaînement de circonstances quelconques, me faire refuser par Clotilde ?… Il ne s’avisera pas de proposer un gendre à mon oncle, mais il pourrait… il pourrait…
Ici, Paul d’Herbilliers resta court et finit par se rejeter dans le lieu commun :
– Il pourrait me porter malheur !
En haussant les épaules avec dédain, tant cette formule banale lui faisait pitié, Paul conclut en homme qui la prendrait pour base de sa conduite :
– Mon oncle, poursuivit-il, m’a fort judicieusement dit, quand je lui demandai Anna, que je parlais trop tard. Ma tante qui, maintenant, grille d’envie de marier son aînée paraît m’encourager elle-même ; – profitons des circonstances !… Dès demain, c’est arrêté, je tente une démarche définitive.
Le lendemain Paul hésita et remit au jour suivant.
Il tergiversa de la sorte pendant près d’une semaine qu’il consacra, du reste, au culte exclusif de sa cousine Clotilde.
Grands et petits vers, attentions galantes, prévenances, compliments, musique, tendres romances, aimables propos, il ne négligea rien.
Cependant, à la bastide, les jours se passaient en hypothèses et commentaires provoqués par l’étrange lettre de l’aventurier, analyse fort sommaire et singulièrement obscure de sa biographie, depuis sa visite au baron de Coisin, à bord de l’Artémise en 1824, jusqu’à son arrivée à Bordeaux. Adroit mélange d’allusions et de demi-confidences avec d’évidents mensonges destinés à tromper tout lecteur indiscret, la lettre de Bardan se terminait ainsi :
« Vers la fin de 1825, pendant mon séjour en Angleterre, j’écrivis à Châlons. Depuis que j’ai quitté le Brésil avec ma fille Olyntha, j’ai à diverses reprises adressé d’autres lettres à mademoiselle Thérèse. – Son silence m’empêche aujourd’hui de me rendre dans sa ville natale. – Seul au monde, monsieur le baron, vous pouvez me mettre sur la voie que je cherche, et me fournir des renseignements indispensables. Je partirai donc pour Toulon sous peu de jours, avec l’espoir que, cette fois, l’amour paternel sera mon excuse auprès de vous. Votre noble cœur ne verra désormais en moi, j’en suis sûr, qu’un père jaloux d’assurer l’avenir de son enfant. Vous oublierez d’anciennes préventions ; ou, si vous évoquez le passé, vous remonterez jusqu’aux jours où j’étais l’ami d’un brave dont la vie fut sans tache, et qui mourut au champ d’honneur en emportant les regrets et l’admiration de tous vos frères d’armes.
Recevez, etc…
RODOLFO B.comte DO MOELHO. »
En s’aventurant en France, où il était dix fois compromis, et sous le nom de Bardan, et sous celui de comte Des Molleux, Rodolphe était bien obligé de s’envelopper de mystère.
Il venait évidemment confier à sa sœur Thérèse sa fille Olyntha, dont le baron de Coisin n’avait pu soupçonner l’existence, puisqu’à Madagascar l’aventurier ignorait encore qu’il fût père.
Si mademoiselle Thérèse Bardan n’existait plus, Rodolphe venait réclamer au baron de Coisin le dépôt qu’il lui avait confié à bord de l’Artémise.
Mais il était toujours le forçat évadé du bagne de Brest, le banqueroutier mis en fuite après la déconfiture des Vélocifères, l’époux de la comtesse Des Molleux, dont le cadavre, retrouvé sur la route de Belgique, avait motivé des poursuites criminelles, et enfin un agent coupable, sur le compte duquel la haute police possédait un dossier d’inculpations de la plus terrible gravité.
Certainement le comte Do Moëlho devait être pourvu de passeports réguliers, mais le baron de Coisin n’ignorait point que ces papiers étaient donnés à un homme porteur d’un faux nom.
Si Paul d’Herbilliers, épris de Clotilde, fit ses réflexions au point de vue sentimental, à un autre point de vue MM. Roland et de Coisin devaient faire des réflexions encore plus sérieuses.
Après le premier dîner qui suivit la réception de la lettre, ils retinrent auprès d’eux toute la famille.
Tour à tour ils prirent la parole et se repentirent d’avoir trop parlé de Rodolphe Bardan ; ils recommandèrent à leurs enfants la discrétion la plus profonde ; le baron de Coisin conseilla même à M. Roland de ne pas recevoir le vieux coureur d’aventures.
– Cet homme n’a véritablement affaire qu’à moi, dit-il. Je puis en deux mots le renseigner, lui remettre en outre ses titres de rente, et en rester là !… Je le crois parfaitement méconnaissable, déguisé, oublié, à l’abri de toute recherche. Personne ne songe à lui ; on le croit mort ou à l’autre bout du monde ; personne n’a intérêt à le trouver ; on ne soupçonnera point le comte Do Moëlho d’être ce qu’il est, j’en suis convaincu ; et pourtant, étudiez son histoire. Il ne peut jamais conserver une position paisible. La fatalité le fait toujours choir. La fatalité peut le poursuivre ici. Que par un hasard invraisemblable, comme tous les hasards, du reste, on le reconnaisse et on le dénonce ; aussitôt, mon cher Roland, nous voici dans le gâchis jusqu’au cou, mêlés à un interminable et ténébreux procès, dérangés, tracassés, ennuyés à n’en plus finir !… à mon sens, silence absolu désormais sur les faits et gestes de Rodolphe Bardan ; il touche barre chez moi, je le satisfais de mon mieux, et après : bonjour ! bonsoir ! bon voyage !…
L’oncle Roland ne répondit point ; sa femme paraissait de l’avis de M. de Coisin ; mais toutes les jeunes filles, avides de connaître le héros d’un des plus curieux récits de leur père, réclamèrent à la fois.
– L’autre soir, disait Anna, vous-même, messieurs, vous faisiez presque son éloge ; vous le croyiez mort, et vous l’aviez justifié à nos yeux ; il est vivant, il est père, il devient plus intéressant que jamais, et vous voici prêts à le traiter avec rigueur…
– Ne nous privez pas de le voir, s’écria Lucie ; moi, d’abord, je raffole de la petite Olyntha !…
– Et moi donc, murmura Juliette ; elle serait mon amie !
– M. le comte Do Moëlho n’est-il donc pas assez malheureux ? dit Clotilde. La fatalité le poursuivra-t-elle jusque dans cette maison ? Les seules personnes qui excusent ses fautes et qui pourraient l’accueillir avec indulgence lui refuseraient l’hospitalité…
René devait appuyer Anna, Paul ne manqua pas de parler dans le même sens que Clotilde ; Albert lui-même insistait en faveur de Rodolphe Bardan.
Le baron de Coisin n’eût voulu pour rien au monde contrarier sa future belle-fille et tous les enfants de la bastide ; les regards se fixèrent sur le vieux colonel Roland qui fumait lentement sa cigarette.
– Je le recevrai, dit-il enfin avec une certaine émotion ; malgré la sagesse des observations de Coisin, je le recevrai, – non que les désirs de mesdemoiselles mes filles m’influencent aujourd’hui, non que je me laisse aller à une vaine curiosité d’enfant, mais par la même raison qu’autrefois : j’ai contribué à sa première évasion. Je le recevrai chez moi, parce qu’il fut l’ami de Frédéric Dormont, qui n’est plus pour lui tendre les bras, – de Frédéric dont il invoque encore la mémoire !… Vous, Coisin, vous avez à peine connu Frédéric ; il n’était ni de votre âge, ni de votre temps ; vous émigriez lorsqu’il débuta dans la marine ; il périt avant que vous fussiez rentré en France. Dormont n’existe dans vos souvenirs que par la réputation qu’il a laissée parmi nos anciens camarades ; mais Dormont fut mon ami intime, mon frère, mon matelot, comme nous disions ; je recevrai chez moi Rodolphe Bardan comte Do Moëlho !…
Cette déclaration avait quelque chose de triste, qui fit sur tous les hôtes de la bastide une impression heureusement dissipée par la petite Juliette :
– Papa, s’écria-t-elle, soyez tranquille ! j’ai bien compris qu’il faut se taire. Je vous promets que je ne serai pas une enfant terrible, comme vous dites quelquefois.
Un éclat de rire général retentit autour de la vaste cheminée de l’oncle Roland, car, par exception, on était resté au salon ce jour-là, quoique le temps fût magnifique.
– Allons ! puisque Juliette nous y autorise, dit le vieux colonel, que M. le comte Do Moëlho soit le bienvenu !… et le très bien venu, mes enfants. Tout ou rien ! – S’il devient notre hôte, ayons pour lui tous les égards dus à un étranger. N’oubliez pas, d’ailleurs, qu’il m’a rendu plusieurs services importants.
– En sa présence, mon père, dit Clotilde, nous ne nous souviendrons que de ses grands services. Tous ses torts sont effacés parce qu’il y a en lui de sentiments généreux.
– Clotilde parle moins que ses sœurs, pensait Paul d’Herbilliers, mais ce qu’elle dit porte toujours le cachet de la bonté, de la raison, d’une exquise sensibilité, d’une douceur charmante. Je n’ai jamais aimé Anna comme je l’aime. Anna captivait mes yeux et mon esprit, Clotilde me pénètre l’âme. Mon cœur n’est pas moins touché ; mais il l’est, je trouve, d’une manière plus sage. J’éprouve un sentiment d’une nature différente, non moins vif, et meilleur, ce me semble…
Vers la fin de la semaine, Paul, décidé par une foule de petits a parte semblables au précédent, se présenta devant M. et madame Roland sans trop de craintes, leur déclara ses nouvelles intentions et les supplia de lui être favorables.
Sa tante Félicité fut la première à l’approuver cette fois.
– Eh ! eh !… dit l’oncle Roland, très bien, mon ami Paul ; tu vas droit au but ! À la bonne heure ! Le ministre de la guerre n’a pas encore répondu à la demande de René de Coisin ; en nous hâtant un peu, l’on pourrait peut-être encore ne faire qu’une noce !… Mais, voyons ! as-tu adroitement sondé le terrain ? Que va nous répondre Clotilde ?…
– J’espère, mon oncle, qu’elle ne se refusera pas à mon bonheur.
– En ce cas, mon ami, tout ira de soi.
Quelques instants après, M. et madame Roland se trouvant parfaitement d’accord, Clotilde fut mandée.
– Mon enfant, lui dit sa mère, un parti se présente pour toi…
Clotilde demeura calme et sérieuse, ce que M. et madame Roland jugèrent de bon augure ; ils étaient convaincus que leur fille aînée savait déjà ce dont il s’agissait.
– Tes parents, poursuivit la tante Félicité, n’essaieront jamais de forcer tes inclinations. Nous ne voulons pas, quoi qu’il arrive, imposer nos volontés à nos enfants dans une affaire d’où dépend le bonheur de la vie.
– C’est bien cela, dit M. Roland. Nous nous réservons le droit absolu de repousser toute proposition qui nous semblerait fâcheuse ou inconvenante ; mais si le gendre qui se présente est un honnête homme, doué de bonnes qualités, ayant une conduite digne d’éloges, une aisance suffisante, une famille honorable, c’est à notre fille seule qu’il appartient d’accepter ou de refuser.
– Seulement, ajouta madame Roland, nous ne nous sommes pas interdit la faculté de donner nos conseils…
– Je croyais pourtant, dit Clotilde, que toute espèce de conseil avait été refusé à ma sœur Anna.
– Tu te trompes, mon enfant ; en l’autorisant à choisir entre Paul et René, ton père a franchement déclaré ce qu’il pensait de chacun d’eux ; mais ensuite nous n’avons pas voulu l’influencer, autant dans son propre intérêt que pour rester impartiaux entre deux concurrents également convenables. Aujourd’hui, ma fille, tu n’as point à choisir ; tu connais à merveille ton cousin Paul, tu peux donc te prononcer sans hésitation.
Clotilde, étonnée, ne semblait pas avoir bien compris :
– Serait-ce donc Paul qui me demande en mariage ? dit-elle enfin d’un ton de doute.
– Mais, s’écrièrent à la fois M. et madame Roland, nous pensions que tu le savais !…
– J’étais à cent lieues d’y songer, reprit la fière Clotilde ; Paul me demander, moi ! J’avoue que je n’y conçois rien. Si Paul m’en avait parlé à moi-même, j’aurais cru qu’il badinait ; si toute autre personne que vous, mes chers parents, m’en instruisait, je refuserais d’y croire.
– Mais enfin, dit M. Roland avec vivacité, qu’y a-t-il donc là de si extraordinaire ? Paul est un garçon de bon sens, qui a galamment pris son parti du refus de ta sœur Anna. Par sa démarche actuelle, il nous prouve son attachement ; il a le bon goût de reconnaître tes qualités, il est franc, aimable, spirituel ; il t’aime !… Tout cela me paraît fort naturel !…
– Paul a passé quatre ans à courtiser Anna, reprit Clotilde. Il vient de bouder quinze jours après son échec, et maintenant, au bout de huit ou dix autres, c’est sur moi qu’il se rabat ; j’en suis médiocrement flattée, je l’avoue !…
– Clotilde, interrompit madame Roland, je ne m’attendais pas de ta part à une réponse dictée par l’amour-propre…
– N’appelons pas ceci une réponse, s’empressa de dire M. Roland. J’espère bien qu’elle ne refusera point.
– Vous me pardonnerez, mon père, reprit Clotilde du ton le plus calme ; je refuse très nettement, et ne consentirai jamais à être madame Paul d’Herbilliers…
– Corbleu ! voici qui est violent ! s’écria le vieux colonel avec humeur. S’il le faut, mademoiselle, j’accepterai votre singulier refus, mais j’exige au moins que vous m’en donniez les raisons.
– C’est ce que j’allais faire, mon père, répliqua Clotilde avec une respectueuse fermeté ; je ne dirai pas que Paul se presse beaucoup trop, qu’il a l’air de faire un coup de tête, que je lui ai été indifférente pendant quatre ou cinq ans, et que tout à coup il me découvre comme une huitième merveille ; non, ce serait encore de l’amour-propre. Mais ses petits talents de poète me touchent fort peu, sa profession d’avocat ne me séduit guère, son caractère léger n’a pour moi aucun attrait ; je suis habituée à le traiter avec un sans-façon fraternel, je vois en lui un charmant cousin…
– Un charmant cousin, corbleu ! peut devenir un charmant mari ! dit l’oncle de Paul médiocrement touché des motifs de Clotilde.
– Cependant, mon ami, dit madame Roland, si son cousin lui déplaît.
– Il ne me déplaît ni ne me plaît ; mais je ne l’épouserais que si vous me l’ordonniez…
– Allons ! mademoiselle, vous y mettez de l’obstination, restons-en là, interrompit le vieux colonel ; vous mériteriez !… Mais un seul mot ! Je trouve mon pauvre Paul assez à plaindre pour exiger qu’on lui garde le secret le plus absolu de cette dernière démarche.
– Je n’en ouvrirai la bouche à qui que ce soit, et serai pour lui la même aujourd’hui qu’hier, qu’avant-hier, qu’il y a six mois, qu’il y a quatre ans !…
– C’est de l’entêtement puéril !… dit madame Roland avec brusquerie ; mais je renonce à le vaincre !… Tant pis pour toi, Clotilde, si tu restes vieille fille !… Juliette, je gage, se mariera avant toi !
L’ancien colonel, laissant Clotilde avec sa mère, descendit au jardin, où Paul d’Herbilliers, rempli d’espoir, l’attendait impatiemment.
L’oncle Roland lui prit la main, l’entraîna sous la tonnelle, le fit asseoir à ses côtés, et fronçant les sourcils, mâcha entre ses dents quelques paroles inintelligibles.
– Vous me faites frémir, mon oncle ! dit Paul d’une voix étouffée.
– Mon ami, je suis outré, je suis furieux. Je croyais Clotilde plus raisonnable… Tiens ! console-toi, c’est une franche pécore, je te le déclare ! Tu aurais mille fois mieux fait de jeter les yeux sur Lucie. Mademoiselle notre aînée, piquée par je ne sais quelle mouche, s’avise de trouver que tu n’es pas un homme assez sérieux, que tu es trop aimable, que tu as le tort d’être avocat, de faire des vers, d’avoir de l’esprit, d’être son cousin, et presque un frère pour elle… On n’a point idée de balivernes semblables ! Lucie, notre petite folle, ne serait pas à coup sûr si enfant que sa grave sœur !
À côté du bosquet où l’oncle Roland s’acquittait en ces termes de son fâcheux message, Lucie elle-même, cachée par un massif de verdure, cueillait un bouquet. Elle entendit par hasard ; elle comprit le secret de Paul, de Clotilde et de ses parents. Immobile, muette, craignant de faire un pas, retenant son haleine, tremblant d’être aperçue, la jeune fille se garda bien pourtant de fermer les oreilles.
Paul, déconcerté, n’avait pas rompu le silence.
– Mon cher ami, poursuivit l’oncle Roland, reçois non seulement l’expression de nos regrets les plus vifs, à ta tante et à moi mais encore mes excuses !… C’est par ma faute que tu reçois un second échec beaucoup plus pénible que le premier !… D’après mes propres conseils, tu n’as pas perdu un seul jour ; eh bien ! mademoiselle Clotilde trouve surtout que tu t’es trop pressé ! la petite sotte !… J’ai péremptoirement défendu qu’on ouvrît la bouche de tout ceci ; je veux que tu restes parmi nous ; tu me désobligerais infiniment si tu prenais la fuite. Montre-toi tel que tu es, aimable, bon, gracieux ; sois galant envers Lucie, envers Anna autant que le permettent les circonstances, et envers Clotilde elle-même ; je voudrais qu’elle se repentît de son refus, ne serait-ce que pour te fournir l’occasion de prendre ta revanche ! Je voudrais que, faisant le fier à ton tour, tu pusses lui dire merci… Elle se mordra les doigts de son absurde caprice… qui me prive d’un gendre tel que toi !
– Mon oncle, répondit Paul, vous êtes mille fois trop bon !… Clotilde ne mérite pas votre colère ; pardonnez-lui, je vous en conjure, comme je lui pardonne moi-même…
– Ah ! certes, non ! Elle ne portera pas ses belles tirades en paradis !…
– Je me suis trompé, je le vois, ajouta Paul d’Herbilliers avec un accent de tristesse ironique ; j’ai oublié de changer de caractère, de me faire moins frivole et capitaine de hussards ; moins empressé de me rendre agréable et cavalièrement sérieux… Je ne puis empêcher que mon père Joseph d’Herbilliers ait été votre parent, votre ami, votre condisciple et votre compagnon durant votre première campagne à bord de l’Hermione. Je ne puis faire que je sois étranger à votre famille. Mes torts sont irréparables !… Ménagez donc ma sérieuse cousine, je vous en supplie, mon oncle… À quoi bon les reproches, les regrets, les revanches ?… J’avoue que je suis peu disposé désormais à courtiser qui que ce soit ; – la galanterie me paraît chose trop frivole !… Clotilde en me voyant maussade aurait peut-être du chagrin… de grâce, souffrez que je le lui épargne.
– Paul, je conçois ton humeur, mais encore, une fois, ne nous quille pas !
– Je ne me sens pas capable de suivre vos conseils ; Anna, qui a un fiancé digne d’elle, n’a que faire de mes compliments ; Lucie rira fort bien sans moi, et peut-être, si je me laissais aller à lui dire des riens, les trouverait-elle trop sérieux… Quant à Clotilde, toute ma bonne volonté désormais échouerait devant sa froideur !…
M. Roland commençait à se fatiguer.
– Ne m’obligez pas à rester à la bastide, ajouta Paul avec chaleur ; laissez-moi retourner à Toulon, ou plutôt partir pour je ne sais où… J’irai à Paris, j’irai !… Mon Dieu, j’irais au bout du monde si je m’en croyais !…
– Autres folies ! ne désespère encore de rien ! Le bonheur est bien souvent plus près qu’on ne pense ! Demeure au moins parmi nous jusqu’à la fin du congé d’Albert. Tu nous as promis plusieurs fois de ne pas reprendre tes affaires avant qu’il reprît son service…
– C’est vrai, mon oncle ; mais alors…
– Personne ne sera instruit de ta pénible démarche de ce matin ; personne ne comprendrait ton départ, qui produirait ici le plus fâcheux effet. On le croirait jaloux de René, l’on jaserait méchamment peut-être. Anna, ta tante, moi surtout, serions péniblement affectés. Albert serait très mécontent. – Allons Paul ! un peu de fermeté, corbleu ! Tu es un joyeux compère, prouve-le une fois de plus. Si tu veux bouder Clotilde, Lucie ne te boudera pas. Mon fils et mon futur gendre sont de bons compagnons, la saison est superbe, la campagne délicieuse…