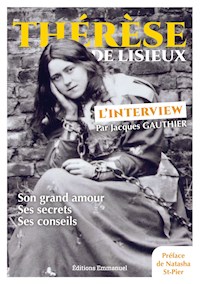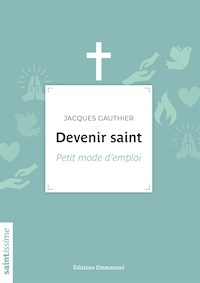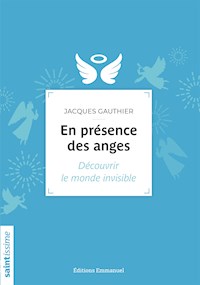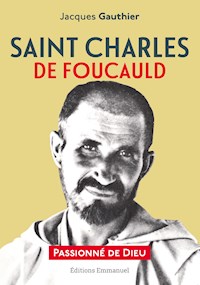Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Französisch
À la soixantaine vient l’heure des bilans et des bouleversements : c’est le temps de la retraite, celui où l’on devient grands-parents, où la santé n’est plus ce qu’elle était…
Mais cet âge offre aussi l’occasion d’un retour sur soi, d’une plus grande liberté et d’une redécouverte de la vie de couple.
Jacques Gauthier nous invite à assumer notre passé et à accueillir nos fragilités. Il aborde aussi bien les réalités de la ménopause et l’andropause que la possibilité de retrouvailles avec Dieu ou la joie partagée avec les petits-enfants.
À tous ceux qui traversent le cap de la soixantaine, l’auteur propose un véritable art de vivre au présent. Il nous montre que la route qui reste à parcourir peut se révéler merveilleuse et pleine d’inattendu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jacques Gauthier
Les défis de la soixantaine
Nouvelle édition revue et augmentée
Conception couverture : © Christophe Roger
Illustration couverture : © Bendo
Composition : Soft Office (38)
© Éditions Emmanuel, 2021
89, bd Auguste-Blanqui – 75013 Paris
www.editions-emmanuel.com
ISBN : 978-2-35389-893-0
Dépôt légal : 1er trimestre 2021
À vous, mes confidents et confidentes, complices dans l’aventure humaine, je dédie ces pages qui constituent un art de vivre au présent.
« Il ne faut pas neuf mois, il faut soixante ans pour faire un homme, soixante ans de sacrifices, de volonté, de… de tant de choses ! Et quand cet homme est fait, quand il n’y a plus en lui rien de l’enfance, ni de l’adolescence, quand vraiment, il est homme, il n’est plus bon qu’à mourir. »
André MALRAUX, La Condition humaine
Introduction
La vie humaine est un chemin en perpétuelle transformation avec ses lignes droites et ses tournants, ses montées et ses descentes. Nous marchons plus ou moins seul dans ce voyage unique, car la route varie pour chacun d’entre nous. Rien n’est tracé d’avance. Naître, grandir et mourir en sont les grands mouvements. Nous avançons en franchissant des étapes et en relevant les défis inhérents à chaque âge : l’enfance, l’adolescence, l’adulte, la vieillesse. Chaque seuil franchi comporte une crise de croissance par laquelle l’individu se fait ou se défait, grandit ou régresse, s’ouvre ou s’enferme.
Les âges de la vie sont séparés par des crises. Ils représentent des formes fondamentales de l’existence humaine, des façons caractéristiques de la vie de l’homme aux diverses périodes de sa route, de la naissance à la mort. Manières de sentir, de voir, de se comporter en face du monde. Ces ensembles de caractères sont si nettement marqués qu’au lieu de passer simplement d’une phase à l’autre, l’homme doit, chaque fois, à chaque degré, se détacher, ce qui peut être difficile au point de pouvoir être dangereux. Ce passage peut être lent ou rapide1.
Des psychologues et auteurs comme Erickson, Jung, Levinson et Sheehy ont montré que la vie adulte est faite de périodes, de stades qui surviennent principalement autour des décennies (trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine). L’idéal est de passer le cap sans trop prolonger l’étape. Les crises à traverser sont vécues différemment selon les contextes socioculturels. Elles poussent la personne à se renouveler de l’intérieur, à découvrir une nouvelle façon d’être. Les éléments déclencheurs sont multiples : une naissance, un décès, une maladie, une rupture, un licenciement, un échec, un changement hormonal, une insatisfaction profonde.
Une opportunité à vivre
La crise est donc une opportunité qui permet de trouver un nouvel équilibre. Elle nous conduit normalement à une plus grande maturité et sérénité. Chaque dépassement est ressenti comme des petites morts qui nous dépouillent, des moments pénibles qui nous redéfinissent, des occasions de croissance qui nous aident à renaître, car nous n’avons jamais fini de nous développer, de nous transformer.
Ce livre sur la soixantaine se situe dans la continuité de mon essai La crise de la quarantaine. Il n’y a pas de commune mesure entre ces deux étapes de l’âge adulte. La première, plus tourmentée, est vue comme « une seconde adolescence », une crise du désir où tout est remis en question ; la deuxième, plus sereine, est celle de l’intégration des valeurs, de la récolte de ce que l’on a semé, de la fécondité intérieure. Cette « sérénité dynamique » suppose que la quarantaine a bien été assumée, ni fuie, ni oblitérée, ce qui aurait pour conséquence de fâcheux retours de bâton quelques années plus tard. On ne peut pas toujours vivre coupé de soi-même, sans connaître son désir profond, qui est le désir d’aimer, sans communier à sa source intérieure, sans boire l’eau de son propre puits. Chaque étape réussie est l’occasion d’un retournement intérieur, d’une mutation. Cette transformation nous donne une plus grande énergie, une nouvelle joie, un sens accru de la liberté.
Certains ont pu dire que la vie était séparée en deux : avant quarante ans et après. Selon le psychologue américain, Daniel Levinson, cette étape de la quarantaine est la plus importante des transitions chez l’homme2. Ses études empiriques, menées auprès de sujets masculins, ont montré que la pointe de la crise se situe normalement entre trente-huit et quarante-trois ans. Elle peut durer jusqu’à cinquante-cinq ans. Cette phase de transition sert de pont entre le jeune adulte, homme ou femme, et l’adulte de l’âge mûr.
Les Romains appelaient senex l’homme de soixante ans, d’où le joli terme de sénilité. On était vieux à soixante ans, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, bien sûr.
Dans ce livre, il faut comprendre la soixantaine comme un âge qui s’échelonne de cinquante-cinq à soixante-dix ans. Cette période arrive souvent après l’andropause et la ménopause. C’est normalement l’étape de la retraite, le temps d’être grands-parents, le début des signes du vieillissement et de la sécheresse spirituelle pour beaucoup, l’accueil de ses propres limites et de l’acceptation de la mort. Chaque individu vit ce stade à son rythme, selon le bilan qu’il fait de son passé et l’orientation qu’il veut donner à son avenir. Tout dépend de sa santé physique et financière, de son évolution psychologique et de son cheminement spirituel. Cette étape peut être ennuyeuse et pénible si l’on reste inactif et amer, ou épanouissante, si l’on a des projets et que l’on demeure vraiment acteur de sa vie.
La soixantaine affecte autant les femmes, qui ont à faire le deuil d’une certaine jeunesse, que les hommes, qui s’interrogent sur leur virilité. Pensons au succès grandissant des crèmes antirides et des pilules comme le Viagra. À l’heure où les baby-boomers ont déjà pris leur retraite, on remarque une frénésie de vivre qui peut être le signe de la peur de vieillir. Il y a illusion à vouloir jouer le jeu de la performance à un âge où l’éparpillement ne comble plus.
La soixantaine peut être l’occasion d’une plus grande liberté intérieure si nous savons en relever les défis. Cet âge invite à faire le tri de ce que nous avons accumulé, à l’intériorité, au silence qui nourrit l’âme, à l’unité entre les différentes parties de notre être physique, psychique, social, professionnel et spirituel. Le désir d’aimer devient le seul qui importe vraiment. Ses fruits sont l’accueil de soi et de l’autre, l’amitié et la tendresse, la sagesse et la sérénité.
Un guide d’accompagnement
Ce livre se présente comme un guide d’accompagnement pour les personnes qui approchent de la soixantaine ou qui la dépassent. Il ne se réduit pas à des recettes et à des réponses toutes faites, car elles sont différentes pour chacun. L’objectif est simple : comprendre le passage de la soixantaine pour mieux le vivre comme une rencontre avec soi-même, les autres, l’univers, Dieu.
Au premier chapitre, nous passerons en revue quelques caractéristiques des âges de la vie, surtout celles de l’âge adulte : l’enfance et la conscience d’amour, l’adolescence et la quête de sens, la trentaine et l’accueil de la vie, la quarantaine et la crise du désir, la cinquantaine et la force d’un second souffle, la soixantaine et la voie de l’intériorité, la vieillesse et l’approche de la mort.
Je dégagerai, au chapitre suivant, quelques attitudes importantes pour bien passer le cap de la soixantaine : assumer son passé, écouter sa blessure, reconnaître sa faiblesse, accueillir sa fragilité, s’émerveiller, désirer aimer, s’abandonner au désir de Dieu.
Le troisième chapitre sera consacré à l’andropause et à la ménopause, phénomènes naturels qui précèdent l’entrée en soixantaine. L’andropause, beaucoup moins connue que la ménopause et qui est aussi un tournant pour l’homme, sera abordée plus longuement.
La soixantaine est marquée par la retraite et la joie de devenir parfois grands-parents, sujets des chapitres 4 et 5. La retraite : défi ou épreuve ? Elle demande sûrement un réaménagement dans le couple, une gestion du temps qui soit en accord avec le sens que l’on donne à sa vie. C’est une pause pour mieux reprendre son élan. Devenir grands-parents est une joie singulière. Pour le vivre moi-même depuis quelques années, je peux témoigner que tenir dans ses bras l’enfant de son enfant procure des sentiments profonds et nouveaux. Les questions d’appartenance à une famille, d’enracinement, de transmission, d’éveil à la foi, seront traitées en lien avec la vie d’aujourd’hui.
Ce passage de la soixantaine pose aussi la question de la spiritualité, c’est-à-dire de la manière dont la personne vit son expérience humaine et spirituelle. Qui dit spiritualité, dit vie, esprit, souffle, amour, dynamisme, intériorité. La vie spirituelle n’évolue pas parallèlement à notre vie quotidienne, elle est en croissance avec et en nous. Mais que faire lorsque Dieu semble absent ? Au sixième chapitre, nous proposerons dix pistes à suivre pour traverser ce désert spirituel que nous connaissons tous un jour ou l’autre.
J’aborderai au septième chapitre la réalité du vieillissement, en ces temps où l’espérance de vie progresse sans cesse. À quel âge commence-t-on à être vieux ? Certainement pas dans la soixantaine. Mais y a-t-il un art du vieillissement ? Vieillir et vivre peuvent-ils aller de pair ? Comment aborder « la vie montante » en évitant le leurre de la jeunesse ?
Le dernier chapitre sera réservé à « notre sœur la mort », selon l’expression de François d’Assise. Elle est réelle dès la naissance et nous suit tout au long des âges de la vie. L’accepter c’est vivre vraiment, corps et âme. La mort sera présentée dans une perspective chrétienne, c’est-à-dire comme une œuvre d’amour, une nouvelle naissance, une résurrection.
Un poème conclura chacun de ces huit chapitres pour mieux les ouvrir sur un horizon de désir et d’intériorité. La poésie nous tend la main au quotidien comme une amie fidèle pour sécréter du sens et construire l’humain là où il est planté. Nous pouvons faire de la soixantaine une œuvre d’art si nous savons découvrir l’insolite et l’imprévu cachés dans la beauté des jours ordinaires.
1. Romano Guardini, Les Âges de la vie, Paris, Cerf, 1976, p. 41.
2. Daniel J. Levinson, The Seasons of a Man’s Life, New York, Ballantine Books, 1979.
1
Les âges de la vie
Point de révolte : honorons les âges dans leurs chutes et le temps dans sa voracité.
Victor SEGALEN, Stèles
On naît comme on peut, après chacun fait de son mieux, qu’il soit seul ou en couple. Notre premier devoir ne consiste-t-il pas à ne pas gâcher cette chance que nous avons de vivre ? Au début, quelqu’un nous prend par la main, nous apprend à marcher, nous conduit à l’école. Puis nous faisons rapidement notre chemin comme des enfants, en sautant, en jouant, en courant, comme si on voulait retenir le temps :
Mais les enfants ce qui les intéresse ce n’est que de faire le chemin.
D’aller et de venir et de sauter. D’user le chemin avec leurs jambes.
De n’en avoir jamais assez. Et de sentir pousser leurs jambes.
Ils boivent le chemin. Ils ont soif du chemin. Ils n’en ont jamais assez3.
Adolescents, nous délaissons le chemin de l’enfance pour risquer d’autres sentiers qui ouvrent sur des horizons nouveaux. Nous arrivons à des carrefours inconnus, nous faisons des choix de vie, nous prenons des chemins de traverse, nous entrons dans l’âge adulte, quelquefois à cloche-pied.
Le temps file selon le tic-tac de l’horloge, nous reprenons souffle à chaque décennie. Nous nous arrêtons au mitan de notre vie. Parfois nous manquons d’air, essoufflés par le rythme effréné de nos sociétés axées sur la performance et la vitesse. Puis arrive le temps de la retraite. Nous pouvions rester debout très tard, maintenant nous nous couchons plus tôt. Après le printemps et l’été, nous voici rendus à l’automne de la vie. Le grand hiver approche et nous nous surprenons à rêver au jardin de l’enfance.
Voici donc une brève synthèse de ces phases qui constituent l’ensemble de la vie. Au risque d’idéaliser ou de généraliser, je veux surtout montrer dans ce chapitre l’intégration réussie des forces psychologiques et spirituelles de la personne. Je sais que les parcours sont différents pour chacun et que la traversée n’est pas la même pour tous. Il y a des naufrages, bien sûr, mais il existe aussi des îles sur lesquelles se reposer avant de repartir.
L’enfance et la conscience d’amour
La vie n’est pas morcelée en parties indépendantes. Elle est inhérente à la personne, et palpable à chaque étape de sa croissance, au début comme à la fin. Elle donne un visage à chaque décennie qui n’existe qu’en fonction du tout. Ainsi, le jeune homme porte en lui son enfance et son adolescence, le sexagénaire prolonge l’expérience et la réalisation de sa jeunesse, le vieillard récolte les fruits de son passé. Et la mort est présente dès le début, comme on retrouve l’enfance à la fin.
Mais l’enfance n’est pas seulement le point de départ d’une vie, elle en est le germe qui s’épanouit ; elle accompagne tous les âges. Elle est l’expérience marquante de notre vie qui nourrit nos rêves et façonne notre identité. Il y a un état d’enfance qui se cache en nous, qui se conjugue au présent pour s’accorder avec le vieillissement et la mort. Gaston Bachelard, phénoménologue de l’imagination poétique et grand ami des poètes, a bien illustré ce noyau d’enfance toujours vivant au fond de l’âme et qui lui donne sa dimension universelle et permanente.
En nous, un enfant vient parfois veiller dans notre sommeil. Mais, dans la vie éveillée elle-même, quand la rêverie travaille sur notre histoire, l’enfance qui est en nous nous apporte son bienfait. Il faut vivre, il est parfois très bon de vivre avec l’enfant qu’on a été. On en reçoit une conscience de racine. Tout l’arbre de l’être s’en réconforte. Les poètes nous aideront à retrouver en nous cette enfance vivante, cette enfance permanente, durable, immobile4.
L’enfant naît et déjà son souffle veut durer. Il quitte la chaleur du sein maternel pour absorber l’amour qui l’entoure comme une nourriture essentielle à son développement. Il attend tout de maman et de papa pour vivre. Il devra quitter la relation fusionnelle avec sa mère pour affronter le monde. S’il est entouré d’amour, malgré les maladresses et les imperfections des parents, la traversée s’annoncera plus aisée. S’il ne se sent pas aimé, ce sera plus difficile, car nous sommes faits pour aimer et être aimés.
Notre enfance, quoique personnelle, rejoint une enfance plus universelle. Elle a mille saisons et aquarelles de couleurs jamais vues. Temps d’apprentissage à la maison comme à l’école, l’enfance reste en nous le premier départ, le principe de vie par excellence. Elle est fixée dans l’image porteuse du premier mot, du premier regard, du premier souvenir, de « l’éternelle enfance de Dieu », dirait Claudel, celle qui ne vieillit pas, qui s’écrit à l’encre de nos désirs, et qui est à l’origine de notre vocation d’homme et de femme.
Pour les chrétiens, « Dieu est amour » (1 Jean 4, 8). Il crée l’être humain à son image et à sa ressemblance, c’est-à-dire par amour et dans l’amour. Le souffle reçu à la naissance est déposé dans une conscience faite pour aimer.
La conscience d’amour du tout-petit se laisse mieux comprendre analogiquement par l’expérience mystique qui est vue, surtout par saint Jean de la Croix, comme un toucher de personne à personne, un contact amoureux, une union à Dieu dans la nuit de la foi. Le tout-petit possède une conscience d’amour qui l’enracine dans la vie de la grâce divine. Cette conscience d’amour est une source substantielle d’unité qui est présente dans la personne à chaque âge de sa vie.
Le petit enfant qui est aimé devient essentiellement un être de confiance et de foi, capable d’aimer à travers toutes les étapes de sa vie. Même si sa mère est tout pour lui, il s’aperçoit assez vite qu’elle n’est pas Dieu. Si elle prie à ses côtés, l’enfant découvrira une autre présence qui peut être tout aussi comblante.
Il est étonnant de voir comment beaucoup d’enfants de cet âge, s’ils en ont l’occasion, aiment faire silence devant l’éclat d’une bougie, la lumière d’une icône, d’une croix. Ils ont une grande capacité contemplative qui découle de leur pensée intuitive et du sens de l’émerveillement. Si le petit enfant entend ses parents réciter souvent des prières comme le Notre Père et le Je vous salue Marie, elles s’imprégneront dans son cœur et pourront l’accompagner aux différentes saisons de sa vie5.
La spiritualité existe déjà chez l’enfant. Certes, elle n’est pas l’expression d’une foi religieuse explicite, mais cette spiritualité émerge de la vie même des tout-petits qui est à la fois sensible, relationnelle et existentielle. Comment découvrir cette spiritualité qui s’ouvre à la transcendance, voire à la contemplation ? En écoutant attentivement les enfants, en partant de leurs paroles et de leurs gestes. C’est ce que fit une observatrice souriante d’une soixantaine d’enfants de trois centres de petite enfance âgés de trois à six ans. Elle a reconnu l’action de l’Esprit agissant au cœur de ces enfants dans leur environnement : « Le pari de cette recherche consiste à croire que le spirituel peut se découvrir dans l’ordinaire du quotidien des petits6. »
L’adolescence et la quête de sens
Nul ne sait à quel âge ou à quelle saison l’enfant nous quitte. Quel vent emporte nos vêtements trop petits pour nous revêtir le corps d’un feu qui veut tout envahir ? Comment reconnaître cet enfant que nous avons été ? Que répondre à cet appel obscur de la vie qui ébranle tout ? L’adolescence : recherche d’autonomie, besoin d’affirmation de soi, quête d’identité, poussée de l’instinct sexuel, appel de la liberté, sans avoir encore les véritables responsabilités à gérer.
Il va, je ne sais où : c’est lui qui mène,
Et il veut se laisser mener comme un enfant.
Il fraye son chemin vers le cœur du printemps7.
L’adolescence suscite un intérêt grandissant depuis quelques décennies. Cette étape émerge véritablement en tant que telle au tournant du XXe siècle avec la société industrielle. Le passage à l’âge adulte est retardé par l’accès aux études et par une entrée plus tardive dans la vie active. Nous assistons, après la Seconde Guerre mondiale, à la naissance d’une catégorie sociale à part. Les jeunes deviennent de plus en plus nombreux – en raison du baby-boom – et plus importants par leur pouvoir d’achat. Les adolescents sont une cible de choix pour le capitalisme et la société devient de plus en plus « adolescentrique » : le plaisir à tout prix, le paraître au détriment de l’être, le sexe sans entraves, le culte du corps. Un slogan de Mai 68 résume bien l’ambiance : « Il est interdit d’interdire. »
L’adolescence se distingue par la puberté. Le jeune devient homme ou femme et les modifications hormonales et physiques qui en découlent peuvent entraîner une phase de malaise identitaire. La sexualité prend beaucoup de place et l’adolescent commence à se définir par ses propres valeurs, ses désirs, ses rêves, sa manière de voir la vie. Il apprend, il explore. Contrairement au calme assez relatif de l’enfance, il vit une certaine insécurité qui le remet en question. Il se définit dans un groupe, en se confrontant à son milieu. Il prend une distance par rapport à ses parents pour se structurer lui-même. Il recherche des modèles qui sont créateurs, aventuriers, libres. Même s’il ressent le besoin de s’isoler et de contester parfois les modèles qu’on lui propose, il revient toujours au groupe, si ce n’est virtuellement grâce à son téléphone portable, car il ne veut pas être rejeté par les autres.
Le jeune désire la totalité de l’expérience, surtout l’expérience de l’amour. C’est dans la mesure où il apprend à aimer, c’est-à-dire à échanger et à se donner, qu’il se constitue comme personne humaine. Il se trouve lorsqu’il a l’occasion de se donner pour quelque chose qui le dépasse : une cause, un rêve, un désir, un ami, une amie, Dieu. Le temps passé à chercher ce plus « grand » que lui n’est jamais du temps perdu.
Peu à peu, la société est devenue davantage individualiste, technologique et consumériste ; la tentation est grande pour les adolescents de consommer toujours plus, dans « le confort et l’indifférence ». Mais l’adolescent est fait pour brûler, pour toucher la beauté, pour partir à la poursuite de « l’inaccessible étoile », comme le chante Jacques Brel, envoûté par l’enfance, et qui a terminé sa vie dans la douceur d’une île, « claire comme un matin de Pâques ».
Dans la conjoncture économique et socioculturelle d’aujourd’hui, le passage de l’adolescence à l’âge adulte survient plus tard, vers le milieu de la vingtaine, et souvent un peu plus, dans la trentaine. On remarque que les jeunes tardent à quitter leur monde fantaisiste et idéaliste pour choisir une carrière et se marier. Souvent captifs des écrans, des réseaux sociaux et des jeux vidéo, ils ne sont pas pressés de sortir de la dépendance de leur famille pour assumer leur autonomie et passer dans le monde réel des adultes. Ce qui occasionne des conflits, les parents ne sachant pas trop comment réagir.
Il n’est pas toujours agréable de s’asseoir à la même table que nos grands adolescents qui se cherchent et se terrent dans un mutisme qui change au gré de leurs humeurs et de leurs hormones. Un jour, c’est la gaieté, le lendemain, c’est la tristesse. Pourtant, ce rapport entre les âges stimule les échanges. Nous avons la tâche de leur transmettre des raisons de croire et d’espérer en la vie, de leur proposer un dépassement pour construire l’avenir, sans les étouffer et les décourager.
Le temps arrive tout de même assez rapidement où ils s’assument eux-mêmes en aimant et en travaillant. C’est l’heure de s’engager professionnellement, hors du nid familial, en fondant leur propre famille, en assumant leur part de responsabilités dans la société. C’est ainsi qu’après un long apprentissage d’insertion sociale, ils prennent progressivement racine en eux-mêmes et acquièrent une certaine indépendance.
La trentaine et l’accueil de la vie
L’individu tente de se faire une place dans la société. Il a pu étudier plusieurs années, a trouvé un emploi, s’est marié ou vit en union de fait, a un enfant, ou désire en avoir. Il doit rembourser ses dettes d’études, se trouver un logement convenable, prouver sa valeur au travail, se conformer à ce que l’on attend de lui. Il ne ménage ni son temps ni ses forces. L’essoufflement le guette.
Cette période de la trentaine s’échelonne de vingt-cinq à trente-cinq ans. Le jeune adulte commence à mesurer l’écart entre ses rêves et la réalité, ses désirs et les obligations de la vie. Il prend conscience du parcours déjà accompli, qu’il est seul à pouvoir assumer, sans trop remettre en question certains de ses engagements, comme son travail et son mariage. Il désire se retrouver davantage lui-même, être plus libre, moins angoissé. Il se pose occasionnellement cette question, qui préfigure la crise de la quarantaine : « Ce que je fais actuellement, est-ce bien cela que je veux faire toute ma vie » ?
Le trentenaire ressent parfois une insatisfaction, résultat d’un désir obscur qui n’est pas comblé. Une partie de lui-même est restée dans l’ombre, à cause des normes socio-culturelles, économiques et parentales. Cette partie enfouie comme un trésor veut maintenant se laisser découvrir. Il s’agit de naître à soi-même, non à ce que les autres attendent. Les relations avec le patron et les collègues de travail, le conjoint et les enfants, se modifient. Le respect de sa personne devient vital, la gratuité dans l’intimité plus importante. Il donne du sens à ses réalisations, mais il constate que ses décisions ne sont pas toujours en conformité avec ses points de repère et ses valeurs.
Vers trente-cinq ans, l’adulte réalise avec plus d’acuité que le temps est limité. Il ne peut pas tout faire. Il connaît mieux ses aptitudes, mais il se demande quelles sont ses priorités maintenant : Est-ce que je peux avoir cette promotion annoncée depuis un mois ? Est-ce que je veux changer de métier ? Dois-je avoir un autre enfant ? Comment être disponible aux enfants et continuer le travail à l’extérieur ? Est-ce que ça vaut la peine de faire tous ces efforts ? Comment assumer le reste de ma vie ?
La tentation est de courir à gauche et à droite, sans prendre le temps de s’arrêter. L’homme ou la femme ne souhaite pas que ses réalisations, son métier, ses fonctions, prennent le dessus sur sa vie intérieure. Il se cherche ; il ressent une plus grande solitude. S’il la fuit, elle l’envahira quelques années plus tard. Il aura beau trouver divers moyens pour combler le vide et l’ennui qu’il ressent, en travaillant toujours plus ou en esquivant les responsabilités conjugales et familiales, il se retrouvera à un carrefour de son existence où il devra choisir le chemin qui est en accord avec ses aspirations profondes.
Alors qu’il approche de la quarantaine, l’adulte est amené à réexaminer ses raisons de croire, d’espérer et d’aimer. Il doit se réapproprier sa foi en s’ouvrant à son désir profond et en vivant en communion avec les autres. En prenant la route de l’intériorité, il scrute le sens profond de ses engagements de vie.
À cet âge, l’homme veut se donner du temps pour approfondir le désir d’aimer, même si le travail prend toute la place. La femme révise ses choix touchant la carrière et la maternité. Les deux ressentent le besoin de s’appartenir davantage. Le défi est d’accueillir la vie qui sourd en eux. Ils ont à s’ajuster à un nouvel impératif qui les pousse vers un horizon inconnu, à l’intérieur d’eux-mêmes. Cela les conduit au tournant le plus marquant de leur existence, le milieu de leur vie.
La quarantaine et la crise du désir
Dérivé du terme grec krisis (décision, jugement), le mot « crise » est utilisé dans un contexte évolutif de croissance. La crise devient ainsi un lieu de croissance, une occasion de grandir, malgré les déséquilibres et les peurs. Il faut donc appréhender la crise comme une opportunité non comme un échec. La quarantaine exprime ce défi de croissance. Les symptômes ne trompent pas : doute, manque de confiance, périodes de dépression, absence de plaisir à accomplir ce que l’on faisait habituellement, indifférence devant la vie, ambivalence, besoin d’aventure et de changement, difficulté à savoir ce que l’on veut, ennui, conscience de la mort, grand besoin d’intériorité, nuit de la foi… Ces indices sont des signaux qui indiquent que des choses sont en train de changer.
Tous ne sont pas frappés de la même façon par cette étape de la quarantaine, crise du désir et de la durée. Pour certains, le passage est graduel ; pour d’autres, il est immédiat. En revanche, tous peuvent la vivre comme une croissance psychologique et spirituelle. Cet âge des premiers bilans et des remises en question place chacun devant l’exigence de la connaissance de soi. L’inquiétude et l’insatisfaction exigent un retour sur soi qui transforme la personne de l’intérieur. Du point de vue de la foi, c’est Dieu lui-même qui est à l’œuvre et qui cherche à ébranler le cœur humain pour le délivrer de ses illusions et l’ouvrir à une nouvelle rencontre avec son mystère. La quarantaine devient alors un chemin de renaissance.
Au mitan de la vie, les certitudes s’effritent, les émotions s’entremêlent, les questions se multiplient. C’est le temps de recentrer sa vie en fonction du désir profond qui correspond à l’élan vital de l’être. Approfondir ce désir qui fait vivre, c’est aller au bout de soi-même, monter toujours plus haut, se dépasser en se décentrant de soi pour se tourner vers l’autre. Le désir, contrairement au besoin répétitif, est du domaine de la communication, de la relation, de l’amour, du spirituel en nous. Encore faut-il le nommer, l’ouvrir au désir de Dieu sur soi. La crise de la quarantaine en est l’occasion rêvée, car elle invite au changement et à l’intériorisation. On part à la conquête des aspects de sa personnalité que l’on a auparavant négligés.
Le seuil des quarante ans est aujourd’hui un moment critique dans l’existence humaine. Jusqu’à ce tournant, l’itinéraire de beaucoup d’hommes et de femmes fut plein d’efforts et de réussites. Au moment où ils se réjouissent d’être « arrivés », voici que surgit un harcèlement inattendu : il faut se recycler, voire se réorienter ou même changer de métier ; il faut devenir plus compétitif, car âpre est la lutte économique, précaire mainte situation. Il faut se remettre en question… Une fois la crise surmontée, les plus courageux – ou les plus chanceux – parviennent à ce que Beirnaert appelle la sérénité dynamique : état calme, et non « plat », de santé humaine. Ils vont leur chemin, paisibles parce que réalistes. Ils entreront en leur vieillesse avec une assurance contagieuse pour leurs proches8.