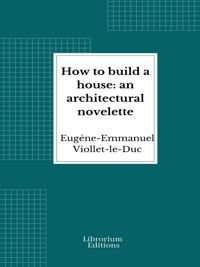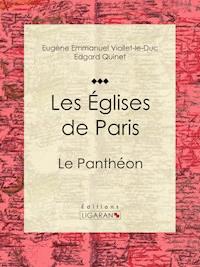
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"Les Eglises de Paris est un ouvrage incontournable pour tous les amateurs d'architecture et d'histoire. Écrit par deux grands noms de la littérature et de l'architecture, Viollet-le-Duc et Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, ce livre offre une exploration détaillée des églises de Paris, mettant en lumière leur beauté, leur histoire et leur importance dans la ville.
Viollet-le-Duc, célèbre pour ses restaurations de nombreux monuments historiques, apporte son expertise en architecture gothique et en histoire de l'art pour offrir une analyse approfondie des églises parisiennes. Quant à Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, écrivain et historien, il apporte un regard littéraire et poétique sur ces édifices emblématiques.
Ensemble, ils nous emmènent à la découverte de ces lieux de culte, nous dévoilant les détails architecturaux, les symboles religieux et les anecdotes historiques qui les entourent. À travers des descriptions vivantes et des illustrations magnifiques, Les Eglises de Paris nous invite à redécouvrir ces trésors de l'architecture française.
Que vous soyez passionné d'histoire, d'architecture ou tout simplement curieux de mieux connaître les églises de Paris, ce livre saura vous captiver et vous émerveiller. Une lecture enrichissante et inspirante qui vous transportera au cœur de la capitale française et de son patrimoine exceptionnel.
Extrait : ""L'église cathédrale de Paris est comme les héros, elle a deux histoires, l'une légendaire, l'autre réelle, et comme toujours aussi, la légende est au-dessous de la réalité."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335014730
©Ligaran 2015
L’église cathédrale de Paris est comme les héros, elle a deux histoires, l’une légendaire, l’autre réelle, et comme toujours aussi, la légende est au-dessous de la réalité. Si l’on s’en rapportait aux auteurs les plus anciens qui ont écrit sur Notre-Dame de Paris, le monument que nous voyons aurait été commencé, tout au moins, du temps de Charlemagne, et n’aurait été achevé que sous Philippe le Bel. Il n’aurait pas fallu moins de six siècles environ pour accumuler ces stratifications de pierres. De s’enquérir comment un plan, dressé sous Hercandus, quarante-deuxième évêque de Paris, aurait pu être suivi à travers les siècles et dans un pays aussi prompt aux changements que le nôtre, on ne s’en souciait guère. Cependant, le R.P. Du Breul, qui écrivait en 1612, ne laisse pas que d’élever un doute à l’endroit de cette prodigieuse lenteur, et incline à penser que l’évêque Maurice de Sully « l’a possible recommencé du tout ». Et, en effet, sur la tombe du digne prélat, placée jadis au milieu du chœur de l’église des religieux de Saint-Victor, on lisait : « Hic jacet R.P. Mauricius, episcopus Parisiensis, qui primus magnam busilicam Sanctæ Mariæ Virginis incohuvit. Obüt anno D 1196,3 idus septembre ». Il n’y avait donc point à s’y tromper, Maurice de Sully avait bien commencé ou recommencé, si l’on veut, la cathédrale de Paris. La légende dit encore que l’église est fondée sur pilotis. Corrozet, du Breul, et tant d’autres qui ont copié sans scrupule ces deux auteurs, ont répété cette fable. J’ai même, dans ma jeunesse, entendu un bonhomme prétendre qu’un vieillard, de lui connu, s’était promené en bateau, disait-il, entre les pilotis de la cathédrale. Le fait est que les fouilles n’ont montré nulle part l’apparence d’un pilotage, mais bien de belles et hautes assises de pierres, parfaitement taillées, posées sur le sable de la Seine. La légende veut aussi que les vingt-huit statues colossales qui garnissent la galerie inférieure du portail occidental représentent les rois de France jusqu’à Philippe Auguste, tandis que ces statues sont celles de rois de Juda, considérés comme les ancêtres de la Vierge, l’église cathédrale étant placée sous le vocable de la mère du Sauveur. Mais la légende dit encore bien d’autres choses.
Avant Maurice de Sully, deux églises couvraient à peu près l’espace occupé par la cathédrale actuelle, l’une sous le vocable de saint Étienne, qui était la plus ancienne, l’autre dédiée à la Vierge Marie. L’archidiacre Étienne de Garlande, qui mourut en 1142, fit faire des réparations importantes à l’église Sainte-Marie. De ces travaux, il nous reste les beaux bas-reliefs du tympan de la porte Sainte-Anne et quelques voussures, replacés au commencement du XIIIe siècle, lorsqu’on éleva la façade que nous voyons. C’était une habitude assez ordinaire, lorsqu’on reconstruisit à cette époque les grandes cathédrales, de conserver des parties ou des fragments des monuments antérieurs. Le même fait se présente à Chartres, à Bourges, à Rouen.
Si l’on tient compte des difficultés que présentait au XIIe siècle l’érection d’un vaste édifice dans la Cité, alors populeuse, encombrée de palais, d’églises et de maisons, à cette époque où l’on ne possédait que peu de moyens de transport, où les engins faisaient défaut, on peut s’émerveiller de l’activité des constructeurs de Notre-Dame. Commencée en 1163, en 1182 le maître-autel était consacré ; en 1196, Maurice de Sully, en mourant, laissait 5 000 livres pour couvrir en plomb la toiture de la partie orientale. Alors le chœur était achevé jusqu’au transept, la nef était fondée. Continués sous l’épiscopat d’Eudes de Sully et sous celui de Pierre de Nemours, les travaux, à la mort de Philippe Auguste, en 1223, étaient presque achevés, l’église était entièrement voûtée et la partie supérieure du portail seule restait à terminer. L’œuvre, interrompue pendant quelques années, reprise en 1230, fut complétée vers 1235, sauf les flèches en pierre, qui devaient couronner les deux tours et dont les amorces restent en attente depuis cette époque. Mais le colosse, achevé, subit bientôt des modifications notables. Il faut savoir qu’à la fin du XIIe siècle et au commencement du XIIIe, les cathédrales que l’on reconstruisit dans les provinces du nord de la France, avec une prodigieuse ardeur, n’étaient pas seulement des édifices religieux. Les ordres monastiques bénédictins, sapés par saint Bernard, penchaient vers leur déclin. Les communes déjà riches secouaient le joug féodal et s’insurgeaient. Les évêques, dont le pouvoir diocésain, si puissant sous les Mérovingiens et les premiers Carlovingiens, avait été singulièrement amoindri par les établissements monastiques de Cluny, cherchaient à ressaisir ce pouvoir dans toute son étendue ; ils comprirent bientôt l’avantage qu’ils pouvaient tirer des tentatives d’affranchissement des communes, et offrirent à celles-ci d’élever dans les villes épiscopales un monument, qui fût à la fois civil et religieux, refuge de la cité, dans lequel pourraient se rassembler les citoyens, sous la protection épiscopale, fût-ce même pour discuter les affaires de la commune. S’appuyant sur un raisonnement médiocre, mais qui eut un plein succès, l’épiscopat prétendait « que l’Église, en vertu du pouvoir que Dieu lui a donné, devait prendre connaissance de tout ce qui est péché, afin de savoir s’il convient de remettre ou de retenir, de lier ou de délier. Dès lors, comme tout procès résulte d’un crime, d’un délit ou d’une fraude, le clergé soutenait avoir le droit de juger toutes les causes, affaires réelles, personnelles ou mixtes, causes féodales ou criminelles ». Le peuple ne voyait pas d’un mauvais œil ces empiétements sur le pouvoir féodal laïque ; il trouvait dans les cours ecclésiastiques une manière de procéder moins barbare que celle dont on faisait usage dans les justices seigneuriales. Le combat n’y avait jamais été admis ; l’appel y était reçu ; on y suivait le droit canonique, qui se rapproche, à beaucoup d’égards, du droit romain ; en un mot, toutes les garanties légales que refusaient les tribunaux des seigneurs, on était certain de les obtenir dans ces cours ecclésiastiques. C’est alors que, soutenus par le pouvoir monarchique déjà puissant et qui ne voyait pas sans une secrète satisfaction l’abaissement de la puissance indépendante des ordres religieux et les empiétements sur la juridiction féodale, forts des sympathies des riches populations urbaines, qui se précipitaient vers toutes les issues ouvertes sur les voies de l’affranchissement, les évêques songèrent à doter leurs villes épiscopales d’un monument fait sur un nouveau programme. Ils trouvèrent rapidement des sommes considérables, et jetant bas les vieilles cathédrales, ils commencèrent ces monuments immenses, destinés à réunir autour de la cathedra, de la chaire épiscopale, les populations désireuses de trouver un centre pour leurs assemblées. Cela se passait à la fin du règne de Louis le Jeune et sous Philippe Auguste. C’est, en effet, sous le règne de ces princes que nous voyons commencer et élever rapidement les grandes cathédrales de Soissons, de Paris, de Laon, de Chartres, de Reims, d’Amiens, de Rouen, de Senlis, de Meaux, de Bourges. Ce n’est plus dans les couvents que les évêques vont demander des architectes ; ils les prennent dans la population laïque. L’élan fut prodigieux. L’argent abondait, et ces grandes églises s’élevaient comme par enchantement. Mais l’alliance du haut clergé avec la monarchie, l’influence qu’il prenait dans les cités épiscopales ne tarda pas à inquiéter les barons. Saint Louis reconnut bientôt que, pour échapper aux dangers que les prétentions de la féodalité laïque faisaient courir sans cesse au pouvoir royal, le suzerain aurait affaire à d’autres maîtres et qu’il tomberait bientôt aux mains d’une oligarchie cléricale soumise à Rome. D’un autre côté, les bourgeois des villes ne trouvaient pas dans les cours épiscopales les garanties sur lesquelles ils comptaient, et les excommunications, se mêlant aux procédures, causaient des troubles notables dans les familles et les cités. En 1235, la noblesse de France et le roi s’assemblèrent à Saint-Denis pour mettre des bornes à la puissance que les tribunaux ecclésiastiques s’arrogeaient. Il fut arrêté d’un commun accord : 1° que leurs vassaux ne seraient point obligés de répondre en matière civile ni aux ecclésiastiques ni à leurs vassaux, devant le tribunal ecclésiastique ; 2° que si le juge ecclésiastique les excommuniait pour ce sujet, il serait obligé de lever l’excommunication par la saisie de son temporel ou de celui qui aurait poursuivi la sentence ; 3° que les ecclésiastiques et leurs vassaux seraient contraints de répondre devant les laïques dans toutes les causes civiles de leurs fiefs, mais non de leurs personnes .
Au mois de novembre 1246, après que les prétentions des évêques de France, soutenus par les papes, malgré les décisions du roi et des barons, eurent causé des troubles sérieux dans plusieurs villes du royaume, la noblesse rédigea un acte d’union, par lequel elle s’engageait à maintenir ses droits contre le clergé, sans se mettre en peine des excommunications . Les délégués de cette assemblée furent le duc de Bourgogne, le comte Pierre de Bretagne, le comte d’Angoulème, fils aîné du comte de la Marche, et le comte de Saint-Paul. L’acte de délégation, rédigé en latin et en français, témoignait ouvertement que le désir des barons était de réduire les ecclésiastiques à l’état de pauvreté de la primitive Église. « Il est dit en somme que ces seigneurs ligués étaient tous les grands du royaume, et on en parle comme d’une conspiration générale de la France appauvrie par la cour de Rome… » On remarque que saint Louis favorisa cette ligue et en fit sceller l’acte de son sceau. On ajoute même que, suivant l’avis de son conseil, il révoqua la permission qu’il avait donnée au pape de lever de l’argent sur les ecclésiastiques… . D’ailleurs, le roi Louis IX avait institué ses baillis royaux. Ceux-ci, présents dans les cours seigneuriales, toutes fois qu’ils le jugeaient convenable, déclaraient la cause cas royal et la portaient à la cour du roi, qui enlevait ainsi à la féodalité une de ses prérogatives souveraines. C’était une garantie pour les parties, qui trouvaient plus d’équité, plus de lumières dans le parlement du roi que dans les cours féodales. La tentative des évêques avortait ; aussi toutes les grandes cathédrales qui ne furent point achevées avant 1215 ne purent-elles être terminées qu’à grand-peine, quand la construction n’en fut pas interrompue pour toujours.
Alors Notre-Dame de Paris était élevée, sauf les flèches en pierre des deux tours, ainsi que nous l’avons dit tout à l’heure ; l’église était entièrement bâtie sur le programme mi-religieux, mi-civil des cathédrales françaises de la fin du XIIe siècle. Elle ne possédait point de chapelles. L’autel seul, au milieu du rond-point de l’abside, était entouré des stalles du chapitre, la chaire de l’évêque dans l’axe. Les collatéraux de cette abside étaient de plain-pied avec le chœur. C’était la basilique antique avec son tribunal, ses galeries latérales à rez-de-chaussée et au premier étage. Le transept était marqué, mais ne formait point de saillies sur les bas-côtés . Des fenêtres larges, sans meneaux, percées dans les murs des bas-côtés, éclairaient la partie basse de l’église ; d’autres baies plus longues, ouvertes sous les voûtes des galeries supérieures, les éclairaient ainsi que la nef centrale ; et, enfin, un troisième rang d’ouvertures, également sans meneaux, faisait pénétrer le jour sous les hautes voûtes . Des roses, percées sous les combles des galeries supérieures, occupaient l’espace libre entre les arcs de ces galeries et l’appui des fenêtres supérieures. Cette disposition était simple, large, sévère. La cathédrale, ainsi faite, avait un caractère d’unité et de grandeur que les adjonctions postérieures lui ont fait perdre en partie. Dans ces basiliques, au milieu desquelles l’autel unique semblait présider, se tenaient des assemblées qui n’avaient rien de religieux. Des marchands s’établissaient intérieurement dans les collatéraux. Là, à toute heure du jour, on pouvait se réunir, s’occuper des affaires de la cité. Il faut se rappeler qu’alors tout acte, même civil, se rattachait par un certain côté aux habitudes religieuses ; qu’en toute occasion il fallait avoir recours à l’intervention des clercs, et on reconnaîtra que les évêques étaient parfaitement entrés dans l’esprit de leur époque en élevant ces larges abris dont ils occupaient le centre et où il semblait qu’ils dussent être pour toujours les arbitres des intérêts de la cité.
La féodalité laïque et la royauté, réunies cette fois, mirent fin à ce rêve d’une théocratie féodale. Il fallut se résoudre à faire des cathédrales des édifices purement religieux. Les communes, désormais assurées de trouver dans la royauté un pouvoir judiciaire régulier, supérieur aux justices seigneuriales, ayant fait l’expérience des cours où l’excommunication se mêlait aux procédures, ne donnèrent plus d’argent. Cet enthousiasme, que les historiens modernes présentent trop comme exclusivement religieux, s’éteignit comme il s’était allumé, avec les causes qui l’avaient fait naître. La cathédrale de Beauvais, fondée en 1225, restait inachevée ; celles de Troyes, de Tours, d’Auxerre, commencées en même temps, n’étaient à peu près terminées que beaucoup plus tard. Les constructions de celle d’Amiens, commencées en 1220, étaient interrompues vers 1240, et ne pouvaient être poursuivies qu’à l’aide des plus grands efforts, pauvrement, en abandonnant même une partie des projets primitifs. La première pierre de la cathédrale de Reims était posée en 1212 ; vers 1250, l’œuvre n’était pas entièrement achevée et ne put l’être qu’à grand-peine ; encore les flèches des deux tours de la façade occidentale ne furent-elles pas construites.
Paris, centre du pouvoir suzerain, déjà puissamment établi au milieu du XIIIe siècle, devait subir, plus qu’aucune autre ville du domaine royal, l’influence de ces mouvements dans la politique intérieure du royaume. À Beauvais, à Reims (l’histoire en fait foi, les évêques résistèrent et tentèrent de maintenir la suprématie à laquelle prétendaient les cours épiscopales ; mais à Paris, rien de semblable. Il paraîtrait, au contraire, que les évêques se seraient résignés, plus facilement que partout ailleurs, à ne voir dans leur cathédrale qu’un édifice purement religieux. Vers 1245, déjà les chapelles étaient pratiquées entre les contreforts de la nef, en supprimant le mur, percé de fenêtres, qui fermait le double bas-côté. Avant cette époque, c’est-à-dire vers 1240, le fenêtrage supérieur de la nef et du chœur était changé. Les anciennes fenêtres, agrandies aux dépens des roses percées au-dessus de la galerie, étaient garnies de meneaux. Par suite de cette modification dans la disposition primitive des hautes œuvres, les voûtes de la galerie jadis rampantes pour ouvrir de plus grands jours sur la nef , étaient rétablies de niveau et les anciennes fenêtres du triforium diminuées. Les corniches supérieures étaient refaites avec une forte saillie de feuillages, un chéneau et des balustrades. Un jubé était élevé devant le chœur . Les choses restèrent en cet état jusqu’en 1257. Par suite de la construction des chapelles entre les contreforts de la nef, les deux pignons du transept, de la fin du XIIe siècle, se trouvaient en retraite de la saillie formée par ces chapelles, ce qui devait produire extérieurement et intérieurement un très mauvais effet. Ainsi que le constate l’inscription sculptée à la hase du portail méridional, les pignons du transept furent démolis et avancés d’une travée en 1257 . Le maître des œuvres, Jean de Chelles, construisit les deux magnifiques pignons du nord et du midi, et les premières chapelles du chœur, jusqu’à la porte Rouge inclusivement, du côté septentrional, et jusqu’à l’ancienne galerie de communication de l’évêché, du côté méridional. Au commencement du XIVe siècle, l’évêque Matiffas de Bucy fit construire les chapelles du rond-point, entre les saillies des anciens contreforts de l’église de Maurice de Sully. Quant aux grands arcs-boutants, autrefois à deux volées, l’abaissement des voûtes du triforium en nécessita la construction en une seule volée. Ceux de la nef furent refaits d’après ce dernier tracé, vers 1245, au moment où l’on construisait les premières chapelles ; ceux du chœur, de 1260 à 1300. C’est aussi à cette dernière date qu’il faut reporter la réfection des fenêtres absidales de la galerie supérieure.
Comme nous l’avons dit, un jubé avait été élevé devant le chœur, au milieu du XIIIe siècle. La clôture du tour de ce chœur ne fut cependant commencée qu’à la fin du XIIIe siècle, par Jean Ravy, maçon de Notre-Dame, lequel y travailla pendant vingt-cinq ans. L’inscription qui donnait le nom de cet imagier ajoutait que l’œuvre avait été parfaite, en 1351, par Jean le Bouteiller. De cette clôture en pierre et de ce jubé il ne reste que les deux parties au nord et au sud, derrière les stalles. Le segment, qui entourait l’abside et dont les sujets ajourés se voyaient du dedans et du dehors du sanctuaire, fut détruit en 1699. Lorsque Louis XIV voulut acquitter le vœu qu’avait fait le roi Louis XIII son père, en mettant le royaume de France sous la protection de la Vierge, par lettres patentes du 10 février 1638. Les travaux ordonnés par Louis XIV coûtèrent plus d’un million de livres ; terminés une année seulement avant sa mort, ils comprenaient toute une décoration de marbres et de bronze . Le groupe du Christ descendu de la croix, les deux statues de Louis XIII et de Louis XIV, les anges en bronze, les stalles en chêne sculpté et le pavage en mosaïque existent encore. Un autel fort riche avait remplacé le charmant autel du XIIIe siècle, avec ses colonnes en bronze doré, surmontées de statues d’anges, et l’édicule sur lequel était placée la châsse de saint Marcel.
Pour exécuter les travaux ordonnés par Louis XIV, on détruisit encore de magnifiques tombes en bronze, qui se trouvaient placées dans le chœur et qui recouvraient les restes de grands personnages, entre autres d’Isabelle de Hainaut, première femme de Philippe Auguste ; de Geofroy, duc de Bretagne, qui mourut en 1186 ; d’une comtesse de Champagne, et d’un certain nombre d’évêques. Une statue en pierre, peinte et couverte d’incrustations de pâtes coloriées, dont on a retrouvé des restes, était dressée à la droite de l’autel, contre un pilier : c’était celle de Philippe Auguste. Des stalles en bois sculpté, fort riches, à dossiers recouverts de cuirs dorés, avaient été élevées, au commencement du XIVe siècle, des deux côtés du chœur. Elles furent détruites et remplacées par les chaires que l’on voit aujourd’hui, lesquelles sont d’ailleurs d’un beau travail.
La Révolution de 1792 fit subir à la cathédrale de Paris de nouvelles mutilations. Les statues des portails, y compris celles des vingt-huit rois de Juda, qui passaient pour représenter des rois de France, furent jetées bas. Le même sort fut réservé aux nombreuses statues qui, à l’extérieur, étaient placées dans les niches des chapelles du chœur.
En 1793, par un arrêté, la Commune de Paris décida que les gothiques simulacres des rois, qui ornaient la façade de Notre-Dame, seraient renversés, ainsi que les effigies en marbre ou en bronze. Cependant, à la fin de Pan H, le citoyen Chaumette réclama en faveur des arts et de la philosophie ; il affirma que l’astronome Dupuis avait établi son système planétaire en consultant les sculptures de l’une des portes de la cathédrale. Le conseil municipal décréta donc que Dupuis serait adjoint à l’administration des travaux publics, afin de conserver les monuments dignes d’être transmis à la postérité.
Il faut constater d’ailleurs que les populations des grandes villes du Nord de la France aimaient leurs cathédrales et voyaient encore en elles, suivant le programme de leur édification, le monument de la cité. Les fureurs populaires s’acharnaient à détruire les églises abbatiales, mais elles respectaient les cathédrales. La plupart de ces monuments conservaient même leur belle statuaire. Reims, Chartres, Amiens étaient heureusement préservés de toute mutilation. Sur un panneau de porte de cette dernière église, on lisait encore, il y a quelques années, cette phrase gravée avec la pointe d’un canif : « Les républiquain (sic) Lillois ont trouvé de toute indignité de laisser dans un temple de la Raison, tant de hochet (sic) du fanatisme. Signé : Dubois, 2eannée républicaine. »
Les vitraux qui décoraient les fenêtres de la cathédrale de Paris avaient été enlevés par ordre du chapitre, dès 1741, et remplacés par des verres blancs avec bordures fleurdelisées. Seules, les trois roses conservaient leurs verrières coloriées. Quelques travaux intérieurs furent ordonnés par Napoléon Ier avant le sacre. On éleva un maître-autel ; le sanctuaire fut clos de grilles en fer avec socle en marbre. Des ambons, également en marbre, remplacèrent les débris du jubé construit par le cardinal de Noailles, à la place qu’occupait l’ancien jubé du XIIIe siècle.
Notre-Dame de Paris renfermait des monuments dont la destruction, fort regrettable, ne peut être imputée tout entière aux dernières années du XVIIIe siècle. Parmi les monuments enlevés en 1792, l’un des plus intéressants était la statue équestre de Philippe de Valois. Ce prince, après la victoire de Cassel, revenant à Paris, était entré à cheval, entouré de ses barons, dans l’église Notre-Dame, dédiant ainsi son harnois royal à la Vierge. En mémoire de ce fait, une statue équestre avait été érigée sur deux colonnes, contre le dernier pilier sud de la nef. Cette image était revêtue des armes mêmes du prince, chanfreins, hoqueton, haubert, etc. On voyait encore ce précieux monument en 1792, et il n’est pas besoin de faire ressortir l’intérêt qu’il aurait pour nous aujourd’hui , puisque nous ne possédons pas un seul harnois de guerre du XIVe siècle. D’autres monuments consacraient aussi certains faits importants dont la vieille église avait été le témoin. Les drapeaux enlevés par les armées françaises étaient suspendus au niveau des galeries hautes ; mais, par une attention qui fait honneur à notre pays, ces signes de victoires étaient enlevés pendant la paix.
Si les piliers de Notre-Dame de Paris avaient une voix, ils raconteraient toute notre histoire, depuis le règne de Philippe Auguste jusqu’à nos jours. De combien d’évènements n’ont-ils pas été les témoins ! C’est sous les voûtes de cette église que saint Dominique prêcha, après une apparition de la Vierge, dit la légende ; que le comte de Toulouse, Raymond VII, vint abjurer l’hérésie, nu, en chemise auprès de l’autel. C’est là que Henri VI d’Angleterre fut couronné roi de France, en 1431 ; qu’en 1436 fut chanté le Te Deum, à l’occasion de la reprise de Paris par les troupes de Charles VII.
Pendant la domination des Seize, les galeries de l’église servaient d’habitation aux troupes populaires de la Ligue, qui, à la voix des clercs, sortaient de ce casernement d’un nouveau genre pour courir sus aux Politiques et entretenir la terreur parmi les bourgeois paisibles .
Mariages, baptêmes, obsèques, serments et vœux éternels, bientôt démentis par d’autres vœux et d’autres serments ; fêtes populaires, fêtes royales ; chants d’allégresse et de deuil ; apologies et anathèmes ; oraisons funèbres pour les rois et pour les morts à l’attaque de la Bastille ; culte de la déesse Raison et des théophilanthropes ; réinstallation du culte, en 1802 ; sacre de Napoléon Ier et baptême de princes au berceau, qui ne devaient point régner ; la vieille église, impassible, fut un abri protecteur pour tant de misères et de splendeurs, pour les espérances et les malheurs de la population parisienne. Aussi ne faut-il pas s’étonner si le peuple de Paris a conservé pour ces pierres séculaires une vénération qui ne se démentit jamais. C’est le lien visible qui le rattache à un passé plein de grandeur, même pendant la tourmente ; ce sont ses titres de noblesse. Peu d’entreprises furent plus populaires que celle de la restauration de Notre-Dame. Les travaux, commencés sous le règne du roi Louis-Philippe, en 1845, à la suite d’un vote des Chambres, furent continués pendant la République, conduits avec des ressources plus étendues et achevés sous le règne de Napoléon III. Des souscriptions, recueillies avec un esprit de suite et un zèle peu communs par les archevêques de Paris, la fabrique et l’archiprêtre actuel de la cathédrale, ont permis de rendre à l’intérieur de l’église son lustre ancien. Les chapelles ont été peintes, le mobilier a été renouvelé, le trésor s’est enrichi d’objets précieux par le travail et la matière, si bien qu’après tant de mutilations et de spoliations, Notre-Dame redevient l’église métropolitaine digne d’un grand pays. Bientôt isolée au milieu de larges espaces, de jardins, de promenades, ayant sous son ombre l’Hôtel-Dieu reconstruit à neuf, l’archevêché et les services nécessaires au culte, au centre du Paris nouveau, elle montrera que ces premiers constructeurs prévoyaient les destinées futures de la grande ville, puisqu’ils avaient su lui donner cette grandeur et ce noble aspect.