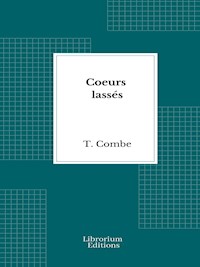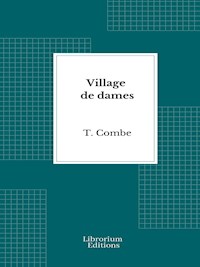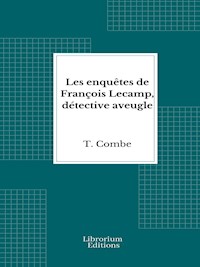
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Französisch
C’est moi, François Lecamp, qui raconte. Ayant été blessé aux yeux en 1916, je fis ma rééducation à Paris, mais je ne découvris pas tout de suite à quoi je pouvais encore être bon. Avant la guerre, j’étais ciseleur, j’aimais les fins outils ; les métiers de brossier, chaisier, vannier, ne me disaient rien.
Je me mariai en 1917 ; ma femme était couturière, elle avait un petit atelier et elle gagnait assez pour nous deux, mais cette position dépendante ne pouvait me convenir. J’allai chez un tourneur, puis chez les Houston-Thompson pour faire du bobinage électrique. À la maison je fabriquais des petites bricoles en bois, des étagères, des meubles de poupée ; ma femme les vendait facilement à ses clientes.
Malheureusement Lucie tomba malade, et le docteur déclara que la couture, l’atelier, l’air de Paris ne lui valaient rien ; la poitrine était menacée. Il fallait partir tout de suite pour la province.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
T. Combe
LES ENQUÊTES DE FRANÇOIS LECAMPDÉTECTIVE AVEUGLE
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782383837787
LA BAGUE À TROIS CHATONS
Histoire du début de François Lecampcomme détective aveugle
CHAPITRE PREMIER
C’est moi, François Lecamp, qui raconte. Ayant été blessé aux yeux en 1916, je fis ma rééducation à Paris, mais je ne découvris pas tout de suite à quoi je pouvais encore être bon. Avant la guerre, j’étais ciseleur, j’aimais les fins outils ; les métiers de brossier, chaisier, vannier, ne me disaient rien.
Je me mariai en 1917 ; ma femme était couturière, elle avait un petit atelier et elle gagnait assez pour nous deux, mais cette position dépendante ne pouvait me convenir. J’allai chez un tourneur, puis chez les Houston-Thompson pour faire du bobinage électrique. À la maison je fabriquais des petites bricoles en bois, des étagères, des meubles de poupée ; ma femme les vendait facilement à ses clientes.
Malheureusement Lucie tomba malade, et le docteur déclara que la couture, l’atelier, l’air de Paris ne lui valaient rien ; la poitrine était menacée. Il fallait partir tout de suite pour la province.
Ma femme avait des amis qui tiennent un hôtel dans une petite ville salubre, bien abritée par une colline et aérée par le cours d’une rivière. Pas de poussière, pas de vent, et les ressources de la campagne toute proche. On déménagea donc ; les amis Marceau nous avaient trouvé une petite maison d’un rez-de-chaussée et mansarde, avec une cour devant, de cinq pas de large, et un jardin derrière, trois arbres fruitiers, un coin pour des poules et des lapins.
À ce moment-là, je n’avais que ma pension de douze cents francs, mais mon ancien patron m’en faisait autant, en attendant que le gouvernement se décide à nous augmenter. Avec un peu de couture que faisait ma femme, et mes bricoles qui se vendaient presque mieux qu’à Paris, nous pouvions vivre.
Dès la première semaine, Lucie fut beaucoup en réquisition à l’hôtel du Veau-Bleu, où on était à court de service. Et je ne vous cacherai pas que je m’ennuyais ferme pendant les heures où ma femme était absente. Je lui dissimulais mon cafard tant que je pouvais. En deux ans, je ne m’étais pas encore habitué à la cécité, et j’avais beau faire, remplir un programme tous les jours, lire du Braille, chapuiser du bois, nourrir les poules et les lapins, je traînais mon existence, et Lucie s’en apercevait bien.
Peu à peu, elle n’alla plus du tout chez Mme Marceau, elle restait avec moi, mais mon cafard me tenait solidement. À dire vrai, rien ne m’intéressait. C’est la bague à trois chatons qui m’a sauvé, car je ne sais pas où j’allais, et Lucie, bien sûr, n’était pas heureuse.
Un matin, vers dix heures, j’étais dans la salle qui nous sert de cuisine et de salle à manger et où j’ai mon établi et mes outils ; cette salle donne sur la cour ; la porte est toujours ouverte quand il fait beau, et les visiteurs, arrivant de la rue, traversent la petite cour, puis entrent sans cérémonie dans la salle.
Mme Chaudron était là depuis un bon quart d’heure avec sa petite fille. Elle me commandait une cassette avec des cases pour la monnaie. Elle tient une petite mercerie en face de chez nous. Tout à coup sa fillette, qui pleurnichait depuis un bon moment, se mit à pleurer plus fort.
— Qu’a donc cet enfant ? demandai-je impatienté. Donnez-lui ce qu’elle demande.
— A roulé… a roulé… faisait-elle.
— Ce n’est rien, c’est cette boucle qu’elle a trouvée et que je lui ai pendue au cou par un cordon… Oui, voilà le cordon défait… La boucle a roulé. Ça n’a aucune importance, ajouta Mme Chaudron.
— Sans doute que la boucle aura roulé un peu loin, peut-être même sous la « cuisinière », dit Lucie. Je la retrouverai en balayant. Pleure pas comme ça, mignonne.
Mais la mignonne hurlait tellement que sa mère l’emmena pour ne pas nous déranger davantage.
— Tiens ! fit ma femme, cinq minutes plus tard, je la vois, cette boucle, là, derrière le pied de la « cuisinière », dans mon petit tas de bois…
Je l’entendis qui écartait des morceaux de bois, puis elle dit :
— Ce n’est pas une boucle, c’est une vieille monture de bague…
— Fais voir, lui dis-je.
Elle me mit dans la main un anneau très pesant pour sa grosseur, car il était petit, fait pour un mince doigt de femme. Je le tâtai soigneusement et m’aperçus qu’il portait trois chatons vides, disposés en quart de cercle.
Avec le bout de l’ongle, je constatai que les griffes étaient très fines, très aiguës, mais écartées ; on avait fait sortir les pierres assez maladroitement : une des griffes était cassée. Le chaton du milieu n’était pas à jour, mais au contraire le fond était plein ; les deux autres étaient percés tout à jour, deux trous.
— De quelle couleur est cette bague ? demandai-je à Lucie. Elle me paraît très lourde.
— Elle n’est pas en or, dit Lucie. Elle est d’un métal gris clair. Du plomb, sans doute.
— Non, dis-je, on n’aurait jamais pu faire en plomb des griffes de sertissage si fines et si dures. Voilà ce que m’apprennent mes doigts et mon bon sens réunis. Donc le métal gris ne peut être que du platine. Donc la bague a de la valeur. Où cette mignonne qui hurle si bien l’a-t-elle trouvée ?
— Je vais le demander à Mme Chaudron, dit Lucie avec empressement.
— Pas tout de suite. Une bague de platine, avec trois chatons vidés, qu’on a forcés... Ça a l’air d’une histoire pas ordinaire.
— Oh ! crois-tu ? fit ma femme.
— En tous cas, ça m’intéresse…
À mon grand étonnement, Lucie me sauta au cou.
— T’entendre dire enfin que quelque chose t’intéresse !
Je me rendis compte alors que mon cafard pesait aussi lourd sur ma femme que sur moi.
— Que veux-tu que je fasse demanda-t-elle.
— D’abord, n’en parle à personne, ensuite tâche de m’amener la petite. Je voudrais la questionner moi-même.
— J’ai un petit collier bleu, je le lui donnerai. Je vais la chercher tout de suite.
Cinq minutes plus tard, la petite Mariette Chaudron arrivait, convoyée par ma femme. Cette enfant m’aimait assez, car je la prenais souvent avec moi pour visiter les poules et les lapins. Le petit collier la ravit tellement que j’eus de la peine à la faire causer de la bague. Je finis tout de même par savoir qu’elle l’avait trouvée dans une petite ruelle de pavés et d’herbes qui sépare l’hôtel du Veau-Bleu de la maisonnette de Mme Chaudron. Mariette a la permission d’y jouer parce que c’est un cul-de-sac où il ne passe jamais de voitures.
— Écoute, dis-je à Lucie, j’ai envie de me rendre compte. Conduis-moi dans cette ruelle et prenons la petite avec nous.
Je voyais combien de temps j’avais perdu à avoir le cafard, car je ne connaissais pas du tout la topographie de notre rue. Dans nos promenades, je me laissais guider sans m’intéresser à rien, ce qui n’était vraiment pas intelligent. Lucie m’expliqua la disposition des maisons en face de la nôtre. Tout à fait en face, la petite boutique de Mme Chaudron, et je n’avais jamais su qu’une ruelle pavée et fermée la séparait de l’hôtel du Veau-Bleu.
En quelques pas, nous nous trouvâmes dans cette ruelle, dont je sentis les pavés et l’herbe sous mes pieds. Je la parcourus d’un bout à l’autre en faisant une trentaine de pas. Lucie, à mes questions, répondit que la maisonnette basse de Mme Chaudron n’avait pas de fenêtres donnant sur la ruelle. De l’autre côté, il y avait la façade de l’hôtel, haute de trois étages, avec des fenêtres.
— Puisque la ruelle est fermée en cul-de-sac, on ne la parcourt pas, dis-je en réfléchissant. Il est peu probable que la bague ait été perdue ici par un passant, puisqu’il n’y a pas de passants. Elle n’est pas tombée du ciel ou d’un avion. Donc elle doit être tombée d’une fenêtre. Il n’y a que les fenêtres de l’hôtel. Toi, Lucie, qui connais la disposition intérieure de l’hôtel, connais-tu les chambres qui ont une fenêtre sur la ruelle ?
— Cette façade est celle de l’escalier, répondit ma femme. Une des fenêtres à chaque étage éclaire l’escalier. Ce sont des fenêtres qu’on n’ouvre pas, à cause de la rampe qui passe devant. Sur chaque palier, il y a une chambre, qui a une fenêtre sur la ruelle, et une autre qui donne derrière sur les écuries. Ces chambres sont : au rez-de-chaussée le bureau du patron, au premier la chambre à coucher des patrons, au second une chambre de voyageur, au troisième la chambre des bonnes qui est mansardée et n’a qu’une lucarne sur la ruelle.
— Supposons, dis-je, que la bague ait été lancée d’une fenêtre dans la ruelle. Ce n’est pas le patron ni Mme Marceau qui auraient fait ça ; et même par mésaventure, ils auraient perdu une bague de platine, tu le saurais. D’ailleurs, les chatons vides indiquent autre chose. Donc ni le patron, ni la patronne, ni les bonnes par leur lucarne. Reste la chambre de voyageur. Saurais-tu peut-être qui a logé récemment dans cette chambre ?
— Non, tu sais que je ne vais plus chez Mme Marceau que de sept en quatorze, mais je peux m’informer. D’ailleurs, mon pauvre ami, la bague pouvait être là depuis des années, entre deux pavés ou sous une touffe d’herbe. Quoique tout de même, elle ait l’air neuve.
— Le platine est inaltérable, dis-je. J’aurai à l’examiner avec tes yeux. Nous n’avons pas encore inspecté l’intérieur.
— Moi j’y ai regardé, dit Lucie. Il y a quelque chose de gravé très fin, en dedans de l’anneau.
— Et tu ne me le disais pas ! et tu prétends être mes yeux ! m’écriai-je assez âprement, car j’étais encore dans la phase où un aveugle s’irrite contre les voyants à leur moindre faute.
— Ne me gronde pas, c’est réparable ! fit Lucie.
Sans perdre une seconde, et comme d’ailleurs la ruelle n’avait plus rien à nous apprendre, la petite Mariette étant incapable de désigner l’endroit exact où elle avait trouvé sa précieuse « boucle », nous rentrâmes.
Dans mes outils de ciseleur qui me servaient encore, il y avait une loupe – celle-ci par exemple n’avait plus d’intérêt pour moi – mais Lucie s’en servit pour lire à l’intérieur de l’anneau, d’un côté des trois chatons, les initiales W. T., et de l’autre côté une date : 1888.
— Tu es bien sûre du double V ? demandai-je. C’est important. Cela m’apprend, joint à d’autres indices, que la bague faite pour un doigt très mince a été offerte comme bague de fiançailles à une jeune Anglaise dont le fiancé habitait les Indes.
— Tiens ! voilà que tu fais concurrence à Sherlock Holmes, dit ma femme en riant. Comment sais-tu tout ça ?
— Je vais te l’exposer, dis-je, essayant mais en vain, de lire avec le bord de l’ongle les traits trop fins de la gravure. Cette bague étant faite pour un doigt de femme, le prénom doit être féminin. Or, il n’y a pas de prénom français de femme commençant par W. Il y en a beaucoup d’anglais au contraire.
— J’admets que c’est une Anglaise, dit Lucie, mais comment trouves-tu le fiancé aux Indes ?
— Au temps d’avant la guerre, expliquai-je, quand j’étais chez mon patron à Paris, il nous arrivait quelquefois des clientes anglaises qui faisaient réparer leurs bagues. Le goût anglais et le goût français diffèrent beaucoup en bijouterie. Les Anglais aiment les belles pierres bien serties ; nous aussi, mais nous les disposons avec variété. Eux, au contraire, ils mettent trois pierres sur la même ligne, en quart de cercle, comme celle-ci. Mais j’ai une indication de plus dans le chaton du milieu. N’y vois-tu rien de particulier, Lucie ?
— J’y vois qu’il n’est pas à jour comme les deux autres, mais fermé en dessous par une petite plaque.
— Donc il contenait une pierre qui n’a pas besoin d’être à jour, une pierre opaque, comme l’œil-de-chat qui vient des Indes, et que les Anglaises affectionnent. Les Françaises ne l’aiment pas. Il m’a passé entre les mains, chez mon patron, des bagues de fiançailles offertes par l’officier ou le fonctionnaire anglais aux Indes ; plusieurs avaient un œil-de-chat entre deux brillants. Je crois qu’on attache un sens superstitieux à l’œil-de-chat. Je ne vois pas une autre pierre opaque qui fasse bien entre deux brillants. La turquoise est trop colorée.
Il me semblait me retrouver dans mon ancien atelier et voir sur mon établi l’arc-en-ciel des pierres aux belles couleurs.
— Sais-tu ? dis-je à ma femme, nous allons mettre une annonce dans le « Matin » !
À son petit claquement de langue, je devinai que ma femme était étonnée et pas d’accord avec moi. Son cher visage, que je n’ai jamais vu, apparaît à mon esprit dans des expressions de sentiment. Je le vois tantôt caressant, ou surpris, ou un peu grondeur, quand Lucie trouve son mari aveugle par trop déraisonnable, ce qu’il est souvent. En cette minute, le visage de ma femme était certainement désapprobateur.
— Une annonce ! s’exclama-t-elle, pour quoi faire ? Mais ça va coûter très cher !
— Écoute, dis-je, j’économiserai ça, si tu veux, sur la cigarette et la pipe.
— Par exemple, te priver de ta bouffarde, ton seul plaisir ! Ah ! ça, jamais ! Je ferai plutôt quelques journées au Veau-Bleu. Mais explique au moins ton idée.
— Mon idée est vague, dis-je un peu embarrassé. Ces trois chatons contenaient des pierres de prix, il est permis de le supposer. Si la bague a été volée, et que le voleur ait déchâssé les pierres pour les vendre plus facilement, pourquoi a-t-il jeté le platine qui vaut 16 francs le gramme ?
— Comme ça, la petite Mariette a fait une bonne trouvaille ?
— Au juger, la bague pèse 5 grammes. Je l’enverrai à mon frère pour qu’il s’assure du poids et du métal. Car enfin, je dis platine, mais sans y voir je ne suis pas certain. N’oublie pas, Lucie, que mon frère seul doit être au courant. Plus tard, s’il y a des résultats, Mme Chaudron n’y perdra rien.
— Des résultats ? quels résultats ? demanda ma femme.
Et je devinais son petit sourire incrédule que je ne voyais pas, mais tous les sourires des femmes incrédules se ressemblent, et j’ai vu bien des sourires de femme avant la guerre.
— Il me semble, dis-je à Lucie, que je tiens le bout d’un fil ; mais ce fil peut très bien n’aller nulle part. Cependant, permets-moi de le suivre puisque ça m’intéresse. D’y réfléchir, ça ne m’empêchera pas de bricoler.
J’entendis que Lucie enlevait la gaine de ma machine à écrire. Une machine qui m’a été donnée par les enfants de la Suisse romande, et je suis heureux de dire ici qu’elle a été ma première consolation après la blessure.
— Eh bien ! qu’est-ce que tu attends ? dit Lucie. Viens l’écrire, cette annonce. Je peux encore la mettre à la poste avant midi.
Car tout ce que je viens de raconter, depuis les pleurs de Mariette, s’était passé dans l’intervalle de neuf à onze heures. Je me mis aussitôt à pianoter sur mon clavier, et ma femme relut les lignes quand elles furent écrites.
Voici le texte de l’annonce :
« Administration du journal Le Matin,Service d’annonces,
Paris,
Veuillez insérer, trois jours de suite, dans la colonne des Petites Correspondances, l’annonce suivante :
« Pour avoir des nouvelles de la bague à trois chatons, W. T. 1888, on peut s’adresser à M. François Lecamp, 18, rue des Vernes, Garlat (Seine-et-Oise). »
— Tu donnes notre adresse ? fit Lucie. Tu ne ferais pas mieux de mettre poste restante ?
— Je me suis dit que si je donne l’adresse, l’individu viendrait peut-être lui-même.
— Quel individu ?
— Soit le voleur, soit le propriétaire. Et après tout, peut-être bien que personne ne viendra…
Pour éviter des longueurs, j’envoyais en même temps un mandat-poste, calculé d’après le taux des annonces ; le montant fit pousser un gros soupir à Lucie, comme je m’y attendais ; mais elle ne dit rien, ma bonne petite femme… Un moment après, comme elle partait pour la poste, je l’entendis qui se murmurait à elle-même : « Il faut bien lui passer une petite fantaisie, à mon pauvre François ! »
CHAPITRE II
On ne pouvait rien attendre avant trois ou quatre jours. Dans l’intervalle, j’écrivis à mon frère Henri, qui habitait Paris, et qui, plus heureux que moi, avait pu reprendre son métier de ciseleur après la guerre. Nous travaillions autrefois dans le même atelier, et notre patron était un des grands bijoutiers de la rue de la Paix.
Je priais mon frère, dont j’étais sûr comme de moi-même, de me garder le secret sur cette petite affaire, dont je lui exposais les détails, et je le priais d’examiner la bague, de la peser et de l’évaluer.
La réponse d’Henri m’arriva deux jours après, il n’avait pas perdu une minute, le brave garçon, connaissant que, depuis que je n’y voyais plus, j’étais devenu, au lieu de patient, d’une impatience extraordinaire. Et mon entourage, loin de chercher à me corriger de ce défaut, l’aggravait au contraire en s’empressant de satisfaire tous mes désirs.
Henri m’écrivait que la bague était en platine comme je l’avais supposé, pesait 6 grammes, et valait donc comme métal fr. 96. Il ajoutait que ma petite enquête l’intéressait et qu’il était à ma disposition s’il se trouvait des démarches à faire à Paris.
Les jours et les heures me semblaient longs ; cependant je travaillais sans relâche à la cassette commandée par Mme Chaudron, je la mignardais de mon mieux pour qu’elle me servît de recommandation auprès d’autres clientes ; le travail, les mesures à prendre, les ajustages, le poli, réclamaient de moi plus d’attention que d’un voyant, et c’est ainsi que mes pensées se détournaient de la bague et de mon impatience.
La lettre d’Henri fit passer un jour. Le troisième et le quatrième jours furent vides. Lucie attendait le facteur avec autant d’anxiété que moi. Le cinquième jour enfin, les réponses à mon annonce du « Matin » arrivèrent : une par le premier courrier, deux par le second courrier…
Ah ! que ne pouvais-je les lire moi-même, voir ces écritures, deviner quelque chose, à l’aspect de ces caractères, de l’être qui les avait tracés ! Mais non, il fallait attendre que Lucie déchiffrât péniblement chaque mot, car elle n’avait pas grande habitude des mauvaises écritures. Je la fis me décrire l’adresse, l’enveloppe, la place du timbre, le papier, et puis autant que possible, le genre de calligraphie.
La première lettre était écrite sur un beau papier de moyen format d’un seul feuillet. Je tâtai le feuillet pour me rendre compte, et en suivant du doigt le bord supérieur, je m’aperçus qu’il n’était pas tout à fait droit ; une bande qui portait probablement l’adresse ou l’en-tête avait été coupée en trois coups de ciseaux dont je percevais le raccord. On n’avait pas pu aller d’un seul coup d’un bout à l’autre.
— Donc, dis-je à Lucie, on a coupé avec de petits ciseaux, et non avec de grands ciseaux de bureau qui auraient détaché la bande d’un seul coup… Ceci nous indiquerait plutôt une femme qu’un homme.
— Il faudrait lire ! fit Lucie.
Car je ne lui avais même pas permis de lire un seul mot : j’essayais de tirer mes petites déductions dans l’ordre où je l’aurais fait si j’avais pu voir. Évidemment la coupure du papier m’avait frappé tout de suite. Je repliai la lettre dans ses plis et je remarquai ceci : elle n’était pas pliée au milieu, mais un peu au-dessus du milieu, ce qui prouvait que la bande supérieure avait été enlevée après le pliage de la lettre. On avait d’abord plié par le milieu la feuille complète, puis on avait songé à enlever la bande de l’adresse, on avait coupé avec de petits ciseaux, puis on avait replié dans le premier pli. Il m’était permis d’en déduire de nouveau une femme impulsive et rapide plutôt qu’un homme ; qu’un homme d’affaires surtout. Je communiquai ma remarque à Lucie, qui me répondit :
— Tout ça est possible, mais laisse-moi donc lire !
Voici la lettre telle que Lucie me la lut :
« Monsieur, la bague W. T. 1888 est à moi. Veuillez l’envoyer contre remboursement de 500 francs de récompense, à l’adresse de Messieurs Lenoyer, bijoutiers, 55 bis, rue de la Paix. Ces messieurs sont prévenus. Avec mes remerciements anticipés. X. Y. Z. ».
— Il n’y a pas de fautes d’orthographe, n’est-ce pas ? dis-je à ma femme.
— Non, autant que je m’y connais. Il faut bien un e à récompense, et un a à anticipés, je crois ?
— Parfaitement. Le style est correct, l’orthographe doit l’être aussi. Cette dame est prudente. Elle a évité tous les adjectifs qui devraient être au féminin.
— Que vas-tu faire ? demanda Lucie avec impatience
— Rien du tout. Il faut attendre, il faut réfléchir. D’abord, cette dame suppose que la bague est intacte. Elle offre 500 francs de récompense donc la bague avec ses pierres en valait bien cinq mille. Dix pour cent, c’est le tarif ordinaire des récompenses honnêtes. La première chose, c’est de faire savoir à cette dame que les chatons sont vides, et que la bague ne vaut plus cent francs.
— C’est vrai ! s’exclama Lucie déçue. Moi qui voyais déjà 250 francs dans ma bourse, et 250 francs au carnet d’épargne de la petite Mariette ! Et j’allais te complimenter sur tes talents de détective !
Jusqu’à quatre heures, l’heure du second courrier, je tourmentai Lucie de questions sur tous les détails de la lettre N° 1, mais alors j’eus d’autres sujets de réflexions, puisque le facteur nous apporta les lettres N° 2 et N° 3.
Ma bonne Lucie n’eut guère de temps pour faire son ménage ce jour-là, car je la harcelai sur l’analyse des trois lettres, dont un détail négligé pouvait avoir son importance. Ma pauvre petite femme se donnait tant de mal pour me satisfaire qu’elle ne montra même ni ennui ni impatience, et qu’elle entra dans ma méthode, allant au-devant de mes questions.
— Le papier de la lettre N° 2 est un papier ordinaire, et le parfum est ordinaire aussi. C’est du papier réglé. Donc, la personne n’a pas beaucoup l’habitude d’écrire, comme moi. D’ailleurs, la lettre est signée, on verra bien.
— La lettre est signée ! m’écriai-je. Et tu ne le disais pas tout de suite !