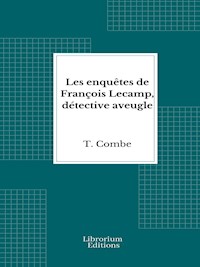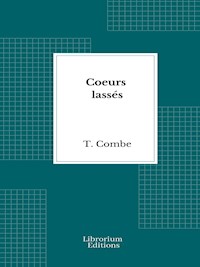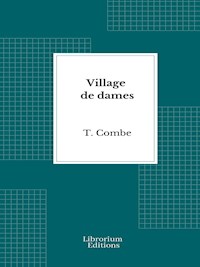
0,59 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Quand le vaste ciel, la nuit, étend au-dessus des collines noires sa sombre transparence, il y a des étoiles là-haut, mais en bas il y a des lampes, et si nous levons les yeux pour contempler, l’intelligence éperdue, cette étincelante et incompréhensible poussière de mondes, nous abaissons nos regards avec plus de tendresse vers les petites lumières, passagères et mortelles comme nous, qu’une main allume chaque soir ; elles nous parlent de choses familières, tristes et douces, de la lassitude du jour, de l’aiguille que tiennent encore des doigts fatigués, du livre qu’on feuillette dans la clarté blanche, des rideaux qu’on ferme autour du berceau.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
T. Combe
Village de dames
1909
© 2022 Librorium Editions
ISBN : 9782383835998
MONSIEUR LE VOLEUR
Quand le vaste ciel, la nuit, étend au-dessus des collines noires sa sombre transparence, il y a des étoiles là-haut, mais en bas il y a des lampes, et si nous levons les yeux pour contempler, l’intelligence éperdue, cette étincelante et incompréhensible poussière de mondes, nous abaissons nos regards avec plus de tendresse vers les petites lumières, passagères et mortelles comme nous, qu’une main allume chaque soir ; elles nous parlent de choses familières, tristes et douces, de la lassitude du jour, de l’aiguille que tiennent encore des doigts fatigués, du livre qu’on feuillette dans la clarté blanche, des rideaux qu’on ferme autour du berceau. Ces lampes sont le symbole visible des existences, et les vies obscures, anonymes, sortent de l’ombre, surgissent en points lumineux, se groupent amies et voisines, chaque petite flamme signifiant une volonté, et peut-être une douleur. Tant qu’il fait jour, on songe moins aux vies individuelles, distrait qu’on est par le grand décor des champs et des bois ; mais la nuit vient, la nature s’efface, et il n’y a plus que des âmes, faibles lueurs qui tremblotent dans l’obscurité.
Sur le petit plateau solitaire qui domine la masse épaisse d’un bois, je vois de ces lumières une dizaine, tout au plus, ce qui annonce un hameau ; trois par trois, et la dixième fort à l’écart, celle-ci plus brillante que les autres, et rouge comme un fanal.
Nous nous en approchons : il y a une barrière, d’abord, en lattes serrées, et, derrière, un moutonnement noir de buissons ; c’est un jardin. La façade étroite, en pignon pointu, nous apparaît vaguement éclairée par une fenêtre ouverte, grand carré lumineux autour duquel flotte une buée de clarté ; des franges de rideaux, la guirlande d’un rosier grimpant remuent doucement et encadrent de leur réseau noir la baie éclairée. L’étage n’est point si élevé que nous ne puissions apercevoir un plafond à solives peint en gris, clair et brillant, et le sommet d’une lampe, avec son abat-jour d’un pourpre intense. C’est cette lampe, comparable à la planète Mars, qui darde dans la nuit un si rouge regard.
Quelqu’un lit là-haut, car le léger bruissement d’une page se joint de temps à autre au frôlement doux des feuilles du rosier. Et si une curiosité nous prenait, – car, à se tenir tout seul dans un jardin noir, l’instinct de sociabilité crie bien vite et soupire après l’être humain qu’on devine si près, – si une curiosité nous prenait, l’escalade de cette chambre ne serait point trop difficile, avec l’aide de l’espalier où s’accrochent les roses, et d’un volet, et d’une planche, au-dessous de l’embrasure, qui paraît solidement fixée et qui est sans doute, en hiver, la table des oiseaux. Mais cette façon d’entrer semblerait insolite ; restons honnêtement en bas, dans l’obscurité.
Si quelqu’un, pour vous donner patience et distraction, peut vous expliquer ce pays et ses particularités, et les gens qui l’habitent, c’est bien moi, car j’ai passé ici toutes mes vacances, chez ma cousine Alyse, depuis les étés lointains où j’étais petite fille.
Un bois, un plateau, puis une pente fort inclinée, dix maisonnettes bâties il y a quelque trente ans par mon grand-oncle qui s’y ruina. Il était médecin, et à une époque où l’on exilait tous les phtisiques dans le Midi, il entrevoyait déjà le traitement de la tuberculose par l’air sec et par le soleil hivernal. Il choisit ce coteau que les brouillards n’atteignent point, qu’une forêt protège contre le vent du nord, que les rayons de midi et du couchant baignent de leur chaleur, et où il pleut moins que dans les vallées voisines, par quelque condition atmosphérique encore inexpliquée. Il y fonda une station, et il fit grand, car cet initiateur était un chimérique, comme presque tous les hommes de quelque génie. Il ne voulut pas de caravansérail où s’entassent les poitrinaires pour tousser ensemble, épier les uns chez les autres les symptômes de leur maladie, et se procurer mutuellement des sensations d’hôpital. Il éleva des maisonnettes pour la vie de famille, ce qui aussitôt compliqua son entreprise et la rendit infiniment plus coûteuse.
Deux ou trois malades dans chaque maison, habitant des chambres fort isolées, prenant leur repas à part, évitant de se réunir avec leurs voisins, cela faisait autant de petits ménages, d’installations séparées, de cuisinières et de garde-malades ; autant de salons, autant de poêles, bref, la négation volontaire de toute économie. Le pécule de mon grand-oncle, père de ma cousine Alyse, se consuma aux frais de bâtisse et de mobilier ; encore dut-il laisser vides cinq de ses chalets.
Dès le premier hiver, il en loua plusieurs, avec ou sans meubles ; la saison, tiède et ensoleillée, servit ses projets ; on se promena, on se lugea sur la neige, on respira beaucoup d’air pur, on guérit, ou l’on espéra guérir. Dès le second hiver, toutes les maisonnettes furent pleines, car regarde-t-on à la dépense pour sauver la jeune vie d’un fils unique, d’une fille chérie ? Le pauvre homme nageait dans la joie, et la vogue l’emportait vers un avenir glorieux, quand une fatalité épouvantable s’abattit sur la petite colonie.
Une épidémie de typhus y éclata ; neuf personnes, non des malades, mais de celles qui les soignaient, succombèrent en quinze jours. Ce fut alors une panique indescriptible, un sauve-qui-peut sans armes ni bagages, et puis des accusations et une polémique forcenée dans la presse locale. Le médecin fut traité d’empoisonneur, son sanatorium mis à l’interdit ; on analysa l’eau des deux fontaines, mais la science des bacilles en était, il y a trente ans, à ses rudiments ; on ne trouva rien. Mon grand-oncle désespéré s’épuisa en recherches, il fit faire de nouvelles canalisations, il planta des arbres sur ses sources et ses citernes, les entoura de clôtures comme un terrain sacré. En même temps il bataillait contre ses calomniateurs, les citait devant la justice de paix, obtenait des rétractations bien inutiles. L’opinion s’était emballée ; elle aurait considéré comme un criminel et un fou l’homme assez téméraire pour envoyer ses enfants chercher la santé où tant d’autres avaient trouvé la mort.
Quand mon grand-oncle apprit que dans son propre village natal on l’appelait couramment le docteur Typhoïde, il partit pour l’Amérique.
Chercher à vendre une propriété aussi mal famée était illusoire ; il en laissa la garde et le rapport à ma cousine Alyse, sa fille unique, qui avait alors une trentaine d’années, beaucoup de raison et de courage. Elle avait combattu aux côtés de son père contre une impopularité qui, pendant quelques mois, ressembla à une persécution, et elle en garda, le reste de sa vie, de l’amertume dans l’âme. Elle devint misanthrope, ne conserva de relations qu’avec deux ou trois amis et parents auxquels elle savait gré d’avoir épousé chaleureusement la cause de son père. Mes propres parents étaient du nombre, ce qui fit que ma cousine Alyse m’aima beaucoup dès ma petite enfance.
Quand elle eut l’extrême douleur, cinq ans après, d’apprendre la mort de son père sans qu’elle l’eût revu, elle tourna le dos à l’univers entier, elle se fit recluse dans sa maisonnette ; ce fut une désolée et une exaspérée.
Cependant il fallait vivre ; son pessimisme n’avait pas détruit en elle le bon sens. Laisser ce joli hameau à l’abandon, livrer les murs aux lézardes, les jardinets aux herbes folles, lui parut un crime et une absurdité. Elle appela mon père en conseil et examina avec lui l’inventaire de la succession. En capital elle n’avait plus rien. Tant d’années improductives avaient englouti les derniers restes de la fortune du docteur ; restaient les dix maisonnettes, la petite forêt et les fatales citernes, grevées encore de quelques dettes et d’un mauvais renom tenace.
— Peut-être, fit Mlle Alyse en redressant sa tête et son cou maigre d’un air de défi altier qu’elle garda toute sa vie, peut-être se trouvera-t-il quelques personnes héroïques pour braver comme moi les chances de typhus qui peuvent être restées au fond des puits.
Aux annonces répondit seule, d’abord, une vieille fille de bonne naissance, mais de chétif revenu, qui cherchait la campagne par économie. Elle s’installa et devint l’amie intime de ma cousine Alyse, qu’elle domina bientôt complètement. Ma cousine lui était reconnaissante du fond de l’âme d’avoir levé l’interdit et d’oser dire partout : « Typhus ? sottise ! on n’a pas le typhus deux fois dans le même endroit, si l’on se tient pour averti et qu’on cure les citernes. C’est moi qui veillerai à ce qu’elles soient curées, je vous en réponds ! » Elle en dit tant que les gens se regardaient, commençant à croire qu’ils avaient été pendant sept ans en proie à une idée fixe morbide.
Et comme le hameau était charmant, le site des plus pittoresques et la forêt de sapins fort balsamique, les demandes de location arrivèrent, petit à petit, plus nombreuses qu’on n’en pouvait satisfaire. Les deux vieilles filles purent faire un choix dans le nombre des candidats ; par une sélection naturelle résultant de leurs goûts et de leurs craintes, elles éliminèrent d’abord les familles nombreuses, parce que, les enfants, ça écrase les pelouses, ça renverse les barrières et ça pousse des cris aux heures douces du crépuscule. Elles éliminèrent ensuite, au fur et à mesure des occasions, les couples mariés sans enfants, parce qu’il n’est rien de plus égoïste, assurèrent-elles, qu’un couple marié sans enfants ; le mari ne voit que sa femme, et la femme que son mari, et l’entourage en éprouve de la gêne. Il est superflu d’ajouter, n’est-ce pas, que les célibataires masculins n’avaient jamais pris pied dans la colonie, car cette catégorie de mortels ne possède pas, en général, de ménage, et présente divers autres inconvénients, tels que difficultés au sujet de la blanchisseuse, relations délicates entre voisins, invitations impossibles.
Tant est que finalement ma cousine Alyse, fortement soutenue par son amie, n’admit plus pour locataires que des personnes de son sexe, célibataires ou veuves sans enfants.
Ô la jolie petite colonie, paisible, ratissée et fleurie, et sans tumulte, et des habitudes régulières, le thé à quatre heures, une promenade où ces dames se rencontrent, toutes les portes closes à dix heures moins un quart ; et le matin, une paysanne du voisinage apporte le bon lait encore chaud, un litre à chaque petit ménage, deux litres s’il y a une bonne, et s’il y a un chat, un demi-litre en plus. Il se pouvait, les beaux dimanches, que l’élément masculin fît son apparition sur cette scène virginale, car on avait en ville des parentes ou des amies dont il fallait bien aussi inviter les maris. Ces messieurs parlaient politique à table, ou crise sociale ; ils fumaient leurs cigares dans les jardinets, de sorte que le lundi matin, « nous ne sommes pas trop fâchées de nous retrouver entre nous, mademoiselle Alyse ».
On prit l’habitude, dans le pays, sans ironie ni malice aucune, d’appeler la petite colonie Village de Dames ; cette dénomination devint même officielle et cadastrale. Ma cousine Alyse en riait, car ce n’est point l’humour qui lui manque ; mais elle laissa le pli se prendre, et maintenant, pas plus qu’en un couvent de nonnes, un membre du sexe à barbe ne chercherait à s’y établir.
La distance du hameau à la ville est de deux bonnes lieues ; il y a bien un autre hameau derrière le bois, se glorifiant d’une boulangerie où l’on vend du pain frais trois fois par semaine, et les autres jours du pain rassis, mais n’offrant pas d’autres ressources séculières ou sociales. Comme les habitantes du Village de Dames sont pour la plupart des personnes âgées qui ne courent guère les grands chemins et ne pratiquent point la bicyclette, elles ont peu de rapports avec le monde ambiant. En hiver, il est des semaines, et même des quinzaines, où elles ne voient aucun visage étranger et où elles en viennent, sans jamais l’avouer, à détester les boucles de Mlle Alyse, à trouver que les beaux yeux vantés de Mme Perrot-Campillon sont décidément surfaits, et la conversation savante de Mlle Alexandrine Jacquet absolument insupportable. Ce sont là des moments pénibles, mais passagers ; une innocente diversion soulage les nerfs tendus, comme le retour des hirondelles, ou la migraine hebdomadaire de Mme Lainier-Nicole, ou encore si Frumencette a reçu une visite de sa terrible nièce.
Ah ! l’on ne sait guère ce qu’il y a de drames en miniature, d’orages de sentiments, de petites batailles sans bruit ni fumée, d’invisibles victoires, de rivalités, de résistances, de luttes pour le bien, de larmes, de prières et de minuscules vanités dans ce paisible Village de Dames, banal et pomponné, comme on ne saurait compter ce qu’il y a de moucherons qui dansent au soleil dans un jour d’été. Chaque moucheron a son heure de vie, de crainte, de mort, et son histoire lui paraît sans doute la plus intéressante qui ait jamais été.
Ma cousine Alyse, qui a le goût des aphorismes, dit souvent : « Tout est dans tout », et cela me rendait rêveuse quand j’étais petite fille, jusqu’à ce que ma cousine commençât à m’expliquer cette sentence abstraite par une histoire vraie, du propre Village de Dames que j’avais sous les yeux. Ce qui fait que je les sais toutes et que je puis les conter à mon tour.
La maisonnette où je vous amène, d’où sort la lueur pourpre d’une lampe encapuchonnée de soie, est précisément celle de ma cousine ; elle l’habite seule avec sa bonne, une jeune fille récemment engagée, car il faut confesser que Mlle Alyse Maîtral change souvent de bonne. Dans la famille, nous continuons à garder l’espoir que la dernière venue sera enfin le trésor désiré ; ma cousine se fait vieille ; il serait temps qu’on la comprît, si elle doit être comprise en ce monde. « Je me verrai contente, dit-elle, quand j’aurai trouvé une bonne qui me comprenne et qui ne se fâche point si je lui dis : « Élise, ou Françoise, au prochain concours de sottise, vous aurez le grand prix. » Pour me prouver que j’ai raison, elle se fâche, la bécasse, et nous nous séparons avec une satisfaction réciproque. »
La bonne actuelle n’a jusqu’ici d’autre défaut que de s’appeler Clermonde, et elle refuse de se séparer de cet aristocratique prénom, assurant que ses père et mère ont eu de bonnes raisons pour le lui donner, sachant qu’ils ne lui laisseraient rien d’autre. Elle rit, elle frotte, elle a des répliques qui sont drôles sans être impertinentes, et, quand il fut pour la première fois question du prix de sottise, elle répondit sans s’émouvoir : « Ça ne m’étonnerait pas, j’ai toujours eu tous les prix. » Mlle Alyse respira. « Voilà, songea-t-elle, un cap difficile qui est doublé. Clermonde me comprend. »
Il y avait encore une autre pierre de touche. Ma cousine est sujette à des malaises la nuit, à de l’oppression et à des accès de toux. Elle aime qu’on s’en aperçoive, non pour se déranger et entrer chez elle, mais pour lui offrir des condoléances au matin. Clermonde négligeait absolument ce pieux devoir, si bien que sa maîtresse, après avoir attendu vainement jusqu’à midi, prononça enfin avec quelque sévérité :
— Clermonde, vous m’avez entendue tousser cette nuit ?
— Mais non, mademoiselle, fit Clermonde d’un ton contrit. Et elle ajouta : Moi, il faudrait qu’on tousse avec des tambours pour me réveiller.
Mlle Alyse rit et pardonna, déclarant qu’après tout, et à sa manière, Clermonde la comprenait.
Ma cousine a une passion : l’astronomie, et une mission : faire partager à d’autres cet enthousiasme ; mais elle n’est point parvenue à enflammer pour la noble science aucune de ses bonnes précédentes. Avec Clermonde elle renaît à l’espoir. Cette jeune fille a l’esprit vif et gai, tout ce qui sort de la routine l’enchante.
Là-haut, dans la chambre à lampe rouge, on marche, on furète puis une voix un peu cassée, un peu aigrelette, s’élève et crie :
— Clermonde, êtes-vous prête ? Voici l’heure où la constellation du Sagittaire se montre sous son aspect le plus favorable.
— Je suis prête, mademoiselle : j’ai la lanterne, répond une voix claire. Mademoiselle n’oublie-t-elle pas la jumelle ?
Là-haut, on ouvre précipitamment un tiroir, et l’on réplique avec vivacité :
— Oublier la jumelle ! comment donc !… mais vous, Clermonde, avez-vous le pliant ?
— Oui, mademoiselle, et aussi votre châle.
La porte de la maison s’ouvre, et les deux femmes paraissent en silhouettes noires au sommet du petit perron de trois marches que la vieille demoiselle descend d’un pas alerte. Mais sa jeune bonne, au moment de tourner la clef dans la grosse serrure, lève les yeux vers la fenêtre de l’étage, et s’écrie.
— Mademoiselle a oublié d’éteindre sa lampe. Vite, je remonte…
— Point du tout, fait la maîtresse d’un ton vexé. Je n’y ai point pensé, je l’avoue, mais c’est une très bonne idée que j’ai eue là. Nous verrons mieux notre chemin jusqu’à la grille, et puis j’aime trouver une lumière quand je rentre.
Clermonde ne souffle mot, mais elle ne peut s’empêcher de tourner la tête à plusieurs reprises vers ce grand réverbère qui pourrait bien fumer en leur absence et moucheter l’appartement de flocons de suie. Cette inquiétude lui gâte un peu le plaisir d’aller contempler les étoiles avec une jumelle.
La grille grince, d’une voix qui ressemble à celle de Mlle Alyse ; la petite lanterne balance sur le sentier un éventail de lumière blanche ; les deux frêles silhouettes féminines s’effacent doucement dans la nuit.
____________
Alors, avec des précautions soupçonneuses, avec un imperceptible frôlement des buissons, une forme noire se coule hors de l’ombre, une tête s’avance furtive et inquiétante, pour écouter. Elle se retire, elle s’allonge de nouveau, un grand corps surgit debout, rasant la muraille, et se glissant vers le perron par petites étapes silencieuses. Tout à coup, il s’élance, franchit d’un saut les marches, saisit la poignée de la porte et la secoue d’une saccade furieuse ; le pêne ne cède point, et l’homme, d’un nouveau bond aussi rapide que le premier, se rejette dans l’ombre à l’angle de la maison, s’y blottit pour concerter un nouveau plan d’assaut.
Il a vu les femmes s’éloigner et sait qu’il n’a pas de temps à perdre s’il veut profiter de leur absence. Il examine la muraille obscure, le treillis du rosier, la bande d’éclatante lumière qui tombe de la fenêtre ouverte. Lentement, mais d’un pied sûr, il commence son escalade, par le rebord de la croisée du rez-de-chaussée, par le volet, par les lattes de l’espalier, par la planche aux oiseaux ; ses doigts cherchent un gond pour s’y accrocher, son autre main s’enfonce dans l’embrasure, saisit l’encadrement ; une enjambée, puis un bruit mat de pas sur le plancher, et aussitôt un tapage précipité, brutal, à faire crier et pâmer d’horreur une vieille personne méticuleuse, car ce sont des tiroirs qu’on ouvre, qu’on bouleverse, des objets qui s’écroulent sur le plancher…
Dix minutes au plus, et l’homme reparaît, découpé comme une ombre chinoise, comme un diable noir sur la clarté rouge. Il est debout dans la fenêtre, il tourne lentement sur lui-même, et de sa main pendante tombent parmi les touffes confuses de la plate-bande deux gros souliers qui sans doute l’ont gêné pour la montée et qu’il ôte pour la descente plus périlleuse encore. Du milieu des plantes froissées s’évapore une vague odeur de réséda, comme réveillée.
Du bout de ses orteils, l’homme tâtonne, cherche son chemin. Il descend, il est suspendu par les doigts au rebord de la fenêtre, un pied sur l’espalier, l’autre pied à la découverte. Subitement le mince croisillon de bois craque net, les deux jambes s’agitent un instant, les mains lâchent prise. Une lourde masse noire tombe à la renverse, touche la terre, ne bouge plus… Mademoiselle Alyse, vos pauvres tiroirs sont vengés.
Cependant ma vieille cousine et sa bonne étaient arrivées au sommet d’une éminence découverte, d’où l’on pouvait contempler un très vaste ciel. Un petit banc de bois se dressait dans l’herbe, mais Clermonde ouvrit son pliant au milieu du chemin caillouteux, afin que sa maîtresse ne risquât point d’avoir les pieds mouillés. Mlle Alyse s’assit posément, tira la jumelle de l’étui :
— Mettez-vous derrière moi, Clermonde, et orientez-vous. Cherchez Véga. Avez-vous Véga ?
— Oui, mademoiselle, je la tiens… Ah ! je voudrais bien avoir éteint cette lampe !…
— Quelle lampe ?
— Celle de mademoiselle. J’ai comme un pressentiment de malheur… Si un voleur allait entrer ?
— Ma pauvre fille, dit Mlle Alyse en haussant les épaules, ne savez-vous pas qu’une lampe allumée est la meilleure sauvegarde qu’il y ait pour une maison ? Les méfaits s’accomplissent dans l’obscurité. Revenons à nos étoiles. Qu’est-ce que nous tenons, Clermonde ?
— Nous tenons la Lyre, dans Véga.
— Non pas. Véga, dans la Lyre. Notre carte nous indique sept étoiles dans cette constellation. Nous allons les vérifier.
La grande idée astronomique de Mlle Alyse était de vérifier les étoiles par sa carte, à l’aide de la lanterne. Si le ciel lui révélait un point lumineux omis par la carte, c’était le ciel qui avait tort. Dans ses jours d’indulgence, elle disait : « Bah ! ce ne sera qu’un astéroïde. »
— Sept étoiles. Parfaitement, elles y sont. Les avez-vous vues et comptées, Clermonde ? Cette constellation étant vérifiée, passons à une autre. Le Cygne nous a donné déjà bien du mal. Sur la carte, il semble qu’il ait les deux pattes en l’air, mais je vous ai déjà expliqué, Clermonde, que les lignes qui relient les étoiles sont fictives.
— Moi je les vois, dit la petite bonne avec assurance.
— Comment ! Vous les voyez ?
— Oui, quand je cligne les yeux, ça fait des traits de feu qui partent d’une étoile à l’autre ; je les vois très bien. Il a une patte beaucoup plus longue que l’autre, et un long cou, mais pas de tête.
— Ce n’est pas là de l’astronomie sérieuse, dit Mlle Alyse un peu fâchée. L’essentiel est de vérifier si les vingt-deux étoiles du Cygne y sont bien. Hier soir nous n’en trouvions que dix-neuf. Prenez la jumelle et comptez. Quand elles y seront, nous donnerons un coup d’œil au Sagittaire, et puis nous rentrerons chez nous, car je commence à me sentir les pieds un peu humides.
« Il y a une étoile qui est si petite, si petite sur la carte, que jamais je ne la trouverai, songeait Clermonde en fouillant les cieux de sa jumelle. Bah ! j’en emprunterai une au tas d’à côté, pour ce soir. Autrement, mademoiselle aimerait mieux s’enrhumer que de quitter la place avant d’avoir son compte. »
Ce qu’elle fit. Elle emprunta une étoile, oh ! toute petite, à Céphée, et compta triomphalement jusqu’à vingt-deux.
— Vos yeux sont meilleurs que les miens, Clermonde, dit sa maîtresse, je sais que je peux me fier à eux.
La fillette baissa la tête, prise d’un remords, et se promit de poursuivre ses recherches, sa maîtresse une fois couchée, jusqu’à ce qu’elle eût mis la main sur l’étoile insaisissable.
— Voyez, dit Mlle Alyse, tandis que Clermonde ouvrait la grille du jardin, combien il est agréable d’être accueillies par cette lampe. C’est une bienvenue… Pourquoi vous arrêtez-vous, ma fille ?
Clermonde, comme pétrifiée, les yeux en arrêt, ne bougeait plus.
— Restez ici, mademoiselle, dit-elle enfin d’une voix un peu étranglée… Je crois… je crois que je vois… Ce n’est peut-être rien, mais attendez…
Elle courut, non pas vers le perron, mais vers le rosier grimpant et la plate-bande sous la fenêtre. Elle se penchait…
— Qu’est-ce donc ? cria Mlle Alyse impatiente et un peu essoufflée, et la suivant le plus vite qu’elle put, car elle n’était pas femme à jouer un second rôle dans n’importe quel drame.
— Pas grand’chose. C’est un homme.
— Par exemple ! un homme chez moi ! Il faut qu’il ait bu. Venir cuver son vin dans mon réséda ! exclama-t-elle avec indignation. Ah ! cela leur ressemble bien !
— Qu’est-ce que mademoiselle désire que je fasse ? demanda Clermonde, la lanterne à la main, attendant ses ordres, comme s’il se fût agi d’un nettoyage ordinaire.
— Le tirer par les pieds hors du jardin, assurément. Ça dérangera le gravier de l’allée et ça écorchera nos bordures, mais qu’y faire ? Vilain mauvais sujet ! Allons, Clermonde, courage ! prenez un pied et moi l’autre, finissons au plus vite cette écœurante besogne.
— Ma foi, dit Clermonde, ce n’est pas aussi facile que mademoiselle croit. Il a un pied replié sous lui.
— Ça se déplie, j’imagine… Pourriez-vous dormir en sachant cet homme abject dans le jardin ?
— On pourrait peut-être… appeler quelqu’un ! suggéra la petite bonne, qui hésitait.
— Et qui donc ? de pauvres femmes plus faibles encore que nous ? Clermonde, si vous étiez dans une île déserte, vous seriez bien obligée de vous tirer d’affaire toute seule. C’est moi qui dégagerai ce pied, pour vous donner l’exemple.
Se baissant, elle noua ses deux petites mains sèches gantées de chamois gris autour de la jambe de l’homme, et tira subitement, de toutes ses forces. Un gémissement rauque sortit de la masse, qui remua.
— Ah ! mon Dieu, je lui ai fait mal ! murmura Mlle Alyse en lâchant prise et en regardant Clermonde d’un air consterné.
— Peut-être qu’il n’est pas ivre, après tout… Il est malade, ou blessé ou bien il a faim… Moi, je crois qu’à toujours supposer le mal, on se trompe des fois, dit Clermonde pleine de reproche.
— C’est possible, acquiesça la maîtresse avec humilité.
Mais elle reprit aussitôt le dessus en ajoutant :
— Vous reconnaîtrez, Clermonde, combien j’ai eu raison de laisser une lampe allumée, car, si nous étions rentrées sans apercevoir le pauvre homme, il aurait passé toute la nuit dehors.
Un nouveau gémissement l’interrompit. Alors les deux femmes se penchèrent, approchant la lanterne d’un visage qui leur apparut pâle et rébarbatif, hérissé d’une grosse barbe dure.
— Vous souffrez, mon ami ? demanda Mlle Alyse qui avait en elle l’âme de son père le médecin.
Les yeux s’ouvrirent, très noirs, puis se refermèrent, comme effrayés ou éblouis. La main eut un mouvement effaré, chiffonna la blouse un instant, et puis se crispa sur la poche du pantalon.
— Il cherche quelque chose, peut-être son mouchoir, murmura Clermonde. Faut-il lui aider ?
— Mais certainement, répondit sa maîtresse d’un ton vif. Et dépêchez-vous de le faire. Nous sommes ici pour lui porter secours.
Elle gardait sur le cœur le blâme de Clermonde et s’accusait elle-même d’avoir manqué de charité.
— C’est qu’il m’empêche, il serre entre ses doigts un objet qui est à moitié sorti de sa poche… Il ne veut pas le lâcher.
— C’est peut-être une gourde contenant un cordial dont il sent le besoin, fit Mlle Alyse qui pour rien au monde n’aurait prononcé le mot d’eau-de-vie. Comme vous savez, Clermonde, je suis loin d’être partisan des spiritueux. Mais, cependant, s’il allait s’évanouir de nouveau…
— C’est un objet en cuir, dit la bonne dont les petits doigts minces avaient réussi à se faufiler dans la grosse main osseuse et fermée… C’est sa bourse, tout bonnement. Allons donc, mon brave homme, vous n’avez pas peur qu’on vous la vole, dites ? Tenez-vous tranquille, pendant que je la renfonce dans votre poche… Elle est bien pleine, cette poche, poursuivit Clermonde, d’un ton qui devint tout à coup soupçonneux, et cette bourse, comme je la sens, elle est bien mignonne pour un homme qui n’a pas mis de souliers… Lâchez-la, je vous dis… Mademoiselle, cria Clermonde, élevant d’une main la lanterne et de l’autre sa capture, c’est votre porte-monnaie !
L’homme se souleva, puis, se tordant péniblement, il essaya de se mettre debout, mais une douleur fort aiguë le fit retomber par terre, et il resta là, assis, tenant à deux mains sa jambe pliée. Ses yeux mornes, plutôt ahuris que mauvais, regardaient fixement les deux femmes.
— Être pincé par des dames ! marmotta-t-il d’une voix enrouée, la voix d’un homme qui a dormi toute une saison à la belle étoile.
— À présent, videz votre poche, voleur que vous êtes ! fit Clermonde toute vibrante d’indignation et agitant son petit poing fermé.
Mais alors sa maîtresse s’interposa. Avez-vous remarqué que les misanthropes sont presque toujours des cœurs généreux, qui peuvent bien détester leur espèce, mais qui ne lui décocheront jamais le coup de pied de l’âne ?
— Le pauvre homme est par terre, dit Mlle Alyse, nous lui parlerons poliment.
Étonnée, Clermonde regarda sa maîtresse, si âpre, si grondeuse à l’ordinaire ; dès cette minute elle la comprit et l’aima.
— Si vous avez encore sur vous quelque chose qui m’appartienne, poursuivit Mlle Alyse, je vous prie de bien vouloir me le restituer.
L’homme, ne tenant plus que d’une main sa jambe froissée, se mit, de l’autre main, à tâter ses poches et ses vêtements. Sous l’œil sévère et pourtant amusé de Mlle Alyse, – car ma cousine aperçoit aisément le côté comique des choses, – il déposa docilement autour de lui une foule d’objets divers ; des mouchoirs de poche en grand nombre, une écharpe de dentelle noire, un tablier de soie, plusieurs petites boîtes contenant des bijoux sans grande valeur, un petit portefeuille en maroquin gris qui servait de châsse à des reliques d’amitié, boucles de cheveux et fleurs sèches.
— J’aurais regretté mon petit portefeuille, dit Mlle Alyse.
L’homme continuait son déballage.
— J’ai laissé les gants ; nous n’avons pas la même pointure, fit-il avec une éclaircie de sourire gouailleur dans sa grosse barbe… Ma foi, c’est tout… je crois bien que c’est tout.
— Ramassez mon bien, Clermonde, emportez-le dans la maison, et revenez immédiatement, commanda Mlle Alyse.
Le cas du voleur étant ainsi liquidé, restait l’homme blessé qui était un hôte.
— Croyez-vous, demanda-t-elle, que vous puissiez faire deux ou trois pas en vous appuyant sur nous ?
— Si je pouvais faire des pas, répondit le vagabond assez rudement, je ne serais pas ici, j’aurais déjà « dévissé ».
— Tâchez cependant de vous mettre debout, dit Mlle Alyse sans se départir de son calme, nous ne sommes pas assez fortes à nous deux pour vous porter.
— Me porter où ? cria-t-il.
— Mais chez moi, dans la maison. À vous voir, – j’ai pas mal d’expérience, – vous avez le genou luxé. Il vous faudra quelques soins.
L’homme poussa un éclat de rire railleur :
— Oui, oui, je sais… Des soins ! des gendarmes, pas vrai ? Vous allez téléphoner ? Alors c’est pas la peine de me remuer, j’peux bien les attendre ici.
Mlle Alyse, un peu confuse de n’avoir pas songé elle-même à cette ressource, et jugeant plus prudent de ne point révéler à son prisonnier qu’il fallait aller à l’autre bout du hameau pour le téléphone, répondit seulement :
— Avec ce genou, vous ne sauriez vous sauver bien loin, et vous serez mieux dans un lit.
— Un lit… ce sera du nouveau pour moi, mâchonna-t-il d’un air songeur.
Pour n’être pas en reste de politesse, il ajouta : Et puis vous savez, rien à craindre… je me suis baigné pas plus tard qu’hier, et j’ai fait ma lessive…