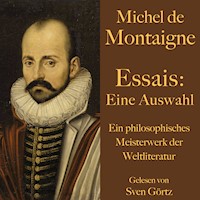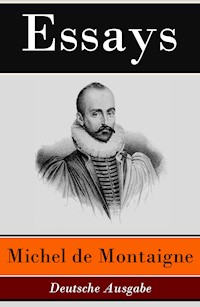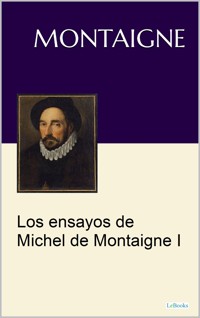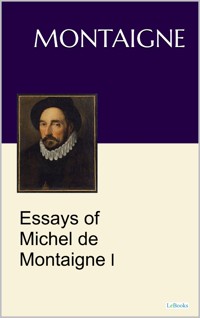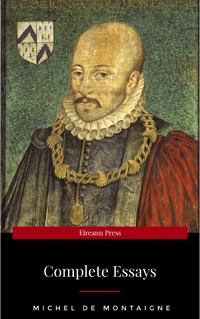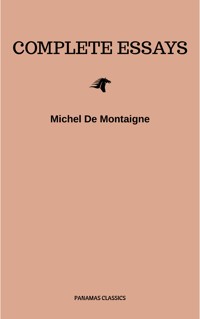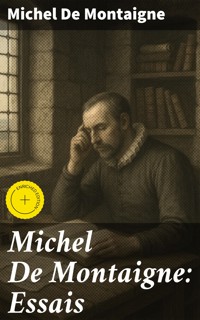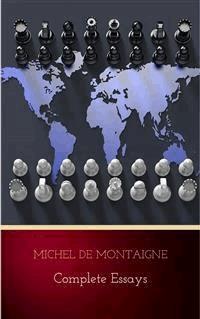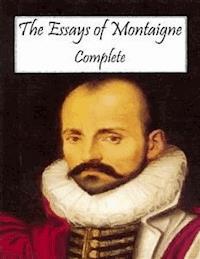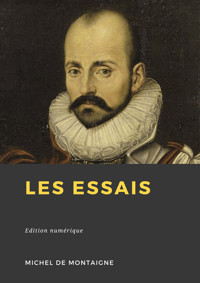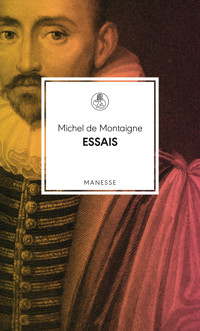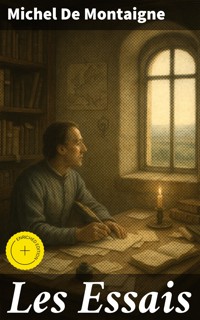
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Les Essais, œuvre majeure de Michel de Montaigne publiée entre 1580 et 1595, constituent une exploration introspective et personnelle où l'auteur examine la nature humaine, la condition humaine et la diversité des expériences individuelles. Divisés en trois livres, ces essais révèlent un style à la fois incisif et libre, mêlant réflexion philosophique, anecdotes personnelles et observations sociales. Contextuellement, cette œuvre s'inscrit dans la période de la Renaissance, marquée par une remise en question des dogmes traditionnels et une valorisation de l'individu. Montaigne, tout en s'inspirant des philosophes grecs et romains, se distingue par son scepticisme et sa manière d'interroger le savoir et les certitudes. Né en 1533 dans une famille de la noblesse bordelaise, Montaigne a eu une éducation humaniste et a connu une vie riche en expériences, notamment à travers ses voyages. Ces éléments biographiques, tels que sa retraite volontaire dans son château pour écrire et réfléchir, ont été déterminants pour la création des Essais. Son engagement envers une pensée critique et ouverte témoigne de ses préoccupations face aux guerres de religion de son époque et à la fragilité de la condition humaine. Je recommande chaudement Les Essais à quiconque s'intéresse à la philosophie, la littérature et à la compréhension de soi. Cette œuvre intemporelle invite à la réflexion sur nos propres convictions et sur la multiplicité des perspectives humaines, offrant ainsi un miroir fascinant sur notre propre existence. Dans cette édition enrichie, nous avons soigneusement créé une valeur ajoutée pour votre expérience de lecture : - Une Introduction approfondie décrit les caractéristiques unifiantes, les thèmes ou les évolutions stylistiques de ces œuvres sélectionnées. - La Biographie de l'auteur met en lumière les jalons personnels et les influences littéraires qui marquent l'ensemble de son œuvre. - Une section dédiée au Contexte historique situe les œuvres dans leur époque, évoquant courants sociaux, tendances culturelles и événements clés qui ont influencé leur création. - Un court Synopsis (Sélection) offre un aperçu accessible des textes inclus, aidant le lecteur à comprendre les intrigues et les idées principales sans révéler les retournements cruciaux. - Une Analyse unifiée étudie les motifs récurrents et les marques stylistiques à travers la collection, tout en soulignant les forces propres à chaque texte. - Des questions de réflexion vous invitent à approfondir le message global de l'auteur, à établir des liens entre les différentes œuvres et à les replacer dans des contextes modernes. - Enfin, nos Citations mémorables soigneusement choisies synthétisent les lignes et points critiques, servant de repères pour les thèmes centraux de la collection.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Les Essais
Table des matières
Introduction
Cette collection réunit, en un ensemble cohérent, les trois Livres des Essais de Michel de Montaigne, précédés de l’adresse Au Lecteur. Elle vise à présenter, dans leur enchaînement organique, les pièces qui ont fondé le genre de l’essai en langue française. Rassemblés ici sous une même couverture d’auteur unique, ces textes donnent à lire une œuvre intégrale, non pas systématique, mais progressivement construite, où chaque chapitre éclaire les autres. L’objectif est double : offrir un accès fidèle à la totalité du projet montanien et mettre en évidence la dynamique d’écriture qui transforme l’expérience vécue en matière de réflexion, d’examen et de conversation avec le lecteur.
Les Essais relèvent d’abord de la prose d’idées, sous la forme de méditations personnelles, morales, politiques et philosophiques. On y rencontre des essais brefs ou amples, des portraits, des notations autobiographiques, des récits exemplaires tirés de l’histoire ancienne et contemporaine, ainsi que des développements proches de l’érudition. La collection inclut également, à l’intérieur du premier Livre, un ensemble de sonnets d’Étienne de La Boétie insérés par Montaigne, signe d’un dialogue poétique au cœur d’une œuvre de prose. Il ne s’agit ni de romans ni de pièces de théâtre, mais d’un art de penser par fragments continus, voué à l’examen du jugement.
Composés et étoffés au fil d’éditions successives à la fin du XVIe siècle, les Essais prennent place dans le cadre de la Renaissance française et des guerres de Religion. Parus d’abord en 1580, puis augmentés notamment en 1588 et revus jusqu’à la version posthume de 1595, ils se présentent en trois Livres qui accompagnent la maturation d’une voix singulière. Cette histoire éditoriale se manifeste par des ajouts, des nuances et une mobilité de la pensée. La collection respecte cette architecture tripartite, pour restituer le mouvement d’un écrivain qui se relit, s’amende et approfondit, sans prétendre imposer une doctrine close.
Le Livre I s’ouvre par Au Lecteur, brève adresse qui annonce la franchise d’un projet d’exploration de soi. Les chapitres y parcourent des sujets variés — peur, imagination, coutume, vieillesse, langage, amitié — en multipliant exemples, anecdotes et rapprochements historiques. On y trouve l’hommage rendu à La Boétie par la reproduction d’un cycle de sonnets, qui inscrit la poésie au cœur d’une réflexion sur le lien humain. Ce premier ensemble pose les lignes de force de l’entreprise: privilégier l’expérience vécue, éprouver la constance des jugements, mesurer la fragilité des certitudes, et accorder la première personne à l’épreuve du commun des hommes.
Le Livre II élargit la perspective en interrogeant l’inconstance de nos actions, la conscience, l’exercice du corps et de l’esprit, la gloire ou la colère. Son pivot est l’Apologie de Raimond de Sebonde, la plus longue des pièces, où Montaigne confronte l’ambition du savoir à ses limites, mobilisant l’érudition ancienne pour éprouver nos assurances. Le ton se fait plus spéculatif sans abandonner le détour concret de l’exemple. Ce livre met à l’épreuve la fiabilité des témoignages, la portée des coutumes et l’autorité des livres, afin de dégager un art de juger prudent, attentif aux circonstances et à la diversité humaine.
Le Livre III, d’une diction plus ample et confiante, rassemble des méditations tardives sur l’utile et l’honnête, le repentir, la conversation, la vanité, l’expérience. L’écriture y progresse par retours, comme si l’auteur éprouvait ses idées à la lumière d’une vie plus avancée. Les thèmes anciens y reviennent transformés, éclairés par le temps et la pratique du gouvernement de soi. On y lit une attention accrue au corps, aux habitudes, aux faiblesses, dans une prose qui cultive la souplesse plutôt que la démonstration. Ce dernier livre scelle l’unité d’un projet: faire de la vie ordinaire la matière d’une éthique du discernement.
Le style de Montaigne se reconnaît à la première personne assumée, à la phrase sinueuse, à l’art de la digression maîtrisée. Les chapitres s’ouvrent souvent sur une remarque concrète puis s’élèvent vers une réflexion plus générale, avant de revenir aux détails. L’auteur agence l’exemple, l’anecdote, la référence gréco-latine et l’observation personnelle en un montage vif. La langue, marquée par les usages du XVIe siècle, conserve une saveur d’époque, avec des graphies et tournures que la présente édition signale sans en atténuer la force. La vivacité du ton, parfois ironique, soutient une conversation continue avec le lecteur.
Lecteur des moralistes anciens, Montaigne dialogue avec Plutarque, Sénèque, Cicéron, Virgile et de nombreux historiens, non pour les ériger en autorités intangibles, mais pour éprouver son propre jugement. La citation, résumée ou rapportée, sert de tremplin plutôt que d’ornement. Les récits tirés de l’histoire romaine, les exemples contemporains et les souvenirs personnels composent un laboratoire d’expériences morales. Dans ce tissu intertextuel, l’auteur ne cherche pas la preuve définitive, mais la mesure d’un consentement raisonnable. Ainsi se dessine un art de lire et de reprendre, qui fait de l’érudition une pratique vivante, tournée vers l’usage présent.
L’unité des Essais procède d’une méthode: s’observer pour mieux comprendre l’humaine condition. La mort, l’amitié, l’éducation, la peur, l’imagination, la coutume et l’inégalité nourrissent une interrogation permanente sur la valeur de nos choix. Montaigne met à l’épreuve les promesses de la raison, la force des habitudes, la part du corps dans les pensées, et le poids de l’opinion. De chapitre en chapitre, il recherche moins la certitude que l’ajustement d’un jugement prudent, attentif aux situations. Cette enquête, conduite sans système préalable, ordonne pourtant l’ensemble en une éthique de la mesure, du doute et de la responsabilité.
L’importance durable des Essais tient à la création d’une forme où l’auteur fait de sa singularité un instrument de connaissance accessible à tous. Loin des traités dogmatiques, l’ouvrage propose une manière de penser par essais, c’est‑à‑dire par tentatives, qui a profondément marqué la prose d’idées en français et au‑delà. Sa modernité tient à l’attention au sujet, à la reconnaissance des limites, à la critique des préjugés, et à la valeur accordée à l’expérience. De génération en génération, lecteurs, traducteurs et commentateurs y trouvent une compagnie intellectuelle qui accompagne l’examen de soi et la conduite de la vie.
La présente réunion s’attache à restituer l’architecture en trois Livres, l’adresse liminaire, les titres d’époque et la variété des longueurs, de la note resserrée au chapitre étendu. Elle préserve les singularités de langue et de rythme qui font la saveur des Essais, tout en offrant une lisibilité continue. On peut lire d’un trait ou par sauts, au fil des sujets, sans perdre de vue l’équilibre général. Chaque pièce demeure autonome, mais répond aux autres par échos et reprises. Ainsi s’organise une circulation qui favorise l’appropriation personnelle, condition même de la compréhension du dessein montanien.
Rassembler les Essais dans une collection de l’auteur unique permet de suivre, pas à pas, la formation d’une parole qui s’éprouve dans le temps. On y voit un écrivain inventer une forme à sa mesure, ouverte, hospitalière, capable d’accueillir l’histoire, la poésie, la conversation et l’expérience intime. L’ensemble offre un panorama complet d’une œuvre qui a fait entrer la subjectivité dans la littérature de pensée, sans renoncer à l’universel. En mettant en valeur ses thèmes maîtres, ses formes et son héritage, cette édition se propose comme une invitation durable à lire, relire et méditer avec Montaigne.
Biographie de l’auteur
Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), écrivain et magistrat bordelais, est l’auteur des Essais, oeuvre inaugurale du genre qui associe réflexion morale, observation de soi et regard sur le monde. Dans la France des guerres de Religion, il propose une voie de prudence et de tolérance, nourrie par l’humanisme renaissant. Son projet, exposé dans Au Lecteur, consiste à se peindre soi-même pour atteindre l’universel à partir du singulier. Publiés d’abord en 1580, les Essais seront augmentés jusqu’en 1588, avant une édition posthume. Leur style libre, sceptique et expérimental marque durablement la littérature et la philosophie européennes.
Formé très tôt au latin et aux lettres anciennes, Montaigne étudie au Collège de Guyenne puis le droit, avant d’entrer au Parlement de Bordeaux comme conseiller. Sa culture s’enracine dans les auteurs antiques, notamment Plutarque, Sénèque et Cicéron, qu’il cite et discute dans Des livres (II, 10) et ailleurs. L’amitié intellectuelle avec Étienne de La Boétie, dont il insère Vingt et neuf sonnets dans le Livre I, nourrit une réflexion durable sur la liberté et la fidélité, culminant dans De l’Amitié (I, 27). Cette formation humaniste oriente sa prose vers l’examen de soi et l’épreuve des exemples.
Après s’être retiré de la vie judiciaire vers 1571, Montaigne se consacre à l’écriture dans sa bibliothèque, laissant se déployer une pensée à la première personne. Le Livre I expose les lignes de force du projet: la fragilité des jugements (Des menteurs, I, 9), le gouvernement de soi (De l’oisiveté, I, 8), la mort comme apprentissage de sagesse (Que philosopher, c’est apprendre à mourir, I, 19), la relativité des moeurs (Des Cannibales, I, 30), l’amitié (I, 27). Il privilégie l’exemple vécu, les autorités antiques et l’aveu de l’incertitude, selon une écriture digressive pourtant fermement architecturée.
Le Livre II approfondit un scepticisme méthodique, particulièrement dans l’Apologie de Raimond de Sebonde (II, 12), vaste examen des limites de la raison et des conflits d’autorité. Montaigne y étend la critique à la crédulité, au témoignage, aux coutumes, en dialogue avec les sceptiques antiques. D’autres chapitres, comme De la conscience (II, 5), De la gloire (II, 16), De la presumption (II, 17) et De la liberté de conscience (II, 19), poursuivent la mise à l’épreuve de l’opinion et des passions. Des livres (II, 10) révèle sa pratique de lecture: familière, discontinuée, tournée vers l’usage et l’expérience.
Malgré le retrait proclamé, Montaigne exerce des responsabilités, notamment comme maire de Bordeaux dans les années 1580, cherchant l’équilibre au milieu des violences civiles. Ses voyages, dont un long périple en 1580-1581, alimentent son observation des moeurs et sa réflexion politique. Les Essais connaissent des révisions successives, intégrant de nouveaux développements et nuances. L’attention aux circonstances, à la diversité des lois (De la coustume, I, 22), aux hasards et aux accidents (Divers evenemens de mesme Conseil, I, 23) illustre une pensée de la prudence, attachée à la mesure et à l’adaptation des conduites.
Le Livre III, ajouté en 1588, approfondit l’art d’examiner la vie ordinaire. Des coches (III, 6) interroge la conquête et ses violences; De la vanité (III, 9) multiplie les détours pour mesurer l’inconstance du moi; De l’art de conferer (III, 8) exalte la conversation comme discipline du jugement; Du repentir (III, 2) et De l’experience (III, 13) portent à maturité une éthique de la mesure et de l’essai. Des boyteux (III, 11) manifeste sa défiance envers les superstitions et les certitudes hâtives. La prose, plus sinueuse, assume pleinement l’essai comme méthode et comme forme.
Jusqu’à sa mort en 1592, Montaigne annote et corrige ses textes. L’édition de 1595, préparée par Marie de Gournay, transmet un état élargi des Essais et contribue à leur diffusion. Son héritage se lit dans l’histoire de l’essai, genre qu’il institue, et dans une attitude intellectuelle faite de probité, de doute et d’attention au particulier. Les lecteurs y trouvent un art de vivre et de juger, applicable aux crises individuelles et collectives. Par l’entremise de chapitres comme De l’experience, De l’art de conferer ou De la liberté de conscience, sa pertinence demeure vive et actuelle.
Contexte historique
Rédigés par Michel de Montaigne (1533–1592), les Essais paraissent d’abord en deux livres (1580), puis en version augmentée avec un troisième livre (1588), avant l’édition posthume établie par Marie de Gournay (1595). L’ensemble naît au cœur de la Renaissance française, entre essor de l’humanisme, fracture religieuse et expansion européenne. Montaigne, gentilhomme périgourdin, y expérimente une forme neuve, l’“essai”, tentative personnelle adossée aux Anciens et à l’observation contemporaine. Les chapitres cités dans le Livre I, II et III traversent les décennies 1560–1580 et répondent aux tensions politiques et spirituelles de la France des guerres de Religion, tout en s’inscrivant dans des mutations culturelles plus larges.
La formation de Montaigne s’inscrit dans l’éducation humaniste du milieu du XVIe siècle. Son père encourage une immersion précoce dans le latin, reflet de l’idéal pédagogique qui privilégie les langues anciennes, la rhétorique et l’histoire. Le Collège de Guyenne à Bordeaux, où Montaigne étudie enfant, illustre ce climat d’émulation érudite. Des chapitres comme De l’institution des enfans et Du pedantisme discutent la méthode, la douceur d’apprendre et les limites d’un savoir purement scolastique. Par-delà la technique, l’objectif humaniste est moral: former un jugement souple, apte à confronter l’incertitude du monde et à ordonner l’expérience par la lecture des auteurs de l’Antiquité.
La carrière de Montaigne comme magistrat au Parlement de Bordeaux, à partir de la fin des années 1550, l’initie à la pratique du droit et aux débats de la “jurisprudence humaniste”, attentive aux textes romains et aux coutumes locales. Des chapitres tels que De la coustume, et de ne changer aisément une loy receüe, Des loix somptuaires ou De ne communiquer sa gloire témoignent d’un intérêt constant pour l’autorité des usages, la modulation des normes et la réputation publique. Cette expérience nourrit une approche prudente des réformes: l’ordre civil se règle moins par l’abstraction que par le poids des pratiques et de l’exemple.
Le cadre politique majeur est celui des guerres de Religion (1562–1598), affrontant catholiques et protestants. Montaigne, catholique modéré, vit les violences, les sièges et les basculements d’alliances. La bataille de Dreux (1562), évoquée au Livre I, reflète l’entrée brutale de la guerre civile. Des chapitres comme De la peur, Que philosopher, c’est apprendre à mourir et De la constance reçoivent cette pression: ils pensent la fragilité des affaires humaines et cherchent, dans Sénèque ou Plutarque, des ressources pour la tenue de soi. Le pari éthique est la mesure en temps extrême, plus que l’héroïsme spectaculaire.
Après 1572 et le massacre de la Saint-Barthélemy, le climat de méfiance s’intensifie. Des textes comme Des Menteurs, De l’incertitude de nostre jugement et Au Lecteur montrent une conscience aiguë de l’instabilité des informations, des rumeurs et des préjugés partisans. Montaigne revendique une parole située, expérimentale, qui circonscrit son objet et s’ouvre au correctif. Loin d’un traité dogmatique, l’essai prend acte d’un monde brisé où la vérité se cherche par comparaisons prudentes. Cette méthode répond à l’époque: contrôler ses passions, douter des témoignages, substituer à la colère une enquête lente sur les motifs, les circonstances et les effets des actions.
Élu maire de Bordeaux (1581–1585), Montaigne exerce des responsabilités dans une grande ville commerçante, soumise aux tensions militaires et à des épisodes d’épidémie et de disette. Cette expérience concrète transparaît dans De l’utile et de l’honeste, Des mauvais moyens employez à bonne fin ou Des postes: l’équilibre entre opportunité et probité, circulation des nouvelles, administration des urgences. La fonction exige de ménager des camps ennemis et de maintenir la vie civique. Les Essais enregistrent ainsi la matérialité gouvernementale de la fin du XVIe siècle: relais, vivres, impôts, et la prudence pratique requise par l’incertitude permanente.
Les voyages de Montaigne en 1580–1581, à travers la France, l’Empire et l’Italie, s’inscrivent dans une Europe marquée par la Réforme et la Réforme catholique (le concile de Trente s’achève en 1563). Observateur de mœurs et d’institutions, il compare villes, langues, cultes et justices. De la vanité et De l’art de conferer portent l’emprunte de ces circulations: mobilité des opinions, relativité des usages, discipline du dialogue. Sans dresser de système, Montaigne confronte les cadres confessionnels et politiques, et mesure la diversité européenne. Les Essais s’enrichissent de ce regard comparatif, attentif à ce qui rapproche et distingue, en deçà des polémiques de doctrine.
La diffusion de l’imprimerie depuis le XVe siècle donne aux Essais leur horizon médiatique: multiplication des livres, publics élargis, débats rapides. Montaigne écrit en français, participant au mouvement qui, depuis le milieu du XVIe siècle, affirme la dignité littéraire de la langue vernaculaire. Le chapitre Des livres réfléchit à la lecture et aux bibliothèques d’époque, saturées de compilations et de traductions. Des vaines subtilitez ou De la vanité des paroles réagissent à un climat où la prolifération des discours n’assure ni la justesse ni la sagesse. L’essai devient une forme de résistance à l’enflure rhétorique, par le retour au vécu et au jugement.
La centralité des Anciens est typiquement renaissante. Montaigne lit Plutarque (notamment dans la traduction d’Amyot, 1559), Sénèque, Cicéron, et les convoque comme autorités morales et interlocuteurs familiers. Des chapitres comme Consideration sur Ciceron, Defence de Seneque et de Plutarque ou Du jeune Caton révèlent l’usage humaniste de l’exemple antique comme laboratoire éthique. Que philosopher, c’est apprendre à mourir doit autant à la sagesse stoïcienne qu’à l’expérience des guerres. Cependant, l’imitation n’est pas servile: les Essais négocient continuellement la distance entre modèles vénérables et conditions modernes, en privilégiant la conversation plutôt que la règle.
Le scepticisme renaissant offre à Montaigne une méthode. La circulation, au milieu du XVIe siècle, d’éditions de Sextus Empiricus et les critiques humanistes de la scolastique favorisent un art du suspendre son jugement. L’Apologie de Raimond de Sebonde (Livre II) en est la pièce maîtresse: examen des limites de la raison, de l’autorité et des sens, et rappel des bornes de l’accès humain au divin. Des Prognostications, C’est folie de rapporter le vray et le faux à nostre suffisance et De l’incertitude de nostre jugement contestent l’astrologie judiciaire, les systèmes totalisants et la précipitation dogmatique, au profit d’une prudence expérimentale.
Les rencontres européennes avec les Amériques, depuis la fin du XVe siècle, offrent un miroir critique à l’Europe. Dans Des Cannibales et Des Coches, Montaigne s’appuie sur des témoignages contemporains et sur une entrevue qu’il dit avoir eue, à Rouen dans les années 1560, avec des indigènes du Brésil. Il compare les mœurs, dénonce les violences des conquêtes et interroge l’ethnocentrisme. Sans idéaliser, il oppose la barbarie supposée des “autres” aux cruautés bien réelles des guerres civiles européennes. Ces chapitres participent d’une première ethnographie morale, attentive aux écarts de coutume et aux jugements que ces écarts suscitent.
Les Essais interviennent aussi dans la querelle religieuse par une éthique de la tolérance. De la liberté de conscience, Des prieres et Qu’il faut sobrement se mesler de juger des ordonnances divines plaident pour la modestie des jugements et la paix civile. Montaigne reste catholique, mais défend la primauté de la charité et la relativité des formes extérieures. Dans la perspective des guerres qui ne s’achèvent qu’avec l’édit de Nantes (1598), ces textes représentent un effort de conciliation fondé sur l’examen de soi et la reconnaissance de la faiblesse humaine, plutôt que sur la victoire d’un camp doctrinal.
La vie matérielle de la fin du XVIe siècle affleure partout: vêtements, parfums, sommeil, alimentation, circulation. Montaigne observe l’économie morale des apparences dans Des loix somptuaires, les usages du vêtir dans De l’usage de se vestir, les commodités nouvelles dans Des postes, et les changements de mobilité dans Des Coches (les carrosses). Il interroge aussi les noms propres et leur prestige social dans Des noms, ou la “parsimonie” antique des dépenses publiques. Ces chapitres saisis ensemble documentent une société de rangs, où la représentation, la dépense et l’innovation technique recomposent les hiérarchies et les habitudes.
Le contexte scientifique est encore dominé par la médecine galéniste et une cosmologie héritée d’Aristote, en débat. Montaigne, sans être savant de profession, examine les prétentions du savoir: De l’exercitation, De la force de l’imagination, D’un enfant monstrueux et Des boyteux croisent corps, anomalies, croyances et tribunaux. Les chasses aux sorcières, actives en Europe à la fin du XVIe siècle, donnent à Des boyteux son urgence: Montaigne y appelle à la retenue des juges et au doute méthodique face aux “preuves” extraordinaires. Sa critique des “subtilités” vise moins la science que la témérité du jugement dans l’inconnu.
La vie politique de cour et la diplomatie, codifiées par des rituels, traversent plusieurs chapitres. Ceremonie de l’entreveuë des Rois, Un traict de quelques Ambassadeurs ou Des recompenses d’honneur observent les signes, gestes et gratifications qui ordonnent la monarchie française et les rapports entre puissances. Parallèlement, Du parler prompt ou tardif, De la vanité des paroles et De l’art de conferer insistent sur la responsabilité du langage en matière publique. Dans une époque d’ambassades risquées et de négociations précaires, l’“art de conférer” — écouter, répondre, différer — apparaît comme une vertu politique indispensable à la survie commune.
Le privé a chez Montaigne une dignité historique. La mort d’Étienne de La Boétie (1563) structure De l’Amitié; les Vingt et neuf sonnets de La Boëtie insérés au Livre I signalent la mémoire d’un compagnonnage intellectuel né dans les années 1550. De l’affection des peres aux enfans et De la ressemblance des enfans aux peres esquissent l’ordre domestique d’Ancien Régime et ses héritages. De la solitude et De trois commerces situent la retraite de Montaigne dans sa “librairie” — sa tour garnie de sentences — inaugurée vers 1571. Loin de l’évasion, cette retraite est un observatoire: écrire soi-même pour comprendre l’histoire qui passe.
La collection reflète des conflits armés et leurs techniques. Observation sur les moyens de faire la guerre, de Julius Cæsar et La battaille de Dreux côtoient Des armes des Parthes, signe d’un intérêt comparatif pour stratégies, cavalerie et tirs. Pourtant, la leçon n’est pas belliqueuse: La fortune se rencontre souvent au train de la raison, De la moderation ou De la punition de la couardise discutent l’aléa, la vertu et la sanction. L’ensemble souligne la précarité des réputations militaires, l’ambivalence de la gloire (De la gloire) et la tentation des “mauvais moyens” quand la fin paraît juste — tentation que Montaigne juge dangereuse politiquement et moralement.
Synopsis (Sélection)
Les Essais — Panorama thématique et style
Montaigne invente un art d’examiner l’homme par fragments, en mêlant anecdotes, lectures et observations quotidiennes dans une prose digressive et intime. Les thèmes récurrents — la variation des mœurs, l’incertitude du jugement, la souveraineté de l’expérience — s’y réfractent sous des angles toujours mobiles. Le ton oscille entre scepticisme, ironie et bienveillance, cherchant moins à conclure qu’à éprouver.
Livre I — Adresse au lecteur et méthode de l’essai (Au Lecteur; ch. 8, 51, 54)
Prologue d’une voix qui s’expose sans fard, l’adresse situe l’ouvrage comme un autoportrait mouvant plutôt qu’un traité. L’oisiveté, la vanité des paroles et les vaines subtilités y servent de laboratoire pour tester une écriture qui préfère l’aveu d’ignorance aux systèmes. Le ton est libre, expérimental et antidoctrinal.
Livre I — Passions, imagination et affects (ch. 2, 3, 4, 17, 20, 37, 40)
Ces essais scrutent la poussée des émotions — tristesse, peur, emballement des affections — et montrent comment l’imagination forge ou déforme nos réalités. Montaigne insiste sur la part d’opinion dans le goût des biens et des maux, et sur la simultanéité paradoxale de nos rires et de nos larmes. Le ton est clinique et empathique, attentif aux illusions et à la plasticité de l’âme.
Livre I — Parole, mensonge et langage (ch. 9, 10, 11, 46)
S’y discutent le mensonge, la vitesse ou lenteur du parler, les pronostics hasardeux et le pouvoir des noms. Montaigne met en garde contre les séductions du verbe qui captent plus qu’elles n’éclairent. Le ton allie prudence rhétorique et sens des nuances.
Livre I — Jugement, intention, mort et religion (ch. 7, 18, 19, 26, 31, 47, 56, 57)
La mesure morale dépend de l’intention et d’un jugement révisable, d’où la réserve à conclure sur le bonheur d’une vie avant son terme. Philosopher, c’est s’exercer à la mort, à l’incertitude et à l’humilité devant l’ordre divin, sans confondre notre suffisance avec le vrai. Le ton est méditatif, sceptique et spirituel, traversé par la conscience du temps et de l’âge.
Livre I — Coutumes, lois et société (ch. 22, 34, 41, 42, 43, 49)
L’auteur montre combien la coutume façonne nos jugements, jusqu’aux lois somptuaires et aux usages anciens. Inégalité, réputation et réserve dans l’affichage de la gloire composent une sociabilité prudente. Le ton est relativiste et civique, critique sans moralisme.
Livre I — Guerre, diplomatie et prudence (ch. 5, 6, 14, 15, 16, 45, 53, 33)
À travers sièges, parlements périlleux, bravoures mal avisées et batailles, Montaigne pèse le risque et la mesure. Un mot de César et la rencontre de la fortune avec la raison nourrissent une éthique de la décision sous contrainte. Le ton reste pragmatique, attentif aux revers et aux entêtements funestes.
Livre I — Éducation et formation de l’esprit (ch. 24, 25, 39)
Contre le pédantisme, l’institution de l’enfant vise le jugement, l’expérience et la fréquentation des grands auteurs. Les considérations sur Cicéron servent d’exemple pour une lecture active plutôt que révérencielle. Le ton est pédagogique et libéral, hostile aux savoirs stériles.
Livre I — Amitié et La Boétie (ch. 27, 28)
L’amitié se décrit comme un lien rare, total et choisi, dépassant les usages ordinaires. L’inclusion des sonnets d’Estienne de La Boétie souligne l’hommage et la profondeur affective de ce pacte. Le ton est chaleureux, grave et élégiaque.
Livre I — Modération, fortune et plaisirs (ch. 21, 29, 32)
Les profits des uns font parfois les pertes des autres, d’où la nécessité d’une modération lucide. Fuir les voluptés au prix de la vie comme ériger l’excès en règle sont également critiqués. Le ton est mesuré, hostile aux absolus.
Livre I — Solitude et retraite (ch. 38)
La solitude se conçoit comme un exercice d’indépendance intérieure plutôt qu’un isolement misanthrope. Elle ouvre un espace de soin de soi et de recul face au tumulte public. Le ton est apaisé, introspectif.
Livre I — Usages du corps et vie quotidienne (ch. 35, 44, 48, 55)
Des vêtements au sommeil, des destriers aux senteurs, le quotidien devient matière à réflexion sur l’habitude, le confort et l’apparat. Montaigne dédramatise ces sujets en y cherchant la mesure et l’agrément. Le ton est concret, curieux et souvent souriant.
Livre I — Exempla et philosophies anciennes (ch. 12, 13, 36, 50, 52)
Constance, cérémonial royal, figure de Caton, couple Démocrite/Héraclite et frugalité antique offrent un répertoire d’exemples contrastés. Montaigne y éprouve la diversité des tempéraments et des conduites. Le ton est comparatif et moral sans dogmatisme.
Livre I — Fins, moyens et conseil (ch. 1, 23)
Des routes différentes peuvent mener à une même fin, et un même conseil produire des issues variées. Montaigne en tire une sagesse de la contingence, opposée aux recettes. Le ton est probabiliste et désabusé.
Livre I — Culture et altérité: Des Cannibales (ch. 30)
Le regard porté sur des mœurs lointaines sert de miroir critique aux certitudes européennes. Montaigne souligne la relativité des usages et la tentation d’ethnocentrisme. Le ton est comparatif, volontairement décentré.
Livre II — Scepticisme, foi et conscience (ch. 5, 12, 19, 20)
De la conscience individuelle à l’Apologie de Raimond de Sebonde, Montaigne interroge la portée et les limites de la raison. Liberté de conscience et mélange inévitable des choses humaines appellent modestie et tolérance. Le ton est ample, critique et spirituel.
Livre II — Inconstance, ajournement et exercice de soi (ch. 1, 4, 6, 21)
Nos actions manquent de tenue, ajournées ou précipitées au gré des circonstances. L’exercitation et la lutte contre la paresse deviennent des techniques de soi. Le ton est pratique, réflexif, ennemi des résolutions vides.
Livre II — Vertu, gloire et honneurs (ch. 7, 16, 17, 29)
Récompenses d’honneur, quête de gloire, présomption et définition de la vertu sont soupesées à l’épreuve du réel. Montaigne démêle apparence et substance pour mesurer le prix des grandeurs humaines. Le ton est moral, incisif mais nuancé.
Livre II — Dire vrai, juger la mort et la cruauté (ch. 3, 11, 13, 18)
Dire vrai et démentir demandent discernement, surtout quand il s’agit d’évaluer la mort d’autrui ou d’affronter la cruauté. Des coutumes extrêmes invitent à réfléchir sans hâte ni parti pris. Le ton est grave, méthodique et sceptique.
Livre II — Lecture et modèles philosophiques (ch. 10, 32)
Réflexion sur les livres et défense de Sénèque et Plutarque dessinent une lecture vivante, critique et incorporée. Les auteurs servent d’aiguillons plutôt que d’autorités intangibles. Le ton est familier, complice avec les Anciens.
Livre II — Famille et hérédité (ch. 8, 37)
Affection paternelle et ressemblance des enfants aux pères ouvrent une enquête sur le lien et la transmission. Montaigne y observe le poids du milieu et des caractères. Le ton est domestique, attentif aux nuances.
Livre II — Guerre et techniques (ch. 9, 34)
Armes des Parthes et observations tirées de César éclairent les arts de faire la guerre. L’efficacité dépend de l’adaptation aux terrains, aux usages et aux moyens. Le ton est tactique et empirique.
Livre II — Exempla antiques et grandeur (ch. 24, 33, 35, 36)
Grandeur romaine, histoire de Spurina, portraits d’excellents hommes et de trois bonnes femmes composent une galerie d’exemples. Montaigne y cherche la variété des vertus plus que l’exemplarité figée. Le ton est narratif et évaluatif.
Livre II — Corps, santé et passions (ch. 2, 25, 31)
L’ivrognerie, la tentation de feindre la maladie et la colère sont lus comme des désordres du corps et de l’âme. L’auteur défend une sobriété lucide et la franchise envers soi. Le ton est hygiénique, moral sans sévérité.
Livre II — Corps et singularités (ch. 26, 30)
Des pouces aux naissances extraordinaires, Montaigne s’intéresse aux singularités comme révélateurs de notre curiosité et de nos jugements. Il y voit moins des monstres que des variations de nature. Le ton est descriptif et relativiste.
Livre II — Temps, saisons et opportunité (ch. 28)
Chaque chose a sa saison, et la réussite dépend d’un sens des circonstances. L’essai plaide pour l’à-propos plutôt que la précipitation. Le ton est temporel, conciliateur.
Livre II — Pratiques publiques et moyens douteux (ch. 22, 23)
Des postes aux moyens discutables employés pour une fin réputée bonne, Montaigne examine les institutions et la moralité des procédés. La fin ne sauve pas toujours les moyens, surtout vus dans la durée. Le ton est civique et casuiste.
Livre II — Interlude: New Chapter (ch. 27)
Section au titre énigmatique, elle s’inscrit dans la logique exploratoire des Essais. Son économie suggère une pause ou un décentrement, fidèle à la liberté de cheminement de l’ouvrage. Le ton est allusif et ouvert.
Livre III — Morale intime: utile, honnête, repentir, volonté (ch. 1, 2, 10)
Montaigne confronte l’utile à l’honnête, interroge le repentir et l’art de ménager sa volonté. Il prône une éthique souple, adaptée aux faiblesses humaines. Le ton est introspectif et conciliant.
Livre III — Sociabilité et conversation (ch. 3, 8)
Des trois commerces à l’art de conférer, l’auteur décrit les conditions d’un échange fécond. La conversation devient exercice de liberté et d’écoute, où l’esprit s’aiguise sans vaincre. Le ton est civil, vif et ludique.
Livre III — Vanité, diversion et lecture (ch. 4, 5, 9)
La diversion et la vanité désignent nos échappatoires face à nous-mêmes, tandis que la lecture d’un poète sert de tremplin à des méditations sur le désir et le temps. Montaigne met en scène la dispersion comme condition humaine. Le ton est élégiaque, ironique, mobile.
Livre III — Conquête et conscience: Des Coches (ch. 6)
À partir d’un objet de confort et de prestige, l’essai élargit la réflexion à la rencontre des mondes et aux excès de la conquête. Montaigne en appelle à une mesure qui juge les œuvres humaines à l’aune de la justice et de l’humanité. Le ton est critique et moral.
Livre III — Grandeur et limites (ch. 7)
La grandeur expose à des incommodités qui troublent l’âme autant que le corps. Montaigne dresse le bilan ambivalent des hautes charges. Le ton est désenchanté et réaliste.
Livre III — Signes incertains et nature humaine (ch. 11, 12)
Boiterie et physionomie servent à discuter la prétendue lecture sûre des signes. L’auteur y oppose l’expérience à la superstition et aux jugements hâtifs. Le ton est sceptique et rationnel.
Livre III — L’expérience (ch. 13)
Dernière halte, l’expérience s’érige en guide devant la fragilité des doctrines. Montaigne conclut par une sagesse pratique, ajustée au corps, à l’habitude et au temps. Le ton est serein, concret et confiant sans certitude.
Les Essais
Les Essais, Livre I
Au Lecteur
C‘EST icy un livre de bonne foy, lecteur. Il t’advertit dés l’entree, que je ne m’y suis proposé aucune fin, que domestique et privee : je n’y ay eu nulle consideration de ton service, ny de ma gloire : mes forces ne sont pas capables d’un tel dessein. Je l’ay voüé à la commodité particuliere de mes parens et amis : à ce que m’ayans perdu (ce qu’ils ont à faire bien tost) ils y puissent retrouver aucuns traicts de mes conditions et humeurs, et que par ce moyen ils nourrissent plus entiere et plus vifve, la connoissance qu’ils ont eu de moy. Si c’eust esté pour rechercher la faveur du monde, je me fusse paré de beautez empruntees. Je veux qu’on m’y voye en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans estude et artifice : car c’est moy que je peins. Mes defauts s’y liront au vif, mes imperfections et ma forme naïfve, autant que la reverence publique me l’a permis. Que si j’eusse esté parmy ces nations qu’on dit vivre encore souz la douce liberté des premieres loix de nature, je t’asseure que je m’y fusse tres-volontiers peint tout entier, Et tout nud. Ainsi, Lecteur, je suis moymesme la matiere de mon livre : ce n’est pas raison que tu employes ton loisir en un subject si frivole et si vain. A Dieu donq.
De Montaigne, ce 12 de juin 1580.
Chapitre 1 Par divers moyens on arrive à pareille fin
LA plus commune façon d’amollir les coeurs de ceux qu’on a offencez, lors qu’ayans la vengeance en main, ils nous tiennent à leur mercy, c’est de les esmouvoir par submission, à commiseration et à pitié : Toutesfois la braverie, la constance, et la resolution, moyens tous contraires, ont quelquesfois servy à ce mesme effect.
Edouard Prince de Galles, celuy qui regenta si long temps nostre Guienne : personnage duquel les conditions et la fortune ont beaucoup de notables parties de grandeur ; ayant esté bien fort offencé par les Limosins, et prenant leur ville par force, ne peut estre arresté par les cris du peuple, et des femmes, et enfans abandonnez à la boucherie, luy criants mercy, et se jettans à ses pieds : jusqu’à ce que passant tousjours outre dans la ville, il apperçeut trois gentilshommes François, qui d’une hardiesse incroyable soustenoient seuls l’effort de son armee victorieuse. La consideration et le respect d’une si notable vertu, reboucha premierement la pointe de sa cholere : et commença par ces trois, à faire misericorde à tous les autres habitans de la ville.
Scanderberch, Prince de l’Epire, suyvant un soldat des siens pour le tuer, et ce soldat ayant essayé par toute espece d’humilité et de supplication de l’appaiser, se resolut à toute extremité de l’attendre l’espee au poing : cette sienne resolution arresta sus bout la furie de son maistre, qui pour luy avoir veu prendre un si honorable party, le reçeut en grace. Cet exemple pourra souffrir autre interpretation de ceux, qui n’auront leu la prodigieuse force et vaillance de ce Prince là.
L’Empereur Conrad troisiesme, ayant assiegé Guelphe Duc de Bavieres, ne voulut condescendre à plus douces conditions, quelques viles et lasches satisfactions qu’on luy offrist, que de permettre seulement aux gentils-femmes qui estoient assiegees avec le Duc, de sortir leur honneur sauve, à pied, avec ce qu’elles pourroient emporter sur elles. Elles d’un coeur magnanime, s’adviserent de charger sur leurs espaules leurs maris, leurs enfans, et le Duc mesme. L’Empereur print si grand plaisir à voir la gentillesse de leur courage, qu’il en pleura d’aise, et amortit toute cette aigreur d’inimitié mortelle et capitale qu’il avoit portee contre ce Duc : et dés lors en avant traita humainement luy et les siens. L’un et l’autre de ces deux moyens m’emporteroit aysement : car j’ay une merveilleuse lascheté vers la miséricorde et mansuetude : Tant y a, qu’à mon advis, je serois pour me rendre plus naturellement à la compassion, qu’à l’estimation. Si est la pitié passion vitieuse aux Stoiques : Ils veulent qu’on secoure les affligez, mais non pas qu’on flechisse et compatisse avec eux.
Or ces exemples me semblent plus à propos, d’autant qu’on voit ces ames assaillies et essayees par ces deux moyens, en soustenir l’un sans s’esbranler, et courber sous l’autre. Il se peut dire, que de rompre son coeur à la commiseration, c’est l’effet de la facilité, debonnaireté, et mollesse : d’où il advient que les natures plus foibles, comme celles des femmes, des enfans, et du vulgaire, y sont plus subjettes. Mais (ayant eu à desdaing les larmes et les pleurs) de se rendre à la seule reverence de la saincte image de la vertu, que c’est l’effect d’une ame forte et imployable, ayant en affection et en honneur une vigueur masle, et obstinee. Toutesfois és ames moins genereuses, l’estonnement et l’admiration peuvent faire naistre un pareil effect : Tesmoin le peuple Thebain, lequel ayant mis en Justice d’accusation capitale, ses capitaines, pour avoir continué leur charge outre le temps qui leur avoit esté prescript et preordonné, absolut à toute peine Pelopidas, qui plioit sous le faix de telles objections, et n’employoit à se garantir que requestes et supplications : et au contraire Epaminondas, qui vint à raconter magnifiquement les choses par luy faites, et à les reprocher au peuple d’une façon fiere et arrogante, il n’eut pas le coeur de prendre seulement les balotes en main, et se departit : l’assemblee louant grandement la hautesse du courage de ce personnage.
Dionysius le vieil, apres des longueurs et difficultés extremes, ayant prins la ville de Rege, et en icelle le Capitaine Phyton, grand homme de bien, qui l’avoit si obstinéement defendue, voulut en tirer un tragique exemple de vengeance. Il luy dict premierement, comment le jour avant, il avoit faict noyer son fils, et tous ceux de sa parenté. A quoy Phyton respondit seulement, qu’ils en estoient d’un jour plus heureux que luy. Apres il le fit despouiller, et saisir à des Bourreaux, et le trainer par la ville, en le fouëttant tres ignominieusement et cruellement : et en outre le chargeant de felonnes parolles et contumelieuses. Mais il eut le courage tousjours constant, sans se perdre. Et d’un visage ferme, alloit au contraire ramentevant à haute voix, l’honorable et glorieuse cause de sa mort, pour n’avoir voulu rendre son païs entre les mains d’un tyran : le menaçant d’une prochaine punition des dieux. Dionysius, lisant dans les yeux de la commune de son armee, qu’au lieu de s’animer des bravades de cet ennemy vaincu, au mespris de leur chef, et de son triomphe : elle alloit s’amollissant par l’estonnement d’une si rare vertu, et marchandoit de se mutiner, et mesmes d’arracher Phyton d’entre les mains de ses sergens, feit cesser ce martyre : et à cachettes l’envoya noyer en la mer.
Certes c’est un subject merveilleusement vain, divers, et ondoyant, que l’homme : il est malaisé d’y fonder jugement constant et uniforrme. Voyla Pompeius qui pardonna à toute la ville des Mamertins, contre laquelle il estoit fort animé, en consideration de la vertu et magnanimité du citoyen Zenon, qui se chargeoit seul de la faute publique, et ne requeroit autre grace que d’en porter seul la peine. Et l’hoste de Sylla, ayant usé en la ville de Peruse de semblable vertu, n’y gaigna rien, ny pour soy, ny pour les autres.
Et directement contre mes premiers exemples, le plus hardy des hommes et si gratieux aux vaincus Alexandre, forçant apres beaucoup de grandes difficultez la ville de Gaza, rencontra Betis qui y commandoit, de la valeur duquel il avoit, pendant ce siege, senty des preuves merveilleuses, lors seul, abandonné des siens, ses armes despecees, tout couvert de sang et de playes, combatant encores au milieu de plusieurs Macedoniens, qui le chamailloient de toutes parts : et luy dit, tout piqué d’une si chere victoire (car entre autres dommages, il avoit receu deux fresches blessures sur sa personne) Tu ne mourras pas comme tu as voulu, Betis : fais estat qu’il te faut souffrir toutes les sortes de tourmens qui se pourront inventer contre un captif. L’autre, d’une mine non seulement asseuree, mais rogue et altiere, se tint sans mot dire à ces menaces. Lors Alexandre voyant l’obstination à se taire : A il flechy un genouil ? luy est-il eschappé quelque voix suppliante ? Vrayement je vainqueray ce silence : et si je n’en puis arracher parole, j’en arracheray au moins du gemissement. Et tournant sa cholere en rage, commanda qu’on luy perçast les talons, et le fit ainsi trainer tout vif, deschirer et desmembrer au cul d’une charrette.
Seroit-ce que la force de courage luy fust si naturelle et commune, que pour ne l’admirer point, il la respectast moins ? ou qu’il l’estimast si proprement sienne, qu’en cette hauteur il ne peust souffrir de la veoir en un autre, sans le despit d’une passion envieuse ? ou que l’impetuosité naturelle de sa cholere fust incapable d’opposition ?
De vray, si elle eust receu bride, il est à croire, qu’en la prinse et desolation de la ville de Thebes elle l’eust receue : à veoir cruellement mettre au fil de l’espee tant de vaillans hommes, perdus, et n’ayans plus moyen de defence publique. Car il en fut tué bien six mille, desquels nul ne fut veu ny fuiant, ny demandant mercy. Au rebours cerchans, qui çà, qui là, par les rues, à affronter les ennemis victorieux : les provoquans à les faire mourir d’une mort honorable. Nul ne fut veu, qui n’essaiast en son dernier souspir, de se venger encores : et à tout les armes du desespoir consoler sa mort en la mort de quelque ennemy. Si ne trouva l’affliction de leur vertu aucune pitié et ne suffit la longueur d’un jour à assouvir sa vengeance. Ce carnage dura jusques à la derniere goute de sang espandable : et ne s’arresta qu’aux personnes desarmées, vieillards, femmes et enfants, pour en tirer trente mille esclaves.
Chapitre 2 De la Tristesse
JE suis des plus exempts de cette passion, et ne l’ayme ny l’estime : quoy que le monde ayt entrepris, comme à prix faict, de l’honorer de faveur particuliere. Ils en habillent la sagesse, la vertu, la conscience. Sot et vilain ornement. Les Italiens ont plus sortablement baptisé de son nom la malignité. Car c’est une qualité tousjours nuisible, tousjours folle : et comme tousjours couarde et basse, les Stoïciens en defendent le sentiment à leurs sages.
Mais le conte dit que Psammenitus Roy d’Ægypte, ayant esté deffait et pris par Cambysez Roy de Perse, voyant passer devant luy sa fille prisonniere habillee en servante, qu’on envoyoit puiser de l’eau, tous ses amis pleurans et lamentans autour de luy, se tint coy sans mot dire, les yeux fichez en terre : et voyant encore tantost qu’on menoit son fils à la mort, se maintint en cette mesme contenance : mais qu’ayant apperçeu un de ses domestiques conduit entre les captifs, il se mit à battre sa teste, et mener un dueil extreme.
Cecy se pourroit apparier à ce qu’on vid dernierement d’un Prince des nostres, qui ayant ouy à Trente, où il estoit, nouvelles de la mort de son frere aisné, mais un frere en qui consistoit l’appuy et l’honneur de toute sa maison, et bien tost apres d’un puisné, sa seconde esperance, et ayant soustenu ces deux charges d’une constance exemplaire, comme quelques jours apres un de ses gens vint à mourir, il se laissa emporter à ce dernier accident ; et quitant sa resolution, s’abandonna au dueil et aux regrets ; en maniere qu’aucuns en prindrent argument, qu’il n’avoit esté touché au vif que de cette derniere secousse : mais à la verité ce fut, qu’estant d’ailleurs plein et comblé de tristesse, la moindre surcharge brisa les barrieres de la patience. Il s’en pourroit (di-je) autant juger de nostre histoire, n’estoit qu’elle adjouste, que Cambyses s’enquerant à Psammenitus, pourquoy ne s’estant esmeu au malheur de son filz et de sa fille, il portoit si impatiemment celuy de ses amis : C’est, respondit-il, que ce seul dernier desplaisir se peut signifier par larmes, les deux premiers surpassans de bien loin tout moyen de se pouvoir exprimer.
A l’aventure reviendroit à ce propos l’invention de cet ancien peintre, lequel ayant à representer au sacrifice de Iphigenia le dueil des assistans, selon les degrez de l’interest que chacun apportoit à la mort de cette belle fille innocente : ayant espuisé les derniers efforts de son art, quand ce vint au pere de la vierge, il le peignit le visage couvert, comme si nulle contenance ne pouvoit rapporter ce degré de dueil. Voyla pourquoy les Poëtes feignent cette miserable mere Niobé, ayant perdu premierement sept filz, et puis de suite autant de filles, sur-chargee de pertes, avoir esté en fin transmuee en rocher,
diriguisse malis,
pour exprimer cette morne, muette et sourde stupidité, qui nous transsit, lors que les accidens nous accablent surpassans nostre portee.
De vray, l’effort d’un desplaisir, pour estre extreme, doit estonner toute l’ame, et luy empescher la liberté de ses actions : Comme il nous advient à la chaude alarme d’une bien mauvaise nouvelle, de nous sentir saisis, transsis, et comme perclus de tous mouvemens : de façon que l’ame se relaschant apres aux larmes et aux plaintes, semble se desprendre, se desmeller, et se mettre plus au large, et à son aise,
Et via vix tandem voci laxata dolore est.
En la guerre que le Roy Ferdinand mena contre la veufve du Roy Jean de Hongrie, autour de Bude, un gendarme fut particulierement remerqué de chacun, pour avoir excessivement bien faict de sa personne, en certaine meslee : et incognu, hautement loué, et plaint y estant demeuré. Mais de nul tant que de Raiscïac seigneur Allemand, esprins d’une si rare vertu : le corps estant rapporté, cetuicy d’une commune curiosité, s’approcha pour voir qui c’estoit : et les armes ostees au trespassé, il reconut son fils. Cela augmenta la compassion aux assistans : luy seul, sans rien dire, sans siller les yeux, se tint debout, contemplant fixement le corps de son fils : jusques à ce que la vehemence de la tristesse, aiant accablé ses esprits vitaux, le porta roide mort par terre.
Chi puo dir com’egli arde è in picciol fuoco,
disent les amoureux, qui veulent representer une passion insupportable :
misero quod omnesEripit sensus mihi. Nam simul teLesbia aspexi, nihil est super miQuod loquar amens.Lingua sed torpet, tenuis sub artusFlamma dimanat, sonitu suopteTinniunt aures, gemina tegunturLumina nocte.
Aussi n’est ce pas en la vive, et plus cuysante chaleur de l’accés, que nous sommes propres à desployer nos plaintes et nos persuasions : l’ame est lors aggravee de profondes pensees, et le corps abbatu et languissant d’amour.
Et de là s’engendre par fois la defaillance fortuite, qui surprent les amoureux si hors de saison ; et cette glace qui les saisit par la force d’une ardeur extreme, au giron mesme de la jouïssance. Toutes passions qui se laissent gouster, et digerer, ne sont que mediocres,
Curæ leves loquuntur, ingentes stupent.
La surprise d’un plaisir inesperé nous estonne de mesme,
Ut me conspexit venientem, Et Troïa circumArma amens vidit, magnis exterrita monstris,Diriguit visu in medio, calor ossa reliquit,Labitur, et longo vix tandem tempore fatur.
Outre la femme Romaine, qui mourut surprise d’aise de voir son fils revenu de la routte de Cannes : Sophocles et Denis le Tyran, qui trespasserent d’aise : et Talva qui mourut en Corsegue, lisant les nouvelles des honneurs que le Senat de Rome luy avoit decernez. Nous tenons en nostre siecle, que le Pape Leon dixiesme ayant esté adverty de la prinse de Milan, qu’il avoit extremement souhaittee, entra en tel excez de joye, que la fievre l’en print, et en mourut. Et pour un plus notable tesmoignage de l’imbecillité humaine, il a esté remerqué par les anciens, que Diodorus le Dialecticien mourut sur le champ, espris d’une extreme passion de honte, pour en son escole, et en public, ne se pouvoir desvelopper d’un argument qu’on luy avoit faict.
Je suis peu en prise de ces violentes passions : J’ay l’apprehension naturellement dure ; et l’encrouste et espessis tous les jours par discours.
Chapitre 3 Nos affections s’emportent au delà de nous
CEUX qui accusent les hommes d’aller tousjours beant apres les choses futures, et nous apprennent à nous saisir des biens presens, et nous rassoir en ceux-là : comme n’ayants aucune prise sur ce qui est à venir, voire assez moins que nous n’avons sur ce qui est passé, touchent la plus commune des humaines erreurs : s’ils osent appeller erreur, chose à quoy nature mesme nous achemine, pour le service de la continuation de son ouvrage, nous imprimant, comme assez d’autres, cette imagination fausse, plus jalouse de nostre action, que de nostre science. Nous ne sommes jamais chez nous, nous sommes tousjours au delà. La crainte, le desir, l’esperance, nous eslancent vers l’advenir : et nous desrobent le sentiment et la consideration de ce qui est, pour nous amuser à ce qui sera, voire quand nous ne serons plus. Calamitosus est animus futuri anxius.
Ce grand precepte est souvent allegué en Platon, « Fay ton faict, et te congnoy. » Chascun de ces deux membres enveloppe generallement tout nostre devoir : et semblablement enveloppe son compagnon. Qui auroit à faire son faict, verroit que sa premiere leçon, c’est cognoistre ce qu’il est, et ce qui luy est propre. Et qui se cognoist, ne prend plus l’estranger faict pour le sien : s’ayme, et se cultive avant toute autre chose : refuse les occupations superflues, et les pensees, et propositions inutiles. Comme la folie quand on luy octroyera ce qu’elle desire, ne sera pas contente : aussi est la sagesse contente de ce qui est present, ne se desplait jamais de soy.
Epicurus dispense son sage de la prevoyance et soucy de l’advenir.
Entre les loix qui regardent les trespassez, celle icy me semble autant solide, qui oblige les actions des Princes à estre examinees apres leur mort : Ils sont compagnons, sinon maistres des loix : ce que la Justice n’a peu sur leurs testes, c’est raison qu’elle l’ayt sur leur reputation, et biens de leurs successeurs : choses que souvent nous preferons à la vie. C’est une usance qui apporte des commoditez singulieres aux nations où elle est observee, et desirable à tous bons Princes : qui ont à se plaindre de ce, qu’on traitte la memoire des meschants comme la leur. Nous devons la subjection et obeïssance egalement à tous Rois : car elle regarde leur office : mais l’estimation, non plus que l’affection, nous ne la devons qu’à leur vertu. Donnons à l’ordre politique de les souffrir patiemment, indignes : de celer leurs vices : d’aider de nostre recommandation leurs actions indifferentes, pendant que leur auctorité a besoin de nostre appuy. Mais nostre commerce finy, ce n’est pas raison de refuser à la justice, et à nostre liberté, l’expression de noz vrays ressentiments. Et nommément de refuser aux bons subjects, la gloire d’avoir reveremment et fidellement servi un maistre, les imperfections duquel leur estoient si bien cognues : frustrant la posterité d’un si utile exemple. Et ceux, qui, par respect de quelque obligation privee, espousent iniquement la memoire d’un Prince mesloüable, font justice particuliere aux despends de la justice publique. Titus Livius dict vray, que le langage des hommes nourris sous la Royauté, est tousjours plein de vaines ostentations et faux tesmoignages : chascun eslevant indifferemment son Roy, à l’extreme ligne de valeur et grandeur souveraine.
On peult reprouver la magnanimité de ces deux soldats, qui respondirent à Neron, à sa barbe, l’un enquis de luy, pourquoy il luy vouloit mal : Je t’aimoy quand tu le valois : mais despuis que tu és devenu parricide, boutefeu, basteleur, cochier, je te hay, comme tu merites. L’autre, pourquoy il le vouloit tuer ; Par ce que je ne trouve autre remede à tes continuels malefices. Mais les publics et universels tesmoignages, qui apres sa mort ont esté rendus, et le seront à tout jamais, à luy, et à tous meschans comme luy, de ses tiranniques et vilains deportements, qui de sain entendement les peut reprouver ?
Il me desplaist, qu’en une si saincte police que la Lacedemonienne, se fust meslée une si feinte ceremonie à la mort des Roys. Tous les confederez et voysins, et tous les Ilotes, hommes, femmes, pesle-mesle, se descoupoient le front, pour tesmoignage de deuil : et disoient en leurs cris et lamentations, que celuy la, quel qu’il eust esté, estoit le meilleur Roy de tous les leurs : attribuants au reng, le los qui appartenoit au merite ; et, qui appartient au premier merite, au postreme et dernier reng. Aristote, qui remue toutes choses, s’enquiert sur le mot de Solon, Que nul avant mourir ne peut estre dict heureux, Si celuy la mesme, qui a vescu, et qui est mort à souhait, peut estre dict heureux, si sa renommee va mal, si sa posterité est miserable. Pendant que nous nous remuons, nous nous portons par preoccupation où il nous plaist : mais estant hors de l’estre, nous n’avons aucune communication avec ce qui est. Et seroit meilleur de dire à Solon, que jamais homme n’est donc heureux, puis qu’il ne l’est qu’apres qu’il n’est plus.
QuisquamVix radicitus è vita se tollit, et ejicit :Sed facit esse sui quiddam super inscius ipse,Nec removet satis à projecto corpore sese, etVindicat.
Bertrand du Glesquin mourut au siege du chasteau de Rancon, pres du Puy en Auvergne : les assiegez s’estans rendus apres, furent obligez de porter les clefs de la place sur le corps du trespassé.
Barthelemy d’Alviane, General de l’armee des Venitiens, estant mort au service de leurs guerres en la Bresse, et son corps ayant esté rapporté à Venise par le Veronois, terre ennemie la pluspart de ceux de l’armee estoient d’advis, qu’on demandast sauf-conduit pour le passage à ceux de Veronne : mais Theodore Trivulce y contredit ; et choisit plustost de le passer par vive force, au hazard du combat : n’estant convenable, disoit-il, que celuy qui en sa vie n’avoit jamais eu peur de ses ennemis, estant mort fist demonstration de les craindre.
De vray, en chose voisine, par les loix Grecques, celuy qui demandoit à l’ennemy un corps pour l’inhumer, renonçoit à la victoire, et ne luy estoit plus loisible d’en dresser trophee : à celuy qui en estoit requis, c’estoit tiltre de gain. Ainsi perdit Nicias l’avantage qu’il avoit nettement gaigné sur les Corinthiens : et au rebours, Agesilaus asseura celuy qui luy estoit bien doubteusement acquis sur les Bæotiens.
Ces traits se pourroient trouver estranges, s’il n’estoit receu de tout temps, non seulement d’estendre le soing de nous, au delà cette vie, mais encore de croire, que bien souvent les faveurs celestes nous accompaignent au tombeau, et continuent à nos reliques. Dequoy il y a tant d’exemples anciens, laissant à part les nostres, qu’il n’est besoing que je m’y estende. Edouard premier Roy d’Angleterre, ayant essayé aux longues guerres d’entre luy et Robert Roy d’Escosse, combien sa presence donnoit d’advantage à ses affaires, rapportant tousjours la victoire de ce qu’il entreprenoit en personne ; mourant, obligea son fils par solennel serment, à ce qu’estant trespassé, il fist bouillir son corps pour desprendre sa chair d’avec les os, laquelle il fit enterrer : et quant aux os, qu’il les reservast pour les porter avec luy, et en son armee, toutes les fois qu’il luy adviendroit d’avoir guerre contre les Escossois : comme si la destinee avoit fatalement attaché la victoire à ses membres.