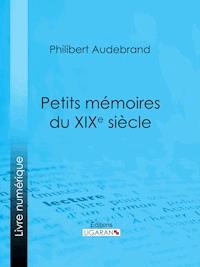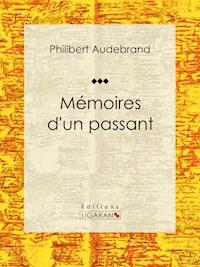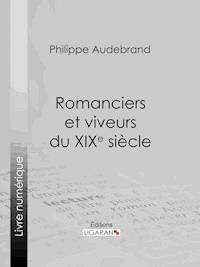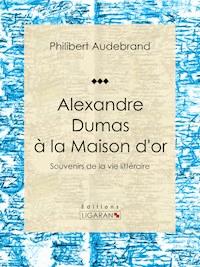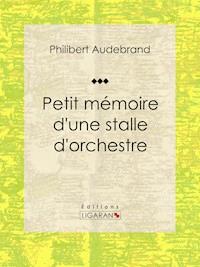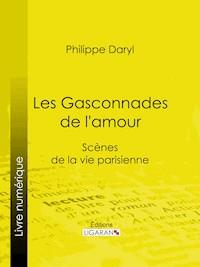
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "Ombre d'un infatigable noctambule, Âme d'un fureteur, Spectre d'un rêveur tout éveillé, Fantôme du premier des historiographes de la rue, Du fond des Enfers, où tu dois être, accepteras-tu la dédicace de ce livre écrit par un de tes disciples?..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ombre d’un infatigable noctambule,
Âme d’un fureteur,
Spectre d’un rêveur tout éveillé,
Fantôme du premier des historiographes de la rue,
Du fond des Enfers, où tu dois être, accepteras-tu la dédicace de ce livre écrit par un de tes disciples ?
Vieux diseur de calembredaines,
Arrière-neveu de l’empereur Pertinax, à ce que tu as cherché à nous faire accroire ;
Petit-fils d’un honnête toucheur de bœufs de la Basse-Bourgogne, à ce que disent les biographes ;
Prolétaire à particule, à ce que nous voyons au frontispice de tes œuvres si nombreuses et déjà introuvables ;
Révolutionnaire par caprice, on pourrait dire par suite d’épidémie ;
Philosophe, la nuit, toujours armé d’une lanterne, comme Diogène, un autre de tes ancêtres ;
Ivrogne de gloire littéraire, toujours poussé par la soif d’apprendre comme l’auteur d’Émile, ce qui t’a fait surnommer par nos pères de 1795 à 1805 : le Jean-Jacques du ruisseau ;
Romancier, le jour ;
Ouvrier typographe, le soir, pour imprimer toi-même tes romans, que tu composais souvent sans les écrire ;
Ami inattendu de ce bizarre Sébastien Mercier, l’auteur du Tableau de Paris, – lequel était l’ennemi de tout le monde ;
Amoureux de duchesses idéales, que tu ne faisais que voir passer dans leurs carrosses ;
Ne pouvant guère soupirer en réalité que pour des Gothons de cabaret, mais que ton imagination parait de perles et de plumes d’autruche ;
Tribun mêlé de satiriste, prédicateur sans colère mais non pas sans verve ;
Enfant d’une époque famélique et rabelaisienne, t’inquiétant plus de penser que de manger ;
Homme d’action, voyant ses contemporains chercher à s’enrichir et travaillant surtout à la fortune des autres ;
Plus marcheur que ne l’a été le Juif-Errant, mais ne te lassant pas d’user la plante de tes pieds sur le même pavé ;
Ne possédant pas une seule notion complète d’une spécialité quelconque, mais ayant au fond de ta boîte osseuse un peu du trésor de cent bibliothèques ;
Sentimental et grossier, lyrique et englué de grosse prose ;
Mariant sans cesse la réalité au rêve, l’utopie à la chose du présent ;
Réfractaire d’une société que tu t’épuisais à défendre ;
Original sans copie, mais, à travers tant de dissonances, de contrastes et de métamorphoses, observateur vigilant des mœurs du Paris d’il y a cent ans, à qui aurais-je pu mieux m’adresser qu’à toi pour patronner ce petit livre ?
Déjà, bien avant moi, des écrivains de ce siècle, et des plus illustres, se sont recommandés de toi, tout en glanant sur ton domaine. Gérard de Nerval les a signalés : Frédéric Soulié, quand il a écrit les Mémoires du Diable ; Eugène Sue, quand il s’est mis à faire les Mystères de Paris.
Pour moi, je n’ai voulu m’aider que d’un mot prophétique. Sous le Directoire, lorsque tu composais le Pied de Fanchette, ce récit si étrange, tu as dit : Notre dix-huitième siècle a fait de l’Amour un amusant mensonge. Celui qui viendra après lui en fera une suite de Gasconnades. – Cette parole d’un homme aux yeux de lynx m’a paru bonne à recueillir.
Bien mieux, j’en ai fait le titre de ces pages.
Ce sera à toi à dire s’il se trouve dans ce livre autant d’observation et de vérité que dans un des chapitres de tes Nuits de Paris.
Cela a commencé à l’Opéra. On jouait l’Aïda de Verdi. Au moment même où la fille de Pharaon entrait en scène, une action romanesque s’engageait dans la salle. Un jeune homme blond, place dans une stalle du balcon, côté droit, paraissait moins occupé de la musique et des chanteurs que d’une très belle dame qui ornait une loge de face ; – nous ne disons pas de quel rang afin de n’être pas trop indiscret. Un jeune homme brun, debout dans le couloir de l’orchestre, côté gauche, observait le manège et ne perdait aucun des légers signes d’intelligence qui s’échangeaient entre le balcon et la loge.
Les trois personnages, ainsi posés, formaient un triangle à peu près équilatéral. La jeune dame jouait assez bien la coquetterie ; le jeune homme blond était riant et radieux : le jeune homme brun, sombre et farouche.
Après le spectacle, le triangle se resserra ; les trois personnages se trouvèrent assez rapprochés, dans la foule, pour permettre à la jeune dame de glisser un billet dans la main du jeune homme blond, et cela si adroitement que l’œil d’un jaloux pouvait seul s’en apercevoir. Le tour étant fait, la jeune dame monta en voiture avec les personnes qui l’accompagnaient ; le jeune homme blond plaça mystérieusement le billet dans un petit portefeuille qu’il mit dans la poche de son habit, sur sa poitrine, et le jeune homme brun prit en frémissant le bras d’un de ses amis qui lui parlait depuis cinq minutes et qu’il n’écoutait pas.
Suivons le jeune homme blond, qui jusqu’ici joue le meilleur rôle dans l’intrigue. Leste et fringant comme on l’est à l’aurore d’une bonne fortune, il allume un cigare et il prend d’un pied léger le chemin de sa demeure, se réservant de lire sa lettre lorsqu’il sera chez lui et commodément assis près d’un bon feu. Le sybarite voulait savourer délicieusement son bonheur. La nuit était belle, le ciel étoilé, le pavé sec ; il demeurait à peu de distance de l’Opéra ; ce n’était pas la peine de prendre une voiture.
Il s’en allait donc à pied, fredonnant, la tête pleine d’idées voluptueuses, – lorsque au coin de la rue Saint-Lazare, deux hommes enveloppés de paletots dont le collet relevé leur cachait le visage et armés de grosses cannes, s’élancent sur lui, le saisissent, lui ferment la bouche, plongent leurs mains dans ses poches, puis se sauvent à toutes jambes. Cela se passa avec la rapidité d’un éclair.
Revenu de sa première émotion, le jeune homme blond commença par s’assurer qu’il n’avait reçu aucune blessure ; puis il tâta ses poches pour savoir ce qu’on lui avait pris. Ô surprise ! il avait encore sa montre et sa bourse : on ne lui avait enlevé que son portefeuille.
– Sans doute les bandits se seront imaginés que son portefeuille était garni de billets de banque !… Les maladroits ! pensa le volé en souriant ; il n’y avait pas un seul billet… c’est-à-dire si, il y en avait un ! le billet d’Hortense ! Ah ! j’aurais préféré perdre un billet de mille francs, ma montre, ma bourse et tout ce que j’avais sur moi. Ces damnés voleurs, qui vont être bien attrapés, me rendraient service si, reconnaissant leur erreur, ils venaient me rapporter mon portefeuille pour me prendre ce qu’ils m’ont laissé.
Mais les voleurs me revinrent pas, comme vous le pensez bien.
Quittons maintenant le jeune homme blond, qui commence à jouer le mauvais rôle de l’intrigue ; nous rejoindrons le jeune homme brun sur le boulevard des Italiens, au moment où il dit à son ami, à son co-voleur :
– Merci, mon cher complice. Je tiens ma proie ! Décidément le métier de voleur a du bon et peut profiter aux bonnes gens dans l’occasion. Voilà la lettre de mon adorée à cet animal !
Le lendemain, à l’heure du rendez-vous que le billet donnait à l’infortuné jeune homme blond, le voleur, par circonstance, se présenta chez la jeune dame, que le nom d’Hortense ne compromettra pas.
– Madame, lui dit-il, vous avez été indignement trahie, et je viens vous faire une restitution.
– Que voulez-vous dire, monsieur ?
– Cette lettre vous expliquera tout.
Et il présenta la lettre volée.
– Ah ! mon billet à Frédéric ! Comment est-il entre vos mains ?
– Hier, madame, en sortant de l’Opéra, j’ai soupé avec M. Frédéric au café de Paris. Nous étions là sept ou huit jeunes gens. Chacun parlait de ses aventures, excepté moi, qui n’avais rien à dire, car je suis malheureux, et vous le savez peut-être. M. Frédéric, au contraire, était triomphant. Animé par le vin de Champagne, il osa prononcer votre nom ; je lui imposai silence. Alors il tira de son portefeuille cette lettre, qu’il voulait montrer aux convives afin de prouver son bonheur : je la lui arrachai des mains en disant qu’il mentait. Demain je me battrai avec lui ; mais nul autre que moi n’a vu votre lettre, et je serai trop heureux de risquer ma vie pour vous donner un gage de mon dévouement.
– C’est bien, monsieur. Ce que vous avez fait est d’un homme de cœur et je vous en suis reconnaissante.
Ce mot ne disait que la moitié de la pensée. Le voleur était charmant, et Hortense se sentait attendrie de son action. Elle se repentait d’avoir dédaigné la barbe noire si sentimentale, pour la moustache blonde, si perfide. Mais le tort était facile à réparer. – Il se répara… très vite.
Le malheur de Frédéric était à son comble, lorsque, plein de confiance et voulant continuer son roman, il parvint à se trouver un moment seul avec Hortense.
– Eh quoi ! monsieur, lui dit-elle, vous avez l’audace de vous présenter devant moi ?
Étonné de cet accueil, Frédéric demanda comment il l’avait mérité, puis il reprit :
– Ah ! je devine ! c’est peut-être parce que je n’ai ni obéi ni répondu à votre billet ?
– Mon billet ! vous osez m’en parler !
– Pourquoi ne l’oserais-je pas ?
– Je sais tout, monsieur.
– Ah ! vous avez été informée de mon aventure ? C’est singulier ! je n’en ai parlé à personne.
– J’ai tout appris, monsieur, et l’on m’a rendu la lettre que j’avais eu la faiblesse d’écrire dans un moment d’erreur.
– On vous l’a rendue ! Et qui donc ?
– Mais celui qui vous l’avait prise.
– Le voleur ?
– Je vous prie, monsieur, d’employer d’autres termes lorsque vous parlerez devant moi de M. Anatole de S ***.
– Anatole ! c’est lui qui avait ma lettre ?
– Vous le savez, puisqu’il vous l’a arrachée de vive force…
Frédéric comprit alors seulement qu’il était dupe d’une mystification. Il apprit à Hortense de quelle façon le billet lui avait été enlevé, mais le voleur avait si bien gagné sa cause que la ruse lui fut pardonnée, – et Frédéric avait si bien perdu la sienne que la preuve de son innocence ne pouvait plus lui rendre ses droits usurpés.
Il ne lui restait plus qu’à provoquer son heureux rival, et c’est ce qu’il fit. Anatole avait annoncé qu’il se battrait pour l’objet de sa passion, et en cela du moins il disait vrai. Le sort, qui devait une réparation à Frédéric, lui envoya un coup d’épée. N’était-ce pas là ce qui pouvait lui arriver de mieux ? Un bras en écharpe était le seul moyen qui lui restât de reprendre l’air intéressant.
Et puis sa blessure lui permettait de rester enfermé chez lui pendant une quinzaine de jours et de laisser ainsi tomber les railleries que son aventure ne pouvait manquer de soulever. Et, en nous racontant cette histoire, il ajoutait :
– Ce n’est pas au bras droit, c’est au cœur que je suis le plus blessé.
Il se nomme Ernest Caussade. Entre nous, c’est un assez beau garçon et un élégant par-dessus le marché. Ne le prenez pas d’ailleurs pour un sot ni pour un lâche. Quant à moi, j’inclinerais à penser qu’il y a en lui l’étoffe d’un philosophe de très haute portée.
Au fait, tenez, vous allez bien voir ce qui en est.
C’était il y a quatre ans, au moment même de ses noces, à l’heure toujours solennelle du bal.
– Tu me trouves gai, me dit-il : au fond je ne le suis guère.
– Avec une si belle femme, après une si belle dot ?
Il alla fermer la porte et revint à moi : puis, d’un ton mystérieux :
– Écoute, me dit-il. Ce matin, en passant par la Halle, je vis chez une grosse fruitière un petit panier de fraises magnifiques. J’en fus tenté : c’est une primeur. J’en offris un prix fou. La marchande, avec un soupir de regret, me refusa : c’était un cadeau d’un amoureux pour sa belle. La fruitière me le dit, tout en arrangeant les fraises dans une corbeille de fort bon goût et d’une forme particulière. Je me résignai, non sans être tenté d’attendre l’amoureux et de le conjurer de se départir de ce fruit en faveur de ma galanterie de nouvel époux. Le temps me pressait : quelques acquisitions, les témoins, la mairie, l’église, l’heure qu’il était, m’empêchèrent d’insister. En sorte que j’éprouvai le rancœur de ne pouvoir emporter avec moi le panier de fraises.
– Et c’est cela qui te tourmente ?
– Pardieu !
– Je ne t’aurais jamais cru si gourmand.
– Et moi, je ne t’aurais jamais cru si stupide ; tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez ; mais avant de te dire le reste, va voir si l’on danse toujours.
Je m’approchai de la porte vitrée, et, par le rideau de mousseline, je vis la mariée qui dansait la Petite laitière. On était à la note criarde et traditionnelle qui se prolonge démesurément pour que le cavalier tienne avec intérêt sa danseuse pendant quelques secondes.
– Et puis ? dis-je à mon ami.
– Figure-toi que tout à l’heure, tandis que la mère de ma femme et les demoiselles d’honneur lui passaient une robe de bal, j’ai pénétré, comme un fraudeur, dans le sanctuaire où ma belle, en simple corset, mangeait du bout de ses lèvres, avec une petite cuiller de vermeil, les maudites fraises l’une après l’autre.
– En vérité ?
– C’est comme j’ai l’honneur de te le dire. J’ai reconnu la jolie corbeille de la marchande. À mon air décontenancé devant cet objet qui m’a fait ouvrir les yeux comme des portes cochères :
– C’est une primeur, m’a dit la gentille gourmande, et je les adore : n’y touchez pas.
– Et tu n’y as pas touché ?
– Bien entendu. C’est un pupille de son père, le joli cavalier qui l’embrasse dans ce moment, si j’en crois les violons, qui m’a joué ce plaisant tour-là.
– Pardieu ! tu connais dès le premier jour l’ami de la maison. Que feras-tu ?
– Rien : il n’y a rien à faire. Seulement, comme je suis prévenu, j’aurai toute la discrétion possible, afin de ne plus m’apercevoir de rien : et cette confidence est pour ta gouverne.
Il y a quelques années de ceci, et Ernest Caussade est heureux comme Scarmentado.
En 1867, le colonel Anderson, chef de la police de Londres, envoyait au préfet de police de Paris, une dépêche conçue à peu près en ces termes :
« Londres, 15 mai 1867.
Monsieur le préfet,
En vertu des traités qui lient la France et la Grande-Bretagne, je viens vous prier de rendre à Sa Majesté Britannique un très grand service. Il s’agit de faciliter, d’abord, l’arrestation, et, en second lieu, l’extradition d’un hardi coquin, d’origine anglaise, qu’on sait s’être réfugié récemment à Paris. Cet homme, nommé John Smith, est un véritable Protée. Il change presque aussi aisément de visage que de nom. On assure qu’il porte toujours sur lui un portefeuille bourré de banknotes, et ses goussets sont remplis d’or. Mais le trait distinctif de cette personnalité, est une tendance invincible à s’emparer des femmes d’autrui. Divers procès-verbaux constatent que ce John Smith est bigame en Angleterre, bigame en Écosse, bigame en Irlande, bigame aux États-Unis, bigame en Allemagne, bigame en Italie, bigame en Espagne, bigame en Portugal, bigame en Danemark, bigame en Russie, bigame en Suisse, et tout annonce qu’il se prépare à être encore bigame en France. C’est pour empêcher la consommation d’un nouvel attentat social que la police de Sa Majesté tient à mettre la main sur ce sacrilège de la pire espèce.
Avec la dépêche que je prends la liberté de vous adresser, monsieur le préfet, vous trouverez quinze portraits photographiques. Ces cartes représentent aussi fidèlement que possible le susdit John Smith dans ses principaux avatars. J’y ajoute son signalement fort détaillé, mais en prenant soin de vous faire remarquer que l’individu en question, plus habile à se grimer qu’un comédien de Covent-Garden, déroute sans cesse les pistes les plus vigilantes, en prenant d’heure en heure toutes les figures qu’il lui plaît. Pendant son séjour à Londres, il s’est montré à tour de rôle sous la physionomie d’un maire, sous celle d’un jockey, sous celle d’un clown nègre, sous celle d’un gentleman du meilleur ton et sous celle d’un prêtre catholique attaché à la personne du cardinal Wiseman. On se disposait à l’arrêter sous cette dernière forme, quand il a trouvé moyen de l’échapper et de gagner Douvres, habillé en jeune lady, s’en allant à Calais rejoindre un gros négociant en coutellerie de votre ville, lequel avait la naïveté de se croire en bonne fortune.
Là s’arrêtent nos renseignements, monsieur le préfet ; seulement nous savons, à ne pouvoir nous y méprendre, que le drôle est à Paris, la ville du monde où l’on s’amuse le plus et où il y a trois cent mille moyens de se cacher. Néanmoins nous ne perdons pas l’espoir de prendre notre coquin au trébuchet. La police française aidant, notre tâche sera vite simplifiée. Au surplus, en même temps que part cette missive, deux de nos plus habiles détectives prennent le paquebot et se mettront à votre disposition. Ce sont les nommés Peters Jacoby et Isaaç Shore, deux limiers qui ont les narines de vrais chiens de chasse. Il faudra que le John Smith ait le diable au corps, s’il leur échappe.
Veuillez agréer, monsieur le préfet, l’assurance de ma considération la plus distinguée.
Colonel W. ANDERSON. »
Extrader un malfaiteur international n’est rien, quand on a le sujet sous la main, mais arrêter un Anglais retors au milieu de ces dix mille îlots de maisons qu’on appelle Paris, c’est le diable à confesser ou la mer à boire. Plein d’audace, cousu d’or, ayant l’habitude de changer plus souvent de physionomie qu’un gommeux ne change de chemise, fait à vivre avec le peuple autant qu’à frayer avec l’aristocratie, ce John Smith échappait réellement à toutes les investigations. Par bonheur, chacun des deux détectives lui ressemblait sous le rapport de l’art de se métamorphoser ; chacun d’eux aussi avait beaucoup d’or dans ses goussets.
– Ne craignez pas la dépense, avait dit le colonel Anderson : c’est la morale publique qui paie.
Au bout de la première semaine, un jour, Isaac Shore, habillé en marchand des quatre saisons, promenait dans une voiture dix bottes d’asperges, qu’il ne songeait pas à vendre, lorsque ses yeux de lynx se fixèrent, quai Conti, sur un personnage qui, le lorgnon pendu à un fil de caoutchouc, ébauchait un madrigal avec une jeune et jolie modiste du pays Latin, évidemment en course pour les besoins de son magasin. Il ne fallut au limier qu’un éclair pour voir que ce promeneur galant n’était autre que le Joconde qui promenait à travers les deux mondes la passion de la bigamie. L’arrêter ? Il l’eût fait, s’il avait vu passer un sergent de ville ou un gardien de la paix, et cela en exhibant une commission de Londres, approuvée à Paris ; mais, pour le moment, il ne passait sur le quai qu’un groupe de membres de l’Académie française se rendant au palais Mazarin pour y toucher des jetons de présence.
– Il est à Paris, pour sûr, dit Isaac Shore, le soir, à Peters Jacoby. Je l’ai vu, quai Conti, papillonnant avec une grisette. Voilà déjà une certitude acquise. Veillons !
Peters Jacoby, piqué au jeu, veilla de la manière la plus sérieuse. Pour avoir une raison plausible de parcourir Paris, il portait sur la tête une planche, et sur cette planche cette sempiternelle réduction en plâtre de l’Écorché, de Michel-Ange, que les petits Italiens font semblant de vendre aux passants, et que ces derniers n’achètent jamais. Léon Gozlan disait, une fois, à l’un de ces problématiques industriels : – Combien avez-vous vendu de ces Écorchés ? – Jamais un seul, monsieur. – Et ils vivent pourtant. Mais de quoi donc vivent-ils ? Allez donc demander au pinson de quoi il vit, l’hiver. – Ce qu’il y a de sûr, c’est que le détective faisait ce métier-là.
En longeant le boulevard Malesherbes, zone des millionnaires et des Phrynés de la haute gomme, à cent pas du parc de Monceaux, Peters Jacoby, promenant toujours sa statuette, aperçut un groupe de trois personnes. Comme presque toujours à Paris, ce trio formait le bouquet à trois fleurs : le mari, la femme et l’amant.
LE MARI.– Figure joufflue, tête bouclée, des joues rouges, gros ventre, avec un paquet de breloques dessus. C’était M. Z ***, brave homme, qui sollicitait alors une place de préfet, – un préfet de l’empire !
LA FEMME.– Ah ! charmante ! mille fois charmante, suivant le type de la beauté de ce millésime : tête blonde, yeux bleus, nez impudent, figure endiablée, un luxe insensé. – Ah ! les blondes de la vieille garde ! les blondes de la chronique des chroniques !
L’AMANT.– Cavalier d’une toilette irréprochable, une gravure du Journal des Tailleurs, binocle en nikel, gants gris-perle, un stick et les bottes vernies, les mieux vernies qu’il y ait sous la calotte du firmament.
– Mais, se dit le détective in petto, voilà notre homme. Ah ! si je pouvais l’arquepincer !
Justement on l’appelait. Les blondes ont des caprices. Celle-là voulait avoir un exemplaire de l’Écorché, de Michel-Ange. Demandez-moi un peu pourquoi ? Péters s’approcha avec son bagage, et en s’approchant, il se disait :
– Pas de fol emportement. Dissimulons. Mûrissons un projet. Allons lentement, mais sûrement.
Il vendit l’Écorché vingt-sept francs cinquante centimes, mais en demandant à apporter une copie du Persée de Benvenuto Cellini. Ce qu’il voulait c’était entrer dans l’hôtel et il y entra. Une fois là, au bout de trois jours, il s’ouvrit au mari et lui dit tout :
– On vous nommera préfet, lui dit-il, si vous voulez vous prêter à l’arrestation du bigame. Ça vous va-t-il ?
– Ça me va.
Un soir donc, tous trois étaient à table, boulevard Malesherbes, le mari, la femme et l’amant, quand, au dessert, celui qui désirait être préfet s’esquiva, sous un prétexte, pour aller à cent pas, dans la rue, chercher deux extraits de la police française et de la police anglaise. Mais grande fut sa surprise, à son retour : John Smith, l’incorrigible bigame, s’était enfui par les derrières, en emmenant avec lui la belle blonde.
Il devenait bigame pour la quatorzième fois.
Toutes les polices de l’Europe sont à ses trousses, mais il paraît que le fugitif est en Chine, pays de quatre cents millions d’habitants. – Cherchez-le donc !
Blaguer, gasconner, tromper, tout cela est usité chez nous en fait de mariage ou, si vous voulez, en fait d’amour qui mène au mariage. À la fin, pourtant, il n’est pas de pot-au-rose qui ne se découvre. On démasque le mensonge. Eh bien, après ?
L’amour n’étant presque plus compté pour rien dans les accouplements légaux du jour, une incessante comédie se joue à ce sujet. On s’épouse par intérêt, par vanité, par suite d’importunité. Si la chose n’était pas odieuse, elle serait comique. Le fait est que l’aventure prête fort souvent à rire.
Ah ! nous le savons, les mariages burlesques ou infâmes ne datent pas de nos jours. Ça a commencé surtout sous Henri IV, c’est-à-dire du temps de Sébastien Zamet, seigneur de quinze mille écus d’or. Plus tard, le maquignonnage s’est perfectionné avec le temps. Ainsi, sous la Régence, l’Ecossais Lawavait une fille âgée de sept ans. Du jour où ce fut connu, on se disputa chez les nobles de vieille souche à qui aurait l’honneur de faire épouser son fils à cette progéniture du hardi spéculateur. À la même époque, un manieur d’argent, qui descendait en ligne directe des Hébreux, entrait de plain-pied dans une famille catholique blasonnée, celle des Molé ; on n’a pas oublié cette prouesse de Samuel Bernard. Mais pour ceux des grands qui s’encanaillaient si résolument, il y avait alors une formule qui était tout à la fois une impertinence et une excuse. Se marier avec des roturiers enrichis, ils appelaient ça : fumer leurs terres.
Dans les Souvenirs de la marquise de Créquy, ces Mémoires bourrés de tant de révélations amusantes, on trouve une anecdote des plus curieuses sur le mariage d’un duc de Broglie avec une bourgeoise d’Alsace. Mais en dépit de la nuit du 4 août 89, les gens de bel air ont conservé dans notre dix-neuvième siècle leurs dédains traditionnels pour les vilains ; néanmoins ils n’hésitent pas à marier leurs héritiers au dernier des croquants ou des réprouvés, quand il est prouvé qu’il y a au fond beaucoup d’argent. Est-ce que nous n’avons pas vu un prince ultra-catholique, fils du dernier ministre de Charles X, donner sa personne et son nom à la fille d’un petit juif de Bordeaux ? Ah ! ce rusé Israélite ! un fin renard qui avait ramassé des millions en Bourse aussi aisément que ses ancêtres, fuyant l’Égypte, avaient recueilli la manne dans le désert ! En visant ce sujet presque épique, Léon Gozlan a écrit un de ses plus jolis contes, sous ce titre : – Notre fille sera princesse. – Princesse, la petite juive l’a été, un jour, mais le prince de Polignac mort, les instincts de sa race ont repris le dessus et elle a convolé en secondes noces avec un riche marchand de bouteilles du chef-lieu des Bouches-du-Rhône.
Laissez-nous maintenant arriver au racontar du faux baron.
Rois sans couronnes, princes sans états, ducs sans duchés, marquis sans marquisats, comtes sans comtés, barons sans baronnies, que de nobles pour rire sur le pavé de Paris ! J *** S *** n’était rien de tout cela et il s’était lui-même créé baron.
– Jean Sauvigny, baron de la Sapinière.
Cela se voyait sur de fort belles cartes de visite, enjolivées, bien entendu d’un très beau dessin héraldique, avec une devise ad hoc. La livrée allait de pair. Cinq valets de différents grades, stylés à cette discipline, ne manquaient pas de répéter cent fois par jour :
– Monsieur le baron par-ci, monsieur le baron par-là !
Baron ! La décoration aristocratique avait pour lui l’avantage inappréciable de déguiser une origine modeste dont il a la faiblesse et le tort de rougir. En se donnant des armoiries, il était heureux de couvrir et de dissimuler sous une fiction chevaleresque une réalité qui lui semblait fâcheuse. Son écusson blasonné cachait les panonceaux de feu son père, digne et honnête huissier dans une petite ville de province, en Bourbonnais.
Ce bon père, l’huissier, avait eu le talent de s’enrichir ; c’était là son beau côté. Sans doute il avait instrumenté hors de son emploi dans quelques bonnes opérations financières, couronnées d’un succès productif ; – il avait saisi l’occasion, disaient les plaisants ; – il avait fait sommation à la Fortune, parlant à sa personne ; après quoi il s’était donné la satisfaction de l’appréhender au corps et de l’incarcérer dans sa caisse.
Le fait est qu’il avait laissé à son fils vingt-cinq ou trente mille francs de rente. C’était là un dédommagement suffisant qui aurait dû le consoler de la médiocrité de son origine, s’il avait été quelque peu philosophe, mais qui, au contraire, lui avait inspiré des idées ambitieuses. Ce fils avait voulu illustrer sa fortune et se poser à la fois sur deux bons pieds dans le monde.
S’étant donc anobli, se sachant assez joli garçon, il avait alors pensé à une alliance matrimoniale avec la fille d’un vrai marquis, mais d’un marquis ruiné. Il ne faut pas oublier que ce gentilhomme, étant à cheval sur le blason, préférait, chose rare de nos jours, même l’éclat de la naissance à l’argent. C’est pourquoi, un peu avant la publication des bans, on le vit se livrer à une enquête sur l’origine du futur gendre.
– S’il était seulement simple chevalier, disait-il, comme nous le pincerions ! Comme il ferait notre affaire !
Mais on découvrit bien vite que le prétendu descendant des croisés n’était que le fils d’un huissier.
De là ce billet dont les belles dames se sont passé la copie de main en main, dans les salons de la rive gauche.
« Paris, le 15 mars 1875.
Cher monsieur Jean Sauvigny,
Un devoir impérieux me faisait une loi de me renseigner sur votre compte. J’ai donc interrogé l’état civil de votre arrondissement. Vous savez que j’ai pu apprendre une particularité : c’est que les exploits de vos ancêtres n’ont rien de semblable aux exploits des miens.
En un tel état de choses, je n’ai qu’à vous prier de considérer ce qui s’est passé entre nous comme une fable sans moralité.
Veuillez agréer, monsieur, tous mes compliments.
MARQUIS DE P ***. »
Les belles gasconnades de part et d’autre !
VARIANTE DE L’HISTOIRE DES AMOURS DE MARS ET DE VÉNUS
Le 8 mai 1860, devait être un grand jour pour mademoiselle Félicie Spilmann, fille majeure de la blonde Alsace ; ce jour-là, elle devait être conduite à l’autel par un des vainqueurs de Sébastopol, un ancien zouave retiré du service avec une superbe moustache et la médaille de Crimée bardée de ses quatre brochettes d’argent. Des circonstances indépendantes de sa volonté ont obligé l’ex-guerrier à faire une légère conversion, et, au lieu de conduire mademoiselle Félicie devant M. le maire, il la conduit aujourd’hui devant le tribunal correctionnel.
L’Alsacienne ne paraît pas le moins du monde effrayée de ce changement de conversion ; elle arrive sur le banc des prévenus la tête haute, se campe fièrement sur la hanche droite, les bras croisés sur la poitrine ; ainsi pourrait-on représenter la statue de la force au repos.
Le zouave, appelé à formuler sa plainte, ne paraît pas intimidé de l’attitude de sa puissante adversaire, et, d’une voix non émue, dépose :
– Ayant placé ma confiance dans mademoiselle, au point de vouloir l’épouser pour le bon motif, je lui ai déposé entre ses propres mains différents effets de petit équipement, qui sont : une montre moitié or, moitié argent (le mot vermeil ne fait sans doute pas partie du dictionnaire du noble guerrier), une autre montre en argent pur et une troisième montre en or fin…
M. LE PRÉSIDENT.– Il n’est pas ordinaire d’avoir trois montres ; d’où vous venaient-elles ?
LE ZOUAVE.– Me venaient de trois camarades de Crimée, avec lesquels j’avais fait le pari au dernier vivant. S’est trouvé qu’ils ont passé l’arme à gauche, et moi, naturellement, j’ai empoché les toquantes ; j’en ai eu bien des autres dans la campagne, vu que les camarades ne duraient pas longtemps sur leurs jambes ; mais comme on n’avait pas du rôti tous les jours dans le pays, a fallu s’en défaire de pas mal, au point que je n’ai rapporté que les trois que j’ai eu la faiblesse de confier à mademoiselle, qui me les a rincées par le moyen du Mont-de-Piété, son recéleur et son complice.
L’ALSACIENNE.– Puisque nous étions pour nous marier, je pouvais bien croire que j’avais le droit. Surtout, après. Il n’a plus voulu, mais il était trop tard. S’il veut les reconnaissances, je lui dirai le marchand à qui je les ai vendues ; je crains rien, je suis une honnête femme ; je crains rien, du tout, du tout, ah ! mais du tout !
M. LE PRÉSIDENT.– Vous dites vous-même que vous étiez dans l’intention d’épouser cette fille ; qui vous a fait changer d’idée ?
Le ZOUAVE.– Mon président, voilà. Telle que vous la voyez, la particulière, elle m’a dit qu’elle avait vingt-huit ans ; mais quand j’ai eu mis le nez dans ses papiers, j’ai vu que les vingt-huit ans, elle les avait possédés en 1846, ce qui fait aujourd’hui la bonne quarantaine. Alors, j’ai été trouver mon ancien major (chirurgien major), pour lui demander si une femme de quarante ans ça pouvait vous donner la chance d’avoir des enfants, vu que, les enfants, je les adore et que j’en veux, et que sans enfants, pas de mariage. Le major m’ayant répondu avec sa grimace, que je connais bien, j’ai dit à mademoiselle Félicie : « Mademoiselle, si ça vous est égal, j’épouserai votre sœur ; mais, pour ce qui est de vous, impossible, vu que je désire donner des enfants à la patrie. » Mademoiselle Félicie m’ayant griffé à la figure, je n’ai rien dit ; mais n’ayant pas voulu me rendre les montres, qui est tout mon patrimoine pour me marier, j’ai été chez le commissaire, et voilà.
M. LE PRÉSIDENT, à Félicie. – Est-ce que vous n’êtes pas dans l’intention de rendre les montres ou leur valeur ?
FÉLICIE.– Je crains rien du tout, du tout. Le zouave, il m’a fait faire des dépenses pour nous marier, pour les papiers et tout ; tout ce que je peux faire, c’est de lui donner l’adresse des reconnaissances : je ne veux pas qu’il épouse ma sœur avec les montres qu’il m’a données.
LE ZOUAVE.– Données ! pas de bêtises, l’ancienne ! déposées, confiées, prêtées, si voulez, mais données, jamais !
À la grande surprise du zouave, le Tribunal n’a pas vu, dans le fait reproché à l’Alsacienne, une intention frauduleuse, et l’a renvoyée de la plainte.
– Mais quel amas de gasconnades de l’amour !
Comment faut-il l’appeler ? Louise ? Jenny ? Alice ? Laura ? – Au fond, un nom importe peu. Tous les noms de femme sont beaux, quand ils sont bien portés. Une actrice a rarement un vilain nom. Celle-là, – c’est une chanteuse légère, – est connue du public à cause de sa famille, très répandue sur les affiches de théâtre depuis un demi-siècle. Quant à elle, on ne la désigne, entre amis, que par son petit nom, tout différent de son nom d’artiste. – Je me rappelle à présent : on l’appelle Polly ; c’est anglais et c’est doux.
Pour une sorte de magnat hongrois qui l’adore, ce nom est une magie. – Ah ! bien, oui, la diplomatie, la politique, le jeu, les voyages, l’orgie, les duels, l’ambition, les rubans, qu’est-ce que tout cela peut faire à Son Excellence ? Le magnat, qui est comte palatin, a des forêts, trois châteaux, une grande pêche sur un affluent du Danube, et un crû qui donne un vin qui rivalise avec le tokay, mais il n’apprécie tout cela qu’en raison de Polly.
Rien de trop cher pour cette tête folle. En Hongrie, dans la demeure aristocratique où il est né, le comte a trouvé, dans une cassette, pour un demi-million de diamants. – Ces brillants ont dansé souvent à la cour d’Autriche. – Ils entourent une couronne d’aïeule. – Ça ne fait rien, c’est pour coiffer la jolie tête brune de Polly.
Croiriez-vous que Polly ne se tient pas pour heureuse ? – Je vais vous dire, c’est ce qui arrive souvent pour ces adorables corps de femme qui sortent souvent de souches vulgaires : elles sont malheureuses de trop de bonheur. – Toutes, plus ou moins, ressemblent à l’enfant capricieux auquel on avait tout donné et qui, par-dessus le marché, demandait encore la lune.
Ah ! si le magnat pouvait donner la lune à Polly, il y a longtemps que Polly aurait lâché la lune pour la donner à sa femme de chambre !
Un jour Polly était rêveuse, ce qui indique naturellement que le comte hongrois était devenu triste.
– Comment donc ! se disait-il, y a-t-il donc un de ses souhaits que je ne puisse satisfaire ?
Polly laissait tomber sa jolie tête dans ses mains. Elle rêvait, je viens de vous le dire. À un certain moment, elle se mit à soupirer. – Le comte pensa mourir de chagrin et d’effroi.
– Qu’avez-vous, chère Polly ? demanda-t-il en s’approchant d’elle comme la mère de son fils dans le petit poème d’André Chénier qui est intitulé le Jeune Malade.
Elle ne répondit pas.
– Vous soupirez ! reprit-il. Désirez-vous donc quelque chose ?
– Oui, répondit-elle avec une voix de bengali.
– Qu’est-ce donc ?
– Une maison de campagne.