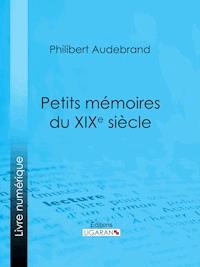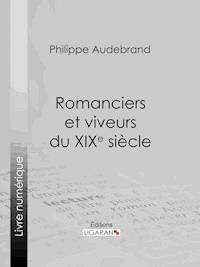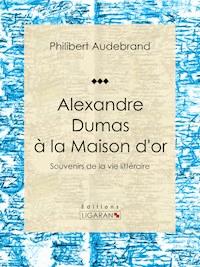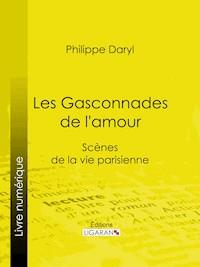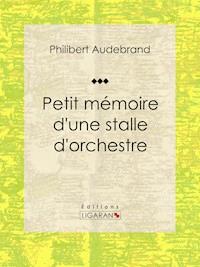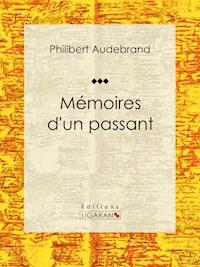
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Imaginez le lendemain de la Révolution de Juillet. Il n'y avait plus trace de barricades ; Paris était tout à fait pacifié. Au printemps, on ne rencontrait le long des rues que petites charrettes pleines de fleurs et que jeunes marchands de hannetons, car, il y a cinquante ans, vendre des hannetons empilés dans un bas, c'était encore un commerce."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335076271
©Ligaran 2015
En guise d’avant-propos, un simple mot de reconnaissance.
Il y a un an, sous ce titre : Petits Mémoires du XIXe siècle, il a paru, à cette même librairie, un volume signé de notre nom et que l’on n’a peut-être pas encore eu le temps d’oublier.
Ces pages étaient des Souvenirs de la vie littéraire.
On y voit défiler une vingtaine de figures rayonnantes, figures de poètes et d’artistes, qui ont marqué avec éclat de 1820 à 1860.
Le public ayant fait très bon accueil à ces récits qui roulent sur le passé d’hier, l’auteur s’est cru autorisé à donner suite à cette publication.
Sous un titre quelque peu différent, ce livre est donc le tome second des Petits Mémoires du XIXe siècle.
Cette vie parisienne, faite de labeur et de plaisir, de misère et de gloire, de crime et de vertu, nul ne la connaît autant que nous. Voilà cinquante ans que nous la pratiquons jour par jour, ce qui nous a mis à même d’en noter tous les contrastes. C’est un monde à part, où abonde le mystère. La scène n’y est pas moins changeante que l’aspect d’un de ces kaléidoscopes à l’aide desquels on fournit des loisirs ou un amusement salutaire aux enfants malades. Dans la circonstance, le passe-temps a cet autre avantage de rappeler sans cesse l’histoire contemporaine et de servir ainsi d’enseignement.
Dans le premier volume des Petits Mémoires du XIXe siècle se meuvent des personnalités littéraires de haute volée : Henri Heine, Alexandre Dumas, Philarète Chasles, Méry, Félix Arvers, Charles Philipon, Gérard de Nerval, Alfred de Musset, des journalistes, des actrices. Dans ce tome second, le personnel qu’on exhibe n’est pas moins intéressant à passer en revue.
Ce sont toujours des hommes de ce siècle, des acteurs de la comédie sociale qui se joue de notre temps : des grands et des petits, des fantoches et des hommes de génie, les Dieux et les Diables du jour.
Prenez, lisez et jugez.
PHILIBERT AUDEBRAND.
Avril 1893.
Imaginez le lendemain de la Révolution de Juillet.
Il n’y avait plus trace de barricades ; Paris était tout à fait pacifié. Au printemps, on ne rencontrait le long des rues que petites charrettes pleines de fleurs et que jeunes marchands de hannetons, car, il y a cinquante ans, vendre des hannetons empilés dans un bas, c’était encore un commerce. À la fièvre de la politique succédait une autre endémie, l’amour de l’art. Impossible de faire cent pas sans se heurter à une question de poésie, de peinture ou de musique. Le beau temps ! La libérale et joyeuse époque ! Victor Hugo venait de faire paraître les Feuilles d’automne, si bien venues, quoiqu’on fût en avril. Eugène Delacroix attirait déjà tous les regards par sa grande toile : Dante et Virgile ; l’Opéra montait Robert le Diable, qui, tout compté, sera tenu pour l’œuvre maîtresse de Meyerbeer. Dans une mansarde, un débutant taillait son crayon pour jeter sur le vélin son premier dessin : un jeune beau du jour, entre deux jeunes femmes, deux dominos, qui se le disputaient au bal masqué, et il signait cet essai d’un pseudonyme destiné à devenir célèbre, celui de Gavarni.
Vous voyez d’ici ce que pouvait être la physionomie de la grande ville à une pareille heure : une autre Sybaris, mais autant éprise de volupté que des plaisirs de l’esprit. À cette immense fourmilière, il fallait désormais à forte dose les jouissances que donne l’étude. Ce fut sur ces entrefaites qu’après son retour d’une superbe tournée en Angleterre, Paganini opéra sa rentrée dans Paris afin d’y reprendre la série de ses premiers concerts, ceux qu’il avait donnés en 1829.
À un demi-siècle de distance, il y a eu tant de révolutions, les choses ont si souvent changé d’aspect, et la Mort d’Hogarth a couché sur le sol tant de contemporains illustres, que les générations, naturellement peu poussées à reporter les yeux en arrière, sont bien excusables de ne pas savoir ce qu’a été Nicolo Paganini. Il en est, d’ailleurs, d’un joueur de lyre ou de violon comme d’un grand comédien. Une fois mort, il ne reste de l’homme que son nom, et un nom s’en va vite quand il n’est pas imprimé sur le papier, taillé dans la pierre ou gravé sur le bronze. Ce nom de musicien, c’est donc aux survivants de ces âges lointains à l’apprendre aux âges nouveaux.
Premier point : Paganini était-il seulement un homme ? On comptait alors un quatuor de grands pianistes : Franz Liszt, Sigismond Thalberg, Chopin et Albert Sowinski, tous quatre rivaux ou à peu près. Mais il n’existait qu’un Paganini, l’incomparable Linus du violon, et, de la Néva à la Seine, et du ruisseau de la rue Le Peletier à la Tamise, il n’y avait là-dessus qu’une voix : l’instrumentiste était divin. Second point : ce mystérieux Italien portait sur les épaules une tête étrange, échappant à toutes les lois de l’esthétique, pas belle et pourtant séduisante au plus haut point, terrible et souriante tout ensemble, ce qui faisait que Théodore Hoffmann, le grand conteur allemand, l’avait introduite comme un élément diabolique dans l’une de ses sombres fantaisies. Cette même figure, presque surhumaine, faisait que, de Vienne à Paris, on disait : « Regardez donc ! c’est un démon ! »
Une chose certaine, rien qu’avec son Stradivarius, il donnait à lui seul un concert, et l’élite de la société la plus élégante du monde accourait à lui. Jeune homme, il avait débuté tour à tour à Naples et à Milan ; après quoi, enjambant le Tyrol, il était allé à Vienne et à Saint-Pétersbourg ; mais, après quinze années d’épreuves, il s’était dit : « On aurait en soi tout le génie du monde, tant qu’on n’a pas conquis le public de Paris, on ne compte pas ; on n’est rien. » Et, bien qu’ayant déjà un peu de renommée, il s’était décidé à venir chez nous. Ce fut pour le mieux de ses intérêts, car, au sortir de Paris, il emportait dans sa valise quelque chose de plus précieux que l’or pour un artiste, c’est-à-dire la gloire. « À présent, me voilà sacré roi du violon, » disait-il, et c’était vrai. Il alla de là à Londres et la richissime aristocratie anglaise, ces lords qui sont de petits rois, prévenus par notre presse, le couvrirent de bravos et de banknotes. Paganini n’était pas insensible aux applaudissements, mais, né de parents pauvres, il aimait le fauve métal avec ferveur, et il ne s’en cachait pas. Quand il est mort, il a laissé à son jeune fils, alors à Nice, un trésor de trois millions, déposé chez les Rothschild. Trois millions en 1840, c’était presque la fortune d’un prince.
Ces trois millions, on les lui a grandement reprochés. Par exemple, la presse satirique l’a traité d’avare en toutes lettres. À tort ou à raison, chez nous un grand artiste, s’il veut être aimé de ses pairs, doit négliger les biens temporels. Il faut qu’il soit prodigue jusqu’à devenir un panier percé. Autrement, c’est un bourgeois ou un cancre, par conséquent un petit esprit. Ajoutons que l’épithète d’Harpagon, appliquée au divin violoniste, venait surtout de Jules Janin. En ce temps-là, l’auteur de Barnave était dans tout l’éclat de sa rayonnante jeunesse. On aimait sa figure rose et réjouie ; on s’arrachait ses romans, écrits avec tant de verve ; on se répétait l’écho de ses feuilletons. Enfant de Saint-Étienne, il avait, un jour, organisé un grand concert au profit des inondés de sa ville natale, et, pour donner à cette fête musicale un surcroît d’agrément, il avait demandé, par écrit, à Paganini de venir y produire deux ou trois coups d’archet. Un salut au public, un air, cinq minutes d’art, un autre salut et un sourire. C’en aurait été assez ; les deux grands faubourgs, Saint-Germain et Saint-Honoré, avaient mis un vif empressement à prendre des billets. Mais que vous dire ? Un soupir de son violon qui ne rapporterait rien, pas un sou, pas un centime, le positif Italien n’entendait pas de cette oreille-là. Il refusa donc net. Il refusa à Jules Janin et il eut lieu de s’en repentir. À dater du jour où il avait répondu par un « non » formel, il eut, non à soutenir, mais à endurer la guerre. Faisant l’opinion publique juge de ce qui se passait, Jules Janin le prit à partie dans le Journal des Débats, et, tout le temps que le céleste instrumentiste passa dans nos murs, il ne lui laissa ni repos ni trêve. « Ce ménétrier d’au-delà des Alpes, écrivait-il, ce n’est pas un avare : non, ne croyez pas cela ; ce n’est pas un avare : « c’est l’avare ! » Entre nous, le feuilletoniste copiait un peu Royer-Collard, qui, tout récemment, avait dit d’un de ses disciples, futur ministre de Louis-Philippe : « Ce n’est pas un sot : c’est « le sot ! » Cependant Nicolo Paganini laissait dire et laissait faire, et, ainsi que je le note plus haut, toujours acclamé par les dilettanti du continent, agissant en fourmi prévoyante, il finissait par amasser trois millions.
Il devenait riche et le spectacle de son capital l’enchantait, à ce qu’il paraît. Néanmoins la plume, alors si aiguë, du critique lui avait fait une vive blessure au cœur. Un adage dit : « Ne joue ni avec le feu, ni avec l’œil, ni avec l’amour. » Il n’est pas bon non plus de jouer avec le journal. Plus d’une fois, à la fin de ces superbes soirées où il était si bien acclamé, le grand violon laissait tomber sa tête pâle et si maigre entre ses mains, et, en gémissant, s’écriait : « Ils m’ont applaudi, c’est vrai, mais tout à l’heure quand je suis sorti, j’ai voulu m’approcher d’eux. Au même instant, j’ai pu lire dans leurs regards l’expression d’un cruel reproche. Tous semblaient me dire : Nicolo, tu as refusé un coup d’archet au bénéfice des inondés de Saint-Étienne ; Jules Janin t’accuse à bon droit. Tu es un avare ! un avare ! un avare ! » Et il demeurait près d’une heure dans cette posture de prostration et d’accablement.
Ce fut à quelques jours de là qu’il partit pour l’Angleterre. Eh bien ! l’écho du feuilleton monta avec lui sur la proue du bateau et le suivit pas à pas. Les papiers anglais le lui répétaient avec des variantes, mais il avait fini par s’y faire. À la longue, du reste, la nécessité où il s’était trouvé si longtemps de se confiner dans la solitude afin d’étudier son instrument, n’avait pu que façonner son esprit à l’exercice de la pensée. C’était pour cela que, sous le grand violon, nous devions rencontrer plus d’une fois un grand philosophe. De 1829 à 1835, il a écrit quelques lettres qui laissent voir en lui un penseur un peu parent de Beethoven. On sait que le docteur Bennati, son médecin, le suivait volontiers en quelque coin qu’il se rendît. Or, ce témoin de sa vie intime le tenait pour un causeur plein d’observation, et faisait grand cas des facultés psychiques dont il était orné. À l’en croire, loin de redouter les aiguillons de l’épigramme, Paganini les aurait plutôt recherchés, en ce qu’il les regardait comme un élément d’hygiène, indispensable au maintien de sa santé intellectuelle et morale.
– Docteur, lui disait son client pendant la traversée de Douvres à Calais, quand nous étions à Londres, un humoriste a lancé contre moi une brochure de dix pages. Vous supposez que j’en souffre, et il n’en est rien. Ce serait bien plutôt le contraire. Un peu d’amertume corrige trop de sucrerie. Un artiste qui parvient au point culminant de la réputation peut perdre la tête. Du jour où il est applaudi, couvert de fleurs, baigné dans l’or, entouré de toutes les caresses de la fortune, il a besoin du sel de la critique pour ne pas se corrompre. Sans le journal, il passerait à l’état de prince asiatique. Il deviendrait la proie de l’ennui, ce ver invisible qui ronge les rois et les millionnaires et, sous le coup de la satiété, il ne tarderait pas à tomber dans l’imbécillité des Césars.
Cette tirade ou quelque chose d’approchant, il la terminait par un mot qui ne manquait pas d’esprit.
– Une satire, une brochure, un quatrain moqueur, qu’est-ce donc ? Une piqûre de guêpe. Ça passe vite et ça rajeunit la joie de vivre.
Ainsi que je l’ai dit plus haut, il était parti pour les trois royaumes, et il ne devait reparaître à Paris qu’au bout de six mois, c’est-à-dire au commencement du printemps de 1832. Quand il nous avait quittés, il était pâle, amaigri, morose ; il toussait même un peu. On prétendait alors qu’il n’aurait pas la force de supporter la mer. On ajoutait que, s’il passait le détroit, il ne résisterait ni aux brouillards de la Tamise, ni aux vapeurs du charbon de terre. Nous ne devions plus le revoir. Le charbon de terre, les brouillards, la mer, les viandes bouillies, la face de John Bull, Paganini avait tout surmonté en brave. Il nous revenait presque gras et bien portant.
Lorsque le premier choléra se propagea à Londres, en faisant tomber cinquante mille victimes par jour, on ne manquait pas de dire à Paris que le grand violon serait l’un des premiers atteints et que sa faiblesse ne résisterait pas aux fureurs de l’épidémie. Paganini revint de Londres sans même avoir fait quarantaine, et le docteur Bennati, son médecin, affirmait que ses poumons avaient acquis plus de force. Cet Orphée, qu’on avait voulu faire passer pour un poitrinaire, ne devait mourir que d’apoplexie et aurait probablement, un jour, l’embonpoint cyclopéen de Lablache, la fameuse basse des Bouffons. – Vous rappelez-vous Lablache ?
Il va sans dire que les faiseurs de bons mots, Jules Janin en tête, s’emparaient de ce bel état de santé pour broder de nouvelles plaisanteries. Sur le boulevard des Italiens, devant le perron de Tortoni, les fumeurs de cigares blaguaient à qui mieux mieux. À les entendre, après ce voyage en Angleterre, où il avait gagné cinq cent mille francs, somme énorme pour l’époque, la santé brillante de Paganini donnait plus d’autorité aux savantes dissertations du docteur Chrétien de Montpellier sur les préparations médicales d’or. « L’or engraisse, » avait dit ce théoricien. Ainsi le tempérament du grand artiste se trouvait à merveille de ce système ; chez lui, l’application du fauve métal, au lieu d’être faite d’une manière interne et à petites doses, devait s’opérer extérieurement et en grande quantité, dans une bourse.
– C’est au point, disait Raymond Brucker dans le Figaro, que si, le jour de sa mort, on plaçait Paganini dans un cercueil en or massif, ce contact produirait infailliblement un miracle et rendrait aussitôt la vie au célèbre violoniste.
Au surplus, les succès du musicien en Écosse et en Irlande avaient peu surpris les Parisiens. On sait que, dans ces deux pays, les vieilles traditions maintiennent les idées du peuple au merveilleux, au surnaturel. Or, à l’aspect du mystérieux artiste, les bruits les plus extraordinaires circulaient. Ils se disaient que Béelzébuth en personne avait pris l’archet pour recruter des âmes ; Méphistophélès s’était fait violon ; Astaroth, ménétrier ; Lucifer, troubadour. Et l’on courait aux concerts de l’Italien comme aux féeries, et l’on en sortait convaincu de la vérité de ces assertions bizarres. On avait contemplé la figure fantastique du héros d’Hoffmann ; on avait été témoin de ses tours de force miraculeux sur son instrument ; on avait frémi à ses conversations diaboliques. Et, là-dessus, Paganini riait d’un air sardonique, laissant de côté les âmes et ramassant les guinées.
Du reste, après le retour du célèbre improvisateur, ces contes bleus n’avaient pas cessé, mais les boulevardiers leur avaient donné une autre tournure.
Qu’avait fait Paganini de ses cinq cent mille francs ? On prétendait qu’il était joueur. Toutes ses nuits, disait-on, il les passait à la roulette de Frascati, encore existante en ce temps-là. Tous ses jours, il les employait à étudier la martingale mitigée de d’Alembert. Son teint livide, ses yeux caves annonçaient ces insomnies et ces mystères. Son air constamment préoccupé en était un surcroît de preuve.
D’autres annonçaient que, miné par des vices secrets, Paganini était criblé de dettes. Ceux-là affirmaient qu’il n’avait pas touché un sou des cinq cent mille francs gagnés en Angleterre. Il y avait encore à ce sujet un racontar qui tenait de la légende. Les créanciers du musicien avaient délégué à sa suite un agent d’affaires chargé d’encaisser les recettes. Paganini, toujours suivi de cet ami intime, comme un révérend père jésuite de son socius, de ce recors, de cette ombre, ne pouvait faire une note ni donner un coup d’archet sans la permission de ce susdit agent d’affaires.
Ainsi, de l’autre côté du détroit, l’artiste, déjà si difficile à analyser, était un être double : premièrement lui, deuxièmement l’argent ; premièrement le Paganini qui gagnait les cinq cent mille francs ; deuxièmement le Paganini qui les touchait ; premièrement le Paganini du violon ; deuxièmement le Paganini de la caisse. Par suite de ces récits, l’agent d’affaires plaçait Paganini dans une des chambres les plus reculées de l’hôtel, et si les oreilles des voisins avaient saisi quelques notes au passage, ils recevaient le lendemain une facture en règle signée de l’agent d’affaires. Pour tant de mesures ouïes par hasard, tant de shellings. Pour un air entier, une couronne ou une guinée, etc., etc.
Encore un coup, il va sans dire que ce n’étaient là que de ces jolies histoires en l’air comme on ne se lasse jamais d’en faire à Paris.
Il était vrai que Paganini était un grand joueur… de violon. Il était vrai qu’il passait toutes ses nuits… dans son lit. Il était vrai que son teint livide annonçait… l’étude. Il était vrai aussi que Paganini avait gagné les fameux cinq cent mille francs en Angleterre. Il était également vrai qu’il ne les avait plus, parce qu’il les avait envoyés à son notaire de Gênes, en lui en indiquant l’emploi, un placement chez les Rothschild.
Cependant, un point de cette prodigieuse existence d’artiste demeurait impénétrable. Par quels procédés l’Italien obtenait-il de son instrument des sons divins ? L’Europe se faisait, tous les jours, cette question, mais sans pouvoir y répondre. Ça n’avait rien d’usité, ça n’avait rien d’humain. On croyait généralement que Paganini avait des secrets, et l’astucieux Transalpin prenait plaisir à le laisser croire. Un Anglais, nommé Harris, violoniste distingué, se jura de les surprendre. Harris suivit partout Paganini, dans les concerts, dans les hôtels, tout le long de ses voyages. Il s’arrêtait aux mêmes auberges que le maître et louait la chambre voisine. Là, nuit et jour, il prêtait une oreille attentive pour entendre les études. Peines perdues ! Insomnies inutiles ! Paganini n’étudiait plus. Il ne touchait à son violon que pour l’accorder avant le concert. Harris revint bredouille de son voyage d’explorateur. Harris n’était pas le seul. Meyerbeer, lui aussi, avait juré de surprendre les secrets du maître. Admirateur passionné de Paganini, il voulait se rendre compte de cette méthode mystérieuse qui déconcertait tous les virtuoses. Meyerbeer suivit le célèbre Italien dans tous ses concerts en Allemagne. Il en entendit dix-neuf de suite, au bout desquels il n’était pas plus avancé qu’Harris.
– Décidément, se disait l’illustre compositeur, il faut que ce Génois soit un diable ou un dieu.
Quand il reparut à Paris, bien portant, enrichi et célèbre, il ne songea pas, un seul instant, à demeurer inactif. Huit jours ne s’étaient pas écoulés qu’il se remettait à donner des soirées musicales. Tout le grand monde y accourut, attiré par le nouveau prestige du revenant. Nicolo Paganini parut, seul, sur la scène la plus vaste du continent, long, vêtu simplement, encore maigre, ses longs cheveux négligés, son violon à la main, et il sourit de ce sourire sans pareil qu’on n’avait jamais remarqué chez aucun autre. Un silence étrange, solennel et religieux, s’établit de l’orchestre aux loges. Bientôt ce fut quelque chose comme de l’extase. Il jouait une fantaisie nocturne intitulée : la Danse des étoiles, et, dans toute cette salle de l’Opéra, l’air fini, ce ne fut qu’un cri d’admiration et d’ivresse. Cet auditoire d’élite applaudissait avec frénésie, il en déchirait ses gants blancs. Les femmes jetaient leurs bouquets aux pieds du musicien ; messieurs du Jockey-Club cognaient sur le parquet avec leurs cannes à pomme d’or. Dans un coin, un poète mystique, Antony Deschamps, le traducteur de Dante, improvisait un sonnet que le chanteur Dérivis venait lire à haute voix sur le devant de la scène. En même temps, le plus grand dessinateur d’alors, Achille Devéria, prenait sur son calepin la silhouette du triomphateur. « Ah ! l’incomparable artiste ! » s’écriait le public en chœur. – Et cela recommença pour les trois autres morceaux dont le programme était composé. Paris saurait-il retrouver ce superbe enthousiasme ?
Il va sans dire que tant de succès devait avoir un contrecoup au dehors. La rue aussi célébrait Paganini. Ainsi les portraits de l’idole se voyaient partout. Ressemblantes ou non, ces images s’enlevaient par ballots pour la province et pour l’étranger. Mais ce n’était pas à un vulgaire portrait sur pierre que se bornait la spéculation. Pour amorcer les amateurs, les hommes du crayon avaient imaginé de découper la vie de l’Orphée en épisodes et de mettre ensuite ces scènes en vente. Un matin d’avril, avant déjeuner, l’artiste était sorti afin de faire son tour de promenade. Il parcourait en flâneur le boulevard des Italiens, cette zone de la grande ville qu’on dit être la capitale de la capitale, quand, après s’être approché de la devanture d’un marchand d’estampes, il y vit une lithographie au bas de laquelle figurait une légende : Paganini en prison. À première vue, il ne put se défendre de froncer le sourcil ; après quoi, il laissa ces mots tomber de sa bouche :
– Bon ! voici d’honnêtes gens, qui, à la manière de Basile, exploitent à leur profit une vieille calomnie dont je suis poursuivi depuis quinze ans !
Cependant il avait fini par rire de cette mystification agrémentée de détails imaginaires, lorsqu’il s’aperçut que quelques passants venaient de le reconnaître. Peu à peu, un cercle assez nombreux s’était formé autour de sa personne. Chacun alors, confrontant sa figure avec celle du jeune homme représenté dans la lithographie, constatait de vive voix combien il était changé depuis sa détention. Paganini comprit alors que cette mauvaise plaisanterie était prise au sérieux par ce qu’on appelle « les badauds de Paris », et qu’il n’y avait rien autre chose à faire que de se retirer. Il se disposait donc à battre en retraite quand il vit, par bonheur, venir à lui deux personnes de son monde, M. Bernard Latte, éditeur de musique, et Hector Berlioz, un ex-carabin, qui, la surveille, avait déserté les bancs de l’École de médecine pour apprendre le métier d’homme de génie.
Chacun d’eux l’ayant pris sous un bras, il les mit en quelques mots au courant de ce qui se passait.
– Ces messieurs les dessinateurs, dit-il, sont des hommes d’une très grande imagination. Ils m’ont représenté en prison. Mais où çà ? À Venise ? À Rome ? À Vienne ? Ils n’indiquent point le lieu de ma captivité, et c’est probablement qu’ils ne le savent pas. Ils ne savent pas davantage ce qui m’a conduit dans un cachot, et en cela ils sont aussi bien renseignés que moi-même et que les beaux esprits qui ont fait courir l’anecdote. Le fait est qu’il y a là-dessus plusieurs histoires qui pourraient fournir deux ou trois sujets de roman, tenez, à un écrivain de chez vous, à M. Victor Ducange, par exemple.
– Des sujets de roman ! s’écria ici Hector Berlioz affriolé. Contez-nous donc ça, mon maître.
Paganini se fit d’abord un peu prier. S’il écrivait assez convenablement le français, ainsi que le démontrent les lettres dont j’ai eu à parler plus haut, il ne pouvait que le baragouiner, quand il lui fallait prendre part à la conversation. À la fin, il se rendit aux instances répétées de ses deux interlocuteurs et il reprit, tout en répondant à la question faite par Berlioz :
– Mon roman ? Eh bien, vous allez voir combien il contient de matière dramatique. D’abord, on a fait de la chose une affaire d’amour. En ce temps-là, à ce qu’ils racontent, j’avais une jeune maîtresse que j’aimais éperdument. Qu’était-ce que cette femme ? Une danseuse de la Fenice ou une Fornarina aux grands yeux noirs qui posait pour le nu chez les peintres ? Ils ne sont pas d’accord sur la condition sociale de la belle personne, mais ils lui attribuent une beauté souveraine. Elle était adorablement belle, mais elle pratiquait au plus haut point l’art de tromper. Sur ce, ils ajoutent qu’ayant surpris un rival chez elle, je l’ai tué bravement, par derrière, au moment où il se délectait d’une orangeade à la neige.
– Ça, ce serait tout au plus une scène pour la Porte-Saint-Martin, objecta M. Bernard Latte.
– Il y a une autre version dont on pourrait peut-être mieux tirer parti, reprit le grand violon. Certainement j’ai poignardé mon rival, qui est le propre neveu d’un cardinal, et vous voyez que l’aventure est déjà assez corsée ; mais ces messieurs les inventeurs assurent que ma fureur jalouse ne s’est pas arrêtée en si beau chemin. Ma vengeance s’est donc appesantie sur la traîtresse elle-même, mais ils ne s’accordent pas sur la manière dont j’ai mis fin à ses jours.
– Au fait, comment vous y êtes-vous pris ? demanda ici l’ancien carabin.
– Les uns veulent que j’aie étranglé Clélia avec une écharpe de soie ; les autres que j’aie voulu jouir de ses dernières souffrances en la forçant à boire du poison. Enfin chacun a arrangé le poème suivant sa fantaisie. À présent, les lithographes ne pourraient-ils donc pas jouir de la même liberté ?
– Tout cela doit être un tissu d’extravagances, mon maître ; pourtant…
– Pourtant il faut qu’il y ait quelque chose qui serve d’excuse à ces étranges inventions ? Eh bien, oui, sans doute, il y a quelque chose, et vous allez voir que c’est toujours l’adorable fable de l’homme qui a pondu un œuf. Mais avant que j’entre dans ce nouveau récit, laissez-moi vous raconter un préliminaire qui ne manque pas d’originalité.
Il y eut ici un petit temps de silence, le temps nécessaire au conteur pour se recueillir, puis il commença :
– Voilà de cela quinze ans, reprit-il, j’étais à Padoue. J’y avais donné un concert et je m’y étais fait entendre avec quelque succès. Le lendemain, j’étais à table d’hôte, moi soixantième, et je n’avais point été remarqué lorsque j’étais entré dans la salle. Au dessert, un des convives s’exprima en termes flatteurs sur l’effet que j’avais produit, la veille. Son voisin joignit ses éloges aux siens, mais il ajouta d’un air entendu des paroles bien capables de faire dresser l’oreille à tous les assistants :
– Messieurs, dit-il, l’habileté de Paganini n’a rien qui doive surprendre. Il la doit au séjour de huit années qu’il a fait dans un cachot, n’ayant que son violon pour adoucir sa captivité. Il avait été condamné à cette longue détention pour avoir assassiné lâchement un de mes amis, qui était son rival.
Chacun, ainsi que vous pouvez bien le penser, se récria sur l’énormité du crime. Moi, je pris la parole et, m’adressant à la personne qui savait si bien mon histoire, je la priai de me dire en quel lieu et en quel temps cette aventure s’était passée. Tous les yeux se tournèrent alors vers moi. Jugez de la stupeur quand on reconnut l’acteur principal du drame ! Fort embarrassé fut le narrateur. Il hésitait. Il balbutiait. Il ânonnait. Ce n’était plus son ami, à lui, qui avait péri sous la lame de mon poignard… Il avait entendu dire… On lui avait affirmé… Il avait cru… mais il était possible qu’on l’eût trompé… Voilà, mes chers messieurs, comment on se joue de la réputation d’un artiste, parce que les gens enclins à la paresse ne veulent pas comprendre qu’il a pu étudier en liberté dans sa chambre aussi bien qu’il l’eût fait en prison.
– Il y a lieu de croire, reprit M. Bernard Latte, que ces ridicules rumeurs ont fini par s’arrêter là.
– Oui, si vous entendez parler de ce qui concerne le meurtre de mon prétendu rival ; mais les inventeurs ont su bien vite imaginer autre chose. Ainsi, cette fois, pour avoir à ne redouter aucune enquête, ils se sont jetés dans le merveilleux.
Ici, Hector Berlioz était tout yeux et tout oreilles.
Paganini continua :
– Pendant l’hiver de 1825, dit-il, j’étais à Vienne, le chef-lieu du plaisir. J’y avais joué les variations qui ont pour titre : le Streghe (les Sorcières), et elles avaient produit quelque effet. Un monsieur que l’on m’a dépeint, au teint pâle, à l’air mélancolique, à l’œil inspiré, affirma qu’il ne trouvait rien qui l’étonnât dans mon jeu, car, pendant que j’exécutais ces mêmes variations, il avait vu distinctement le diable debout près de moi, guidant mon bras et conduisant mon archet. Sa ressemblance frappante avec mes traits démontrait assez mon origine. Satan avait des cornes à la tête et la queue légendaire entre les jambes. Vous concevez bien, mes amis, qu’après une description si minutieuse du fait, il n’y avait pas moyen de douter de la vérité du fait. Aussi, beaucoup de Viennois et de Viennoises furent-ils persuadés que l’inconnu avait découvert le secret de ce qu’on appelle mes tours de force. J’étais l’élève favori du diable.
Que faire pour détruire tant d’absurdités ? Le grand instrumentiste ajoutait que sa vie avait été longtemps troublée par tous les bruits qu’on répandait sur son compte. À l’origine, il s’était efforcé d’en démontrer l’absurdité. Il n’avait jamais commis d’assassinat. Il n’était pas secondé par le diable. Çà et là, à travers ses voyages, quand il rencontrait ces deux romans sur son chemin, il se donnait la peine de raconter sa studieuse enfance. Il disait comment, depuis l’âge de quatorze ans, ayant à gagner le pain de chaque jour à l’aide de son art, il avait donné des concerts en ne cessant pas d’être sous les yeux du public. Il montrait qu’il avait été employé, pendant seize années, comme chef d’orchestre à la cour d’un prince. Il ajoutait que, s’il eût été vrai qu’on l’eût retenu, pendant huit années, pour avoir tué sa maîtresse ou son rival, il aurait fallu, conséquemment, que ce fût avant de se faire connaître comme violoniste. Dès lors, il aurait fallu qu’il eût eu une maîtresse ou un rival à l’âge de sept ans. Mais encore une fois, qu’opposer aux étranges conceptions de cette force invincible et inépuisable qu’on appelle la bêtise humaine ? Il n’y avait qu’à laisser la malignité des sots s’exercer à ses dépens. Cette lithographie qu’il venait de voir s’étaler en plein Paris avec ces mots : Paganini en prison, était une millième démonstration de cette vérité qu’on ne peut jamais en finir avec la folle crédulité des masses. Les contes en l’air, ça ne finira jamais.
Mais avant de se séparer des deux amis qui se promenaient avec lui au soleil naissant, il crut devoir les mettre au courant d’une anecdote, déjà très ancienne, très confuse et fort peu romanesque, qui avait donné lieu à tous ces contes bleus.
Voici en quoi cela consistait :
Un violoniste, nommé Demonoschi, qui se trouvait à Milan, en 1800, se lia avec deux hommes de mauvaise vie, gens de sac et de corde. Ceux-ci l’engagèrent à se transporter avec eux, la nuit, dans un village voisin, pour y assassiner le curé, qui passait pour avoir beaucoup d’argent. Heureusement, la veille de l’exécution, le cœur faiblit à l’un des coupables, et il alla dénoncer ses complices. La gendarmerie se rendit sur les lieux et elle s’empara du musicien et de l’autre gredin, au moment où ils arrivaient chez le curé. Ils furent condamnés à vingt années de fer et jetés dans un cachot ; mais le général Menou, étant devenu gouverneur de Milan, rendit au bout de deux ans la liberté à l’artiste.
Eh bien ! c’est sur ce fonds qu’on avait brodé toute l’histoire de l’illustre Génois. Il s’agissait d’un violoniste dont le nom finissait en i : ce fut Paganini. L’assassinat projeté devint l’immolation de sa maîtresse ou de son rival, et ce fut encore le merveilleux instrumentiste qu’on prétendit avoir été mis en prison.
Seulement, comme on avait été charmé par un nouveau système de violon, un général français fit grâce des galères. Quant à ce qui se rapportait à l’apparition du diable à Vienne, il fallait en voir le point de départ dans celui des ses Contes fantastiques où Hoffmann parle du grand violon. Ces pages, du moins, n’ont pas de quoi offenser un esprit délicat.
Tout finit par s’arranger ici-bas ; Paganini est mort, en 1840, à Nice. Il est mort riche, célèbre et regretté. Mais ce n’est qu’au lendemain de son décès que se sont évanouies les fables que nous venons d’énumérer dans ces pages.
La moralité de ce récit, s’il en contient une, c’est que, dans toute biographie d’homme célèbre, on trouverait toujours un alliage de fiction ou de mensonge, ce qui est tout un. Raison pour laquelle on peut rappeler ici le cri de Schopenhaüer :
– Regardons-y à deux fois avant de croire à l’histoire.
Et ! dame, depuis Hérodote, l’histoire est-elle donc autre chose qu’un roman ?