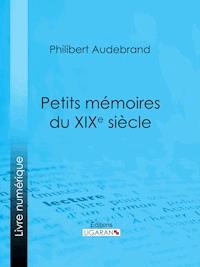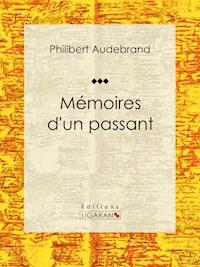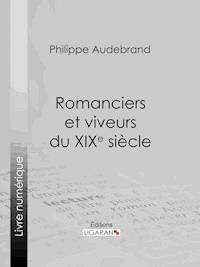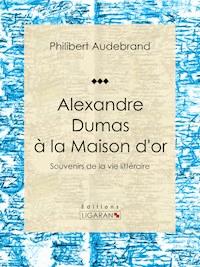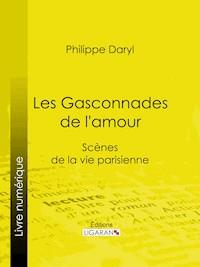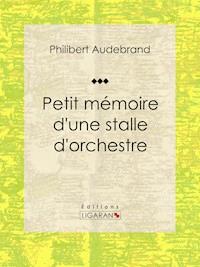
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Toutes les fois qu'un Lauréat du Conservatoire aborde avec un peu de succès les planches de l'Opéra-Comique, un vieillard quelconque, un Nestor de l'orchestre allant à lui, par amour de l'art, le prend à part et lui dit : – Jeune homme, pensez à Elleviou. Elleviou, vous vous le rappelez sans doute, a été un des plus brillants chanteurs du premier Empire."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335034783
©Ligaran 2015
– Comment ! encore un livre, et un livre sur le théâtre !
– Mon Dieu, oui.
– Mais il en paraît, tous les jours, de ces livres-là !
– Cela prouve qu’on ne cesse pas d’en vouloir.
– Eh bien, que chante ce nouveau venu ?
– Mille choses, toute sorte d’histoires. Tenez, un mot d’explication là-dessus.
– Parlez.
– De son métier l’Auteur est journaliste. Un biographe a dit qu’avec les feuilles qu’il a noircies de sa plume on couvrirait aisément la place du Carrousel, et cela est vrai. Durant près de quarante-cinq ans, il a fréquenté, à peu près tous les soirs, les divers théâtres de Paris. Hommes et choses, le mouvement littéraire et le mouvement artistique, les auteurs, les acteurs, le public, la salle, les coulisses, le foyer, l’affiche, le feuilleton, les procès, il a vu défiler sous ses yeux tout un monde à part, bigarré, passionné, étrange, le plus curieux de tous les mondes.
– Celui de Jacques Callot au dix-neuvième siècle ?
– Précisément. Or, ce sont ses Souvenirs à cet égard qu’il rassemble aujourd’hui dans ces pages. Dans ce livre, divisé en un grand nombre de chapitres, on trouvera des portraits de grands artistes, des traits historiques ignorés des conteurs, des anecdotes et aussi beaucoup de ces on dit de foyer, de ces mots aigus et ailés, qui voltigent à travers les groupes, les jours de première représentation.
– Un sujet d’amusement pour les oisifs, tout au plus.
– Attendez. Un sujet d’amusement, soit, mais tout cela forme, en outre, un coup-d’œil jeté sur la vie théâtrale, telle qu’elle était hier encore, mais telle qu’elle ne sera sans doute plus demain. En raison de ce qu’il vient de dire, l’Auteur a cru devoir donner à ce nouveau livre ce titre : Petits Mémoires d’une stalle d’orchestre.
– Va pour le titre.
– Un dernier mot. S’il arrive que le public y prenne goût, il y sera donné suite.
P.A.
Toutes les fois qu’un Lauréat du Conservatoire aborde avec un peu de succès les planches de l’Opéra-Comique, un vieillard quelconque, un Nestor de l’orchestre, allant à lui, par amour de l’art, le prend à part et lui dit :
– Jeune homme, pensez à Elleviou.
Elleviou, vous vous le rappelez sans doute, a été un des plus brillants chanteurs du premier Empire.
L’ancien Opéra-Comique en avait fait quelque chose comme un dieu.
On l’assourdissait de bravos, on le bombardait de couronnes et de fleurs ; on le couvrait de billets de mille francs.
Un moment, de Marengo à Austerlitz, Elleviou a été regardé comme l’homme le plus heureux de son temps.
Succès d’argent, Elleviou ;
Succès de femmes, Elleviou ;
Succès de renommée, Elleviou.
Paris, côté des hommes, s’habillait comme Elleviou.
Paris, côté de l’autre sexe, ne parlait que comme Elleviou, c’est-à-dire en zézayant légèrement.
Un jour, en plein succès, se voyant en belle santé, Elleviou, ne voulant plus être qu’un homme heureux, prit une résolution bien rare chez les grands artistes.
– J’ai assez de fortune pour me retirer à la campagne et y vivre en sage, dit-il. Assez de vaine gloire comme ça. J’abdique. Je quitte le théâtre.
On n’en revenait pas : Elleviou, l’idole des Parisiens et surtout des Parisiennes, se dérober si soudainement à l’enthousiasme de ses contemporains !
Léon Gozlan a écrit, du reste, là-dessus une charmante Étude, sous ce titre : Un homme plus grand que Charles-Quint.
Évidemment l’éminent Elleviou était plus grand que cet empereur vieilli, lequel abdiqua un sceptre que sa main n’avait plus la force de tenir et qui s’en alla finir ses jours au couvent de Saint-Just.
Le chanteur ne se réfugia pas dans une maison religieuse, mais il se fit construire un charmant ermitage sur les bords de la Marne et y vécut doucement, en cultivant son jardin, à la manière de Dioclétien et de Candide.
Petite maison, assez grande pour recevoir une demi-douzaine d’amis, et il n’en faut pas plus. Un parc très vert, entrecoupé d’arbres, de fleurs de pelouses. Entre la cour d’entrée et le jardin, une basse-cour où vivaient pêle-mêle, coqs, poules, oies, dindons, faisans, canards, plus deux jolis petits cochons de Siam.
L’ancien chanteur, qui jouait si bien le Rossignol de M. Étienne, donnait de ses mains à manger à tous ces oiseaux-là, les deux petits cochons d’Inde compris.
En sage, l’homme se disait, du matin au soir :
– J’ai une famille qui m’aime ; – j’ai un abri où je dors, loin des bruits de la ville et des coulisses ; – j’ai des arbres dont l’ombre et le murmure sont à moi ; – j’ai de quoi faire, presque en toute saison, un bouquet qui me rappelle ma promenade du matin.
Et il ajoutait :
– Moyennant cela et quelques livres de choix, est-ce que je ne suis pas l’homme le plus heureux de France ?
Elleviou était, sans s’en douter, l’homme le plus heureux des cinq parties du monde.
Il vivait donc là, dans le silence, sans gloire.
Paris disait de temps en temps :
– Ah ça, qu’est donc devenu Elleviou ? Où donc est Elleviou ?
L’écho ne répondait même pas.
Nul n’aurait pu dire ce qu’était devenu le séduisant chanteur.
Paris oublie vite.
On parla un peu de ce fugitif de la vie d’artiste, puis on n’en parla plus, puis on crut qu’il avait cessé d’exister.
Point du tout, Elleviou, rose et vert, existait encore.
Un jour, sur la fin du règne de Louis-Philippe, il revint un moment à Paris, mais un moment seulement.
Il alla lui-même renouveler son abonnement au Charivari, mais voyez la bizarrerie des choses ! En redescendant l’escalier, rue du Croissant, Elleviou, le brillant chanteur, trébucha sur une marche, tomba et se tua.
L’apoplexie l’avait foudroyé, en dix secondes.
Ce décès fit naturellement grand bruit. Tous les biographes s’emparèrent de l’évènement, ainsi que c’était leur droit.
– Heureux Elleviou ! Point de médecins, ni de pharmaciens, ni de prêtres, ni de parents !
Il en résulta une sorte de renaissance pour le nom de l’artiste.
Eh bien, ce n’était pas tout.
Elleviou était le maire d’une charmante petite commune rurale, une localité obscure au point d’être inconnue.
Savez-vous ce qui arriva ?
C’est que ses administrés, non moins enthousiastes que les anciens habitués de l’Opéra-Comique, voulurent lui rendre hommage à leur tour.
Ils se cotisèrent donc et dirent :
– Nous élèverons à nos frais une chapelle qui servira de tombe à ses os.
Et c’est, en effet, ce qui a eu lieu.
Mais le plus bizarre, c’est la pensée du peintre chargé des travaux.
Le Raphaël de village a imaginé de peindre sur les vitraux de cette chapelle, et sous les traits de saint Pierre, Elleviou lui-même, qui ne s’attendait pas à être un jour canonisé.
Supposer que le brillant hussard du premier empire, le joyeux interprète de Trente-et-quarante et de Maison à vendre, puisse paraître sous les traits d’un si grand saint, c’est pousser un peu loin les fictions de l’art, mais le peintre a eu une bonne réponse.
– Elleviou chantait si bien qu’il a mérité d’être parmi les bienheureux.
Épisode de la vie d’Odry.
Il existe, vous le savez, une Société des artistes dramatiques. Hommes et femmes, tout ce qui vivifie le théâtre national figure dans cette association fraternelle. Grâce à ce groupement d’intérêts trop longtemps disséminés, bien des misères intéressantes sont soulagées ou supprimées. Une caisse, déjà bien garnie, sert de lien à cette famille de comédiens qui ont trop à faire pour songer à être prévoyants ou ordonnés. Si un grand tragédien vieilli se trouve tout à coup sans pain, la Société accourt à son aide et lui en donne. Quand une actrice, hier fêtée parce qu’elle était encore belle, a fini son temps et qu’elle n’a point d’abri, on lui en offre un.
Voilà qui est pour le mieux ; néanmoins ce n’est pas de cette philanthropique fondation que je voulais vous parler ; du moins en tant qu’établissement de bienfaisance. Mon thème était tout autre. Je ne veux que vous dire deux mots du point de départ des artistes et accessoirement de la vocation.
Y a-t-il encore des vocations dans nos temps de prose et de calcul ? Les habitués d’orchestre prétendent que non. De là une déchéance si marquée dans tous les arts. Alphonse Karr affirme que si l’on pendait (on ne pend plus, on guillotine) une dizaine de mauvais comédiens, chaque année, nous n’en aurions bientôt plus que d’excellents, les bons seuls ayant l’audace de se présenter. Est-ce bien vrai ? Un autre observateur très sagace, Léon Gozlan, était d’une autre opinion.
– Si vous voulez faire reverdir le personnel de l’art théâtral, rameau trop desséché, vous n’avez qu’un moyen : c’est de recruter les nouveaux sujets parmi les gens du peuple.
Eh ! mon Dieu ! prendre les recrues dans la foule, les théâtres ne font pas autre chose depuis quatre-vingts ans.
Pour se convaincre de la réalité de ce fait, il suffit de jeter un rapide coup d’œil sur la liste de membres composant la Société des artistes dramatiques.
Nous ne sommes plus à l’époque de Cyrano de Bergerac, où ceux qui montaient sur les planches étaient ou se disaient tous de souche aristocratique. Dans ce grand nombre de sociétaires, il y a même peu de descendants d’artistes, presque pas d’enfants de la balle, comme on dit. Les trois quarts sont d’une source encore plus humble ; presque tous viennent des usines, quelques-uns des ateliers, quelques autres d’une boutique en plein vent.
Qu’importe l’origine, pourvu que le talent y soit ?
Notez que cette observation doit être faite pour les plus célèbres : Bocage, qui a eu une si grande influence sur le mouvement littéraire de 1830, avait commencé par être ouvrier tisseur ; Frédérick Lemaître a été quelque chose comme apprenti ébéniste ; Arnal raconte lui-même, dans des vers assez bien tournés, qu’il a été boutonnier. Z***, si souvent applaudi sur une de nos scènes les plus brillantes, étant enfant, vendait des tartelettes aux passants comme le premier Mentschikoff, lequel est devenu prince, père d’une lignée de princes.
Le plus curieux point de départ, peut-être, a été celui de l’un des acteurs les plus populaires, il y a trente-cinq ans ; c’est nommer celui qui réjouissait tout Paris quand il jouait l’Ours et le Pacha, ou bien les Saltimbanques.
C’était là, du reste, un des souvenirs que le père Du Mersan, le joyeux auteur du Coin de rue, aimait à raconter.
Venu à Paris sur la fin du Consulat, ce futur auteur s’occupait d’abord de numismatique ; ce n’était qu’à ses moments perdus qu’il lui était permis de penser au théâtre. Se faire jouer n’est pas très facile aujourd’hui ; en ce temps-là, à ce qu’il paraît, c’était la mer à boire. Il n’y avait que vingt-cinq auteurs connus, mais ces vingt-cinq garnissaient toutes les scènes sans permettre à un débutant d’approcher.
Cependant, un jour, en flânant sur le boulevard du Temple, le jeune homme aperçut une pauvre petite maison enfumée et sans relief d’aucune espèce ; on y voyait un écriteau, modeste comme elle : Théâtre sans prétention, titre encourageant pour un inconnu. L’enseigne ne mentait pas. Ce théâtre n’avait la prétention ni de payer chèrement de grands artistes, ni d’enrichir des auteurs célèbres, ni d’attirer l’élite du beau monde. Les places de première loge étaient de douze sous, et le parterre de vingt centimes. Tranchons le mot, c’était un boui-boui.
– Voilà mon affaire, se dit le débutant.
Et il alla y porter son premier manuscrit : La Ravaudeuse de bas.
À huit jours de là, le directeur lui dit :
– Je prends votre pièce. Venez à la représentation de ce soir ; vous verrez jouer mon monde, et, après le spectacle, nous ferons la distribution des rôles de l’ouvrage.
Les choses arrivèrent comme elles avaient été convenues.
Quand le rideau fut retombé, Du Mersan alla chez le directeur. Là, les premiers sujets de la troupe furent choisis pour les divers personnages de la pièce ; puis, comme il restait un rôle de peu d’importance, l’imprésario reprit :
– Ne vous inquiétez pas de celui-là ; nous le donnerons au savetier.
Qu’était-ce que le savetier ? Probablement un type comme le Financier ou le Matamore ?
Trois jours après, quand le jeune auteur se présenta à la répétition, le directeur demanda au régisseur :
– Tous nos acteurs sont-ils là ?
– Il ne manque que le savetier.
– Eh bien, appelez-le.
Aussitôt, l’employé, s’en allant ouvrir une fenêtre derrière le fond de la toile, fit entendre une espèce de cri comme celui que poussent les badigeonneurs quand ils peinturlurent les maisons.
– Hiiiiiiiiiii ! Psst !…
Bientôt Du Mersan vit sortir d’une échoppe située en face de la fenêtre, dans la rue des Fossés-du-Temple, un savetier, non déguisé… mais véritable.
Posant sur son établi un ancien soulier auquel il était en train d’ajuster un béquet, l’homme traversa la rue, entra lestement par la petite porte des acteurs et arriva sur le théâtre.
Il n’avait même pas pris la peine de passer une veste et d’ôter son tablier de cuir.
– Ah ! te voilà, gniaf ! lui dirent les autres.
– Oui, cabotins, mes camarades, répondit-il ; c’est bien moi.
– Il paraît que tu as un rôle dans une nouveauté, la Ravaudeuse de bas.
– Tiens, c’est presque de ma partie, ça.
En voyant le nouveau venu, en l’entendant parler, le débutant ne put dissimuler sa surprise.
– Comment ! dit-il, c’est donc réellement un savetier qui jouera le rôle ?
– Oui, répondit sans façon le directeur, mais que ça ne vous effraie pas ; il connaît son affaire ; voilà déjà six mois qu’il fait partie de ma troupe en qualité de surnuméraire. En attendant d’avoir des appointements, comme il faut vivre, il continue dans la journée son métier de restaurateur de chaussures. Ah ! il a le feu sacré, il étudie en raccommodant les souliers de ses pratiques. C’est un garçon qui a d’ailleurs un nez prodigieux, taillé en bouchon de carafe. Je suis sûr que ce nez l’aidera à faire son chemin. Il joue ce soir. Jugez-le. Vous verrez qu’il a du chien dans le ventre.
Ce savetier était un jeune garçon de dix-huit à vingt ans, plaisamment tourné et doué d’un de ces visages dont le seul aspect provoque l’hilarité. Et puis, ce diable de nez ! Du Mersan se disait :
– Il y a une destinée d’artiste dans ce nez-là !
Il ne se trompait pas.
Le savetier n’était autre qu’Odry, d’homérique mémoire.
Qui n’a pas vu Odry aux Variétés n’a rien vu.
Que de succès ! Le Compagnon du devoir, la Chanson des bons gendarmes, le Chevreuil, Tony ou le canard accusateur, l’Ours et le Pacha, les Saltimbanques, que de comédies sans pareilles !
Et tout cela était, un jour, sorti d’une échoppe !
Talma était morose, un jour.
– Qu’avez-vous donc ? lui demandait Ligier.
– Mon cher, je suis jaloux d’Odry.
Pour en revenir à la vocation, hélas ! on la cultive. La Société des artistes dramatiques paraît favoriser ce mouvement. – D’où le mot du vieux F…
– On commence à voir des dynasties de comédiens comme il y a des dynasties de gens de lettres et de peintres. Mauvaise chose pour le théâtre ! Mauvaise chose pour l’art !
Le grand Potier.
Il y a longtemps, bien longtemps, vers 1840, je crois, à l’époque où je faisais des comptes rendus de théâtre pour l’Entr’acte et pour le Corsaire, le hasard me fit me rencontrer avec un acteur encore jeune, ni trop bon ni trop mauvais, mais qui était le fils du comédien le plus populaire de ce siècle. Je veux parler de Charles Potier. Celui-là a joué dans un très grand nombre de pièces de petits rôles modestes. On se rappelle surtout une très jolie comédie de Dennery et de Grangé, Amour et Amourette, où il se montrait auprès de mademoiselle Judith, alors fort jeune et excessivement jolie. Chose peu commune il y a quarante ans, l’ouvrage fut joué cent fois de suite, ce qui était un évènement.
Étant un acteur de troisième ordre, Charles Potier se piquait d’être aussi littérateur. Le catalogue Solesme vous apprendra qu’il a fait jouer dix ou quinze saynètes sur les petits théâtres, mais ce n’était pas tout ce qu’il écrivait. Parfois, quand il avait un peu de loisir, ce qui était rare, il prenait plaisir à jeter du noir sur du blanc. – Que faites-vous donc là, Charles ? lui demandait-on. – Les Mémoires de mon père, répondait-il. – Les Mémoires de Potier ! Et qu’est-ce que le bonhomme aurait donc pu avoir à conter au public en dehors de son rôle des Petites Danaïdes ou de son succès dans le Bourgmestre de Saardam ? Potier n’avait presque pas vécu en dehors du théâtre. Pourtant, à entendre son fils, il y avait eu, dans le courant de cette existence d’artiste, une vingtaine de traits assez instructifs ou assez piquants pour qu’on songeât à les mettre dans un livre.
Dans ces mêmes temps, on m’avait confié la rédaction en chef d’une petite Revue du dimanche, sorte de Magazine, uniquement composée de petites Nouvelles, d’Esquisses de mœurs, d’Épigrammes et de Souvenirs (on dirait aujourd’hui de Racontars). Charles Potier m’apportait de temps en temps quelques articles.
– Eh bien donc, lui dis-je, un jour, faites une chose ; tronçonnez pour nous les Mémoires de votre père. – Bonne idée, répondit-il. – Et, à dater de ce jour-là, la Revue en question publia des épisodes se rapportant à la vie du grand comédien.
Il y a quarante ans, un journal littéraire avait toujours peine à vivre, même en usant d’une héroïque parcimonie. Le Magazine dut disparaître assez vite et, suivant ce qui arrive en pareil cas, tous ceux qui se trouvaient là s’éparpillèrent, dès le lendemain, sur le pavé de Paris, afin de chercher fortune ailleurs. Charles Potier resta, bien entendu, au petit théâtre où il jouait ses joyeux rôles et c’est là qu’il est mort.
Mais que vous dire ? Dans l’un de mes cartons était demeuré un de ses Manuscrits ou, si vous l’aimez mieux, un de ses Souvenirs. Qu’en faire ? Le brûler ? Je ne l’ai pas osé. Je ne l’ai pas voulu. Après quarante-quatre ans, l’occasion se présente de publier le récit, et cette même occasion je la saisis aux cheveux. Ces pages d’un autre, que je mêle à l’un de mes livres, j’espère qu’on ne me blâmera pas de les publier, d’abord parce qu’elles touchent par un côté à l’histoire de ce siècle, et secondement, parce qu’elles se rapportent aux hommes et aux choses du théâtre.
Ainsi le lecteur n’oubliera pas que, dans ce qui suit, c’est Charles Potier, le fils du grand Potier, qui a la parole.
« Mon père eut une carrière brillante, malgré les grandes difficultés qu’il rencontra, d’abord, et qui faillirent cent fois le rebuter. Heureusement il n’en fut rien, pour l’honneur du théâtre, pour celui de son nom et de sa fortune. Il lutta victorieusement contre les cabales des envieux et des ignorants ; il eut beaucoup à faire, mais il en vint à bout.
En 1826, Potier joua au théâtre de la Porte-Saint-Martin une pièce de circonstance pour la fête de Charles X. Cette pièce avait pour titre : Les Invalides. L’administrateur, en montant ce petit ouvrage, n’avait vu qu’un succès éphémère mort avec la circonstance. Loin de là, Potier y mit bon ordre, car dans cette bluette il fit la création la plus inconcevable, la plus miraculeuse, celle du Centenaire ; jamais théâtre secondaire n’avait eu à citer, dans ses fastes, une semblable tradition. Talma disait que ce trophée de Potier l’empêchait de dormir. C’était réellement bien beau, cette tête vieille sans caricature, ce corps courbé et grêle, ces jambes vacillantes et ployées, ces yeux éteints, cet organe qui semblait s’échapper avec peine de sa poitrine. En un mot, c’était un rôle complet. Cette épithète est, selon moi, le plus grand éloge qu’il soit possible d’en faire.
Tout Paris voulut voir les Invalides. Ce vaudeville ayant survécu à la circonstance, on en avait élagué tout ce qui pouvait y avoir quelques rapports. Une loge d’honneur était réservée aux vrais invalides qui assistaient dix par dix aux représentations de ce petit ouvrage, si intéressant pour eux. Quelle fête pour ces bons vieux militaires ! On vit deux manchots qui, ne sachant comment exprimer leur admiration, s’arrangèrent ensemble pour faire, avec les deux mains qui leur restaient, l’office d’un excellent claqueur. Le centenaire véritable, âgé de cent quatorze ans, que Potier retraçait si bien, voulut absolument se voir sur le théâtre. On le transporta, avec les plus grandes précautions, à la première place de la loge d’honneur. Ce fut une grande solennité. La salle, remplie de spectateurs jusqu’aux corridors, partageait sa vénération entre l’imitation et la réalité, entre le vieux soldat et le comédien extraordinaire.
Après la pièce, le bon vieillard, les larmes aux yeux, voulut absolument qu’on lui amenât son confrère, sa partie double, son Ménechme. Le public encombrait le foyer. Cependant on forma une haie, et Potier, grimé et toujours vêtu en centenaire, fut présenté à son original. Ce spectacle touchant provoqua des tonnerres d’applaudissements. On fit asseoir les deux vieillards, dont l’un avait cinquante-huit ans. On leur servit une bouteille de vieux Bordeaux, et les voilà trinquant, causant du temps passé, se rappelant leurs campagnes, oui leurs campagnes, car Potier aussi avait été militaire. Les deux braves se comprirent facilement. On parla du maréchal de Sasque (Saxe), ainsi nommé par le vieux soldat, et puis ils se reconnurent. Le vrai centenaire, qui avait conservé toute sa mémoire, surtout en ce qui concernait son régiment, se souvint d’avoir été le sergent-major du faux centenaire. Ils avaient combattu ensemble sous les mêmes drapeaux, l’un comme conscrit et l’autre comme vieux troupier. La situation devint de plus en plus intéressante ; ils finirent par se presser dans les bras l’un de l’autre, au milieu des bravos redoublés des assistants.
L’heure de se séparer étant arrivée, le vrai centenaire dit à Potier, avec un accent qu’on ne saurait rendre : Vous êtes heureux, vous, monsieur ! Dès que vous vous serez lavé le visage, et que vous aurez enlevé le rouge et le noir qui le couvrent, vos rides disparaîtront, et vous redeviendrez jeune, mais moi, s’écria-t-il d’un ton douloureux, qui me rendra mon jeune âge ? Je serai toujours le vieillard centenaire ! Ces paroles émurent vivement tous les témoins de la scène. On prodigua de nouveau au vieux brave les soins les plus affectueux. Comme il était tard, on voulut lui préparer au théâtre, un lit et un excellent souper, mais il ne put se résoudre à découcher. Il fallut absolument le reconduire à l’Hôtel des Invalides, au milieu de ses compagnons d’armes. ».
Ce récit est fait avec infiniment de naïveté, mais que de sincérité il y a là-dedans ! Est-ce qu’on trouverait mieux dans Tallemant des Réaux et dans Bachaumont ?
Voilà un des grands plaisirs du peuple de Paris : voir les célébrités du théâtre passer dans la rue, sans déguisement, comme tout le monde. On objectera qu’il n’est rien de plus puéril. Vous direz que, le rideau baissé, aussitôt que la pièce est finie, quand le costume du rôle a été remis au clou et qu’on a effacé le fard, il faut de toute nécessité que l’acteur reprenne la forme vulgaire de tous les autres citoyens. Vous chanterez tout ce qu’il vous plaira à l’effet de faire comprendre qu’il n’y a plus à lorgner, ni à siffler, ni à applaudir : le Parisien n’en regardera pas moins ce fait pour une rallonge au spectacle.
– Tiens, voilà Got qui passe ! Pourquoi a-t-il l’air si sérieux ? Ah ! le farceur !
Got est un homme des plus honorables. On l’a tenu pendant trente ans, on le tient encore pour un artiste d’un grand talent. Il a été nommé chevalier de la Légion d’honneur pour avoir professé au Conservatoire.
Les vrais gens du monde prennent plaisir à se croiser avec lui ; on est très heureux de le prévenir pour faire l’échange d’un salut. Pour le Parisien pur sang, badaud de père en fils, depuis Panurge jusqu’à nos jours, c’est bien cela, si vous voulez, mais c’est aussi mille autres choses. Ce type du boulevardier, éventé et bête, n’entend pas qu’un artiste soit seulement préoccupé de sa fonction sur les planches et qu’il ne se révèle que comme citoyen en ville. Il exige qu’il soit comédien partout.
À la Comédie Française, Got l’amuse énormément par sa verve et par le jeu de ses gestes. Pourquoi donc est-ce tout différent dans la rue ? Comment ! l’excellent acteur le frôle en passant, et il a une figure grave ? Cela dérange toutes ses idées, Got qui rêve, qui médite ou qui réfléchit !
– Ah ! le farceur ! s’écrie-t-il.
Et le soir, chez lui, il raconte cet épisode à sa famille :
– Figurez-vous que j’ai rencontré Got (des Français) sur le boulevard Montmartre, près du marchand de petits pâtés de Frascati. Il était d’une gravité sans pareille. On l’aurait pris pour un membre de l’Académie des sciences, section du Bureau des longitudes. Ah ! le farceur !
On a beaucoup parlé des inconvénients de la célébrité.
Qui est plus célèbre qu’un comédien arrivé, jouant, tous les soirs, devant trois mille spectateurs qui ne sont jamais les mêmes ? De cet homme en vue on n’ignore rien, ni son visage, ni sa manière d’être, ni sa voix. Le public tout entier connaît jusqu’à ses tics, et les retient précieusement dans sa mémoire. Aussi, le jeune premier ou le comique, n’importe lequel, ne peut-il faire un pas que le Parisien à l’œil ahuri ne signale sa présence.
– Eh bien, voilà qui est particulier, par exemple, Berton (du Vaudeville) qui vient d’entrer, rue Geoffroy-Marie, n° 3, vous savez, dans la maison où il y a un bureau de Mont-de-Piété ! Est-ce qu’il aurait besoin de mettre sa montre au clou ?
Il est bien entendu qu’un acteur n’a pas le droit d’entrer ni de sortir d’une maison quelconque sans que cent bélîtres ne fassent là-dessus des commentaires plus saugrenus les uns que les autres.
Où la question devient curieuse à examiner, c’est dans l’après-midi, sur la ligne des boulevards, depuis la Chaussée-d’Antin jusqu’au Cirque d’hiver. Dix théâtres, et de premier ordre, sont rangés à gauche et à droite de ce long ruban d’asphalte. C’est vous dire que comédiens et chanteurs des deux sexes vont seul à seul ou par petits groupes à la répétition ou qu’ils en reviennent.
Dire tous les regards obliques par lesquels ils sont visés ne serait pas chose possible. De vingt-cinq pas en vingt-cinq pas, il se fait au milieu de la foule un mouvement de vif remous comme cela se fait en pleine mer au moment de la marée montante. Saint-Germain en veston bleu, le joyeux Berthelier en pardessus, Léonce, si long, si maigre, si étrange, en habit à queue de sifflet, est-ce qu’il n’y a pas là de quoi s’arrêter court ?
Quand le remous se produit sur le boulevard de Gand, entre la rue Drouot et le perron de Tortoni, on est dans la capitale de la capitale. Alors, le coulissier de la petite Bourse, stupéfait de surprise, s’embrouille dans ses chiffres ; le fumeur de cigares oublie de secouer les cendres de son tabac brûlé, le passant ne passe plus.
Il y a une vingtaine d’années, Arnal, quoique âgé, était encore vert. D’un pied alerte, il s’en allait de chez lui à la place de la Bourse, où était alors le Vaudeville, son théâtre. Il nous a raconté que, chemin faisant, il avait vu cent fois des amas de flâneurs se jeter sur lui de manière à lui barrer le passage. Au fond, ce n’était pas autre chose qu’un vrai sentiment de curiosité.
– Il a des lunettes bleues ! disait toujours une voix.
– Pourquoi bleues ? Pourquoi pas blanches ou vertes ? disait invariablement un autre.
– Fantaisie d’artiste. Ils sont tous toqués ! reprenait un troisième.
Un jour, Arnal n’y put tenir et s’écria :
– Pourquoi j’ai des lunettes bleues ? Parce que la Faculté de médecine me l’ordonne, et aussi parce que cette couleur m’empêche de voir trop en noir les imbéciles que je rencontre.
Bocage, le grand Bocage, si fatal dans Antony, si superbe dans le Buridan de la Tour de Nesle, si chevaleresque dans l’Albuquerque d’Échec et Mat, Bocage, un des fiers représentants de l’art dramatique, ne prenait pas non plus du bon côté cet appétit des Parisiens, toujours prêts à se jeter dans les jambes d’un artiste en réputation.
Homme de 1830, il faisait profession d’aimer le peuple, politiquement, j’allais dire platoniquement parlant ; mais il fallait que les masses n’entravassent pas sa marche pendant la promenade. On n’a pas oublié un trait de sa vie professionnelle à la Porte-Saint-Martin.
Un soir, dans un drame d’Émile Souvestre, l’orchestre murmurait ; Bocage, s’écartant de son rôle, s’avança vivement sur le devant de la scène et dit :
– Est-ce à l’homme politique ou à l’artiste que vous en voulez ?
Dans la rue, il montrait la même susceptibilité.
– Est-ce que je n’ai pas le droit de circuler comme tous les autres citoyens ? disait-il en faisant tourner son lorgnon, suspendu à un long fil de caoutchouc.
Quant à Frédérick Lemaître, notre Kean, le Talma des boulevards, il ne cherchait pas midi à quatorze heures.
Un jour qu’il sortait d’un cabaret élégant, où il avait vidé une bouteille de beauté première, comme dix ou douze oisifs l’entouraient, il les regarda bien posément dans les yeux, en s’écriant :
– Les jolis mufles !
En ce qui concerne les actrices, il y aurait à écrire un chapitre à part.
Pour ces dames, surtout quand elles sont jeunes et jolies, il n’y a pas que de la curiosité. La galanterie s’en mêle, et parfois aussi l’amour. On les suit. Les bouquets les bombardent. On les assomme de billets doux, de lettres, de protestations de tout genre. Une actrice ! Morceau friand pour les étrangers et pour les collégiens en vacances. Léontine Fay avait reçu cinquante épîtres de cinquante Werthers différents qui lui disaient : « Si vous ne cédez pas, je me tuerai pour vous. »
Mademoiselle Déjazet montrait une malle pleine de vers écrits à la plume et au crayon par tout un peuple de rimailleurs. Il y avait là-dedans beaucoup de rhétoriciens.
Un jour, dans les galeries du Palais-Royal, elle en arrêta un par l’oreille droite et lui dit :
– Si vous continuez à m’envoyer des alexandrins, je vous reconduirai chez votre maman, monsieur.
L’acteur de Paris le plus répandu en plein air est Hyacinthe.
Habitant des Batignolles, il y a quarante ans qu’on le voit, à peu près tous les jours, coiffé d’un énorme chapeau d’Auvergnat, toujours orné de son nez de Titan, un panier sous le bras, allant faire son marché en personne.
Tout le quartier le salue. Toutes les commères lui parlent. À ceux ou à celles qui l’interrogent sur sa manie de faire la ménagère, le joyeux comédien répond :
– Vu que je passe pour avoir bon nez, j’ai voulu moi-même faire danser l’anse du panier chez moi-même.
Pendant le siège de Paris, tous les acteurs en état de porter les armes s’étaient enrôlés dans des bataillons de marche. Tous se sont bien battus. L’un d’eux, le jeune Séveste, de la Comédie Française, est mort héroïquement à la suite d’une sortie. De ces artistes toute la population parisienne a dit alors :
– Ils ont su faire aussi très belle figure sur le théâtre de la guerre.
Mars, 1884.
Ces jours-ci, la Société des auteurs dramatiques a publié le n° 22 du Bulletin qu’elle a contracté l’habitude de distribuer, tous les deux mois, à chacun de ses membres. À première vue, ce cahier ressemble à tous les recueils sans dessin et sans style qu’on est dans l’usage de jeter aux vieux papiers. À quoi bon conserver tant de chiffons inutiles ? Les journaux d’hier, les romans dont on nous poursuit, les brochures qui obstruent l’air ambiant ? Qu’on en allume le feu, l’hiver ! Qu’on permette, l’été, à la servante de les vendre à son bénéfice, chez le marchand de saucisses !
Pour sûr, voilà ce qu’aura dit plus d’un de nos sept cent cinquante confrères. Mais que voulez-vous que j’y fasse ? À force de vivre à Lilliput, c’est-à-dire au milieu des petits hommes et des petites choses du monde littéraire, j’ai fini par m’attacher aux riens. Ces trente pages, toutes bourrées de chiffres, m’ont attiré presque malgré moi. En les feuilletant une à une, j’y ai vu un travail de fourmis, mais un grand travail. Le budget des droits d’auteur s’y trouve merveilleusement détaillé suivant toutes les zones de la France et de l’étranger. Il est même douteux que le bilan du Trésor public soit plus correctement dressé. Qui aurait cru, que, parmi ceux qui charpentent le drame ou qui gazouillent l’opérette, il y eût de si bons comptables ?
Rien de plus consolant, après tout, qu’un petit voyage à travers ces innombrables totaux. Il en résulte au moins une vérité : c’est que l’art d’éclairer les masses en les amusant au théâtre est devenu, à la longue, une profession aussi sérieuse que le notariat, souvent même plus lucrative. Il est décidément bien passé le temps où le génie ne vivait que de tolérance ou d’une aumône royale. Aujourd’hui Jean Racine n’aurait plus à se courber devant Louis XIV pour dire : « Sire, un peu de bouillon pour le grand Corneille. » L’auteur de Phèdre prendrait sous le bras l’auteur des Horaces. Tout en lui offrant de griller un cigare, il l’emmènerait rue Hippolyte-Lebas à un entresol percé de petites fenêtres, à l’agence. Là, un petit monsieur, qui a parfois un porte-plume derrière l’oreille, demanderait trois minutes au plus au vieux poète pour libeller un reçu ; Pierre Corneille y mettrait sa vénérable griffe, et une main de caissier lui tendrait, en papier ou en or, le loyer de ses beaux vers.
Est-ce que ce système ne vaut pas cent fois la dédaigneuse pension de mille livres que recevait le bonhomme par le canal d’un commis de Colbert ?
En y réfléchissant avec un peu de sang-froid, on voit qu’il n’a pas fallu moins de deux cent cinquante ans pour amener le droit d’auteur au point où il en est de nos jours. Tout le long de cet ancien régime, que tant d’ignorants bélîtres font mine de regretter, il était convenu que le talent d’un écrivain de théâtre ne devait tout au plus lui rapporter que de quoi acheter des culottes. Si l’on voulait s’en donner la peine, il y aurait à exhiber à ce sujet une charretée d’anecdotes, toutes fort plaisantes comme celles qui concernent les meurt-de-faim, lisez les bohèmes. Je ne m’arrêterai à aucun de ces traits, pas même à l’aventure de Dufresny, ce spirituel bâtard d’un prince, qui, n’ayant pas de quoi payer sa blanchisseuse, prit le parti de l’épouser, afin d’éteindre la dette. Nous avons hâte d’arriver au moment où un grand écrivain dramatique, grand homme d’affaires par-dessus le marché, changea tout à coup la face des choses ; Beaumarchais ne voulait pas que ceux-là fussent exposés plus longtemps à crever de misère qui tiraient de leur tête d’assez belles œuvres pour empêcher la foule de mourir d’ennui ou de bêtise.
Ce maître homme, au reste, était endiablé. Il avait appris la guitare aux trois filles de Louis XV. Il avait eu ces fameux procès qui nous ont permis de si bien rire de l’ancienne judicature. Il avait fait la fameuse édition de Voltaire à Kelh. Il avait vendu des fusils aux républicains des États-Unis insurgés contre l’Angleterre. Tant d’affaires le poussaient à se frotter aux gens de loi, aux gens de finance, aux gens du monde, aux gens de justice et aux gens d’Église. Et finalement, toute comparaison faite, il s’était écrié :
– Eh bien, oui, les gens de lettres valent mieux que tout ce monde-là ; mais les gens de lettres sont sans le sou. Il ne faut pas que cela dure.
À la même époque, il venait de se former une société de marchands de farine, stipulant pour la hausse des prix.
– Pardieu, se dit l’auteur du Mariage de Figaro avec sa verve railleuse, je ne vois pas pourquoi les fariniers de l’esprit ne formeraient pas de même bande à part, destinée à substituer la force de l’association à la faiblesse de l’isolement.
Et le lendemain, tout en riant, il convoquait ses confrères chez le Suisse, cabaret de la terrasse des Feuillants. La Société des auteurs dramatiques était créée.
Un jour, en 1843, dans les salons de Lemardelay, rue de Richelieu, nous avons entendu H. de Balzac raconter ce fait en le glorifiant. De ce Beaumarchais tant honni, le grand romancier faisait presque un demi-dieu.
– C’est lui, ajoutait-il, qui nous a appris à réclamer ce qui nous est dû ; c’est lui qui est la cause première de la belle posture de tels et de tels qui n’ont même pas lu ses œuvres !
À la vérité, Beaumarchais n’était parvenu qu’à faire admettre le principe, mais c’était déjà beaucoup. Grâce à lui, il fut stipulé que tout acte rapporterait un droit chaque fois qu’on le jouerait. Cette nouveauté était en opposition avec la coutume. En effet, l’usage voulait qu’on achetât un ouvrage en bloc. L’artisan ne recevait qu’un prix, une fois payé.
Quand Sébastien Mercier eut fait jouer son drame de Jean Hennuyer, il s’acheta un bel habit de velours avec lequel il alla faire une visite à Voltaire, récemment revenu de Ferney.
– Ah ! dit galamment le patriarche en touchant le drap du doigt, je sais ce que c’est que cette étoffe ; c’est du Jean Hennuyer.
Effectivement le droit d’auteur avait rapporté cent écus et ces cent écus avaient servi à payer l’habit de velours.
Suivant les statuts présentés par Beaumarchais, on changea tout cela. Il y eut donc un droit particulier, un tant pour cent sur la recette du théâtre. Évidemment c’était plus conforme à la justice ; mais, dans l’origine, ce n’était pas plus profitable. Pendant les orages de la Révolution, le droit n’était que de trois pour cent sur la recette. Sous le premier Empire, même chose. Paul de Kock raconte dans ses Mémoires qu’en 1814, au moment de la première invasion, il débutait en faisant jouer un mélodrame à l’Ambigu ; on le payait alors à raison de six francs l’acte. Total : 30 francs par soirée, et ce résultat faisait des envieux.
Ce fut à fort peu de temps de là, sous la Restauration, que M. Scribe, voyant l’institution de Beaumarchais tomber, s’évertua à la relever.
Il le fit, et fort heureusement pour la littérature contemporaine et pour lui-même. Après vingt ans de guerres à outrance, on avait besoin de se remettre à respirer, à faire de l’idylle, à aimer, à vivre. Le théâtre reprit faveur. Il y eut de beaux droits à toucher. Seulement le nombre des auteurs, qui ne dépassait pas vingt-cinq, doubla, puis tripla, puis centupla. Hier, il était de 750. Demain, on ne comptera plus. Tout le monde sera auteur comme tout le monde est fumeur de cigares.
Je reviens au dernier numéro du Bulletin de la Société des auteurs dramatiques.
Les chiffres qui concernent l’exercice 1884-1885 font voir que le théâtre rivalise de plus, au point de vue de l’or, avec la Californie. Ajoutons qu’il sera bien moins vite épuisé que le pays des placers ; il ne le sera même jamais tant que Paris sera debout. À nos théâtres si nombreux, aux droits de la ville, de nos provinces, de l’étranger, se joint désormais un produit qu’on ne connaissait pas chez nos pères : celui du tronçon de pièce et celui de la romance qu’on exécute dans les cafés-concerts.
Pour cette seule année, dans le seul Paris, cette branche a donné 36 134 francs 55 centimes, c’est-à-dire trois fois plus que le théâtre entier ne donnait à Paris et en France du temps de Molière.