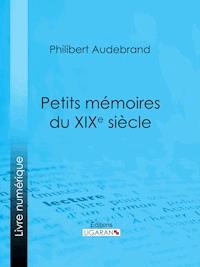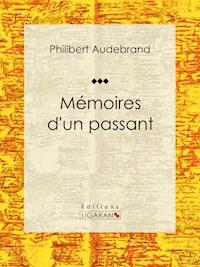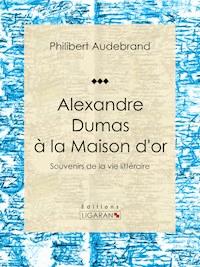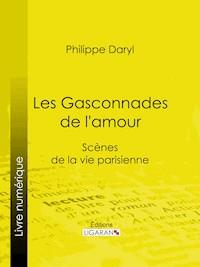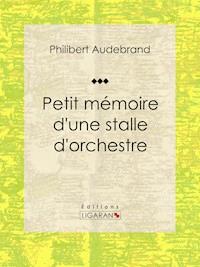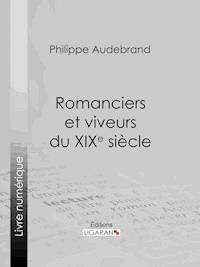
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Dans la préface de son livre si fantasque et si amusant sur la vie nomade des comédiens Paul Scarron, le cul-de-jatte, assure que la France est, par excellence, la terre où fleurit le Roman. C'était fort bien dit pour son temps. À cette époque, pour contrecarrer les querelles religieuses, toujours si sombres, on avait besoin d'excursions dans l'idéal..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dans la préface de son livre si fantasque et si amusant sur la vie nomade des comédiens Paul Scarron, le cul-de-jatte, assure que la France est, par excellence, la terre où fleurit le Roman. C’était fort bien dit pour son temps. À cette époque, pour contrecarrer les querelles religieuses, toujours si sombres, on avait besoin d’excursions dans l’idéal. Ceux qui savaient lire se récréaient en lisant la Bibliothèque bleue. On revenait aux légendes semées le long du pays par les trouvères Nos grand-mères raffolaient des contes. Voyez ceux de la reine de Navarre. Les maîtres du genre allaient venir ; Cyrano de Bergerac, la Calprenède, Honoré d’Urfé, les Scudéry ; Mlle de Lafayette était déjà dans la coulisse. Bref, cet art d’amuser les oisifs s’avançait pour donner les plus belles promesses. Encore un peu de temps, et l’on verrait paraître Candide, Gil Blas et Marianne. Ce qui revient à dire que Voltaire, Lesage et Marivaux composeraient des œuvres qui permettraient à ce genre de prendre rang parmi les formes les plus élevées de la pensée. Presque à la même heure J.-J. Rousseau nous apporte la Nouvelle Héloïse et, pour le coup, le Roman règne en maître, chez nous d’abord, puis dans toute l’Europe. Un moment, sans doute, il se manifeste un mouvement parallèle chez nos voisins d’outremer. Quelques Anglais avaient soulevé l’attention par un certain nombre d’œuvres de la même gamme. C’était Fielding, qui faisait Tom Jones, c’étaient Richardson écrivant Clarisse Harlowe et Daniel de Foë l’inimitable Robinson Crusoë. Il y avait une somme d’originalité dans ces conceptions, mais ce n’était qu’une récolte passagère et une fois donnée. Quant à l’abondance, il ne fallait la demander qu’au terroir français. Bientôt, en effet, on vit arriver à la file : Diderot avec la Religieuse et Jacques le Fataliste ; Marmontel, avec Bélisaire ; Florian avec Estelle et Nemorin ; Crébillon fils avec le Sofa ; Choderlos de Laclos avec les Liaisons dangereuses ; Louvet de Couvray avec les Aventures du Chevalier de Faublas.
Nous n’avons pas à juger, nous ne faisons qu’énumérer.
Un humoriste d’alors a dit que ces livres si dissemblables, idylle et libertinage mêlés, annoncent clairement la chute d’une société trébuchante, oisive, polie et licencieuse. Comme pour lui donner raison, 89 éclata avec un bruit de tonnerre.
Dès la prise de la Bastille, on coupa court au roman. Il n’y eut donc plus à s’arrêter aux propos de boudoir, aux bouquets des bergères, ni aux échelles de soie pour enlèvement. Le drame courait les rues. Il venait se dénouer en scènes sanglantes sur la place de la Révolution, à moins qu’il ne courût à la frontière, le fusil au dos et le sabre à la main. En un pareil temps, un conte d’amour eût été une sacrilège dissonance. Cet état de choses dura à peu près dix ans. Le fait est qu’on ne vit reparaître le Roman qu’après le Dix-Huit Brumaire et le lendemain de Marengo.
Cet autre Lazare, sortant de son tombeau, ne se sentait pas très solide sur ses jambes. Autour de lui, tout avait changé, les mœurs, le costume, la forme du langage, les idées et la géographie elle-même. À ce spectacle il secouait son linceul, tâtonnant, ne sachant trop comment ressaisir le public. Cependant il s’enhardit et finit par se mettre au courant du monde nouveau. Ça ne lui faisait rien, du reste, que le continent européen fût en feu, sur terre et sur mer, puisque, grâce à la main de fer d’un petit artilleur corse, l’intérieur était en paix. Les fêtes mondaines recommençaient. Belle occasion pour les amuseurs de rester en scène. « Salut au ressuscité ! » s’écriaient les femmes et les têtes frivoles.
À dater de cette heure-là, le Roman reprit à Paris droit de cité et, d’empiétement en empiètement, il devait arriver, un jour, très prochainement, à primer la prose parlée, la prose écrite, les grands vers, le théâtre, la chaire sacrée, la chaire des écoles et à lutter de popularité avec la tribune elle-même. « Il détrônera jusqu’à la chanson ! » devait s’écrier, un jour, l’auteur du Roi d’Ivetôt.
En jetant un coup d’œil d’ensemble sur ce que le dix-neuvième a produit rien qu’en France, en fait de romans, l’homme le plus résolu recule avec un sentiment d’effroi. Certes, il faut beaucoup de présomption, il faut aussi une forte dose de courage pour se hasarder à dresser l’inventaire seulement de tant de conceptions soi-disant littéraires. Romans d’amour, romans de cape et d’épée, romans judiciaires dans lesquels s’emmêlent le viol, le faux, le meurtre, la suppression d’enfant, le duel, la trahison, le mystère, le suicide, l’héroïsme, l’adultère, ah ! l’adultère surtout, la folie, l’inceste, romans de toutes les Couleurs et de toutes les dimensions, quelle place vous occupez dans ces cent années ! À plusieurs reprises, cherchant à faire cette énumération, j’ai hésité, terrifié que j’étais par l’énormité de la tâche. Pourtant, à la longue, la patience m’étant venue, je me suis enhardi et je livre à tous les yeux mon travail évidemment incomplet, parce qu’il roule sur quelque chose comme l’infini, mais qui aura peut-être quelque utilité en ce qu’il fera voir en quoi auront consisté les jeux d’esprit de tout un siècle.
En 1800, ce fut un survivant de l’ancien régime, un Bourguignon, qui prit sur lui de remettre la forme romanesque en honneur. Rétif de la Bretonne avait pu traverser les tourmentes de la Révolution en gardant sa tête sur ses épaules, mais aussi en ayant les yeux grands ouverts, de façon à ne rien perdre de ce qui restait dans les Salons et de ce qui se passait dans la rue. Étant tout à la fois ouvrier typographe et auteur, il composait ses œuvres, devant une casse d’imprimeur, sans avoir à les écrire. Disons aussi que, pour n’être jamais à court de sujets, le soir venu, ne craignant pas d’être pris pour un chiffonnier, il allumait une lanterne et parcourait Paris de long en large, en observateur toujours en éveil. Cent fois la patrouille l’a surpris prenant des notes, tantôt sur une borne, tantôt sur son genou. En raison de ses allures diogéniques, nos pères l’avaient surnommé le Jean-Jacques du ruisseau. Ce noctambule n’a pas laissé moins de 80 volumes, dont plusieurs ont encore assez de jeunesse pour former le regain d’une lecture intéressante. Citons les Contemporaines, Le pied de Fanchette et les Confessions de M. Nicholas.
Rétif se rencontrait parfois avec Ducray-Duminil. Qu’est-ce que c’est que celui-là ? Chez nous, comme on ne manque jamais de se moquer des idoles d’hier, on fait encore aujourd’hui des gorges chaudes sur ce grand prêtre du roman naïf. Très peu de conteurs auront eu autant de vogue, surtout parmi les lecteurs du premier âge Particularité très peu connue, le bonhomme avait commencé par être journaliste. Il a écrit, en effet, dans le plus ancien et le plus persistant des journaux, c’est-à-dire dans les Petites Affiches. De 1795 à 1807, il y a fait, chaque semaine le compte rendu des théâtres, ce qui, à cette époque, était une affaire d’importance. Oui, mais la critique, même de très petite envolée, n’était pas son fort et il a eu, un matin, l’heureuse pensée de ne se consacrer tout entier qu’à la culture du roman.
Ce qu’il faut noter, avant tout, c’est qu’il a créé un genre dans lequel il était passé maître à plusieurs titres. Avant lui, ni en France ni ailleurs, nul n’avait encore fait de récits, étant tout à la fois pleins de mélodrame, de tendresse mouillée et d’incidents mystérieux. Nul n’avait donc eu autant de prise sur les âmes sensibles des vieilles filles et sur le cœur des enfants. En envisageant sous ce point de vue son œuvre, dont les esprits graves ont toujours ri à gorge déployée, on trouve que cette poétique puérile n’est pas dépourvue d’intérêt. Les imaginations de douze à dix-sept ans ont besoin d’être amusées. Quoi de plus approprié à cette urgence que Lolotte et Fanfan, Alexis ou la Maisonnette dans les bois, Victor ou l’Enfant de la forêt, et Jacques et Georgette ou les Petits Montagnards Auvergnats ? Il en est deux ou trois autres que j’oublie, mais il en est, très certainement, un qu’il ne me serait pas permis de garder sous silence : je veux dire Cœlina ou l’enfant du mystère, le chef-d’œuvre du genre.
Rivarol disait : « Il faut avoir l’héroïsme de la quinzième année pour goûter Télémaque ». Pour lire Cœlina, il fallait avoir de douze à quinze ans et être jeune fille, élevée dans l’aisance bourgeoise autant que possible. Dès lors, c’était une série de délices. Quelques potaches réfractaires au grec et au latin s’y sont aussi laissés prendre, et j’avoue avoir été de ce nombre. Après tout, la fable n’est pas qu’étrange et cent fois bizarre ; elle est aussi fort attachante et s’empare rudement de ceux qui l’ont commencée. Pour une succession à capter, deux scélérats, les Trugelin père et fils, machinent une horrible gabegie. Une jeune femme du nom d’Isoline a été mal mariée. Pour qu’elle ait un enfant, ils jettent dans son lit un vagabond qui est muet de naissance, défaut qui l’empêchera de révéler la supercherie. Ce n’est pas assez. Ils renferment la jeune mère au fond d’un souterrain, adhérent à un vieux château. Ah ! ce souterrain, quel effet il produisait sur les jeunes esprits ! Savez-vous comment s’y prenait, pour vivre, l’infortunée prisonnière ? Ça, je vous le donne en mille. D’ordinaire les aigles posent leurs nids sur le sommet des monts. Ducray-Duminil a changé cette loi de l’histoire naturelle. Il a donc établi l’aire d’une aigle à trente pieds sous sol, dans cette excavation où gémit la malheureuse. Eh bien ! cet oiseau philanthropique est pour la captive cent fois mieux que ce qu’a été pour Pellisson une araignée fameuse. Non seulement il vient, tous les jours, visiter Isoline et lui tenir compagnie, mais encore il lui pond, tous les jours aussi un œuf, et c’est cet œuf qui sert de nourriture à la mère de Cœlina – D’accord, mais l’aigle, de quoi vit-elle ? L’auteur ne perd pas son temps à nous le dire. – N’importe, cherchez bien, lisez, compulsez, interrogez la tradition de tous les peuples, remuez la poussière de mille bibliothèques, et je vous défie de trouver rien de comparable comme expédient romanesque à cet œuf d’aigle, pondu quotidiennement dans un souterrain. Le livre, au surplus, fourmille d’épisodes de même nature, et c’est probablement ce qui explique le prodigieux succès qu’il a obtenu. Pendant le Consulat, le premier Empire et les deux Restaurations, les générations survenantes y ont suspendu leur attention avec le même empressement : Cœlina ou l’Enfant du mystère n’a pas été tiré à moins de 1 200 000 exemplaires.
Au début de ce siècle, chez nos libraires, on voulait, du reste, n’admettre le roman qu’autant qu’il donnât la chair de poule au lecteur. De l’autre côté du détroit étaient venues, par voie de traduction, les horreurs imaginées par Mme Anne Radcliffe. On s’arrachait les Mystères d’Udolphe, le Secret des Pénitents noirs, les Fantômes du château, le Roman de la forêt. Toujours des moines, des châteaux, des mystères. Chez nous, pour cadrer avec cette mode, un anonyme fit la Forêt de Sénart, un bois qui avait fort mauvaise réputation. Il fallait des brigands, et déjà, M. Guilbert de Pixérécourt en mettait beaucoup dans ses mélodrames. On vit alors paraître la Nuit de sang, par Fleury, Inésilla, Madrid, Paris et Vienne, en 1808, par Artaud ; Serments d’hommes et fidélités de femmes, le Pont des Soupirs, chronique vénitienne ; l’Auberge de la mort, par ***, et l’Héritage du crime, aussi par Trois-Étoiles.
Par bonheur, l’ennui prit vite nos pères et la réaction du raisonnement nous ramena, un beau matin, au bon sens, au bon goût et à la vraie manière de conter. Un savant ingénieur, qui était aussi un très bel esprit, tira du souvenir de ses lointains voyages une très courte aventure d’amour dont il a fait un chef-d’œuvre. Bernardin de Saint-Pierre donnait Paul et Virginie à la France et au monde et, bientôt après, la Chaumière indienne et le Café de Surate. C’en était fait, on revenait à une nourriture intellectuelle plus saine, et qui, peu à peu, à l’aide du temps, ramènerait les belles œuvres littéraires. Une femme de génie, qu’on encensait alors comme si elle eût été une statue de Praxitèle, bien qu’elle ne fût pas belle, aida beaucoup à ce mouvement : Mme de Staël fit paraître coup sur coup Corienne et Delphine, ces deux sœurs, qu’on ne connaît pas de nos jours, mais qui étaient alors une double coqueluche pour la société parisienne. Cette vogue coïncidait d’ailleurs avec celle de Werther (les Souffrances du jeune Werther), la première œuvre de Gœthe, un livre intéressant, sans doute, fort élégiaque, mais très malsain, en ce qu’il répandait le goût sacrilège du suicide. À Paris, un enfant de la Franche-Comté, encore très jeune homme, Charles Nodier, y répondit en faisant Jean Sbogar, pour exprimer qu’au meurtre de soi-même il fallait préférer l’ensevelissement dans les cloîtres. C’était la première voix qui réclamait le rétablissement des couvents.
Revenir à la vie ascétique, c’est-à-dire au célibat sacré, ce n’était pas ce que voulait celui qui menait alors le pays, ce jeune ogre qui faisait une si belle consommation d’hommes et qui, par conséquent, avait besoin qu’on lui fît beaucoup d’enfants. Ce n’était pas non plus l’affaire des femmes du monde, qui, ayant été affriandées par les fêtes du Directoire, demandaient à cor et à cri un retour aux plaisirs de la vie mondaine, Jean Sbogar n’eut donc qu’un succès d’estime parmi les penseurs et les décavés du jeu politique. Le roman qu’on souhaitait, c’était celui des mœurs faciles, le tableau des succès d’amour au salon, au boudoir et même dans l’alcôve. Au besoin, il aurait eu un dénouement et une sanction au confessionnal, car le citoyen Premier Consul venait de signer le Concordat et de rouvrir les églises. Cet autre roman ne devait pas se faire attendre. Les dames s’en mêlèrent et le firent, mais ici une légère digression est indispensable et l’on ne nous en voudra pas de nous arrêter un moment à un peu de parenthèse.
Mme de Staël, dont il vient d’être question, ne fut pas la seule dame qui se mêlât d’écrire. Plusieurs autres, des marquises, des duchesses, même, trempaient volontiers leurs plumes et le bout de leurs jolis doigts roses dans l’encre ; mais la violence des évènements les avait retenues. Après le 18 Brumaire, croyant que la tempête démocratique était décidément refoulée au loin, les Muses des salons avaient repris leurs lyres ou plutôt leurs guitares, car les temps où l’on était se montraient surtout propices à ce dernier instrument. De ce nombre était une femme fort mûre et qui, à plus d’un titre, a droit de figurer dans l’histoire. C’était celle que Philippe-Égalité avait jadis donnée pour gouvernante à ses fils ; c’était Mme de Genlis, la même qui a inauguré en France l’existence de ce type que les Anglais appellent le Bas-bleu. Cette duègne a beaucoup écrit ; elle a trop écrit, en prose et en vers, et rien d’elle n’est resté, mais sur la fin du Consulat, comme elle avait fait entendre un morceau de dithyrambe en l’honneur du victorieux d’alors, ce dernier releva cette grandeur déchue. Non content de lui faire donner une très belle pension, bien qu’elle ne fût plus de nature à être un ornement, il l’invitait aux fêtes de la Malmaison, à ces concerts auxquels Ducis refusait d’assister et que Népomucène Lemercier fuyait à toutes jambes. S’il n’aimait pas l’espèce, celle de la femme qui met du noir sur le blanc, il faisait une exception pour cette vieille et il se plaisait à l’encourager de toutes les façons. Voyait-il en elle une rivale à opposer à l’auteur de Corinne ? Le bruit en a couru. Il est bien vrai qu’elle a publié, elle aussi, des romans et, notamment, le Siège de la Rochelle, où elle a multiplié les scènes attendrissantes, mais vis-à-vis de cette sibylle et contre elle, la faveur publique venait de susciter un escadron de pétulantes inspirées qui la criblaient d’épigrammes. À la tête de ces amazones de l’écritoire, on voit se produire une jeune femme d’assez bon lieu : c’est une élégante déjà fort remarquée pour sa beauté, et aussi pour la vivacité, d’autres ont dit pour la méchanceté de son esprit. Nommons vite Mme Sophie Gay, la moitié d’un receveur d’Aix-la-Chapelle, alors chef-lieu d’un département français. Faisant de fréquentes apparitions à Paris, elle s’y trouve au milieu des bals, des soupers, des intrigues et de tout ce mouvement épicurien qui a été la marque du premier empire. Il lui est donc facile de surprendre sur le vif les mœurs dissolues du temps qui frisent si bien l’orgie. Aussi est-elle la première à fidèlement décrire les séduisantes coquineries (on dirait aujourd’hui les rosseries) de ce monde de soudards et de parvenus. Ses romans sont comme des révélations sur l’art de se tromper décemment en matière d’amour. Celui de ses débuts, an X (1802), est intitulé : Laure d’Estell. Il s’y mêle encore une petite dose de naïveté, mais les autres ! Arrivent Léonie de Montbreuse, les Malheurs d’un amant heureux, le Moqueur amoureux, un Mariage sous l’Empire, puis la Duchesse de Châteauroux. On cite à ce sujet un trait assez piquant. Un soir qu’elle était dans le salon de Joséphine, Bonaparte, encore premier consul, l’aperçut et alla à elle. « Vous êtes, restée deux ans à Aix-la-Chapelle. Qu’y avez-vous fait ? – Deux romans, sire. – Il eût mieux valu y faire deux garçons. » Et il lui tourna les talons, Dame, il avait la monomanie de la chair fraîche et cela se conçoit.
Il faut ajouter, à la gloire de Mme Sophie Gay, qu’elle ne s’est pas bornée à faire des romans. Elle a édité aussi une très belle personne, Mme Émile de Girardin, première du nom, qui, plus tard, à son tour, peindra les mœurs de ce qu’on appelle le beau monde. Nous en parlerons en temps et lieu. En attendant, disons que ces premiers jours de l’Empire, puisque nous y sommes, ont particulièrement aidé à l’éclosion des femmes auteurs. Nous venons d’en signaler trois, mais il devait en pousser bien d’autres. En effet, cette ère aura été le point de départ de toute une escouade. Les unes donnaient lecture de leurs œuvres dans les salons. Quelques autres, plus aguerries, n’hésitaient pas à se faire imprimer. Citons, au courant de la plume : Mme de Souza, Mme de Flahaut, Mme Cottin, la plus célèbre de toutes, à cause de Claire des Îles, Mme de Duras, Mme de Montolieu et bientôt Mme Georgette Ducrest, – Hélas ! ce n’était qu’une avant-garde. Il va en venir cent autres par la suite : que dis-je ? deux cents autres !
– Des pondeuses ! a dit d’elles Raymond Brucker, qui a dû voir en elles des rivales.
Quant au roman proprement dit, comme il se voyait maître du terrain, comme il avait conquis la plus grosse partie du public, il prenait ses aises et il obéissait tout à coup à la fantaisie de faire peau neuve. Pour commencer sa métamorphose, il louvoyait et, par la plume de M. Fiévée, un défroqué, allant du plaisant au sévère, il faisait la Dot de Suzette, mais, bientôt, délaissant le style frivole, il se jeta, tête baissée, dans les divagations philosophiques : Senancour venait d’accoucher d’Obermann. Il en est qui disent ; « Mais ce n’est pas un roman, cet Obermann ! » – Mon Dieu, si, messieurs, puisque l’auteur l’a donné comme tel. En tout cas, c’est un livre de génie, écrit d’une main magistrale, parsemé d’admirables paysages et tout plein des plus savantes mais aussi des plus désolantes analyses psychologiques. Il est évident qu’il ne saurait être au goût du vulgaire et que ceux de la foule le jettent de côté, dès la seconde page. Pour les esprits d’élite, c’est tout le contraire, Constatons, du reste, qu’à l’époque où il a paru, Obermann n’a pas été compris et que la joie du succès ne lui est arrivée qu’un quart de siècle après sa publication première. Mais, pour un livre, c’est bien quelque chose que de ressusciter après un sommeil léthargique de vingt-cinq ans.
Senancour menait son lecteur au scepticisme, au bouddhisme, au panthéisme de Spinosa, ce qui est toujours le doute. Un petit cadet breton, revenant de Jérusalem, entreprit, par contre, de nous ramener à la foi chrétienne. Chateaubriand publia les Martyrs, qu’il supposait être une épopée en prose, mais qui n’étaient bel et bien qu’un roman, à cause des amours d’Eudore et de Cymodocée, puis les deux épisodes de René et d’Atala. En même temps, d’autres manifestations du même genre agitèrent les esprits. Un estimable philosophe, M. Ballanche, faisait paraître Antigone, d’abord, puis Job, tandis que M. Bitaubé, assez mauvais traducteur d’Homère, mais bon professeur de rhétorique, ayant retrouvé quelque part, peut-être chez un marchand de bric-à-brac, une vieille plume ayant servi à Fénelon, brochait une sorte de Télémaque biblique, c’est-à-dire Joseph, l’amant malgré lui de Mme Putiphar. On ne devait plus mettre grand temps à voir venir les Natchez et le Dernier des Abencerages.
Cabanis craignait que cette sacro-sainte méthode d’associer la religion aux choses mondaines ne nous fît rétrograder vers l’ancien régime ; mais si une civilisation s’arrête un instant, jamais elle ne revient au passé. Sur les champs de bataille, le canon supprimait alors les hommes par cent mille. Il fallait faire des remplaçants et très vite. Citons une lettre du général Lassalle à un ami : « Je ne fais que traverser Paris : le temps de faire un enfant à ma femme ». On ne voyait partout que des sociétés bachiques, gastronomiques et érotiques. Il devait logiquement apparaître un romancier pour décrire cette évolution de sybarites. Pigault-Lebrun, un ami de la famille impériale, raconta les joyeux passe-temps de cette époque dans les Hussards de Felsheim, dans M. Botte et surtout dans l’Enfant du Carnaval.
Sans le vouloir, sans s’en douter, Pigault-Lebrun a fondé une école, celle de la belle humeur. Jusqu’à, ce jour, le roman avait été sombre, triste larmoyant. Il en fit un bon drille, membre du Caveau et grand amateur de petites fredaines. Vadé et Collé revivaient dans ces pages, qu’on ne pouvait tourner sans rire aux éclats. Rien de plus français. On avait à prévoir qu’il naîtrait des imitateurs et, en effet, à quinze ans de là, il en est venu.
Avant d’aborder l’histoire de cette lignée des écrivains rieurs, il ne faut pas taire que le roman grave, l’élégie en grand avait encore dans notre sol de profondes racines. Tout près de l’auteur de Corinne, Benjamin Constant composa Adolphe. Vous savez ce que c’est : le reflet trop fidèle des liaisons qui s’engagent, en dehors de la loi, chez les gens du monde. Des amours tourmentées, des scènes trempées de larmes, une rupture. Aux mêmes heures, Mme de Krudener, la maîtresse d’un tsar, composait ! Valérie. Une autre grande dame faisait Adèle de Senanges. Une autre, de Duras, publiait Ourika, les transes d’un cœur de négresse. Charles Nodier aussi donnait toute la mesure de son talent par le Peintre de Salzbourg et par Smarra, en attendant Trilby, son chef-d’œuvre. Tout cela était comme un signe avant-coureur du Romantisme.
Cependant l’Empire tomba. Il tomba même deux fois, dit l’histoire. Les invasions successives de 1814 et de 1815, le retour de l’île d’Elbe. Waterloo, la Terreur Blanche, tant de tristesses patriotiques, firent que notre grand pays, étant encore une fois sens dessus dessous, n’avait guère le loisir de songer au roman. Cet état de choses dura près de trois années, mais, à la fin, après le départ des étrangers, le temps s’étant à peu près remis au beau, la nation ressentit le besoin de récréer ses pensées. À la bonne heure, mais tout était en complet désarroi dans la République des lettres. Conter était un art à refaire entièrement et comment allait-on s’y prendre ? La situation eut assez donné l’idée, d’un chaos à débrouiller, puisque, sans compter la dissemblance des idées, il y avait alors deux langues et même trois : 1° celle de l’ancien régime que rapportaient les émigrés vainqueurs et dont ils ne voulaient pas se défaire ; 2° la langue nationale, rajeunie par la tribune et par la presse de la Révolution ; 3° une autre, participant des deux, et à laquelle des novateurs cousaient l’emphase des anciens troubadours : Et c’est dans celle-là qu’ont été taillés deux romans bien pensants, par exemple, Tristan le Voyageur, par M. de Marchangy, et le Solitaire, par le vicomte d’Arlincourt.
Hélas ! il faut bien se résoudre à le dire, le Solitaire a été un évènement et presqu’une bonne fortune pour la Restauration. Jamais encore on n’avait vu un livre faire ainsi fureur. On le tira à quinze éditions, on le traduisit dans toutes les langues de l’Europe, même en lapon. Il fut mis en opéra-comique, en peinture, en sculpture, en lithographie, en flacon de liqueurs, en patron de robes. Les femmes se l’arrachaient et cette rage d’engouement alla jusqu’à faire concurrence à la girafe, mammifère jusqu’à ce jour inconnu en France et que Méhémet-Ali, pacha d’Égypte, venait d’envoyer en hommage à Charles X. Quant à l’auteur, royaliste ultra, il était naturellement fort célébré à la cour et à la ville : c’était un saint dans sa niche pour les châteaux et pour les presbytères. Rien pourtant ne pourrait donner une idée de la niaiserie sur laquelle s’appuie cette composition saugrenue au double point de vue du fond et de la forme. Qu’est ce donc que le Solitaire ? Un personnage mystérieux et énigmatique, toujours enveloppé des plis d’un long manteau, un être ténébreux qui voit tout et entend tout. Et savez-vous quel est ce type étonnant ? Charles le Téméraire en personne, l’ennemi des Suisses et le rival de Louis XI. Voyons, ne fallait-il pas avoir le diable au corps pour exhumer, en 1825, cette momie du Moyen Âge et pour en faire le héros d’un roman moderne ? Et ce qui ajoutait pas mal de comique à cette témérité, c’était le style impayable dont était enveloppée cette pilule déjà si amère. Qu’on en juge par un court extrait :
« Non loin de la tanière où celui-ci réside, squalide, hérissé et aux bêtes fauves semblable, vit la jeune et belle Élodie. Au milieu de l’orage et des vents, elle l’a aperçu et sa mâle beauté a fait son cœur tressaillir. Son luth elle cherchait, son luth par elle oublié la veille sur l’arche d’un pont, et de le retrouver elle désespérait, lorsque tout à coup se fit ouïr un horrible craquement… »
Ce même vicomte d’Arlincourt a droit d’être regardé comme l’écrivain le plus grotesque du siècle, mais, que voulez-vous ? enivré du parfum de ses triomphes, il ne consentait plus à s’arrêter. Comme il fallait une suite au Solitaire, il fit Ipsiboé. Ce sera assez de citer ici le titre de ce second chef-d’œuvre. Peu après, lorsque les Bourbons de la branche aînée furent remplacés par ceux de la branche cadette, en fidèle légitimiste qu’il se flattait d’être, il écrivit romans sur romans contre Louis-Philippe : « Flagellons l’usurpateur ! » s’écriait-il. Ainsi ont paru, sans trop ébranler le nouveau trône : les Rebelles sous Charles V, le Brasseur-Roi, l’Herbagère et l’Étoile polaire. (En 1850, il fera les Masques d’or contre Mazzini, Garibaldi et leurs complices.) Mais, pendant trente ans et sans le voir, le digne gentilhomme aura été le point de mire de la moquerie universelle.
À propos de ce Walter Scott pour rire, il n’est que juste de rappeler un fait qui est bien caractéristique de nos mœurs commerciales. En contemplant le prodigieux succès des œuvres du vicomte, un libraire eut l’idée de créer, comme concurrence, un romancier du parti libéral, et il eut l’adresse de le choisir étiqueté d’un nom à peu près semblable à celui de l’auteur du Solitaire. Voilà comment fut inventé Dinocourt. Quand le vicomte pondait un livre, celui-là y répondait par un autre. Subsiste-t-il quelque part un centenaire qui se rappelle cette variété du duel ? Dinocourt vivait encore sur la fin du second Empire. J’ai pu le voir à cette époque. Un homme de petite taille, tout blanc, fort modeste, peut-être parce qu’il avait toujours été très pauvre. Très pauvre, et il n’a pas publié moins de 80 volumes ! Celui qu’on avait le plus remarqué a été le Camisard, un épisode de la guerre des Cévennes. Oui, 80 volumes et, sur la fin de ses jours, la Société des gens de lettres a dû donner du pain à ce vieillard et payer les frais de son enterrement.
Dans les temps dont il s’agit, la fécondité en matière de romans était chose courante. Entre les deux conteurs que je viens de rappeler, il s’en est trouvé un troisième qui n’aura pas non plus manqué d’importance, surtout dans le monde des cabinets de lecture, et l’on sait qu’il n’y en avait pas moins de 1 500 alors en France. Le baron de Lamothe-Langon aura été l’un de leurs fournisseurs attitrés. C’était, sur la fin du règne de Louis-Philippe, un vieillard de haute taille, un peu voûté, un peu fané, visiblement surmené par l’excès du travail et l’abus de l’opium, qu’il prenait en globules. Il prétendait avoir été un des pages de l’impératrice Joséphine et, plus tard, sous-préfet dans le Midi, à Mirande, je crois. La liste de ses œuvres est une chose des plus curieuses. Cet improvisateur était une espèce de Protée, se produisant en librairie sous toutes les formes humaines et sous tous les déguisements. Un jour, il signait le livre nouveau de son nom. Une autre fois, l’œuvre était d’un Ancien Diplomate ou d’une Duchesse. Parfois c’était un pseudonyme de fantaisie. Lorsque l’éditeur Ladvocat mit à la mode la manie des Mémoires, le baron tira vingt morts illustres de leurs sépulcres pour leur faire raconter leurs vies, et le public, toujours vorace, toujours crédule, a avalé tout cela. Le baron de Lamothe-Langon m’a donné la nomenclature de ses ouvrages, écrite de sa main. Au total se trouve le chiffre de 150 volumes de tout format ; oui, 150 volumes, 60 de plus que Voltaire, et vous n’en trouveriez pas un à l’heure qu’il est.
À mesure qu’on s’acheminait vers le milieu du siècle, le roman devenait visiblement une nécessité, sociale. Il était indispensable aux femmes, aux ennuyés et aux malades, aussi même aux voyageurs, qui ont besoin de tromper l’ennui sur la longueur de la route. À ces mêmes dates, une obscure officine du Palais-Royal mit en évidence un jeune producteur, pour le moment tout à fait inconnu, mais qui, dès le premier jour, devait être le plus lu et le plus populaire de toute la bande. Charles Paul de Kock venait d’apparaître au soleil de la librairie.
Ceux qui, à l’exemple du dédaigneux Sainte-Beuve, se sont plu à écrire l’histoire littéraire de notre temps, paraissent s’être donné le mot pour ne rien dire de ce grand homme. Ne craignons pas de dire ici que cette conspiration du silence a été tout à la fois une injustice et un enfantillage. Qu’on le veuille ou non, le romancier populaire aura été une figure dont on ne peut effacer l’empreinte et un propagateur quia répandu la prose française par-delà nos frontières, sur tout le continent et jusque chez les Turcs. On n’a pas oublié le cri que ne manquait jamais de pousser spontanément le pape Grégoire XVI toutes les fois qu’il se présentait au Vatican un visiteur de notre pays : « Comment se porte le seigneur Paul de Kock ? » À Pans les écrivains d’un ordre plus élevé ne comprenaient rien à tant de vogue et le jalousaient. H. de Balzac demandait qu’on ne prononçât jamais devant lui le nom de celui qu’il appelait le romancier des cuisinières ; Méry le plaisantait ; Jules Janin l’accusait de ne pas savoir la syntaxe, mais Alexandre Dumas père s’écriait : « Je ne crache pas sur un homme qui s’entend si bien à captiver la masse du peuple. »
Paul de Kock s’est-il modelé sur Pigault-Lebrun, ainsi qu’on l’a dit ? L’analyse démontrerait plutôt qu’il a obéi aux mouvements d’un instinct bien particulier. Ce serait donc un écrivain original. Un peu comparable à Charlet, il n’a taillé sa plume, comme l’artiste son crayon, que pour se confiner dans un genre : la peinture des mœurs de la petite bourgeoisie et des gens d’en bas. M. Dupont, la Maison Blanche, Gustave le mauvais sujet, la Pucelle de Belleville, Ni jamais ni toujours, Zizine, le Toulourou, Mon voisin Raymond, le Cocu, Sans cravate, le Commis et la Grisette, et vingt autres comédies en action, car une remarque à faire, c’est que, pareil en cela à Molière, Paul de Kock n’a jamais écrit que pour faire rire.
Répétons-le, il n’a pas été chef d’école, mais l’empressement que mettait le public à enlever ses livres a dû faire sortir de terre un grand nombre d’imitateurs. Tel a été, entre autres, Victor Ducange, un écrivain de troisième ordre, si voulez, mais qui, lui aussi, possédait l’art de charmer les foules. C’est à celui-là qu’il faut attribuer le mérite d’avoir fait Trente ans ou la vie d’un joueur, la première création de Frédérick Lemaître et le plus retentissant de tous les mélodrames. Victor Ducange s’est révélé aussi par un gros stock de romans, au nombre desquels nous citerons Léonide ou la vieille de Suresne et Marc Lovicot, un épisode du soulèvement de Vendée en 1832. À la suite, toujours dans la gamme du romancier populaire, on entrevoit Auguste Ricard avec Aînée et Cadette, Raban avec la Patrouille grise, le Séminariste, et d’autres figures du même genre ; H. Vallée, avec la Figurante ; Alphonse Signol, avec la Lingère, esquisse des mœurs juives ; Burat de Gurgy, avec la Prima donna et le Garçon boucher ; M. de Saint-Aure, avec M. Popot ; Gustave W., avec le Pompier. Deux autres et des plus prolifiques, Amédée de Bast et Maximilien Perrin, nous ont laissé cinquante de ces récits pour le peuple. Ludibria ventes : il n’en reste pas même les titres.
EN GUISE DE PARENTHÈSE.– En 1833, il a paru un livre humoristique, sous ce titre : CRIC ! CRAC ! BAOUM ! Histoire d’un manteau de sous-lieutenant par Paul de Kick. – Cette débauche d’esprit avait pour auteur le comte de Chaulot, ex grand officier des chasses du prince de Bourbon, le dernier des Condés.
Pour en finir avec Paul de Kock, n’omettons pas de dire que l’auteur de M. Dupont a eu un fils, Henry de Kock, qui, chassant de race, s’est amplement donné carrière dans la romancerie. Il n’a pas publié moins de vingt volumes. Deux de ces livres ont surtout décrit les mœurs décolletées du règne de Napoléon III : les Petits chiens de ces dames, les Petites chattes de ces messieurs. De même que son père, Henri de Kock a aussi écrit pour le théâtre et parfois en collaboration avec Théodore Barrière. C’est dire qu’il n’y a pas figuré sans succès.
Encore un peu de temps, quelques tours du cadran solaire, et une sorte de révolution dans l’art va s’accomplir sous le coup de la querelle des Classiques et des Romantiques. Il en résultera une rapide transformation dans les zones de la pensée. Avant même que le canon de Juillet se soit fait entendre, on médite, on hésite, on tâtonne, on attend. – Eh bien, qu’attend-on ? – Une révolution dans le roman, et elle va être radicale. D’abord, au petit in-12 de deux cents pages, si facile à lire, si portatif, mais trop émietté, ou fera succéder l’in-octavo. Ce sera un tome majestueux, tout aristocratique, avec de grandes marges. Il sera illustré sur la couverture de vignettes superbes, – dessinées par les maîtres, notamment par les Johannot. Format pour les duchesses, mais qui ne déplaira pas aux gens du peuple.
Il est bien entendu que cet in-octavo sera écrit par une élite. Mon Dieu, oui, une nouvelle et brillante génération de conteurs surgira tout à coup demain et étonnera l’Europe littéraire autant par l’éclat que par la prodigieuse variété de ses œuvres. Ainsi, sans qu’il soit besoin de recourir à l’aide du télescope, on contemplera dans le ciel de notre France une autre Voie Lactée, faite d’étoiles de première grandeur. Chacune des formes de la pensée y brillera : l’Histoire, la Poésie lyrique, le Drame, la Comédie, le Pamphlet, mais ce sera au Roman à y occuper la première place, parce qu’il les contiendra toutes. Le Roman verra son âge d’or.
Pour donner une idée exacte de ce mouvement, j’avais projeté de le faire se dérouler dans un déchaînement chronologique, notant pas à pas les grandes œuvres nouvelles suivant la date de leur naissance, mais, à l’usée, j’ai vu que la chose ne se pouvait pas, car le temps et l’espace nous sont mesurés. Il y faudrait un in-folio et nous n’avons que quelques pages de Revue. Force nous est donc de couper au plus court, de n’indiquer que ce qu’il y a de saillant et en ne faisant qu’une relation à bâtons rompus. Au reste, le point de départ de cette Étude n’en subsistera pas moins, puisqu’on va se rencontrer avec cent grands noms, puisqu’on verra aussi à quel point le Roman a été la coqueluche de ce siècle et quelle influence il aura eue sur les destinées de la nation.
Afin d’arriver de plain-pied à l’étincelante période de 1830, liquidons d’abord un passé qui gêne notre marche, mais qui, néanmoins, doit être signalé au lecteur. De même que la tempête, les vents, l’oiseau, sèment des fleurs sur les rocs arides, le roman se met parfois à prendre racine dans la politique. On a vu la pudique Atala naître chez un futur ministre, et Adolphe, l’irrésolu, chez un futur tribun. Pendant la Restauration, d’abord, puis, après la Révolution des Trois jours, des publicistes, des pairs de France, des ministres ont occupé leurs loisirs à ourdir des contes d’amour ou de bonnes femmes, M. de Kératry a publié le Dernier des Beaumanoir, l’héritier de ce héros du Combat des Trente auquel on criait de boire le sang de sa blessure pour se désaltérer ; M. Villemain a fait Lascaris ; M. Pons-Gaspard Viennet, la Tour de Montlhéry et le Château Saint-Ange ; M. J. Vatout, la Conspiration de Cellamare ; M. L. de Jussieu, Simon de Nantua ; M. de Salvandy, Alonzo ; M. de Pastoret, Raoul de Pellevé ; M. André Cochut, Une Réaction (celle de Thermidor) ; M. Aug. Romieu, sous le pseudonyme d’Augusta Kernoc, le Mousse. On pourrait en citer encore quelques autres, tels que Stendhal, un consul de Civitta-Vecchia, et Prosper Mérimée, un sénateur, inspecteur général des Beaux-Arts, mais ces mangeurs de budget n’étaient d’abord romanciers que par intermittence. Passons en revue les vrais représentants du genre, ceux qui n’ont vécu que pour le roman.
Sans doute, mais, pour faire bonne justice, indiquons les précurseurs. J’ai dit, en courant, Benjamin Constant, Charles Nodier, Mme Sophie Gay, Senancour, ceux qui annonçaient une aurore. Ajoutons-y Gustave Drouineau, l’auteur de Resignée, du Manuscrit Vert et de l’Ironie. Hélas ! il a fini dans une maison de santé !
N’oublions pas Rey-Dusseuil et autre pionnier du roman qui, lui, avait commencé par des chroniques, genre Radcliffe. Adepte de la démocratie militante, il a mis dans ses fables des déductions philosophiques. Après Andréa, une histoire émouvante, il a écrit : le Monde ancien et le Monde nouveau, une duologie fort originale. Son œuvre maîtresse a été le Cloître Saint-Merri, épisode de l’insurrection républicaine des 5 et 6 juin 1832. Hélas ! celui-là aussi a fini comme le Tasse !
Un troisième, un illustre, a été H. de Latouche, le restaurateur des beaux vers d’André Chénier et le plus mordant des satiristes. Il a publié dix romans, mais qu’on a vite oubliés parce que, républicain de l’avant-veille, il les a tous bourrés de politique. Tels ont été Léo et Adrienne et cinq autres. Un de ses livres a, toutefois, fait époque. Nous parlons de Fragoletta ou Naples et Paris en 1799. Grâce à la singularité du sujet (les amours d’un hermaphrodite) et aux qualités du style, ce roman a eu dix éditions, chose rare pour le temps ; – mais arrivons à notre galerie.
Régent de rhétorique dans un collège de province, Gustave Drouineau était marqué d’avance pour être une victime de l’art littéraire. Il avait débuté par des vers. « Ah ! les vers, disait Roger Collard, on ne sait jamais où ça conduit ! » Le pauvre homme, rimant trop aisément, vint à Paris et se jeta dans la mêlée des amuseurs. J’ai nommé ses romans. Il y ajouta un volume de vers sous ce titre ; les Ombrages, où l’on trouve de belles strophes. Il toucha aussi au théâtre, fit jouer un Rienzi qui n’eut qu’un succès d’estime, c’est-à-dire point de succès. Il avait écrit un Don Juan d’Autriche, reçu, paraît-il, par le premier de nos théâtres, mais qui ne fut pas représenté parce qu’on dut donner la préférence à celui de Casimir Delavigne. On a aussi de lui, dans les Cent-et-un de Ladvocat, sous ce titre : Une maison de la rue de l’École de médecine, un récit fort émouvant de la mort de Marat, l’éclatante glorification de Charlotte Corday. Après quoi, il a perdu la raison, mais pendant vingt ans ç’a été le plus doux des fous. « Gustave Drouineau ? me disait Aurélien Scholl, un des intimes de mon père. » En 1889, j’ai introduit une jolie petite nouvelle de lui, le Peintre de Weymar, dans le livre des Vingt-et-un.
Jadis, sous Charles X, lorsque le roman n’était encore considéré que comme un genre d’ordre inférieur, Lamartine habitait les cimes de Sion, la harpe à la main. Depuis lors, il est descendu de la montagne sacrée et il a sacrifié au Moloch, mais, à la vérité, sur le tard et y est allé comme un chien qu’on fouette. Après le 24 février ; où il s’est montré sous un si superbe aspect, victime de toutes les ingratitudes, étant tombé dans la dèche, il a dû faire de la prose pour gagner de gros sous. On lui a vu faire alors plusieurs romans : Raphaël, pages de la vingtième année, le Tailleur de pierre de Saint-Point, mais surtout un épisode des Confidences, une histoire d’amour, cette Graziella qui a la douceur et le charme d’une idylle de Théocrite.
Eh ! sans doute, le nommé Victor Hugo est, avant tout, un artisan en fait de prosodie. Celui qui, des Odes et Ballades, est allé à la Légende des siècles, en passant par Ruy-Blas, sera pour la postérité un sculpteur qui s’entend à pétrir passablement le vers de tous les rythmes, mais cette nature d’étonnant cithariste était enrichie d’autres attributs encore. En ce Titan, il y avait aussi un romancier. À seize ans, en 1818, c’est lui-même qui le raconte, il a improvisé Bug-Jargal en quinze jours. À deux ans de là, il faisait Han d’Islande, bientôt suivi du Dernier jour d’un condamne. Tout cela n’était encore qu’une promesse. En effet, lorsqu’il arriva à trente ans, on vit apparaître Notre-Dame de Paris, une Iliade gothique, animée d’amour, de combats, de mystères, de scènes frémissantes, où l’on voit s’agiter pêle-mêle, et pourtant dans un ordre logique, une chanteuse des rues, un prêtre, un roi, des truands, un poète, un sonneur de cloches et un beau capitaine, le tout gravitant autour d’une cathédrale : le Moyen Âge, en abrégé. Vingt ans après, lorsque l’ouvrier de génie est en exil sur un rocher de la Manche, il arrache une plume à l’aile d’un goéland, la taille en fin et écrit les Misérables, un coup d’œil d’amour et de critique jeté sur notre enfer social. Citons-en d’autres : les Travailleurs de la mer, Quatre-vingt-treize et l’Homme qui rit. Mais pendant trente ans, les catalogues d’Eugène Renduel ont annoncé deux œuvres dont on ne connaîtra que les titres : le Fils de la bossue et la Quiquengrogne.
Alfred de Vigny ne nous a pas émus seulement par ses poèmes et par ses drames. Un roman historique, Cinq-Mars, a fait revivre pour nous un épisode horrible du règne de Louis XIII.
Que de scènes émouvantes et quel style de cristal que ces récits : la Canne de jonc, Laurette ou le Cachet rouge, et surtout cette escapade d’un page du palais impérial, à Fontainebleau, l’entrevue secrète entre Napoléon et Pie VII ! Sans doute ce sont de belles pages, mais ce qu’il faut lire surtout, c’est Stella, la parole de ce médecin qui raconte avec tant de charme trois morts d’hommes inspirés : Chatterton, Gilbert et André Chenier. Il devait y avoir un second tome, une deuxième partie que tous les délicats attendaient avec impatience. Que vous dire ? Virgile, mourant, parlait de brûler l’Enéide ; Alfred de Vigny, dans ses derniers jours, a jeté au feu la seconde partie de la Consultation du Docteur noir. Un malheur irréparable.
Alfred de Musset, lui, par bonheur, ne nous a rien enlevé de ses jolis romans : Emmeline, Frédéric et Bernerette, Croisilles, les deux Maîtresses, la Confession d’un enfant du siècle, ces confidences d’un amour trahi, Mardoche, aussi, est un roman en vers.
Halte-là, s’il vous plaît, devant Honoré de Balzac ! Le Tourangeau s’est intitulé de lui-même le plus fécond des romanciers. Il en est sans contredit le plus grand. En novembre 1902, on a inauguré, sur une de nos places, sa statue, la dernière œuvre de Falguière, montrant aux Parisiens la figure tout à la fois sérieuse et ironique, la tête énorme, si puissante, de son incomparable génie, Fils d’un excentrique, pauvre, peu lettré, isolé, il a longtemps tâtonné avant de voir clair dans les abîmes de sa pensée. Dès sa jeunesse, il était gros, court, rougeaud, incorrect, lourd. Par conséquent, il n’avait pas la gracilité d’un lyrique, ni même l’allure déhanchée d’un métromane. Néanmoins, il s’était mis à forger des alexandrins. Dieux immortels ! il a commencé par une tragédie ! Pardieu ! ce ne pouvait être qu’un bloc de plomb, pesant et informe. Heureusement, la Muse du roman se penche à son oreille et l’appelle ; mais pour l’atteindre, pour la maîtriser, il dut prendre, par le chemin des écoliers. Il y eut donc un apprentissage forcé et il le fit en s’associant à deux compagnons obscurs, le Poitevin Saint-Alme et Horace Raisson, et c’est de là qu’il a tiré le pseudonyme d’Horace de Saint-Aubin, marque de fabrique de sa première manière. Ces essais, nous les connaissons : le Vicaire des Ardennes, l’Excommunié, Argow le pirate, la Dernière fée. Il y en a d’autres encore. C’étaient là des péchés de jeunesse qu’il ne reniait pas absolument, puisqu’il les a reconnus, comme Louis XIV a légitimé ses bâtards, mais qu’il n’a pas voulu pourtant souder au grand édifice de la Comédie humaine, et c’était pour le mieux, « J’ai bâti à moi seul une cathédrale », disait-il sur la fin de sa vie en se frottant les mains d’aise. La vérité est que les quatre-vingts volumes qui sont tombés de sa tête forment un monument sans pareil et d’une gloire impérissable.
D’un petit oignon noir, rugueux, abrupte, on voit sortir, à Harlem, la plus resplendissante des fleurs, cette reine des tulipes dont les corolles sont brodées d’or, d’émeraude et de saphir. Ainsi d’une petite châtelaine du Berri est venue, un jour, en 1833, une charmeresse qui a été le plus grand prosateur du XIXe siècle. Rose et Blanche, 4 volumes in-12, voilà l’oignon de la tulipe. Imaginez un roman vulgaire, une grisette de province opposée à une religieuse, des scènes à la manière de Paul de Koch. Chose curieuse, ils s’étaient mis à deux, dans le fond d’une mansarde, pour écrire ce conte et, tous deux, dès le lendemain, devaient prendre rang parmi les plus célèbres : une baronne fugitive et un étudiant qui ne devait pas étudier, ce dernier consentant à couper son nom en deux pour le donner à la dame, Survint une brouille, colle de l’adorable fable des Deux Pigeons, et chacun tira de son côté, mais pour ne plus se rapprocher. Par le fait d’un phénomène bizarre, c’était surtout la femme qui était douée du génie viril. Tandis que, cédant à sa nature, Jules Sandeau devenait, par excellence, le romancier des femmes, faisait Madame de Sommerville, Marianna, la Maison de Penarvan et Mademoiselle de la Seiglière, idylles pour les salons, George Sand, qui avait retrouvé, peut-être chez sa grand-mère, la plume de J.-J. Rousseau, son maître, élevait le roman à des hauteurs jusqu’à ce jour inconnues. S’il reste debout des survivants de la grande génération de 1830, ils n’ont pas oublié, après Indiana et Valentine, ces églogues, l’apparition superbe de Lélia, la magique venue de Mauprat, ces compositions aussi grandioses que charmantes et qui, soit au coin du feu, soit au théâtre, ont rempli l’Europe moderne de surprise et d’enchantement. Que dire après un regard jeté sur l’amoncellement de tant de chefs-d’œuvre ? Rien, car il ne reste qu’à s’incliner devant la statue de La Châtre et à admirer.
Eugène Sue, très mauvais écrivain du point de vue du style, fut le plus grand, le plus hardi, le plus fort en ce qui touche les choses de l’invention. Après avoir un peu copié l’Américain du Corsaire rouge en nous faisant de petits récits maritimes, naviguant trop dans l’eau douce, il s’est jeté, un jour, dans la description des enfers sociaux et il a donné alors la chair de poule à trente millions de lecteurs. Dans son audace, il a brisé les vieilles attaches du préjugé en nous révélant un monde horrible de forçats, de filles perdues, d’assassins, de gredins de toute nature, mélange incroyable et pourtant réel dans lequel s’agitent, pâles comme dans les fresques de Michel-Ange, le crime, la vertu, la virginité, le viol, et tous les vices de notre temps, les sept péchés capitaux, toutes les sanies nées de la civilisation. Les Mystères de Paris, le Juif errant, Martin ou l’enfant trouvé, Mathilde et dix autres, c’est un musée de bêtes monstrueuses, et, après cinquante ans, on lit encore tout cela aussi bien chez les gens du peuple que chez les grandes dames.