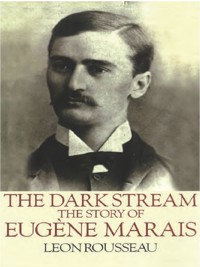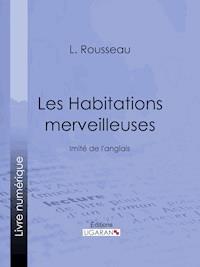
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
Extrait : "Parmi les animaux supérieurs, il s'en trouve un grand nombre qui, parvenus à une certaine période de leur existence, ont besoin d'une habitation, soit comme abri contre le mauvais temps, soit comme lieu de refuge contre les attaques de leurs ennemis. Un terrier creusé sous la terre, dans les bois, dans le roc ou toute autre matière, constitue la forme la plus simple d'une semblable demeure."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’homme. – La taupe et sa demeure. Difficulté de l’observer. Construction compliquée de la forteresse. Naturel de la taupe. – La taupe musaraigne. – La taupe éléphant et le rat musqué. – Le renard arctique et son terrier. – Le renard commun. Économie de travail. – La belette. – Le blaireau. – Le chien des prairies. Le village. Visiteurs importuns. – Le lapin et la garenne. Dévouement. – L’écureuil piauleur. – Le siffleur. – Le rat à abajoues du Canada. – L’ours des mers polaires. Tanière remarquable. La neige comme abri. – Le phichiciago. – Les tatous. – L’échidné.
Parmi les animaux supérieurs, il s’en trouve un grand nombre qui, parvenus à une certaine période de leur existence, ont besoin d’une habitation, soit comme abri contre le mauvais temps, soit comme lieu de refuge contre les attaques de leurs ennemis. Un terrier creusé sous la terre, dans le bois, dans le roc ou toute autre matière, constitue la forme la plus simple d’une semblable demeure. Les races les moins développées de l’espèce humaine, telles que les Bojesmans du Cap et les Indiens « creuseurs » de l’Amérique, emploient cet expédient. Souvent une caverne suffit aux besoins de ces êtres ignorant toute industrie et dont les efforts se bornent à la satisfaction d’appétits grossiers ; mais à cette demeure ne se rattache aucun souvenir domestique ; ni les joies ni les douleurs de la famille ne la sanctifient, et l’être abject, qui s’y livre au sommeil ou s’y abrite dans la mauvaise saison, ne connaît aucun de ces sentiments qui, dès l’antiquité, ont fait du foyer un sanctuaire inviolable. Notre but n’étant pas de nous occuper des demeures de l’homme, nous passons aux habitations construites sans mains, avec les pattes, les griffes ou le bec. C’est l’instinct et non la raison qui en fournit le plan ; l’architecte s’y montre à la hauteur de sa tâche, mais il ne saura jamais apporter la moindre amélioration à son travail.
La première place, parmi les mammifères, revient de droit à la taupe. Cette remarquable bête creuse non seulement des galeries sous le sol, mais elle se crée un refuge compliqué de chambres, de conduits dont l’agencement est merveilleusement complet. Elle y établit un système de communications aussi perfectionné qu’un réseau de chemins de fer ou que la canalisation souterraine d’une grande ville. Elle possède de nombreux talents : assez rapide à la course, d’un courage de bouledogue, elle ne manque jamais sa proie ; elle nage sans crainte et, s’il le faut, creuse un puits pour apaiser sa soif. Le peu que nous connaissons de ses habitudes fait penser qu’une étude plus approfondie nous réserve d’intéressants détails.
J’ai souvent observé la taupe, du moins autant que me l’ont permis des circonstances défavorables ; car il s’agit d’un animal dont la vraie nature ne se développe que sous terre ; par conséquent, en dehors de notre vue. Il est difficile de prendre une taupe sans lui faire de mal, et, en cas de réussite sa conservation exige beaucoup de patience et de persévérance. Il faut être levé avec le jour pour lui procurer une nourriture convenable. La taupe est, malgré un air lourd et sombre, un animal des plus actifs et des plus féroces. Elle possède à un si haut degré ces deux particularités, que je doute que les bêtes les plus sauvages des tropiques puissent l’égaler sous ce rapport. Ne la plaignons pas, si sa vie nous paraît triste et monotone. Il ne faut pas juger les autres d’après nous-mêmes. La taupe se trouve heureuse sous terre ; là seulement, elle peut développer ses diverses capacités : remarquons l’ardeur avec laquelle elle saisit sa proie ; comme elle jouit en dévorant un malheureux ver ! Elle y trouve évidemment un bonheur complet.
Nous ignorons comment, en travaillant dans l’obscurité, elle parvient à faire des galeries en ligne parfaitement droite ; celles-ci ne sont pas construites au hasard, mais d’après un plan bien défini. Les taupinières si communes de nos champs n’offrent rien de remarquable ; ce sont des puits par lesquels le mineur quadrupède rejette la terre, lorsqu’il fait passer des tunnels sous le sol. En les ouvrant avec précaution, quand la pluie a consolidé la terre meuble, on y découvre un trou conduisant à une galerie. Ouvrons une des plus importantes de celles-ci, comme nous l’apprendra un bon chasseur de taupes, et suivons-la jusqu’à ce que nous ayons atteint la véritable demeure de la bête. Le monticule qui la recouvre est assez grand ; un arbre ou un buisson la cache ordinairement et il faut un œil bien exercé pour le découvrir.
L’appartement central ou la forteresse, s’il est permis de parler ainsi, consiste en une chambre à peu près sphérique, dont le plafond atteint presque le niveau du sol ; par conséquent elle se trouve à une assez grande profondeur du sommet du monticule. Deux passages circulaires entourent la forteresse ; l’un est tracé au niveau de la voûte, l’autre un peu au-dessus ; ce dernier est toujours d’une dimension beaucoup moindre. Cinq boyaux en pente les réunissent, mais l’entrée dans la forteresse ne peut se faire qu’en partant du passage supérieur au moyen de trois boyaux. Il est donc évident que lorsque la taupe rentre chez elle par un de ses nombreux tunnels, elle doit d’abord atteindre le passage inférieur, puis remonter dans l’autre pour redescendre dans le réduit central. Cependant il existe un autre chemin : une galerie plongeant du centre de la forteresse remonte en ligne courbe vers un des tunnels ou grandes routes, comme on les appelle. Celles-ci, au nombre de sept ou huit, rayonnent dans différentes directions, mais ne débouchent jamais vis-à-vis d’une des ouvertures du passage supérieur. Pour se rendre à ce dernier, la taupe doit nécessairement, dès son entrée dans son domicile, tourner à droite ou à gauche.
Les continuelles allées et venues de la bête donnent du poli aux parois du terrier et les durcissent tellement qu’il n’y a jamais d’éboulement, même dans les plus mauvais temps. La complication de ce réseau de voies a sans doute pour objet d’offrir, en cas de danger, de nombreuses facilités pour la fuite. Nous ignorons si la pièce centrale sert uniquement de lieu de repos ou si la taupe couche aussi sur ses grandes routes. Les chasseurs de taupes prétendent que ces plantigrades travaillent et se reposent à des intervalles réguliers de trois heures. L’habitation que nous venons de décrire est parfaitement appropriée à un solitaire, mais ne saurait convenir à une famille. Pour la compléter, la taupe choisit un endroit où deux galeries se croisent et y construit une chambre pour la mère et les petits. Cette disposition offre à ceux-ci plusieurs moyens de s’échapper en cas de danger. Ce lieu est tapissé d’herbes sèches et quelquefois de jeune blé, ordinairement il se trouve assez loin de la forteresse centrale.
Vers le milieu de juin ou vers les premiers jours de juillet commence pour les taupes la saison des amours ; dans cette phase de leur existence, elles déploient une furie semblable à celle qui les caractérise en tout. Deux mâles ne peuvent, à cette époque, se rencontrer sans s’attaquer immédiatement. Ils se griffent, se mordent, se déchirent avec une rage tellement aveugle, que, lorsque le combat se livre en plein air, il est aisé de s’emparer d’eux. On prétend qu’avant d’avaler un ver, la taupe le dépouille de sa peau. Il serait difficile de comprendre comment elle peut accomplir cette opération, toutes celles que j’ai observées se contentaient d’avaler leur victime sans aucune préparation préliminaire. Rien ne donne une idée de la furie avec laquelle mange la taupe : elle s’arc-boute d’une singulière façon, rentre la tête entre les épaules, et se sert des pattes de devant pour fourrer le ver dans sa bouche. Je ne m’explique pas comment elle peut prendre cette position ; toutefois je l’ai souvent étudiée ainsi. En la voyant manger je comprends facilement la fureur qui doit l’animer dans les combats et je veux bien croire l’assertion selon laquelle on l’aurait vue se jeter sur un petit oiseau, l’éventrer et l’avaler tout palpitant. Il ne fallait rien moins que cet excès d’ardeur pour aider la bête à se frayer un chemin sous la terre. D’après cela, on concevra ce que doit être un combat entre deux mâles d’égale force ; deux lions n’offriraient pas un spectacle moins terrible, car la taupe est relativement plus puissante et possède des instruments de défense plus terribles.
Grossissez la taupe de façon à lui donner le volume du lion et vous aurez l’animal le plus féroce que la terre ait porté. Quoique incapable, à cause de ses yeux si défectueux, de poursuivre sa proie à la vue, elle s’élancerait sur elle par bonds prodigieux, la terrasserait et la déchirerait en morceaux. Un pareil monstre avalerait des serpents de vingt pieds de long ; encore en faudrait-il vingt ou trente par jour pour satisfaire sa voracité. D’un coup de griffe il abattrait un bœuf, et la rencontre avec un de ses semblables deviendrait le signal d’une lutte horrible. La taupe ne connaît pas la crainte et dans ses combats paraît ne pas ressentir les blessures qu’elle reçoit, tant une rage aveugle l’anime.
Le lecteur appréciera maintenant l’énergie extraordinaire de la taupe, ainsi que les merveilleux instincts dont elle est douée. Il admirera la force musculaire concentrée dans de si étroites limites, car un de ces monticules, que la taupe élève si rapidement, équivaut, toute proportion gardée, à un amas de terre ayant quatre mètres de hauteur et environ sept mètres de circonférence qu’un homme aurait fait avec la bêche.
On s’étonne de voir les mammifères sortir de dessous terre sans la moindre souillure à leur robe. Cette particularité est due, chez la taupe, à la nature de son poil et de sa peau. Le premier, si remarquable par son aspect velouté, ne prend aucune direction déterminée, fait que le microscope nous explique. Le poil est, à sa sortie de la peau, d’une finesse extrême et grossit par degrés ; après avoir atteint un certain volume, il diminue de nouveau. Cette alternative de ténuité et de grosseur se répétant plusieurs fois lui donne le tissu velouté que tout le monde connaît. Une seconde cause de la propreté de la fourrure se trouve dans un muscle très fort, bien que membraneux, placé sous la peau. Pendant le travail de l’excavation, de la terre tombe sur le poil et y adhère, mais la taupe la rejette de temps en temps au moyen d’une forte secousse. Je dirai ici que cette bête émet une odeur peu agréable que j’ai vue persister dans des peaux préparées depuis dix ans.
La taupe se trouve admirablement adaptée aux conditions de son existence ; de tous les animaux terriers, c’est elle qui déploie le plus d’activité musculaire et d’ardeur au travail. Elle en est le type ! Elle passe à travers le sol presque aussi facilement que le poisson fend l’eau, et sa vie, en apparence si triste, ne manque pas d’un intérêt poétique qui fait défaut à beaucoup d’animaux doués d’un extérieur plus brillant.
Que le lecteur se procure un squelette de taupe et il comprendra mieux l’organisation qui produit d’aussi énergiques efforts. D’énormes omoplates se projetant bien au-dessus de l’épine dorsale, des jambes de devant à os courts et forts, de larges attaches, des griffes solides et courbées donnent l’idée du modèle en miniature de quelque machine destinée à fendre un sol rebelle. Toute la force se concentre dans le train de devant ; celui de derrière est relativement faible ; de formidables muscles forment le cou. Le nez est pourvu d’un os accessoire se prolongeant jusqu’au museau et qui lui donne cette mobilité si remarquable chez la taupe. Le museau est, immédiatement après la mort, flexible et se redresse avec l’élasticité de la gomme, mais il perd cette qualité en quelques heures et se dessèche. Afin de donner plus de puissance et de développement aux pattes de devant, celles-ci ont aussi un os accessoire, ressemblant à une faux et qui sort du corps. Cette particularité ne s’observe de nos jours que chez la taupe, mais elle se rencontre chez plusieurs espèces d’animaux fossiles.
J’ai longuement parlé de la taupe à cause de l’intérêt qu’elle offre. Si elle était un animal rare de la zone tropicale, les savants auraient depuis longtemps étudié son squelette. On se serait empressé d’admirer sa fourrure veloutée, ses yeux couverts et enfoncés pour que la terre n’y touche pas, la flexibilité du museau, l’étrange mélange de force et de mollesse des pattes de devant. Mais parce que cet animal habite notre pays et se trouve un peu dans chaque champ, on s’en détourne avec indifférence sans se soucier d’étudier ses habitudes. Pour ma part, je suis heureux que d’aussi merveilleuses créatures soient inconnues et nous fournissent l’occasion d’admirer la sagesse de Celui qui a créé l’humble taupe avec autant de soin que l’homme orgueilleux.
Beaucoup d’animaux terriers sont alliés à la taupe. Je n’en citerai que quelques-uns. Les musaraignes, par exemple, appartiennent à cette classe. Bien qu’elles aient les yeux ronds et pleins, les pieds de devant de la forme ordinaire, il y a quelque chose dans la tête, dans l’élasticité de leur long museau mobile qui rappelle la taupe. Ces jolies petites bêtes ne quittent leur terrier que pendant la nuit. Leur nid, fait d’herbes sèches, se trouve tout au fond.
La musaraigne-taupe de l’Amérique du Nord le cède à peine à la taupe dans son talent à fouiller le sol. Elle aussi soulève la terre à intervalles et se nourrit principalement de vers. Il y a encore la musaraigne-éléphant de l’Afrique méridionale, à fourrure épaisse, à long museau et à courtes oreilles. Elle creuse d’abord une galerie perpendiculaire, puis une seconde à angle droit au bout de laquelle se trouve le réduit. Elle est moins que les autres espèces adonnée à une existence souterraine et aime à se chauffer au soleil.
Le rat musqué appartient aussi à la famille des musaraignes. Il fréquente surtout les bords du Volga, et, semblable au castor, se tient plus souvent dans l’eau que sur la terre ferme. Les galeries qu’il construit s’étendent quelquefois à une distance de sept mètres. Il n’y a jamais qu’une seule entrée qui se trouve toujours sous l’eau. Le terrier monte par degrés, de façon que l’extrémité où repose l’animal est bien au-dessus du niveau de l’eau. Le rat musqué est très recherché pour le musc qu’il fournit, bien que celui-ci soit inférieur au musc du chevrotin porte-musc.
Le renard appartient aussi aux mammifères. Nous avons vu la taupe pourvue de membres spécialement faits pour fouir, mais qui n’excluent pas une certaine vitesse de locomotion ; ceux du renard, au contraire, sont appropriés à une course rapide, tout en restant propres à faire d’assez grandes excavations.
Le renard arctique, pour échapper aux rigueurs du froid, creuse son terrier à une grande profondeur. Vingt à trente de ces animaux s’établissent à proximité les uns des autres. Si l’on pouvait mettre à découvert une telle colonie, on serait témoin d’un singulier spectacle : le sol semblerait percé d’une infinité de galeries, chaque terrier en possède trois ou quatre qui conduisent à un réduit assez grand, sans qu’aucune d’elles communique avec le terrier d’un autre renard. Une seconde cavité de moindre dimension, et reliée à la première par un conduit, sert de refuge aux petits que la mère y met bas, au nombre de cinq ou six. Chaque terrier renferme d’abondantes provisions. Le renard possède une grande intelligence, quoique les premiers voyageurs arctiques aient dit le contraire, et cela parce qu’ils l’attrapaient sans aucune difficulté : il suffisait d’un piège grossier pour en prendre jusqu’à quinze dans l’espace de quelques heures. Des explorateurs subséquents ont émis une tout autre opinion ; cela s’explique aisément. Avant l’arrivée des Européens, le renard était rarement attaqué et devenait facilement la victime des premiers chasseurs. Depuis, comme tout animal poursuivi, il a appris la ruse et se méfie de tout engin suspect. Il n’est même pas rare maintenant de le voir s’emparer de l’appât sans se laisser prendre, tant une poursuite acharnée l’a rendu fin et prudent. On le recherche à cause de sa fourrure, qui, surtout lorsqu’elle a été blanchie jusqu’à la racine des poils par le froid effrayant de ces régions, atteint un prix exorbitant. La chair du renardeau est bonne à manger ; celle du renard est dure, coriace et a une odeur extrêmement désagréable ; l’eau dans laquelle elle a bouilli fait venir par son âcreté des boutons dans la bouche.
Le renard commun de nos pays se construit une demeure beaucoup moins compliquée et même, pour s’épargner toute peine, il s’empare du terrier d’un blaireau ou d’un clapier de lapin. Dans ce dernier cas, il suffit de quelques efforts pour approprier le logis à sa taille et à ses besoins. S’il n’a pas la chance de rencontrer une demeure toute faite, il se met résolument à l’œuvre et se creuse un terrier. Il y dort la journée entière et n’en sort que la nuit, pour chercher sa nourriture. Les mères y mettent bas leurs petits et quelquefois, par une belle soirée d’été, toute la famille se prélasse à l’entrée du refuge sans oser beaucoup s’éloigner. Les renardeaux sont de jolies petites créatures, aimant à jouer autant que les enfants ; dans ces occasions la renarde se prête complaisamment et en bonne mère à tous leurs ébats. Un vieux renard, qu’on a déjà chassé, connaît dans un rayon de quatre ou cinq lieues, toutes les cavités qui peuvent lui offrir une retraite sûre.
Les loutres, selon moi, ne fouissent pas : certaines excavations sur le bord des rivières leur servent, il est vrai, de refuge en cas de poursuite et pour y mettre bas leurs petits ; mais, ce sont là des terriers naturels. La belette ne creuse pas non plus ; elle habite des fentes de rochers, sous les racines noueuses des vieux arbres et surtout dans des tas de pierres. Un seul membre de cette famille est un puissant fouisseur, c’est le blaireau. Il se construit un terrier sombre et tortueux, généralement dans un fourré ou au fond d’une forêt. Il y a plusieurs chambres, dont l’une, tapissée d’herbes et de mousses, reçoit les petits à leur naissance. La conformation des membres du blaireau, l’aide non seulement à se bâtir un domicile inviolable, mais aussi elle lui permet de se procurer une nourriture dont il est très friand. Il est, pour ainsi dire, omnivore ; toutefois il manifeste un goût très prononcé pour les insectes à l’état de larves, et pour le satisfaire il cherche sous terre les nids de guêpes et d’autres hyménoptères.
La classification exacte des animaux, d’après leurs demeures, offre de grandes difficultés, car beaucoup d’entre eux possèdent des caractères qui pourraient les faire ranger dans plusieurs catégories. Les lapins, par exemple, peuvent être considérés comme des mammifères ou comme des animaux vivant en société ; il en est de même de la guêpe, du bourdon et de beaucoup d’autres insectes.
Le chien des prairies présente les mêmes caractères que le lapin. Étudions-le comme animal fouisseur. On l’appelle quelquefois Wish-tom-Wish en Amérique, mais il est plus connu sous sa première dénomination, bien qu’il n’appartienne pas aux carnivores, mais aux rongeurs. Ce nom lui vient d’un petit cri qu’il aime à pousser et qui ressemble au glapissement d’un jeune chien. C’est un assez joli animal, mesurant environ quarante centimètres et de forme arrondie. La tête, très aplatie, lui donne un air singulier ; sa fourrure est d’un gris rougeâtre, son aspect général est d’ailleurs assez semblable à celui de son congénère, la marmotte des Alpes. Il paraît s’apprivoiser facilement, à en juger par les deux spécimens que possède le jardin zoologique de Londres ; tous les deux, surtout le mâle, montrent beaucoup d’attachement à celui qui a soin d’eux. En dépit d’ennemis formidables qui viennent se loger au fond même de sa retraite, le chien des prairies se propage d’une façon incroyable ; sa fécondité semble sans bornes, et lorsqu’il est établi dans une région favorable, on voit les monticules de terre, placés à l’entrée de chaque terrier, s’étendre à perte de vue.
Les terriers sont d’une dimension considérable et pénètrent à une grande profondeur. Ils prennent d’abord une direction oblique à un angle de 45 degrés ; puis, à une distance de deux mètres, ils s’infléchissent brusquement, en remontant vers le sol. Une cité ou un village de chiens, comme on les appelle, présente un spectacle très intéressant, si le voyageur s’approche avec précaution, car ces petits animaux s’effarouchent facilement. Toutefois leur curiosité est très grande et ils la paient souvent de leur vie. Perché sur un des monticules dont nous avons déjà parlé, le chien des prairies embrasse une grande partie de l’horizon, et dès qu’il aperçoit un intrus, il disparaît dans son terrier en jetant un glapissement aigu. Tous ses concitoyens répètent le cri d’alarme et s’élancent dans leur refuge. Bientôt la curiosité l’emporte sur la prudence : de petites têtes se montrent et lancent des regards furtifs vers la cause de ce tumulte. Un tireur habile peut alors les tirer en visant la tête, car la vie est chez eux très tenace et ce n’est qu’en fracassant, pour ainsi dire, cette partie de leur corps qu’on est certain de ne pas les voir s’échapper sous terre.
Le chien des prairies ne jouit pas tout seul de sa demeure ; le hibou fouisseur, appelé aussi hibou coquimbo et le terrible serpent à sonnettes s’emparent forcément de son domicile et en dévorent les habitants. Ce fait est certain quant au serpent à sonnettes, dans l’estomac duquel on a trouvé des preuves irréfragables. Peut-être le hibou ne s’attaque-t-il qu’aux petits.
Le lapin est un des mammifères les mieux connus de nos pays. La famille de ce rongeur se compose de nombreuses variétés, qui pourraient passer pour de nouvelles espèces si elles ne montraient pas une tendance à retourner vers l’origine commune, c’est-à-dire au poil court et brun, aux oreilles droites du lapin sauvage. Ces animaux vivent dans des terriers et en société ; on a donné le nom de garenne à une agglomération considérable de ces demeures. Partout où ils rencontrent un gîte tranquille, un sol sablonneux et la nourriture à proximité, les lapins s’établissent. Ils y creusent de nombreuses galeries et se reproduisent avec une fertilité incroyable. Il en résulterait une véritable plaie, si leur chair et leur peau ne les faisaient pas rechercher et si les fouines, les belettes et les éperviers ne donnaient la chasse aux lapereaux. Il est très difficile de les faire disparaître d’un terrain où ils ont élu domicile, même en se servant de fusils, de furets et de filets. Si deux ou trois de ces animaux, de sexe différent, parviennent à s’échapper, l’armée de lapins se trouve bien vite reconstituée, car le lapin peut déjà, à l’âge d’un an, se voir entouré de ses petits-fils.
La femelle ne met jamais bas dans aucun des terriers que toute la colonie fréquente. Elle se prépare un conduit isolé au bout duquel elle fait un nid. Celui-ci, composé surtout de duvet qu’elle s’arrache de la poitrine, fournit aux petits une couche des plus moelleuses. Quelques auteurs ont voulu voir dans ce fait un sacrifice maternel : grande erreur à mon avis ; en se dépouillant de sa fourrure, l’animal obéit à son instinct et n’accomplit nullement un acte de dévouement.
L’Amérique du Nord possède un grand nombre d’animaux terriers de cet ordre. À défaut d’espace, nous n’en citerons que quelques-uns. Parmi ceux-là, on distingue surtout le hackée ou écureuil piauleur, ainsi nommé à cause de son cri. C’est une jolie petite bête d’un gris brunâtre, ayant sur le dos cinq raies noires et deux d’un jaune pâle. Le ventre et le dessous du cou sont d’un blanc de neige. Son terrier est assez compliqué : la principale galerie descend presque perpendiculairement l’espace d’à peu près un mètre, puis s’infléchit à plusieurs reprises dans une direction légèrement ascendante. Deux ou trois galeries supplémentaires, partant du terrier principal, permettent à l’écureuil piauleur d’échapper à ses ennemis. La fouine seule ne se laisse pas tromper par cette complication de tunnels ; elle glisse son corps ténu à travers les passages les plus contournés et tue tout ce qu’elle rencontre.
Cette espèce entasse dans des galeries latérales des provisions en très grande quantité : on a trouvé dans un seul terrier du blé, du sarrazin, du maïs, des semences de graminées, des glands et des noisettes.
Le siffleur est très connu en Amérique. Son terrier mesure de huit à dix mètres à partir de l’entrée qui se trouve toujours abritée par une saillie de rocher ou pratiquée au flanc d’une colline. Le souterrain descend obliquement pendant quelques pieds pour remonter ensuite vers la surface ; à l’extrémité se trouve un grand réduit circulaire où naissent les petits. Ces derniers se séparent à l’âge de cinq mois et chacun se creuse une demeure indépendante. Le nom de ces animaux leur vient d’un petit sifflement qu’ils poussent sans cesse. Les jeunes garçons de l’Amérique du Nord aiment beaucoup à aller à la chasse des siffleurs et à les déterrer.
Le rat à abajoues du Canada, quelquefois appelé gopher ou mulot, creuse de très grands terriers. Lorsqu’il s’est établi dans un jardin, il cause de grands dommages à toute espèce de plantes et fait même mourir des arbres fruitiers, car il ronge les racines qui traversent son terrier. Du réduit où naissent les petits, rayonnent dans différentes directions plusieurs galeries latérales. L’animal semble avoir multiplié les moyens de fuite. Ce rat a plus de trente centimètres de long et se fait remarquer par le grand développement des incisives qui se projettent au-delà des lèvres ; il est aussi caractérisé par les dimensions considérables des abajoues. Celles-ci mesurent environ dix centimètres et s’étendent jusqu’aux épaules.
Le rat camas est un fouisseur infatigable, creusant ses galeries près de la surface du sol et relevant, comme la taupe, des monticules sur son chemin. Il vit en petites communautés. Son nom dérive de sa nourriture principale, la racine quamash.
Les voyageurs des régions septentrionales disent qu’on ne doit pas craindre de mourir de froid dans la neige. Ils sauront plaindre la victime, mais ils souriront de son ignorance. C’est folie, selon eux, que de périr de froid quand le calorique abonde. Le voyageur, surpris par la tourmente, voyant tomber la neige en masses épaisses, n’a pas besoin d’avoir le corps endurci du montagnard écossais. S’il sait mettre à profit les moyens qui l’entourent de toutes parts, il saluera avec joie chaque flocon qui tombe. Choisissant un endroit où la neige s’est amoncelée, il s’y creuse, avec les mains, un réduit ; enveloppé de ses vêtements, il s’y couche et s’y enfonce tant qu’il peut, sans se soucier de la neige qui commence à l’ensevelir. La cellule improvisée ne tarde pas à montrer ses vertus. La substance qui la compose étant un mauvais conducteur de la chaleur le vent ne l’enlève plus, elle est alors conservée et le voyageur sent renaître la vie dans ses membres engourdis. À mesure que le corps s’échauffe, le réduit se creuse davantage ; l’hôte de ce singulier gîte s’enfonce plus profondément dans la neige, tandis que celle-ci continue à le couvrir en masse épaisse et à effacer toute trace de sa présence.
Il n’est pas à craindre qu’il étouffe faute d’air, la chaleur de son haleine tient ouvert un étroit passage à l’orifice duquel elle se condense en aiguilles étincelantes. Le froid est encore moins à redouter ; l’abri devient plutôt trop chaud, et le voyageur y peut dormir aussi tranquillement que dans son lit. Même dans les Îles Britanniques, chaque hiver on emploie cet expédient. Dans les Highlands, lorsque la neige s’amoncèle en formes fantastiques, au souffle d’un vent impétueux, des troupeaux entiers de moutons disparaissent quelquefois ; alors le berger, suivi de son fidèle compagnon, se met à leur recherche ; il marche au hasard, car le paysage si familier est comme enseveli sous un vaste linceul, et, livré à ses propres ressources, il ne réussirait pas dans sa poursuite. Mais le chien, doué d’un merveilleux instinct, court dans toutes les directions ; levant la tête, il renifle l’air et tout à coup s’élance en avant ; il a senti l’odeur si connue, et s’arrête à une petite ouverture qui se fait jour dans la neige et où brille une incrustation de givre, indice certain que les moutons s’y trouvent et qu’ils sont encore vivants. Ces bêtes ne se sont pas volontairement creusé un abri dans la neige ; pour éviter les rafales glacées, elles se sont réfugiées près de quelque objet qui put les abriter, et serrées, les unes contre les autres, elles ont été ensevelies sous la neige. Lorsque, dans de pareilles circonstances, on laisse un troupeau trop longtemps sans secours, il périt faute de nourriture.
C’est avec intention que l’ours femelle des mers polaires se place dans une semblable position. Vers le mois de décembre, se retirant près d’un rocher, elle creuse un peu la neige, se couche et bientôt disparaît ensevelie sous les flocons. Elle attend dans cette singulière retraite le moment de mettre bas, et continue d’y résider avec ses petits jusqu’au mois de mars. À cette époque, elle se dégage et revient au jour en compagnie des oursons ; ceux-ci ont alors la taille d’un lapin ordinaire. À mesure qu’ils se développaient sous la neige, leur cellule s’agrandissait sous l’influence de la chaleur animale. Il n’y a parmi les ours des régions arctiques que les femelles pleines qui choisissent une semblable retraite. Avant de prendre ses quartiers d’hiver, elle a mangé énormément et est devenue excessivement grasse. Bien que les oursons soient remarquablement petits, si on les compare à la mère, il n’est pas moins étonnant que celle-ci puisse accumuler sur elle assez de graisse pour maintenir, pendant trois mois, sa propre existence et allaiter sa progéniture sans absorber la moindre nourriture.
Nous ne pouvons dans un ouvrage de cette nature oublier le phichiciago. Cet animal est de la grosseur de la taupe à qui il ressemble par ses habitudes. L’inspection de son squelette indique suffisamment sa nature de mammifère. Les os des jambes de devant sont courts, gros et arqués, indice d’une grande force musculaire ; les pattes de devant sont énormes, en forme de mains et garnies de cinq fortes griffes courbées. Le museau est long et pointu ; comme chez la taupe, les yeux, très petits, disparaissent sous une épaisse fourrure.
Le phichiciago habite le Chili ; il vit sous terre où il se creuse de longues galeries, et comme tous les édentés, se nourrit probablement d’insectes. Ce qui le distingue surtout, c’est une cuirasse de lames cornées et carrées. Elle n’est fixée que le long de l’épine dorsale et au sommet de la tête ; elle descend brusquement, à l’insertion de la queue, en forme de tablier et protège efficacement le train de derrière contre toute attaque, lorsque l’animal est occupé à fouir. Cette cuirasse possède la flexibilité d’une cotte de mailles d’autrefois ; elle se prête à tout mouvement. Un pelage jaunâtre recouvre le reste du corps.
Les tatous habitent l’Amérique du Sud ; ils passent le jour dans des terriers et n’en sortent que la nuit. Leurs réduits ont environ cinq mètres de long ; ils descendent d’abord en pente rapide, puis s’infléchissant brusquement, ils remontent vers le sol. Tous portent une cuirasse ; la construction de leurs membres de devant les rend propres à creuser sous terre, où ils trouvent une grande partie de leur nourriture. On a même vu le tatou géant déterrer des corps et s’en nourrir. La cuirasse des tatous est tellement dure, que les gauchos y aiguisent leur long couteau espagnol. Il n’est pas aisé de surprendre ces animaux dans leur terrier : on enfonce d’abord un bâton dans le trou ; s’il en sort des moustiques, c’est que l’animal est chez lui ; sinon, inutile de prolonger les recherches. Certain de la présence du tatou, on enfonce dans le terrier une longue perche ; à l’extrémité de celle-ci, on creuse dans le sol un trou qui sert de nouveau point de départ ; à force de renouveler ce procédé on parvient jusqu’au tatou. Il faut de grandes précautions pour le saisir, car ses griffes sont des armes redoutables. La cuirasse, si dure et si roide chez les spécimens empaillés, jouit comme chez le phichiciago d’une grande flexibilité, au point de permettre à l’animal, en cas de danger, de se rouler en forme de boule.
Un autre fouisseur très curieux, l’aard-vark de l’Afrique méridionale habite de grandes excavations qu’il fait dans le sol. Son nom, qui est hollandais, veut dire cochon de terre ; il lui a été donné à cause de la forme porcine de sa tête et pour caractériser ses habitudes. Les griffes de cet animal sont énormes et parfaitement adaptées à leur emploi, car elles ne servent pas unique ment à creuser une terre meuble ou sablonneuse Armé de ces outils, l’aard-vark démolit les immenses fourmilières des plaines de l’Afrique, édifices qui semblent être construits de pierres plutôt que de boue et dont le sommet peut supporter le poids de plusieurs hommes. Vers le soir l’aard-vark quitte la retraite où il a dormi toute la journée et se met à la recherche d’une fourmilière. Lorsqu’il en a trouvé une, il y pratique aisément une ouverture au moyen de ses grilles ; les habitantes consternées, voyant leur maison ébranlée comme par un tremblement de terre, s’enfuient dans toutes les directions, mais l’assaillant, dardant au milieu d’elles une longue langue gluante les prend par centaines à la fois. Une fourmilière ainsi dévastée devient un refuge pour les chacals et autres bêtes de proie, ainsi que pour quelques variétés de serpents. Les Caffres y mettent souvent leurs morts. Les excavations de l’aard-vark sont assez profondes pour culbuter une charrette si la roue y pénètre et pour abattre la monture du chasseur qui aurait l’imprudence d’y poser le pied.
Deux grandes îles, dont l’une doit être, à cause de son importance, classée parmi les continents, se distinguent par le caractère bizarre de leur faune. Arrive-t-il en Europe un animal plus singulier que de coutume, on peut, en toute assurance, le supposer originaire de Madagascar ou de l’Australie. Les deux animaux dont nous allons parler appartiennent à ce dernier pays.
L’ornithorynque ou mallangong des indigènes est un être unique dans son espèce. À le regarder, on ne dirait pas que c’est un mammifère et cependant il se construit une retraite souterraine d’une assez grande dimension. La large membrane qui s’étend entre les griffes de l’animal, soit à la nage, soit à la marche, se replie quand il creuse et l’aide à rejeter les déblais. Son corps arrondi, sur lequel la peau pend en larges plis, est fait pour parcourir des galeries souterraines, et sa singulière fourrure convient parfaitement à un animal qui vit tantôt sous terre, tantôt dans l’eau : sur la peau se trouve une épaisse fourrure de nature laineuse à travers laquelle sortent de longs poils très minces à la base et qui, comme ceux de la taupe, ne prennent aucune direction particulière. Les yeux sont assez grands, un singulier rebord, pendant, pareil à du cuir et qui contourne la base des mandibules, empêche la terre d’y tomber. Cet appendice sert aussi probablement à empêcher le bec de pénétrer trop en avant, lorsque l’animal l’enfonce dans la vase, en quête de nourriture.
Les spécimens de nos musées ne donnent pas une idée correcte des mandibules si remarquables et pareilles à celles du canard. Elles sont noires, racornies et semblent découpées dans du cuir, tandis qu’elles sont, chez l’animal en vie, pleines et arrondies. La mandibule supérieure est alors d’un gris foncé, parsemé de points noirs et couleur de chair en dessous. L’autre est d’un rose pâle et quelquefois même blanche. L’ornithorynque construit son terrier dans le terrain qui borde un cours d’eau ; il y a toujours deux entrées, l’une au-dessus de la surface de l’eau, l’autre au-dessous. La première se cache sous des plantes à feuilles tombantes ; en les écartant, on voit un trou de moyenne grandeur sur les bords duquel se trouvent les empreintes des pattes de l’animal ; à l’inspection de ces dernières, les indigènes jugent si la bête est récemment rentrée dans son repaire. À partir de l’entrée le terrier pénètre, en faisant beaucoup de détours, à une profondeur de huit à dix mètres et même quelquefois de plus de dix-huit. Il se peut que les sinuosités du souterrain soient dues à des obstacles, tels que des pierres ou des racines, que l’animal rencontre dans ses fouilles, et qu’il est forcé de contourner, car les différents terriers ne se ressemblent nullement sous le rapport des détours. À l’extrémité supérieure du conduit est placé le nid, formé par une excavation ovale beaucoup plus large que les autres parties du réduit. Elle est tapissée d’herbes et de mousses ; l’ornithorynque y met bas ses petits, généralement au nombre de deux ; cependant on en a trouvé jusqu’à quatre dans le même nid. L’existence de l’ornithorynque se passe, comme celle du rat musqué dont nous avons parlé plus haut, moitié dans l’eau, moitié sous terre. Lorsqu’il nage, il ressemble plutôt à un amas d’herbes flottantes qu’à une créature vivante.
L’Australie produit un autre animal bizarre très remarquable par ses facultés de creuser le sol. C’est le porc-épic fourmilier ou l’échidné, de l’ordre des monotrèmes. En dépit de son faible volume, il sait se frayer un chemin à travers des terrains très résistants et arracher de grosses pierres, pourvu qu’il s’y trouve une crevasse où il puisse insérer une patte. C’est pour cela qu’il est si difficile à garder en captivité ; toutefois on voit actuellement deux porcs-épics fourmiliers au jardin zoologique de Londres. Quand cet animal est poursuivi en rase campagne, il s’arc-boute, ramasse sous lui ses jambes et grattant la terre avec furie disparaît bientôt à la vue. Si la nature du sol s’oppose à ce genre de fuite, il se roule en boule, comme le hérisson, et défie ses ennemis. Ses pattes sont non seulement d’excellents outils pour creuser, mais aussi elles ont une telle prise sur une planche même unie qu’on ne peut les en détacher qu’avec peine ; on n’y parvient qu’en saisissant vigoureusement une jambe de derrière, le reste du corps étant défendu par des piquants. Le mâle porte aux pattes de derrière un grand ergot perforé à travers lequel une glande assez grosse sécrète un liquide ; la même particularité se remarque chez l’ornithorynque. Cette arme si redoutable en apparence semble être parfaitement inoffensive, car on n’a jamais vu aucun de ces animaux en faire usage.
L’hirondelle de rivage. Forme de sa demeure. Ses ennemis. – Le martin-pêcheur. Nid et œufs. – Le macareux des îles Færoë. – Le guêpier. – L’oiseau des tempêtes. Manière de nourrir ses petits. Mauvaise odeur de son nid. – Les pies. – Les pies d’Amérique. – Le torcol. – L’étourneau. Sa sociabilité – Le grimpereau. – Le casse-noisette et la huppe. Singulier nid de la huppe. – Le toucan. Son bec.
L’hirondelle de rivage si abondante dans notre pays, nous fournit un des meilleurs échantillons d’oiseaux terriers. En remarquant son bec si délicat, on ne la supposerait pas capable de perforer un grès assez dur. Il en est cependant ainsi ; toutefois l’oiseau choisira de préférence un sol meuble, mais offrant assez de consistance pour qu’il n’y ait aucun danger d’éboulement. À défaut d’une localité de ce genre, l’hirondelle de rivage ne se met pas moins résolument à l’œuvre : se servant de ses pattes comme d’un pivot, elle tourne continuellement en rond et bientôt finit par pratiquer, à coups de bec, un trou presque circulaire dans le grès. Le passage incessant des oiseaux en déforme peu à peu l’entrée, mais lorsque le terrier vient d’être construit, son aspect est presque cylindrique. Afin d’empêcher l’eau de la pluie d’y séjourner, le tunnel remonte invariablement en pente douce, à une profondeur d’environ quatre-vingts centimètres. Il se dirige ordinairement en ligne droite, à moins que quelque obstacle, tel qu’une pierre ou une racine, n’oblige l’oiseau à le tourner. Si la pierre est très grande, l’hirondelle renonce à son travail et va le recommencer ailleurs. On voit souvent dans le grès dur de ces terriers à moitié achevés, puis abandonnés. Le tunnel s’élargit à son extrémité pour recevoir le nid, construction très simple composée de plumes et d’herbes sèches. Les œufs, très petits, sont d’un blanc légèrement rosé. Pendant la période de l’incubation, l’hirondelle de rivage a peu d’ennemis à craindre ; mais dès que les petits sont éclos, de nombreux dangers les menacent. La pie et le corbeau les guettent pour s’emparer d’eux lorsqu’ils quittent le nid afin d’essayer leurs ailes ; la crécerelle et l’émouchet fondent sur eux d’un vol rapide et les emportent dans leurs serres.
L’homme est peut-être l’ennemi le plus redoutable de l’hirondelle de rivage. Faire l’ascension d’un rocher presque perpendiculaire, s’accrocher d’un bras, tandis que l’autre plonge dans le terrier, se savoir suspendu à une hauteur où le moindre faux pas devient fatal, tout cela forme un mélange de dangers et de plaisirs auquel nul gamin ne peut résister. Fort heureusement les nids se trouvent souvent hors de toute atteinte, et les services que rendent ces oiseaux ne sont pas toujours méconnus.
Quoique le martin-pêcheur ne creuse pas tout le terrier dans lequel il demeure, cependant il change et approprie à ses besoins un terrier qu’il trouve déjà fait. Ce charmant oiseau appartient à une des rares espèces de notre pays qui puissent, par leur plumage, lutter avec les oiseaux des tropiques. Les amateurs de pêche, les personnes qui aiment à se promener le long d’un cours d’eau ont dû voir le martin-pêcheur immobile sur une pierre ou sur une branche et guettant d’un regard attentif les mouvements du poisson. Il se tient dans une immobilité si complète qu’il échappe, malgré l’éclat de son plumage bleu de ciel sur le dos et rouge sous le ventre, à tout œil non exercé. S’élançant soudainement dans l’eau, il en ressort, après quelques secondes, un petit poisson dans le bec. Souvent il regagne son perchoir et jetant sa proie en l’air il l’attrape adroitement, la tête en bas, et l’avale avec rapidité ; puis il guette une autre victime. Il choisit toujours sa demeure près d’un cours d’eau et s’établit généralement dans un repaire abandonné par les rats d’eau. J’en ai vu un qui s’était fixé au bord d’un ruisseau qu’un enfant pouvait traverser d’une enjambée et dans le terrier d’une musaraigne aquatique ; par conséquent l’entrée en était si étroite, qu’il me fallait l’élargir pour y passer ma main.
Il est bien reconnu que les œufs reposent sur des os de poisson. La première description exacte du nid nous a été donnée par M. Gould, l’éminent ornithologue. Personne, avant lui, n’avait réussi dans la tâche difficile d’enlever le nid sans le briser.
Dans plusieurs parties de l’Angleterre il existe encore une légende suivant laquelle les autorités du Musée Britannique auraient offert une récompense de cent livres sterling (2 500 fr.) à celui qui apporterait un nid de martin-pêcheur complètement intact. M. Gould ayant découvert la retraite d’un de ces oiseaux s’assura qu’il y avait un nid ; pour le déterrer sans y faire tomber de terre, il remplit tout le terrier de coton, en l’introduisant au moyen d’une canne à pêche ; puis, creusant au-dessus du nid, il parvint à le mettre à découvert et à prendre une femelle couvant huit œufs. Il enleva, avec de grandes précautions, le nid fragile qui se voit encore aujourd’hui au Musée Britannique. Il est entièrement composé d’os de poisson, dont la majeure partie est fournie par des vérons. L’oiseau les rejette après avoir digéré la chair. Le nid n’a que douze millimètres d’épaisseur ; sa forme circulaire, ainsi que le creux peu profond du milieu, indique que l’oiseau y place les os avec régularité et non au hasard. C’est peut-être à ces os et à leur décomposition partielle qu’est due la mauvaise odeur très prononcée d’un terrier de martin-pêcheur. Celle-ci s’attache même à l’oiseau : je possède un spécimen empaillé dont la peau conserve, en dépit de toute précaution, une odeur excessivement pénétrante. Cet oiseau pond une grande quantité d’œufs et remplace ceux qu’on lui enlève.
Le macareux, à l’aspect grotesque, appartient aussi à la classe des oiseaux terriers. Comme tous les plongeurs, il ne pond qu’un œuf qu’il dépose sous terre. Il aime à s’emparer d’une excavation toute faite, telle qu’un clapier de lapin, dont il parvient à chasser les habitants, grâce à son bec formidable ; mais, s’il le faut, il se montre habile à se creuser une retraite. Ces oiseaux fréquentent surtout les îles Færoë, dont le sol léger leur convient parfaitement. Le terrier a ordinairement un mètre de long et n’est jamais tracé en ligne droite ; au fond se trouve l’œuf simplement posé sur la terre. Les jeunes macareux, tant que leur bec n’est pas développé, sont en butte à de nombreux ennemis, mais les parents les défendent courageusement. On les a vus saisir l’agresseur, plonger avec lui dans la mer et le noyer.