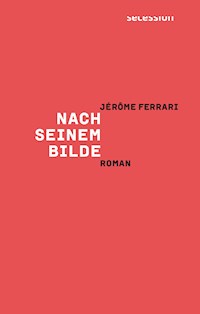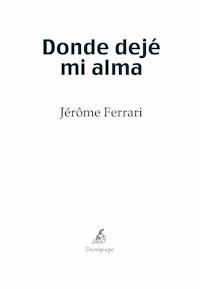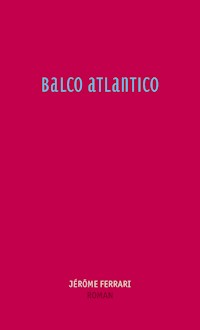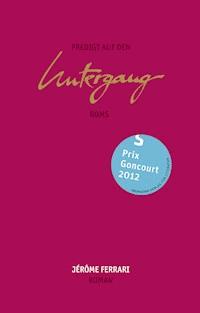Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Diagonale
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Saisir les secrets de la création en regardant par-dessus l’épaule d’un grand écrivain tandis que le texte s’élabore, c’est peut-être là le désir de tout nouvel auteur. Dans ce grand entretien, Pascaline David lève le voile sur le travail d’écriture et l’univers romanesque de Jérôme Ferrari.
L’écrivain aborde des thèmes aussi variés que le rôle de l’enfance dans le déploiement de la vocation romanesque, la construction de personnages, la mise en œuvre de la langue, l’élaboration du récit ou le travail de l’écriture proprement dit.
EXTRAIT
Je ne peux pas écrire quelque chose en quoi, d’une certaine manière, je ne crois pas. Je sais bien que c’est de la fiction mais, en même temps, il faut que j’y croie. Il faut que j’y croie parce que sinon pourquoi irais-je l’écrire ? Il faut que j’y croie et que ce soit comme si je regardais quelque chose qui se déroule dans une espèce de petit monde.
À PROPOS DES AUTEURS
Jérôme Ferrari est un écrivain et traducteur français. Né de parents corses, il est agrégé de philosophie et titulaire d'un DEA d'ethnologie.
Il a vécu en Corse et enseigné la philosophie au lycée de Porto-Vecchio. Durant cette période, il a organisé notamment des "cafés philosophies" à Bastia, puis enseigné au lycée international Alexandre-Dumas d'Alger, au lycée Fesch d'Ajaccio jusqu'en 2012, et au lycée français Louis Massignon d'Abou Dabi jusqu'en 2015.
Depuis la rentrée 2015, il enseigne la philosophie en hypokhâgne, au lycée Giocante de Casabianca de Bastia.
Il débute une carrière d'écrivain en 2001 avec un recueil de nouvelles,
Variété de la mort et un roman,
Aleph Zero (2003). Auteur à la plume corrosive, Jérôme Ferrari s'inspire de la Corse pour écrire
Balco Atlantico, paru chez Actes Sud en 2008.
Avec son roman,
Un dieu un animal, l'écrivain évoque la guerre et le monde de l'après 11 septembre. Il reçoit pour ce roman le prix Landerneau en juin 2009.
Après le Prix France Télévisions et le Grand Prix Poncetton SGDL en 2010 pour
Où j'ai laissé mon âme, son roman
Le sermon sur la chute de Rome (2012) est l'un des événements de la rentrée littéraire finalement couronné par le Prix Goncourt.
Il reçoit le Prix littéraire "Le Monde" 2018.
Pascaline David est née à Bruxelles en 1976. En 2014, elle fonde les éditions Diagonale avec Ann-Gaëlle Dumont.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les mondes possibles de Jérôme Ferrari
« Je ne peux pas écrire quelque chose en quoi, d’une certaine manière, je ne crois pas. Je sais bien que c’est de la fiction mais, en même temps, il faut que j’y croie. Il faut que j’y croie parce que sinon pourquoi irais-je l’écrire ? Il faut que j’y croie et que ce soit comme si je regardais quelque chose qui se déroule dans une espèce de petit monde. »
Les mondes possibles de Jérôme Ferrari, Entretiens sur l’écriture avec Pascaline David
Saisir les secrets de la création en regardant par-dessus l’épaule d’un grand écrivain tandis que le texte s’élabore, c’est peut-être là le désir de tout nouvel auteur. Dans ce grand entretien, Pascaline David lève le voile sur le travail d’écriture et l’univers romanesque de Jérôme Ferrari.
L’écrivain aborde des thèmes aussi variés que le rôle de l’enfance dans le déploiement de la vocation romanesque, la construction de personnages, la mise en œuvre de la langue, l’élaboration du récit ou le travail de l’écriture proprement dit.
Pascaline David est née en 1976. En 2014, elle fonde les éditions diagonale avec Ann-Gaëlle Dumont.
Jérôme Ferrari est né en 1968. Philosophe et écrivain, il est l’auteur de nombreux romans parus chez Actes Sud dont Le Sermon sur la chute de Rome qui a remporté le prix Goncourt en 2012 et À son image, prix littéraire du journal Le Monde 2018 et prix Méditerranée 2019.
Les mondes possibles
de Jérôme Ferrari
Entretiens sur l’écriture avec Pascaline David
ACTES SUD / diagonale
Du même auteur
Variétés de la mort, Albiana, 2001 ; Babel n° 1275.
Aleph zéro, Albiana, 2002 ; Babel n° 1164.
Dans le secret, Actes Sud, 2007 ; Babel n° 1022.
Balco Atlantico, Actes Sud, 2008 ; Babel n° 1138.
Un dieu un animal (prix Landerneau), Actes Sud, 2009 ; Babel n° 1113.
Où j’ai laissé mon âme (grand prix Poncetton de la sgdl, prix France Télévisions, prix Initiales, prix Larbaud), Actes Sud, 2010 ; Babel n° 1247.
Le Sermon sur la chute de Rome (prix Goncourt), Actes Sud, 2012 ; Babel n° 1191.
À fendre le cœur le plus dur (avec Oliver Rohe), Inculte, 2015 ; Babel n° 1500.
Le Principe, Actes Sud, 2015 ; Babel n° 1446.
Il se passe quelque chose, Flammarion, 2017 ; Babel n° 1549.
À son image (prix littéraire du journal Le Monde 2018, prix Méditerranée 2019), Actes Sud, 2018.
Parus aux éditions diagonale
Les conquêtes véritables, Nicolas Marchal, réédition éditions diagonale, 2014 (prix Première 2009)
La vie en ville, Damien Desamory, 2014
Quand les ânes de la colline sont devenus barbus, John Henry, 2015 (prix de la Roquette à Arles 2015 ; lauréat du festival du premier roman de Chambéry 2016)
Le Modèle, Manuel Capouet, 2016 (finaliste du prix Senghor 2017 et du prix des librairies Club 2017).
Autour de la flamme, Daniel Charlez d’Autreppe, 2017
L’Affaire Magritte, Toni Coppers, traduit du néerlandais, 2020
Introduction
Saisir les secrets de la création en regardant par-dessus l’épaule d’un grand écrivain tandis que le texte s’élabore, c’est peut-être là le désir de tout nouvel auteur. Celui de découvrir les procédés d’écriture pour mener à bien un premier roman, de comprendre un certain nombre de techniques au départ de questions simples ou parfois complexes pour retourner ensuite à sa table de travail, fort d’une nouvelle idée.
C’est avec cet objectif que je me suis adressée à Jérôme Ferrari pour les éditions diagonale. La maison d’édition cherchait à accompagner les primo-romanciers en quête de pistes d’écriture. Les notes de lecture personnalisées, envoyées par le comité de lecture, ne suffisaient plus à renseigner l’auteur néophyte. Alors quoi de mieux que l’expérience d’un auteur confirmé ?
Jérôme Ferrari accepta ma proposition et m’accorda trois jours d’entretiens, en Corse, en novembre 2017. On convint de plusieurs périodes d’enregistrement, chacune d’une heure trente. Je préparai une centaine de questions sur des thèmes différents, explorant l’origine de son goût pour l’écriture, des aspects techniques de son travail ainsi que sa réflexion autour de notre monde si complexe.
Ce fut la seule semaine de l’année 2017 où il plut sur l’île de Beauté. À la faveur du temps maussade, je restai immergée dans un bain chaud à lire huit textes romanesques de haute tenue : Variétés de la mort (2001), Aleph zéro (2002), tous deux parus chez Albiana, puis aux éditions Actes Sud, Dans le secret (2007), Balco Atlantico (2008), Un dieu un animal (2009), Où j’ai laissé mon âme (2010), Le Sermon sur la chute de Rome (2012), Le Principe (2015) ainsi qu’un essai coécrit avec Oliver Rohe sur la photographie de guerre, À fendre le cœur le plus dur, paru aux éditions Inculte en 2015.
Au bout de quatre jours de lectures, je retrouvai l’écrivain chez lui. Dès la première rencontre, Jérôme Ferrari me donna l’impression d’un homme courtois, soucieux du détail et en ébullition permanente. De lui se dégageait une sorte de tension. La plupart des entretiens eurent lieu dans son bel appartement coloré où ce qui me frappa d’emblée fut le nombre de bibliothèques qui semblaient avoir colonisé l’espace dédié aux meubles. L’ordre et la suprématie des gros volumes en disaient long sur la culture de mon hôte. À la fois philosophe, enseignant et romancier, Jérôme Ferrari ne me refusa jamais une question, aussi difficile qu’elle fût, pour construire subito la réponse la plus inspirée possible. En cours d’entretien, je découvris qu’il s’attelait à un nouveau roman dédié à la photographie de guerre, À son image, dont la parution était prévue en août 2018 chez Actes Sud.
J’ai recueilli la plus grande partie de ses réponses dans son bureau, une petite pièce sobre, garnie d’un poste de travail, d’un canapé deux places de couleur claire et d’une méridienne assortie. On l’imagine facilement ici, en proie à quelques réflexions au départ d’un nouveau roman ou occupé à visionner de la documentation sur un de ces thèmes qu’il affectionne, la guerre de Serbie, par exemple, ou le travail d’un certain photographe.
À son image fut couronné quelques mois plus tard par le prix littéraire du journal Le Monde 2018 et le prix Méditerranée 2019. Malgré les nombreuses sollicitations dont l’auteur fut l’objet, j’eus l’opportunité de le retrouver une dernière fois, en décembre, pour tenter de saisir ce qui avait fait battre le cœur de son nouveau récit.
La rencontre eut lieu à Bruxelles un jour de crachin belge, bien à l’abri dans les salons de l’hôtel Amigo. C’est donc par un agréable déjeuner que se clôtureraient nos entretiens, et s’il fut toujours question d’écriture, ces derniers échanges précisèrent davantage la lecture du monde de l’auteur, l’utilité de la parole et de la photographie, la place du sacré dans son œuvre, pour se conclure en douceur sur la Corse et les photographies de sa famille, celles prises à Saigon, Dakar ou dans ces pays lointains en guerre. Et avec lesquelles tout a peut-être commencé, ce jour-là et comme à chaque fois que lui vient l’envie d’ouvrir l’un de ces albums qui l’ont toujours fasciné, au point d’y voir un livre d’Histoire minuscule et de vouloir y prendre part en créant un monde possible.
Pascaline David
Un sol natal
Jérôme Ferrari, j’aurais envie, pour commencer, de vous demander : qui êtes-vous ? Qu’est-il nécessaire de connaître de vous pour appréhender plus précisément votre travail et votre parcours d’écrivain ?
Voilà une première question bien compliquée. Peut-être que la chose importante à savoir, c’est que je suis né à Paris et que j’ai grandi en banlieue parisienne dans une famille corse.
Pendant mon enfance et mon adolescence, j’ai passé toutes mes vacances en Corse et j’ai fini par m’y installer en 1988, comme je le désirais depuis très longtemps. Je venais juste d’avoir 20 ans.
Mon premier livre, Variétés de la mort, a été publié chez Albiana, une maison d’édition régionale, en 2001. Six mois plus tôt était paru le recueil de nouvelles de mon ami Marco Biancarelli, Prighjuneri, en édition bilingue, corse-français. Je m’étais chargé de la traduction. J’ai rencontré Marco au lycée de Porto-Vecchio, où nous étions professeurs. On s’est rendu compte qu’on écrivait tous les deux, on a échangé des textes.
Marco et moi, on était sur la même longueur d’onde, on partageait le même projet littéraire. Peut-être y avait-il quelque chose de générationnel. On voulait parler des réalités de la Corse contemporaine, échapper aux fantasmes plus ou moins folkloriques qui sont systématiquement convoqués dès qu’il s’agit de la Corse et qui nous agaçaient prodigieusement. Les écrivains français du XIXe siècle, Mérimée surtout, ont construit une image romantique toujours très vivace sur le continent, mais aussi, je crois, ici même, comme si nous nous percevions nous-mêmes à travers le regard de l’autre.
Marco et moi voulions sortir de cette espèce de carte postale inepte pour parler de la réalité.
J’ai toujours pensé que le but de la fiction littéraire était précisément de parler de la réalité, avec les moyens qui lui sont propres, et de donner à voir une certaine forme de vérité.
Une forme de subversion alors ?
Oui. Peut-être qu’au départ ça s’est manifesté par une écriture un peu trop violemment iconoclaste et provocatrice – qui avait quand même quelque chose de jubilatoire. Marco et moi, on aimait bien prendre le contre-pied des clichés et ça nous amusait beaucoup.
La nouvelle la plus connue sur la Corse est sans doute Colomba, de Prosper Mérimée. Il se trouve que – mais ça aussi ça a conditionné quelque chose pour moi – mon village s’appelle Fozzano et que c’est dans ce village-là que Mérimée a rencontré Colomba Carabelli qui lui a servi de modèle. Elle avait 65 ans, mais il en a fait une jeune fille de 20 ans, plus conforme à la figure idéale de l’héroïne. Mérimée a écrit d’autres textes qui sont des histoires de crime d’honneur, de bandits d’honneur, etc., offrant une vision extrêmement romantique d’une réalité qui ne l’était pas du tout, il suffit d’aller consulter les archives pour s’en rendre compte. C’était déjà complètement fantaisiste au XIXe siècle et ça n’a donc a fortiori rien à voir avec la Corse contemporaine même si beaucoup de choses sont pourtant encore vues à travers ce prisme-là.
À l’époque où j’ai publié Variétés de la mort, j’étais donc professeur au lycée de Porto-Vecchio. Porto-Vecchio est une station balnéaire où toute la jet-set vient passer l’été, et une ville quasiment morte entre le mois d’octobre et le mois de juin, c’est ça la réalité.
Marco et moi, on était très sensibles – d’autant qu’on la vivait douloureusement – à cette espèce de schizophrénie saisonnière qui nous faisait passer d’une forme de désert glacé à deux ou trois mois de frénésie complète où il était plus question de boîte de nuit, de tourisme de masse, de drogue et de fornication que de vendetta et de bandits d’honneur.
Au fond, vous avez grandi à côté d’un Mérimée qui vous agaçait prodigieusement ?
Il ne m’agaçait pas quand j’étais petit, j’étais comme tout le monde, il me fascinait beaucoup avec ses histoires de bandits d’honneur. Il a juste fallu reconnaître que c’était faux.
Vous seriez né entre deux mondes, celui du continent et de la Corse ?
Description absolument exacte. C’est comme ça que j’ai vécu les choses : deux mondes parfaitement étanches, seulement reliés entre eux par l’avion qui m’emmenait de Paris à Ajaccio. Très vite, je n’ai eu qu’une seule envie : quitter la région parisienne.
Pourquoi ?
Je ne l’aimais pas. Ce n’est pas un sentiment d’une originalité bouleversante. Je pense que si la vie donne à quiconque la possibilité d’expérimenter ce que c’est que de vivre en Corse-du-Sud et à Vitry-sur-Seine, le choix est vite fait. J’ai toujours trouvé Vitry détestable et la perspective d’y passer ma vie m’épouvantait – c’était, en fait, impensable. Et puis, entre Vitry et la Corse, il y avait, il y a encore, un gouffre culturel. En arrivant au village, je me sentais chez moi, j’avais mes amis, mes cousins, tout ce qui relève du familier le plus intime et, en même temps, je vivais une expérience exotique comme si je demeurais étranger à ce qui m’était le plus proche.
Et comment êtes-vous passé d’un Paris où vous aviez grandi à la Corse ?
Je venais en Corse pour les vacances. Mon père travaillait à Air France, l’avion ne coûtait pratiquement rien. Donc je venais l’été, à la Toussaint, à Noël, en février, à Pâques, à toutes nos vacances scolaires, j’étais là.
Vous mesuriez à ce moment la distance entre un point et l’autre ?
Oui, vraiment, pour moi, c’étaient deux univers incommensurables. C’était un peu embêtant parce que je voyais bien que mes codes et mes comportements ne pouvaient pas être les mêmes quand j’étais à Vitry et dans mon village. C’était assez troublant comme constat et ça ne me satisfaisait pas du tout. J’ai vraiment vécu cela comme une énorme incohérence dont j’avais hâte qu’elle puisse cesser. Et j’ai tout fait pour la faire cesser.
Peut-on dire de ce fait que le mouvement est constitutif de votre personne ?
Le mouvement, je ne sais pas. Le décalage certainement. Et autant c’était quelque chose que je détestais quand j’étais jeune, autant c’est quelque chose que je suis content d’avoir vécu maintenant, cette expérience étrange d’être chez soi tout en portant sur le monde un regard extérieur. Je pense que ça a été une chance parce que ça a contribué à enrichir mes perspectives sur l’expérience humaine. Et je suis persuadé maintenant que ça a été un atout pour écrire.
Certaines personnes dans votre famille vous ont-elles marqué plus que d’autres ?
J’ai été pas mal marqué par la génération de mes grands-parents. Je veux dire mes grands-parents, mes grands-oncles, etc. Je le suis toujours. Ils sont morts depuis longtemps maintenant. Mes grands-parents maternels sont nés au début du XXe siècle et morts à la fin des années 1980, leur vie correspond donc à peu près à la durée du XXe siècle.
C’est une génération qui, au-delà des liens affectifs, m’a toujours fasciné parce que ce sont des gens qui sont nés en Corse au début du siècle c’est-à-dire dans une ruralité totalement archaïque.
Comme toutes les familles corses, la plupart des hommes nés à cette époque ont fini par partir – comme la Corse était vraiment très pauvre, surtout au sortir de la guerre de 14-18, les gens partaient, principalement dans les colonies. Ce qui fait qu’un de mes grands-parents s’est engagé dans l’armée coloniale et l’autre dans l’administration coloniale. Ma mère est née à Damas, mon père est né à Rabat.
Mon grand-père maternel, qui était militaire, s’est engagé, je crois, à 17 ans. Ce qui m’a toujours frappé, c’est de penser que ce jeune homme, quand il est venu à Ajaccio pour s’engager, n’y avait jamais mis les pieds. Il venait d’un village du Taravo, à une quarantaine de kilomètres au sud et il n’était jamais sorti de sa vallée. Et, six mois plus tard, il débarque à Dakar. L’intensité de l’expérience de dépaysement qu’a vécue cette génération-là, c’est quelque chose qui me fascine et dont nous ne pouvons nous faire aucune idée. Et la deuxième chose qui me fascine c’est de penser que ma grand-mère maternelle gardait un souvenir ébloui de la première fois qu’elle avait vu un vélo. Elle était alors une petite fille de dix ou onze ans et elle a fini sa vie entourée de voitures et d’avions. J’ai l’impression qu’en une vie, cette génération a retracé, à une vitesse vertigineuse, une grande partie de l’histoire de l’humanité. Ils ont vu le monde au moment où le monde n’était pas si facile que ça à découvrir. Cette expérience m’a évidemment beaucoup marqué, je n’arrête pas d’en parler dans mes romans.
Dans un de vos romans, vous évoquez cette scène où un personnage dit à un autre : « Viens voir, il y a quelque chose qui vole ! »
C’est un récit de ma grand-mère, ça. C’est authentique.
Cette expression vous a marqué ?
Ah oui, parce que ces enfants pensaient vraiment qu’il y avait un homme qui volait. Il était assis sur le vélo, les pans de sa veste se soulevaient et, comme les murets bordant la route cachaient le vélo, les enfants le voyaient passer à une vitesse incroyable et pensaient assister à un prodige.
Dans quel type de famille avez-vous grandi ?
D’abord, j’ai grandi dans une famille au sens large du terme c’est-à-dire qu’on était toujours entouré de cousins, surtout au village. Dans notre maison familiale, ma grand-mère et ses trois frères occupaient chacun un étage. En été, j’ai donc toujours été entouré de cousins germains, au troisième degré, au cinquième degré, donc vraiment une famille très élargie et très unie.
Y avait-il beaucoup de livres chez vous ?
Oui, beaucoup. Chez mes parents, il y avait beaucoup, beaucoup de livres. Pas de la grande littérature, d’ailleurs.
Que lisait-on ?
Ma mère aimait bien les beaux livres. Balzac, Zola, Colette, Henry Troyat, Marcel Pagnol, il y avait plein de bouquins. Mon père lisait des livres de poche de toutes sortes sans aucune espèce d’esprit sélectif. En ce qui me concerne, c’était une règle en vigueur chez moi et je ne peux pas faire autrement que de m’en féliciter, j’ai toujours eu le droit de lire tout ce que je voulais dès que j’ai été en âge de savoir lire : il n’y avait aucun interdit.
Comme quoi par exemple ?
Des San Antonio, par exemple. J’aime toujours beaucoup San Antonio. C’est quand même écrit d’une manière extraordinaire, et souvent hilarant. Mais je lisais ça, enfant. Bon, il y a quand même des choses chez San Antonio qu’on publierait difficilement en littérature jeunesse, mais c’était la politique éducative de mon père : pas d’interdit de lecture. C’est une très bonne politique parce que si on a un enfant qui aime lire, le mieux c’est de le laisser lire et de voir un peu ce qui se passe.
Du coup, la lecture a toujours été très importante pour moi. Comment avoir envie d’écrire des romans si on n’est pas d’abord et avant tout un lecteur, si on n’a pas d’abord fait l’expérience de ce que peut la fiction littéraire ?
Jamais je ne me suis dit, tiens, j’ai envie de devenir écrivain. Parce que c’est un statut et que je me fichais du statut : j’avais envie d’écrire des romans. Chaque romancier important qu’on lit donne une idée de ce qu’il est possible de faire avec la langue. La découverte de ces possibilités, voilà ce qui suscite le désir.
Vous n’avez donc pas commencé par lire Prosper Mérimée.
Non, je l’ai lu quand j’étais adolescent. J’ai découvert la littérature, disons, plus classique, plus patrimoniale, au lycée, en première et en terminale. C’était fantastique de découvrir à quel point ça ne correspondait pas à l’idée un peu scolaire, donc pas très enthousiasmante que je pouvais m’en faire. Notre professeure de français nous a fait lire L’Œuvre de Zola, le Voyage au bout de la nuit de Céline, Jacques le fataliste de Diderot, qui était incroyablement drôle, les œuvres de Camus, d’Arthur Koestler, Le Dernier Jour d’un condamné de Victor Hugo…
Quand je repense à ce qu’était la bibliographie conseillée en première, je ne suis pas sûr qu’on pourrait faire ça aujourd’hui. En terminale, la bibliographie de philosophie était tout aussi ambitieuse : Platon, Descartes, Kant, Freud, Marx, Lévi-Strauss, Sartre, on a dû acheter une bonne quinzaine de livres. Une ambition pareille est devenue tout à fait irréaliste.
Pourquoi ?
Ce n’est pas une question de catastrophisme, mais le décalage entre la langue écrite, celle des livres, et la langue orale pratiquée par les adolescents est devenu abyssal. Quand j’étais en terminale, le français de Descartes n’était évidemment pas le nôtre, mais sa compréhension ne nous posait aucun problème, on commençait à avoir du mal avec Montaigne, mais ça allait encore. Pour mes élèves, la langue de Descartes est parfaitement obscure, quant à Montaigne, autant leur donner un texte en ouzbek – et je parle de compréhension de la langue, pas du contenu philosophique.
Le vocabulaire se serait tellement appauvri en quelques années ?
Il n’y a pas que le vocabulaire, il y a la syntaxe. En ce qui concerne Descartes, ce sont les tournures de phrases et leur enchaînement qui sont devenus trop compliqués. L’appauvrissement est indéniable.
Et il y aurait quelque chose à proposer ?
Non, je ne crois pas. Je crois qu’on a affaire à un mouvement d’une telle ampleur sociologique que je ne vois pas ce qu’on peut proposer. Si, de toutes petites choses. C’est-à-dire faire ce qu’on peut dans sa classe, ce n’est déjà pas si mal. Et ça au moins, ça ne dépend que de nous, il n’y a rien qui nous en empêche parce qu’ils ne sont pas idiots, les élèves. Il faut essayer de leur donner accès à des choses auxquelles ils n’ont pas accès en dehors de l’école, essayer de faire naître un peu de désir pour ce qui n’en suscite pas spontanément chez eux. Parfois, ça marche, parfois ça ne marche pas.
La Corse tient une place particulière dans vos romans. Vous écrivez dans Variétés de la mort : « Je pensais qu’il me fallait un autre sol natal. » (Dans la nouvelle, il s’agit en l’occurrence de Ruth, une femme à laquelle le personnage principal doit renoncer.) « Il me fallait n’importe quoi, un point fixe dans l’univers à partir duquel je pouvais m’élever et fleurir et m’épanouir, je pensais à la Corse. » Avez-vous un jour choisi la Corse comme point d’ancrage ?
Bien sûr, je l’ai choisie. Ce que je n’ai pas choisi c’est que ce choix s’offre à moi. On avait des attaches au village, mais j’aurais pu décider que c’était simplement un endroit où passer mes vacances et puis faire ma vie ailleurs.
J’ai vraiment choisi que ce soit chez moi alors que c’était juste une possibilité. Ce n’était pas comme si j’étais né au village et que j’y avais vécu toute mon enfance. Il fallait que ce soit à la fois donné et choisi.
Je ne suis pas arrivé ici en m’imaginant que l’année entière serait comme les vacances scolaires d’été. Avec du monde autour de moi, des choses à faire. Je savais ce que c’était l’hiver ici, au village. Et j’avais donc moins de chance d’être confronté à la terrible désillusion du narrateur de la nouvelle Un sol natal.
Après, je suis reparti. J’ai vécu à l’étranger. Mais à chaque fois que je partais, je savais que je reviendrais ici.
Finalement, peut-être que moi aussi j’avais besoin d’avoir quelque chose que je puisse considérer comme un port d’attache qui ne dépendait pas des aléas de la vie ou des circonstances, qui ne pouvait pas m’être enlevé. C’est une grande chance.
Comment vos premiers textes sur la Corse ont-ils été reçus par les Corses eux-mêmes ?
Très mal. Pour Variétés de la mort