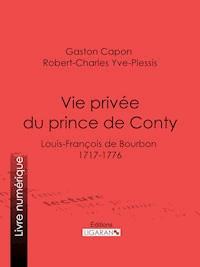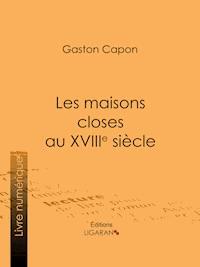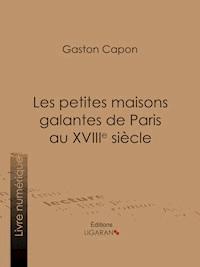
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "Faubourg Saint- Antoine – Sous cette appellation on désignait autrefois toute la partie de Paris formée aujourd'hui par le XIe, XIIe et XXe arrondissements. C'est dans ce quartier que s'élevèrent les premières Folies dont quelques-unes donnèrent leur nom aux voies percées sur leur emplacement."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À MONSIEUR GASTON CAPON
Homme de Lettres
Vous m’avez fait le grand honneur, mon cher confrère, de me demander une préface pour vos « Petites Maisons du XVIIIe siècle ». J’ai promis, sans trop savoir, je l’avoue, à quoi je m’engageais. Après avoir lu les « bonnes feuilles » de votre volume, j’ai compris que les traditionnels souhaits de bonne chance ou les clichés de congratulation banale que les préfaciers accrochent d’ordinaire au fronton des livres qu’ils patronnent, siéraient mal à votre œuvre si curieusement fouillée, si consciencieusement documentée, d’historien probe et sérieux.
Il fallait autre chose : Quoi ? J’ai songé qu’avant de pénétrer avec vous dans ces maisons closes d’un genre à part, il ne serait pas indifférent au lecteur d’en sonder tout d’abord les approches, d’en faire le tour de loin, d’en prendre un croquis d’ensemble, d’en noter l’histoire sommaire, d’après les racontars de la rumeur publique. Mais une préface ainsi traitée devenait une introduction véritable et j’empiétais sur votre domaine. Vous m’avez permis de le faire : j’abuse de la permission.
… Après une vieillesse morose et confite en austérités, le Roi-Soleil venait de s’éteindre. Laissant la veuve Scarron à sa douleur solitaire, les courtisans, libérés, respirèrent longuement. Ils en avaient assez, et trop, de l’hypocrisie béate, de la religiosité de commande auxquelles les condamnait depuis un quart de siècle le bigotisme d’unereine de la main gauche. Tel un pur-sang, qui s’ankylosait au repos forcé de l’écurie, s’ébroue joyeusement et pique un galop dès qu’il revoit le pré, telle la noblesse française, débridée, se rua au plaisir. Aussi bien, Philippe était là pour prêcher d’exemple. La sarabande commença, qui allait durer tout un règne et préparer la chute du trône, au règne suivant.
Les façades sévères et les cours monumentales des hôtels de la grand-ville portaient encore la marque, évoquaient encore la mémoire du Louis défunt. Elles ne tardèrent pas à offusquer la vue de ces grands seigneurs, de ces hauts magistrats, dont le renouveau d’humeur joviale s’accommodait mal de la tenue imposée par l’étiquette en ces demeures pompeuses. Et l’on vit tout à coup s’élever par douzaines, à l’entour du Paris d’alors – nos faubourgs actuels – de riantes maisons, coquettement nichées dans la verdure, au milieu de vastes jardins.
Le luxe extérieur de ces habitations de plaisance, la somptuosité des fêtes qui y succédaient aux fêtes, l’animation folle qui bouleversait des lieux, déserts et silencieux naguère, firent donner, dit-on, à ces palais champêtres, le nom de folies. Mais cette étymologie n’est rien moins que prouvée. Des lexicographes experts préfèrent tirer le mot du latin, à cause des vertes frondaisons qui masquaient aux yeux profanes ces bâtisses perdues sous la feuillée – sub foliis. Ils ajoutent même à l’appui de leur thèse, que les folies se nommaient ainsi bien avant qu’on y fît des folies, plusieurs siècles avant Louis XV.
De ces deux versions, quelle que soit la bonne, il ne semble pas que le terme ait survécu à la Régence. Par un de ces calembours audacieux, par une de ces synonymies fantaisistes où se complaît la langue parisienne de toutes les époques, les folies débaptisées allaient bientôt devenir les petites maisons. Non que celles-ci fussent d’architectureplus exiguë que leurs devancières, ni plus modestes comme décor ; mais folie appelait l’idée de fol et les fous étaient menés aux Petites Maisons, d’où la transition naturelle.
Le mot resta, la mode aussi. Après les pères, les fils. Vers le milieu du dix-huitième siècle, il n’était roué ou petit-maître un peu renté qui ne tînt à honneur de posséder ou de louer à bail, à quelques portées de fusil des boule-verds, un de ces logis discrets, tapi dans un fouillis de bosquets ombreux, et spécialement aménagé pour l’amour. La femme, voire celle de qualité, s’y rendait en simple équipage, pour moins fixer le regard des badauds. Le propriétaire arrivait de son bord, non moins mystérieusement, et le couple amoureux « célébrait son délire », sans autres confidents que la soubrette de Madame ou le valet de Monseigneur. Tels étaient, du moins, les rendez-vous quasi-honnêtes. Plus souvent, la partie fine, partie carrée ou davantage, tournait à l’orgie priapique et, toute pudeur bannie, atteignait crescendo aux limites de la plus crapuleuse débauche. C’est ainsi, par exemple, que la comtesse de Brassac, fille du maréchal de Fourville, qui s’était aventurée dans une petite maison, à la Muette, y fut enivrée par ses hôtes et dépouillée de ses atours. Puis, délicieuse plaisanterie (je cite textuellement) : « On la boucha avec du fromage mou, pétri dans du sel et du poivre. » L’aventure, ébruitée, fit beaucoup rire à Versailles. On en composa même des couplets .
Le duc de Richelieu, arbitre des élégances, possédait autant de petites maisons qu’il avait d’intrigues différentes. Il fut, de plus, l’inventeur des petits soupers.
Aux repas fastueux que la grandeur apprête, dont la gravité fait les honneurs, on a substitué (écrit Magny) ces petits soupers fins que le bon goût et la délicatesse préparent, dont l’amour fait les frais etque la liberté assaisonne. Si l’on ne peut toujours s’arracher à l’ennui des premiers, on a toujours au moins les seconds pour se dédommager et il n’y a pas à Cythéropolis un homme de bon ton qui n’ait deux ou trois fois par semaine sa petite partie, arrangée avec des amis choisis, pour un petit souper dans une petite maison.
Les gros financiers ne restaient pas en arrière et leurs petits soupers s’inspiraient à la fois de Lucullus et de Trimalcion. Un invité de Samuel Bernard nous en a gardé ce tableau :
On me mit entre deux jolies femmes dont le voisinage méritait d’être envié par toute la compagnie.
Quel coup d’œil, ô ciel ! quel spectacle enchanteur. Le Salon, le Buffet, la table et les convives ravissaient également mes yeux. Le Salon ouvert de tous côtés donnait sur une orangerie ; il était éclairé d’un nombre infini de lumières que les glaces et les cristaux répétaient et multipliaient encore. La richesse du Buffet ne peut se décrire ; je n’en ferais qu’affaiblir l’idée en voulant la réduire aux miennes. Là, brillaient mille vases précieux ciselés de la main de Myron. L’argile de Samos et la terre de Sicile par leur délicatesse et leur fragilité y disputaient de prix avec l’or et l’argent. Pour la table, l’œil était partagé entre la propreté, la symétrie, la diversité et l’abondance des mets. Les présents de Pomone, les dons de Comus étaient agréablement entremêlés et Flore embellissait tout de ses couleurs. Mais comment vous dépeindre les agréments que vingt beautés, assises à cette table, ajoutaient encore au spectacle ? De beaux yeux animés par la joie et la bonne chère, ne sont déjà que trop séduisants, mais quand des attraits qui peuvent soutenir le jour en empruntent encore des lumières de la nuit ; quand les lustres et les flambeaux viennent répandre un fard innocent sur les visages et par un clair-obscur inimitable, donner aux attraits cet adoucissement ou ce relief qui échappe au pinceau, vous pouvez vous figurer l’effet d’une si aimable perspective. Comme le Salon était spacieux et bien percé, le grand nombre des convives n’empêchait point de goûter la fraîcheur des jardins qui nous environnaient de tous côtés. Un air délicieux qui se renouvelait sans cesse nous l’apportait avec l’odeur des myrthes et des orangers. Ce doux parfum venait se confondre avec les délicates fumées des viandes ; ainsi l’odorat invitait encore et servait en même temps le goût…
Que vous dirais-je enfin ! Concevez tout ce qu’il est possible d’imaginer en fait de bonne chère, d’exquis, de délicieux, de délicat, de relevé, de fin et de piquant : rassemblez tous les termes inventés pour l’art voluptueux des Apicius, vous ne trouverez rien au-dessus de l’idée que je veux vous donner de ce repas. Cent flacons ensevelissous la neige dans des puits d’argent, remplissaient de temps en temps les coupes des plus excellents vins de Grèce et d’Italie.
La joie, la volupté, l’aimable ivresse coulait à la fois dans tous les cœurs, et toujours au fond de la coupe naissaient les ris et les doux propos. À mesure que l’appétit faisait place à la pure sensualité, et que la sensualité s’émoussait, les langues se déliaient peu à peu .
Telle était la vogue de ces repas que, pour avoir prétexte à se mettre à table, on goûtait quoiqu’on eût dîné, on réveillonnait quoiqu’on eût soupé. Le maréchal de Richelieu, toujours lui, établit une petite maison exclusivement consacrée aux petits soupers. Tout ce que la sensualité, le faste, la profusion peuvent faire inventer, s’y trouvait réuni. Enfin, création suprême du vainqueur de Fontenoy, il imagina les « repas adamiques », expression nouvelle qui porte en soi sa définition, exemple aussitôt suivi par tous les petits-maîtres, tous les hommes bien nés, tous les robins à la mode ayant à leurs appointements quelque « fille du monde » et possédant une petite maison.
En vertu de la loi d’airain de l’offre et de la demande, ces retraites si courues devinrent assez rares, partant assez chères ; la note de police suivante en fait foi : – « 29 sept 1744. Le marquis de Nesle se donne de grands mouvements pour avoir la petite maison de Bonnier, rue de Clichy, aux Porcherons. Elle est meublée au mieux et remplie de tout ce qui peut servir à la commodité et même à la volupté. »
Rien d’étonnant, dès lors, qu’un réformateur des mœurs du temps – cette engeance est de tous les temps – ait conçu l’idée baroque d’alléger les finances royales en taxant les petites maisons. Cet homme ingénieux se nommait l’abbé Coyer et il exposait ainsi son système :
Pour avoir une grande maison il ne faut que 30 000 livres de rente, mais pour en avoir une petite il en faut 100 000. C’est ordinairementun azile de plaisir et d’abondance ; n’est-il pas juste d’y prendre quelque chose pour le bien public ?
De compte fait, il entre dans une petite maison douze agréables et quatre femmes par semaine, ou la même femme quatre fois. Le propriétaire paiera une livre par homme et trois livres par femme, n’y entrât-elle que pour faire des nœuds.
Ainsi 500 petites maisons à 24 livres par semaine, donneront 624 000 livres par an.
Les jours où le propriétaire ira souper dans sa petite maison avec sa femme, ses enfants ou son curé, ne seront pas sujets à la taxe.
En dépit des quelques citations qui précédent, nous serions assez mal renseignés sur les petites maisons du dix-huitième siècle, si nous ne possédions, pour tous documents, que la littérature imprimée de l’époque.
De patientes recherches ne m’ont pas découvert plus de quatre ouvrages entièrement consacrés au sujet qui nous occupe. Encore trois de ces œuvres, de pure imagination, ne donnent-elles, comme on va le voir, que des notions très vagues et générales sur la matière. Elles reflètent bien les mœurs galantes d’une société ; mais ce n’est qu’un reflet sans reliefs précis.
La première en date est une comédie en trois actes, du président Hénault, intitulée : La Petite Maison, imprimée en 1749, sans nom d’auteur ni de libraire, avec un délicieux dessin de haut-de-page par Eisen. La pièce est assommante et bien faite pour les comédiens d’occasion qui la représentèrent en petit comité.
L’auteur nous mène dans la petite maison d’un certain Valère, lequel trompe la confiance de son ami Clitandre avec la maîtresse de ce dernier, la coquette Cidalise. Clitandre d’ailleurs n’a que ce qu’il mérite, ayant délaissé, pour s’enticher de Cidalise une jeune veuve nommée Julie, digne en tout point de l’amour d’un homme de bien. Mais Julie ne se tient pas pour battue. Grâce à la complicité d’un serviteur dévoué, elle a loué un hôtel contigu à la petite maison, d’où elle épie les faits et gestes de Clitandre, guettant l’occasion favorable pour ramener l’infidèle qu’elle aime toujours. Cette occasion pourrait tarder à naître si, par une de ces rencontres qu’on ne voit qu’au théâtre, Cidalise qui n’a pris Valère que comme un passe-temps, ne s’amourachait brusquement d’un jeune cavalier inconnu qu’elle a entraperçu rôdant dans les allées désertes du jardin. Vous devinez sans peine que ce cavalier n’est autre que Julie, qui se glisse parfois, travestie en homme, dans le parc de la petite maison. Julie s’arrangera pour se faire surprendre par Clitandre en rendez-vous galant avec Cidalise. L’amant qui, déjà, le même jour, a trouvé son ami Valère aux pieds de sa maîtresse et qui en a gardé quelques soupçons fâcheux, ne doute plus de la perfidie de la coquette. Il veut pourfendre le bel inconnu. Mais celui-ci se fait connaître : « C’est Julie ! » Effusions, transports. Tout finira par un mariage.
Cette action bébête, bien qu’embrouillée par endroits, est encore alanguie par un quatuor de personnages, laquais, soubrettes, dont l’unique fonction est, au début de chaque acte, de nous mettre au fait de ce qui s’est passé durant l’entracte ; et par un rôle épisodique de provinciale ridicule, Araminte, tante de Julie, venue à la recherche de sa nièce dont la disparition inquiète la famille.
Cependant, ne nous plaignons pas trop ; c’est à ces valets, c’est à cette tante, que nous devrons les quelques fragmentsde dialogue ayant directement trait aux petites maisons, à ce qui s’y dit, à ce qui s’y fait.
La toile se lève, au premier acte, sur un entretien de La Montagne, intendant de Valère, avec Frozine, camériste de Cidalise :
LA MONTAGNE. Tout cela peut être ; mais mon Maître m’ennuye à la mort.
FROZINE. Mais quelle condition peux-tu trouver de préférable à la tienne ?
LA MONTAGNE. Cela est vrai.
FROZINE. Tu as de l’argent tant que tu veux.
LA MONTAGNE. Jusqu’à présent, tout le revenu de Valère m’a passé par les mains, et il ne tenait qu’à moi de le ruiner ; mais il n’a besoin de personne pour cela.
FROZINE. Tu fais la plus grande chère du monde.
LA MONTAGNE. J’en suis si las que je préfère tous les jours le potage aux choux de notre jardinier.
FROZINE. Tu ne vois que des gens heureux.
LA MONTAGNE. Cela devrait être.
FROZINE. Il est vrai que ton métier exige une grande discrétion. Que tu as beaucoup à t’observer, et que cela ne laisse pas de gêner. Par exemple, quand tu viens dans cette petite maison, il faut prendre garde qu’on ne t’y voie entrer, pour qu’on ne sache pas dans le quartier qu’elle appartient à ton Maître.
LA MONTAGNE. Que veux-tu donc dire avec ta discrétion ? Je crois que tu te moques de nous. Ah ! ma pauvre Frozine, tu t’es bien rouillée pendant deux ans de province, et pourquoi du mystère ?
FROZINE. Apparemment que ton maître en met à ses bonnes fortunes.
LA MONTAGNE. Lui, point du tout.
FROZINE. Et à quoi lui sert-il donc d’avoir une petite maison ? Il me semble qu’elles n’ont été inventées que pour y venir à la dérobée et y attendre les personnes que l’on ne pourrait voir chez elles sans conséquence.
LA MONTAGNE. Cela était bon du temps du roi Guillemot. Aujourd’hui, une petite maison n’est qu’une indiscrétion de plus : on sait à qui elle appartient, ce qui s’y passe, les personnes qui y viennent, comme dans une maison de ville ; et, excepté qu’il n’y a pas sur la porte en lettres d’or : Hôtel de Valère, d’ailleurs, c’est toute la même chose. Encore je ne désespère point que la mode n’en vienne…
Même acte, scène VI, l’arrivée inopinée de la tante Araminte (car on pénètre dans cette petite maison comme dans un moulin) donne lieu à une nouvelle définition, complétant la première :
ARAMINTEs’adressant au jardinier Mathurin. Bonjour, mon cher ; n’est-ce pas ici ce qu’on appelle une petite maison ?
MATHURIN. C’est une maison qui n’est pas bien grande.
ARAMINTE. Oh ! non ; je m’entends bien… Je me sens dans une joie d’être dans une petite maison, et puis en même temps j’ai une frayeur… on dit…
MATHURIN. Et de quoi, diantre, avez-vous peur ?
ARAMINTE. Enfin donc m’y voilà : il faut que j’aime bien ma nièce pour m’exposer ainsi. J’avais tant entendu parler de cela à feu Monsieur de la Grivoisière… Mais je regarde de tous côtés, il me paraît que cela ressemble à tout ce que je connais. J’avais imaginé…
MATHURIN. Quoi ? Qu’on y entrait par les fenêtres ?
ARAMINTE. Je ne sais, mais je me figurais que ce devait être toutes choses singulières ; de ces inventions galantes ; là, des devises, des emblèmes, des nains comme dans l’ancienne chevalerie, des fausses portes, des trappes, des guirlandes.
MATHURIN. Eh ! mon Dieu, miséricorde, et où est-ce que tout cela tiendrait ?
ARAMINTE. Enfin tout ce qui annonce la galanterie amoureuse.
MATHURIN. Je ne sais pas comme cela était du temps de feu Monsieur de la Grivoisière ; mais pour ce qui est quant à présent, je puis vous assurer qu’il n’y a pas plus de galanterie ici que dans mon œil.
ARAMINTE. Comment, ce n’est point l’amour qui conduit ici de jeunes amants, que les recherches des jaloux…
MATHURIN. Si c’est l’amour qui les y conduit, il faut apparemment qu’il les laisse à la porte.
ARAMINTE. Vous m’étonnez ; et pourquoi donc y venir ?
MATHURIN. Pour voir si le changement de lieu ne remettra pas quelque petit grain d’amitié ; et je ne sais comment cela se fait, mais il arrive toujours le contraire…
Suit une longue tirade où Mathurin révèle à cette dame, qu’il n’a jamais vue, les secrets les plus intimes de ses maîtres. Il est vrai qu’il pense enfin à lui poser la question par quoi il eût dû commencer : « Mais, Madame, dites-moi, s’il vous plaît, ce que vous venez faire ici ? »
La comédie du président Hénault était sans doute bien oubliée quand parurent, en 1763, les quatre tomes des Contes moraux, de J.-F. Bastide – qu’il ne faut pas confondre avec ceux de Marmontel. La plupart des nouvelles composant le recueil avaient été publiées précédemment dans le Mercure ou autres périodiques : entre autres, celle qui a pour titre : La Petite Maison.
Trémicour possède, sur les bords de la Seine, une admirable petite maison. Il en fait les honneurs à son amie Mélite, espérant triompher plus aisément de la demi-vertu d’une jolie femme en des lieux où tout porte à la volupté. La maligne Mélite se joue de cette impatience qu’elle devine et exige qu’on lui montre tout en détail, s’attardant comme à plaisir devant chacune des beautés du logis. D’où, l’inventaire en règle des richesses d’une petite maison : architecture, peinture, sculpture, ameublement, bibelots.
Ce badinage est échafaudé sur une pointe d’aiguille ; mais le style en est vif, précis, délicat. Et c’est à bon droit que le bibliophile Jacob l’a fait entrer dans la collection des « Chefs-d’œuvre inconnus », réimprimés par Jouaust.
Comme il faudrait tout citer, je renvoie le lecteur à cette charmante édition.
Le troisième document littéraire qui nous parle des petites maisons est une nouvelle à tiroirs, œuvre anonyme de la jeunesse de Cailhava, futur membre de l’Institut. Le Souper forme la pièce de résistance des Contes de l’abbé de Colibri, volume souvent réimprimé et dont la meilleure édition fut donnée par Didot le jeune, en l’an VI. Toutefois, l’ouvrage est de 1771. On n’avait pas encore perdu à cette date le goût des petits soupers.
Peu de passages descriptifs dans cette suite de récits pimentés où chacun des convives du Souper rapporte, à son tour, comment il débuta dans la carrière de l’amour physique. On peut noter pourtant ce qui concerne le jardin de la petite maison :
Un parterre simple mais bien dessiné charme l’odorat et les yeux par la diversité des fleurs dont il est orné. Zéphire y trouve Flore plus belle que partout ailleurs. Aussi y soupire-t-il plus agréablement.
Deux petits bois touffus bornent la vue et s’opposent aux regards curieux des voisins. Nous nous enfonçâmes dans celui qui se trouvait à notre droite. Il recélait un bassin dont le cristal répétait jusqu’aux plus petites feuilles…
Le milieu de ce dédale forme un salon de charmille. Tout autour sont pratiqués de petits cabinets parés d’un seul sofa de gazon et d’une tapisserie de chèvrefeuille entrelacé avec du jasmin et des roses…
C’est au bord de ce bassin, c’est dans ce dédale de charmilles que les acteurs du Souper vêtus, ou plutôt dévêtus à la grecque, jouent au jeu érotico-mythologique de Diane se faisant surprendre par Actéon, – un Actéon qui ne se change en cerf que pour mieux poursuivre la déesse, – ou d’Ariane aguichant Thésée dans les méandres du labyrinthe. Au bout de la course, le sofa de gazon.
Pour l’intérieur de la petite maison, même sobriété de détails. Retenons seulement que « chaque meuble y affiche la volupté ; on sent en mettant le pied dans ce séjour enchanté que c’est le temple du plaisir et l’on est dévoré du désir d’y sacrifier, dût-on y servir de victime. »
Une dernière production que j’hésiterais à analyser si la fidélité n’était de rigueur en bibliographie, est un « proverbe » de Mérard de Saint-Just, dont voici le titre un peu long : « Œuvres de la Marquise de Palmarèze. L’Esprit des mœurs du XVIIIe siècle ou la Petite Maison, proverbe en 2 actes et en prose, Traduit du Congo. Il fut représenté à la cour du Congo et il devait l’être en 1776 le jeudi de la première semaine de Carême sur le théâtre de MlleGuimard s’il en faut croire le manuscrit trouvé à la Bastille, le 15 juillet de 1789, IIIe édition. »
Primitivement ce proverbe devait s’appeler : La Folle Journée. Mais l’auteur appréhenda d’être confondu avec Beaumarchais et il modifia son enseigne.
Le scénario en est d’une simplicité touchante. La marquise de Palmarèze a disposé de la petite maison de son amant, le président de Guibraville, pour y faire quelques passades. Elle est interrompue dans ses exercices amoureux par le président qui survient sans crier gare, en compagniede petits-maîtres et de filles de l’Opéra-Comique. Après quelques réticences de pure forme, la grande dame condescend à s’encanailler avec ces espèces et l’orgie va bon train jusqu’à l’entrée soudaine du marquis de Palmarèze, cocu sévère mais juste, qui profitera de l’occasion pour faire mettre sa femme à l’Hôpital.
L’action, qui consiste à nous exhiber la marquise subissant en diverses attitudes la luxure successive du colonel suisse Illacaré, de Mllede Lesbosie, du chevalier Catso di Coulo, de l’abbé de Guérindal, du président de Guibraville, etc., pouvait fort bien se passer de dialogue. La pantomime aurait suffi. Cependant, Mérard de Saint-Just qui se piquait d’avoir des lettres, crut devoir régaler ses lecteurs d’un morceau de style… je n’ose ajouter : de sa façon.
Voici, en effet, comment Discreto, valet du président, et Justine, soubrette de la marquise, ouvrent la pièce :
JUSTINE. Quelle condition peux-tu rencontrer qui soit préférable à la tienne ?
DISCRETO. Cela est vrai.
JUSTINE. Tu as de l’argent tant que tu veux.
DISCRETO. Jusqu’à présent, tous les revenus de mon maître m’ont passé par les mains, et il ne tenait qu’à moi de le ruiner ; mais il n’a besoin de personne pour cela.
JUSTINE. Souvent tu fais la plus grande chère du monde.
DISCRETO. J’en suis las.
JUSTINE. Tu ne vois que des gens heureux.
DISCRETO. Cela devrait être.
JUSTINE. Il est vrai qu’il te faut une discrétion à l’épreuve qui te pèse peut-être beaucoup. Car ton maître étant de robe…
DISCRETO. Et pourquoi mettrait-il plus de mystère qu’un autre ?
JUSTINE. À quoi sert à Monsieur le président d’avoir une petite maison si ce n’est pour cacher ses bonnes fortunes ?
DISCRETO. Lui ! il ne les cache à personne.
JUSTINE. Mais il me semble pourtant avoir ouï dire que les petites maisons des gens comme il faut, n’avaient été inventées que pour y venir à la dérobée, et y attendre les femmes qu’on ne peut voir chez elles sans conséquence.
DISCRETO. Cela était bon du temps du Roi Guillemot : aujourd’hui une petite maison n’est qu’une indiscrétion de plus. On sait à qui elle appartient, ce qui s’y passe, et celles qui y viennent, comme dans une autre maison. Excepté qu’il n’y a pas écrit en lettres d’or sur un marbre, à la porte : Hôtel de Guibraville. D’ailleurs, c’est toute la même chose. Encore la mode en viendra-t-elle peut-être.
JUSTINE. Je t’avouerai, Discreto, que si j’étais un jeune seigneur ou fils d’un riche financier, ce qui revient au même, je m’accommoderais fort bien d’une petite maison. Quelle liberté il y règne ! On y soupe en tête à tête sans scandale.
DISCRETO. En effet ; point de ressource plus sûre pour former un engagement avec décence ; une femme qui se respecte, qui a le cœur tendre, l’esprit libertin, y goûte des plaisirs que n’interrompt jamais l’œil malin du public.
JUSTINE. Aisément j’imagine que rien n’est si charmant que ces petits réduits, aziles des amours et des plaisirs clandestins.
DISCRETO. On ne trouve jamais là de parents au degré prohibé. Aussi jamais de trouble ; la sagesse est consignée à la porte, et le secret qui fait sentinelle ne laisse entrer que le plaisir et l’aimable libertinage.
On a pu observer qu’à part les quatre dernières répliques, tout ce dialogue est audacieusement pillé par Mérard dans la pièce du président Hénault. J’exagérais, en annonçant plus haut quatre fragments imprimés sur les petites maisons ; de bon compte, cela fait trois et demi, tout au plus.
Nous serions donc en peine de nous faire une idée juste des petites maisons, si les documents manuscrits ne venaient à notre aide.
Heureusement pour l’Histoire, Paris possédait alors un lieutenant de police assez enclin à la gaillardise et qui, parvenu à ce tournant de la vie qu’un littérateur célèbre a nommé « l’âge heureux de l’impuissance », aimait à tisonner encore les restes d’un feu mal éteint. M. Berryer avait à ses ordres toute une équipe de mouchards spéciaux, préposés à la surveillance des mauvaises mœurs. Chaque matin, à sa toilette, ce « voyeur » cérébral se délectait aux rapports qui lui étaient fournis par ses limiers sur les débauches de ses administrés des deux et même des trois sexes. Parfois, le soir, il étonnait fort quelque seigneur dela cour en lui contant par le menu les fredaines que celui-ci croyait le mieux cachées .
Ces rapports ont été conservés, ils abondent en détails piquants. En veut-on un échantillon ? L’archevêque de Cambrai, lors de ses passages à Paris, avait l’habitude – tous les goûts sont dans la nature – de prévenir une procureuse qu’elle eût à lui fournir un couple dont il contemplait les ébats, avec une lorgnette, dans une maison sise en face de la sienne. Par exemple, Monseigneur en voulait pour son argent :
Pour satisfaire promptement Son Éminence (dit un rapport de police) la Verville a envoyé dans cette chambre deux femmes, dont l’une avait pris une chemise d’homme, et qui ont imaginé entre elles toutes sortes de postures lubriques ; mais Mgr n’en a point été la dupe et lui a prouvé par une lettre (à la Verville) que son télescope ne pouvait le tromper ; puisqu’il avait très bien remarqué qu’il manquait quelque chose de fort essentiel à l’un des deux champions, et qu’il la priait très fort, sous peine de perdre sa confiance, de lui faire voir à l’avenir un véritable étalon en chantier .
Un homme aussi averti que M. le lieutenant de police ne pouvait manquer de prêter une attention particulière aux petites maisons. Et, de même qu’il savait quel jour, dans une partie fine, à Puteaux, le duc de Grammont avait, au dessert, fait admirer à ses convives les charmes nus de MlleHumblot, de même il n’ignorait point, dès le lendemain, le repas donné, rue Montmartre près les boulevards, par M. Voyer d’Argenson à trois de ses amis et à trois filles, lesquels avaient « soupé comme des cochons et bu comme des diables », au point « qu’il y en avait trois saouls comme des dogues » et que la dernière fille qui resta fut livrée aux laquais .
Parmi les inspecteurs employés au service galant, le sieur Meusnier fut le plus habile à rédiger ces anecdotes. Ilexcellait à en dégager tout ce qu’il importait de savoir : le nom, la fortune, la munificence des personnages. Seigneurs français ou nobles étrangers de passage, étaient « filés » par lui avec une admirable sûreté de direction, avec un flair et un tact remarquables. Leur figure, leur taille, leur âge, jusqu’à leurs signes particuliers ; leur demeure clandestine, son ameublement, le prix du loyer et le prix de la femme ; leurs contrats et ventes, leurs conflits judiciaires, leurs batailles et leurs saouleries, rien n’était omis par Meusnier qui joignait, dans ses rapports, à une observation profonde, le trait pittoresque et le mot pince-sans-rire.
Meusnier n’était point sans culture. Il avait servi d’abord dans les Vivres, puis avait été commis aux Aides, sous les ordres du fermier-général Savalette. C’est dans ce poste que sa mauvaise fortune mit sur sa route la femme qui devait faire le malheur de sa vie. Dès lors qu’il eut épousé Geneviève Longagne, sa maîtresse, celle-ci se livra aux excès d’un tel libertinage qu’il se vit dans l’obligation de la faire enfermer. Ces mésaventures conjugales expliquent assez la rancune qu’il gardait aux femmes en général et l’espèce de satisfaction cynique avec laquelle il détaillait leurs dévergondages.
Inflexible dans ses fonctions autant qu’il était « rosse » dans les termes de ses rapports, Meusnier amassa sur sa tête tant de haines, qu’en mars 1757, tandis qu’il conduisait un prisonnier au château d’If, il périt, assassiné sur la route par le nommé Herment, un de ses clients ordinaires.
L’inspecteur Marais, son collègue, n’est pas moins précieux à consulter. En ses notes de police, il narre à souhait la nouvelle égrillarde et déshabille lestement les gens les plus huppés. Dès 1749, M. Berryer avait fait dresserun « État des maisons galantes qu’aurait à surveiller le sieur Marais ». Trois ans plus tard, celui-ci remit un rapport, par quartiers, « sur les petites maisons situées aux environs de Paris avec les noms des propriétaires et les noms de ceux qui les occupent, le 1er juillet 1752. »
En vous guidant sur ces deux documents et sur les rapports de Meusnier, vous avez entrepris, mon cher Capon, de nous restituer l’histoire vraie des petites maisons. Puissent vos lecteurs prendre autant de plaisir que j’en ai pris moi-même à vous suivre dans ce voyage d’exploration à travers le Paris galant d’autrefois.
Amicalement vôtre,
R. YVE-PLESSIS.
Paris, janvier 1902.