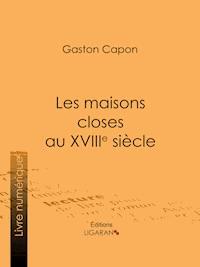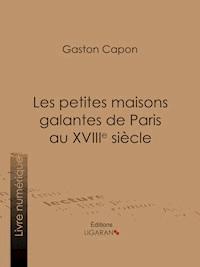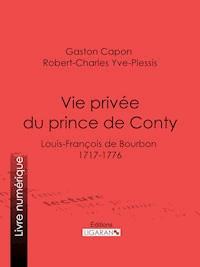
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Extrait : "La lune de miel du prince de Conty s'écoula sans nuages. Il n'était point follement amoureux de sa femme, son mariage ayant été, comme toutes les unions princières, bien plus de convenance que d'inclination. Au mois de juin 1733, sollicité d'accompagner le Roi à Compiègne, Louis-François, sans effort, se séparait de sa jeune épouse qu'il laissait aux soins de la duchesse d'Orléans, à Bagnolet."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pour juger impartialement un personnage historique, rien de tel que de connaître, au préalable, le bien et le mal que disaient de lui ses contemporains. Avant d’entreprendre une relation de la vie privée de Louis-François de Bourbon-Conty, il n’est pas sans intérêt de résumer, d’après une liasse de papiers du temps, l’opinion qu’avaient de ce prince les gens qui l’approchaient.
Nous classerons ces portraits à peu près par ordre chronologique.
En 1740 (Conty a vingt-trois ans), le marquis d’Argenson, qui le déteste cordialement, note cette impression :
M. le prince de Conty a un fonds d’esprit, mais il a la grande sottise de quantité d’affectation ; il outre ce qu’il est ; il joue le libertin, l’étant ; le méchant, le satyrique, l’étant aussi ; et, à tout ce métier-là, il se fera crever et haïr.
En 1745, dans un de ces livres à clé comme il en parut tant au dix-huitième siècle, les Mémoires Secrets pour servir à l’Histoire de la Perse, attribués à La Beaumelle, on trouve cette esquisse sous le nom supposé de Morad-Bakche :
Morad-Bakche (Prince de Conty), fils d’une sœur de Mirza-Haddi (Duc de Bourbon) fut, dans ses jeunes années, un Prince d’une grande beauté et bien fait. Il avoit de l’esprit ; il étoit d’un caractère aimable, et il ne démentit guère, en croissant, les grandes espérances qu’on en avoit conçues. Il étoit brave, aimant le métier de la guerre, vif, jaloux de son rang, mais trop prodigue, défaut qui dérangea ses affaires .
Le prince de Ligne, dans ses Lettres et pensées, étaye et fortifie son sentiment personnel de celui de la mère du prince de Conty :
C’est un composé de vingt ou trente hommes. Il est fier, il est affable, ambitieux et philosophe tour à tour ; frondeur, gourmand, paresseux, noble, crapuleux ; l’idole et l’exemple de la bonne compagnie, n’aimant la mauvaise que par un libertinage de tête, mais y mettant beaucoup d’amour-propre, tenant un peu de M. de Vendôme et du grand Condé ; voulant jouer un rôle, mais n’ayant pas assez de tenue dans l’esprit. Sa mère disait un jour de lui : « Mon fils a bien de l’esprit ; oh ! il en a beaucoup ; on en voit d’abord une grande étendue ; mais il est en obélisque, il va toujours en diminuant à mesure qu’il s’élève, et finit par une pointe, comme un clocher » .
À propos de la campagne de Conty en Italie (1744), Mouffle d’Angerville, auteur de la Vie privée de Louis XV, parue sous l’anonyme en 1777, dit :
C’étoit un prince appliqué et qui, dans la fougue de l’âge et des plaisirs, étoit tourmenté de cet amour de la gloirequi fait supporter le travail le plus pénible et vaincre tous les obstacles .
L’écrivain qui, sous le titre : Fastes de Louis XV, « démarqua » la Vie privée de Mouffle, explique ainsi la retraite prématurée du prince de Conty et son détachement des affaires :
Son aversion pour les gênes de la Cour, son peu d’égards pour les maîtresses de Louis XV l’en ont éloigné depuis et empêché d’être employé selon ses mérites. En général la franchise du caractère du prince de Conty ne sympathisoit point avec celui du monarque qui sentoit la supériorité de cette âme forte et énergique sur la sienne .
Dans une note, rédigée vers 1759 par M. de Paulmy et conservée avec son « portefeuille » aux manuscrits de la Bibliothèque de l’Arsenal, on peut lire :
Il (Conty) est de la plus belle figure ; il a beaucoup d’esprit et la superficie de beaucoup de connoissances. Il est noble, fier, généreux, ennemy dangereux ; bon amy et protecteur zélé dès qu’il affectionne .
D’une villégiature à l’Isle-Adam en 1767, la comtesse de Genlis rapporte toute une collection de notes, petits essais malins, sur les familiers du prince. De l’amphitryon, voici ce qu’elle pense :
M. le prince de Conty étoit le seul des princes du sang, qui eût le goût des sciences et de la littérature, et qui sut parler en public. Il avoit une beauté, une taille et des manières imposantes ; personne ne sut dire des choses obligeantes avec plus de finesse et de grâce et, malgré ses succès auprès des femmes, il étoit impossible de découvrir en luila plus légère nuance de fatuité. Il fut aussi le plus magnifique de nos princes… .
Mme de Genlis ne reproche à Conty que son regard. Il a l’œil trop profond et scrutateur ; quand il vous fixe, on se sent comme paralysé.
Le président Hénault lui consacre ces lignes :
Ce prince né sauvage et en même temps si bien fait pour la société, n’a pu en être séparé d’abord que par timidité ; car il ne faut pas s’y méprendre, le désir de plaire qui tient tant à l’amour-propre et au témoignage favorable que l’on se rend de soi-même, fait qu’on ne veut pas manquer son coup. Mais enfin ses succès l’ont encouragé et il n’y a pas de particulier plus aimable. Nul ne connaît mieux les attentions les plus flatteuses ; ce n’est pas populaire, ni civil qu’il est ; c’est de cette politesse qui n’est restée qu’à lui dans l’âge où nous vivons .
À la mort de Conty les Mémoires secrets, ditsde Bachaumont, constatent :
On s’entretient beaucoup de la mort du prince de Conty qui, par son patriotisme généreux, avoit mérité l’affection des Français .
Enfin un mémorialiste qui a vu le prince de très près, un ami de la comtesse de Boufflers-Rouverel, maîtresse de Conty, le diplomate Dutens, écrit, en 1808, ce panégyrique désintéressé :
M. le prince de Conty étoit l’un des plus aimables et des plus grands hommes de son siècle ; il avoit la taille parfaitement belle, l’air noble et majestueux, les traits beaux et réguliers, la physionomie agréable et spirituelle, le regardfier ou doux, suivant l’occasion ; il parloit bien, avec une éloquence mâle et vive, s’exprimoit sur tous les sujets avec beaucoup de chaleur et de force ; l’élévation de son âme, la fermeté de son caractère, son courage et sa capacité sont assez connus en Europe pour que je me dispense d’en parler ici. Quand il vivoit familièrement avec ceux qu’il aimoit, il étoit simple dans ses manières, mais c’étoit la simplicité du génie ; dans la société, il étoit le premier à bannir toute contrainte ; il s’en trouvoit gêné lui-même, au point d’en témoigner de l’impatience… .
Comment ce prince si remarquablement doué – tous là-dessus sont d’accord – appelé par sa naissance et son intelligence à jouer un rôle politique considérable à une époque où les grands hommes étaient plutôt rares, n’a-t-il laissé qu’une trace presque nulle ? Comment, selon le mot de Sainte-Beuve, est-il, en quelque sorte, « passé à côté de l’Histoire, sans y entrer » ?
C’est que le prince de Conty, simple et bienveillant avec ses inférieurs, se montrait au contraire, avec ceux qu’il estimait être ses pairs, d’une intraitable roideur. C’est qu’il manquait absolument de souplesse dans l’échine ; souplesse nécessaire alors, non seulement devant le Roi, mais encore devant ses favoris, voire ses favorites. Conty, brave, actif, ambitieux, opiniâtre ; généreux jusqu’à la prodigalité et pourtant très entendu aux affaires ; ardent mais réfléchi et voyant de loin ; amoureux des arts, épris du beau sous toutes ses formes ; libertin à l’excès, mais sans jamais se laisser avilir par ses maîtresses ; infatué de son rang quoique philosophe ; indévot sans être athée ; – Conty, esprit complexe, mais caractère droit et tout d’une pièce, professait par-dessus toute chose l’horreur de la bassesse, le mépris de la courtisanerie. Écarté de la faveur du Roi par l’animadversion de Mme de Pompadour, il préféra se hérisser dans son orgueil et vivre exilé de Versailles, brouillé avec Louis XV, même après la mort de sonennemie, plutôt que de tenter un geste de rapprochement qu’on aurait pu prendre pour un acte de soumission. Par son opposition systématique aux hommes de la Cour, il devint le plus populaire des princes. Mais la popularité ne survit pas à son objet et Conty en mourant disparut tout entier, faute d’avoir eu l’occasion de donner la mesure de ses talents.
Naissance de Louis-François de Bourbon-Conty. – Son père putatif, Louis-Armand de Bourbon. – Passe-temps princiers. – Un ménage troublé. – Les amants de madame de Conty. – M. de la Fare, dit « Poupart ». – Éducation du prince. – La mort du père Ducerceau. – Mariage de Louis-François.
Louis-François de Bourbon naquit à Paris, le 13 août 1717, en l’hôtel de Conty, sur le quai qui porte aujourd’hui son nom. Dangeau dit, à cette date : « Le prince dont madame la princesse de Conty vient d’accoucher, ne s’appellera point comte de la Marche ; il aura le nom de prince de La Roche-sur-Yon » .
Dangeau se trompe de bonne foi. Très probablement, le prince de Conty avait-il au mois de juillet l’intention de nommer ainsi son second fils. À ce moment, en effet, son fils aîné, le jeune comte de La Marche, né le 28 mars 1715, vivait encore et deux frères, à supposer que l’enfant qu’on attendait fût un garçon, ne pouvaient pas porter le même titre. Mais le petit prince, valétudinaire et rachitique, mourut le 1er août 1717, douze jours avant les deuxièmes couches de sa mère. Et très certainement cette mort détermina les parents à changer de projet pour donner à Louis-François, devenu l’aîné de leur descendance le titre qui désignait, de père en fils, les héritiers présomptifs de leur nom.
Héritier du nom, Louis-François l’était, à coup sûr. Quant à être le fils de son père et le descendant des Conty, la chose est beaucoup moins probable et la controverse au moins est permise.
Son père putatif, Louis-Armand II de Bourbon-Conty, était un très vilain sire, au moral aussi bien, ou plutôt aussi mal qu’au physique. Bossu par devant et par derrière, plein de tics nerveux, d’une laideur si forte qu’on l’avait, à la Cour, surnommé le « Singe vert », il n’était pas moins méchant que contrefait, pas moins vicieux que hideux. Possible même qu’il fût un peu dément ; car outre son humeur, en tout temps bizarre, il apportait dans la débauche, « sadique » avant le marquis de Sade, certains raffinements qui dénoncent un véritable déséquilibre d’esprit. Ses simples passe-temps étaient volontiers cruels et il semblait faire assaut de férocité avec son jeune parent, le comte de Charolais, cet autre fou dont l’Histoire rapporte des traits à faire frémir… Veut-on savoir comment le prince Armand de Conty se divertissait au bal ?
À l’un des derniers bals de l’Opéra, raconte la princesse Palatine, il s’empara d’une pauvre petite fille récemment arrivée de la province, l’arracha d’à côté de sa mère, la plaça entre ses jambes, et tandis qu’il la tenait d’un bras, il lui appliqua des soufflets et des chiquenaudes, qui lui firent sortir le sang du nez et de la bouche. La jeune personne qui ne lui avait jamais fait de mal, et qui ne le connaissait même pas, pleura à chaudes larmes ; mais il se mit à rire et dit : « Ne sais-je pas bien donner des chiquenaudes » ? Tous ceux qui ont été témoins de cette scène brutale, en ont eu pitié ; cependant personne n’a osé venir au secours de la pauvre enfant ; car on craint d’avoir affaire à ce fou violent : il fait les grimaces les plus affreuses ; moi, qui redoute extrêmement les fous, je tremble quand je me trouve tête à tête avec lui » .
On disait encore de Louis-Armand, s’il faut croire aux Souvenirs de Mme de Caylus, qu’il était « le mary de bien des femmes et la femme de bien des hommes ».
À dix-huit ans, Conty avait épousé, le 9 juillet 1713, en la chapelle du château de Versailles, sa cousine Louise-Élisabeth de Bourbon-Condé, dite mademoiselle de Bourbon, de deux ans plus âgée que lui, femme charmante et très digne d’être aimée de son mari.
« C’est une personne pleine d’agréments, qui joue à la beauté le tour de prouver clairement que la grâce est préférable. Quand elle veut se faire aimer, on ne peut y résister ; elle a des manières agréables, de la douceur et point de mauvaise humeur et dit toujours quelque chose d’obligeant ». Ainsi témoigne d’elle une contemporaine, qui ne pèche point dans ses jugements par excès d’indulgence.
Mais le mariage n’avait modifié ni les goûts ni les habitudes de l’affreux bossu, sinon qu’il ajouta à ses violences ordinaires des accès de jalousie maladive. Il séquestrait sa femme, lui défendait toute société masculine, la menaçait sans cesse, faisait épier ses moindres mouvements, se plaisait à la venir surprendre, au milieu de la nuit, pistolet au poing, sous prétexte qu’elle cachait des amants dans sa chambre à coucher ; et comme il était souvent enflammé de vin, la princesse tremblait que, dans ces crises, il ne se portât à quelque extrémité.
Gardait-il au moins, de son côté, cette fidélité qu’il exigeait de sa femme avec tant de rigueurs ? Une anecdote va nous le peindre tout entier.
Parmi les prostibules de Paris, un des mieux achalandés, à la fin du règne de Louis XIV, était celui des époux Berlier de Montrival, au faubourg Saint-Martin. Ces entremetteurs de condition, vraie noblesse s’il vous plaît, avaient réuni dans leur demeure, magnifiquement meublée, une demi-douzaine de jolies « barboteuses » dont les chroniqueurs du temps nous ont conservé les noms et dont l’aînée n’avait pas plus de vingt ans . La clientèle n’était que de qualité. Ce fut dans cette maison que, malgré le tarif élevé du sérail et la jeunesse des almées, Louis-Armand de Bourbon gagna, l’année qui suivit son mariage, une de ces maladies que les plaisants d’alors nommaient « clou de Saint-Côme » . Le pire est qu’il en fit immédiatement présent à la princesse, sa femme. Non content de porter plainte au lieutenant de police, Conty retourna chez les Montrival avec sa livrée, accompagné d’un garçon boucher qu’il avait habillé de même et muni d’un gros soufflet. Après avoir fait subir mille cruautés à la fille coupable, le prince la livra au boucher qui la souffla par l’anus comme il eût fait d’un veau ou d’un mouton. La malheureuse creva de cette opération terrible. L’affaire, on le pense, s’ébruita et le lieutenant de police, déjà saisi de la plainte de Conty, chercha des responsables. Comme il ne pouvait s’attaquer à un prince du sang, le poids de la vindicte publique retomba sur les tenanciers chez qui s’était commis ce crime étrange. Le 12 mars 1714, le bourreau fustigea publiquement le marquis et la marquise de Montrival attachés au cul d’une charrette, nus jusqu’à la ceinture, et, selon le cérémonial ordinaire, coiffés d’un chapeau de paille. Ce n’est pas le chapeau qui les gênait le plus. Ils furent menés dans cet équipage depuis la prison de la Conciergerie où ils étaient détenus jusqu’à leur hôtel du faubourg Saint-Martin. L’arrêt de la Chambre de la Tournelle qui les avait condamnés à cette peine infamante prescrivait en plus qu’ils seraient bannis de Paris pendant neuf ans « pour avoir fait de leur maison une académie de débauche en corrompant des jeunes filles, pour y attirer des jeunes gens de qualité et autres afin de s’en divertir ». Les Montrival se retirèrent à Rouen où ils continuèrent leur commerce .
Si la vengeance abominable qu’il avait tirée d’une pauvre prostituée avait apaisé le prince, il n’en était pas de même de la princesse. Outragée et souillée, elle résolut de se venger à sa manière et cette manière fut de rendre à son mari trait pour trait, cocuage pour infidélité. Elle prit des amants. Le premier paraît avoir été Georges-Gaspard de Clermont-Gessans, comte de Clermont, marquis de Saint-Aignan, colonel au régiment d’Auvergne et gentilhomme du prince de Conty, qui le logeait dans son hôtel aux appointements de 12 000 livres. Mais le prince s’aperçut vite de la manigance, fit des éclats qui amusèrent la Cour et la Ville, et mit Clermont à la porte, pour donner sa place à Armand-Louis du Plessis, fils du marquis de Richelieu .
D’après Soulavie (Mémoires du duc de Richelieu) le successeur de M. de Clermont dans le cœur de Mme de Conty fut le marquis de La Fare, capitaine des gardes du Régent. Mais nous avons des raisons de croire qu’une autre intrigue fut nouée par la princesse, dans l’intervalle, avec M. de Matignon-Gacé .
Nous avons vu que les éclats du prince de Conty avaient prêté à rire à tout Paris. On chansonnait ferme le jaloux contrefait qui mettait sottement le public au courant de ses déboires conjugaux. Or, deux couplets, différents, du Chansonnier de Maurepas, nomment M. de Matignon-Gacé comme prédécesseur de M. de La Fare :
Chanson, sur l’air : « La Fari don daine ».
Autre Chanson sur l’air des « Cloches ».
À notre compte, le marquis de La Fare ne vint donc probablement que troisième, en l’année 1716, ainsi que l’indiquent très formellement les dates des chansons qui précèdent et de celles qu’on va lire.
Philippe-Charles, marquis de La Fare et comte de Laugère, était né en 1685. Il avait été tenu sur les fonts du baptême, au Palais Royal, par Monsieur et Madame. Lieutenant dans la maison du Roi, il avait eu le régiment de Gâtinais en 1704. Depuis le mois de mai 1712, il était capitaine des gardes du corps de Philippe d’Orléans et il avait été nommé brigadier d’infanterie le 1er janvier de cette année 1716 . Il avait épousé, le 6 août 1713, Françoise Paparel, fille de Claude-François, seigneur de Vitry-sur-Seine, trésorier de l’ordinaire des guerres. Mais Paparel venait d’être condamné à mort pour crime de péculat et ses biens confisqués au profit du Roi. La Fare avait obtenu que son beau-père fût seulement détenu à vie aux îles Sainte-Marguerite et ses biens attribués à lui-même, son gendre. De ce fait, il était puissamment riche, d’autant plus qu’il conservait seul l’administration de cette fortune mal acquise, ayant décidé sa femme à s’enfermer au couvent pour fuir le scandale. Cet homme pratique était un beau cavalier, grand, bien charpenté, auquel on ne pouvait guère reprocher que son obésité précoce et sa face trop ronde. La princesse de Conty l’appelait en riant : son poupart et le sobriquet lui resta. Il passait auprès des femmes pour un médiocre champion dans les tournois amoureux. Ces couplets en font foi :
Chanson sur l’air de « La Fronde », ou : Il a battu son petit frère.
Autre Chanson sur l’air des « Landiris ».
(Extrait d’un) Noël pour 1717.
L’Enfant qui connaît tout dit :
Tous ces vaudevilles prouvent surabondamment que les amours de la princesse de Conty et du marquis de La Fare étaient en quelque sorte publiques. Encore avons-nous négligé de citer une facétie, très goûtée dans les ruelles, qui assignait des logements fantaisistes aux personnes de la Cour. Les satirisants logeaient le prince de Conty, laid et malpropre : « À l’enseigne du Singe vert, à la Savonnerie », et la princesse, sa femme : « Au Poupart, rue du Singe ».
Nul d’ailleurs ne songeait à complaindre le « singe vert » de son infortune. On approuvait plutôt la princesse :
Chanson sur l’air : « Daye, dandaye » ou « L’année est bonne ».
Nous ne nous appesantirons pas plus longtemps sur les querelles scandaleuses du ménage Conty. On en retrouvera les échos dans tous les mémoires de la Régence. Soulavie prétend qu’à La Fare succéda le prince de Soubise qui, lui-même, fut remplacé par M. de Richelieu. Cette fois le prince de Conty, trahi par son propre favori, par l’homme qu’il avait introduit dans sa maison en le substituant à M. de Clermont, déchaîna un tapage infernal. La princesse pour se soustraire aux fureurs de son mari, fit instruire un gros mâtin qui couchait sous son lit et qui en défendait les approches . Enfin, après une scène plus violente que les autres qui se passa le matin de Noël 1721, Mme de Conty, grosse pour la quatrième fois, se décida à quitter le prince et, profitant de ce qu’il était ivre à rouler, se réfugia chez la princesse Palatine, au Petit Luxembourg ; de là, dans un couvent. Les époux se raccommodèrent pourtant lors du mariage du Roi (1723) et reprirent la vie commune qui fut, jusqu’à la fin, traversée par des orages fréquents, car la princesse ne cessait point de voir M. de Richelieu .
Revenons, en 1717, à la naissance de Louis-François, comte de la Marche, futur prince de Conty. À cette époque, la princesse était, depuis plus d’un an, la maîtresse du marquis de La Fare. Personne n’hésita à attribuer le poupon au Poupart .
À l’inverse de son aîné, cet enfant d’ailleurs était superbe. Le chirurgien Clément l’ayant, à la demande de la mère, examiné pour savoir s’il était né viable, le trouva conformé à souhait. Il se rendit chez le prince et lui dit naïvement : – « Monseigneur, j’ai examiné la taille du prince qui vient de naître. Il est droit. Faites-le coucher sans chevet, pour qu’il reste ainsi. Songez quel chagrin ce serait pour la princesse qui a fait ce prince droit si vous le rendiez tortu et bossu ». Le prince de Conty aurait bien voulu parler d’autre chose. Mais Clément, sans y entendre malice, le ramenait toujours à ses moutons : – « Songez qu’il est droit comme un jonc. Ne le rendez pas tortu et bossu, Monseigneur ». Le prince de Conty, n’y pouvant plus tenir, prit le parti de la fuite .
La prime jeunesse du comte de La Marche s’écoula sans incidents. Livré aux femmes, ainsi que tous les bambins de son âge et de son rang, il grandit et prospéra en force et en santé tandis que s’étiolait et dépérissait son cadet, Louis-Armand, duc de Mercœur, venu au monde en 1720 . Quand il eut quatre ans, on le baptisa. Il eut l’honneur d’être tenu sur les fonts par son grand cousin, Sa Majesté le roi de France. Le Mercure, en ces termes, relata l’évènement :
Avril 1721. – Le 23, le Roy entendit la Messe chantée par sa musique, après laquelle M. le comte de La Marche, Prince du sang, fils de Louis-Armand, Prince de Conty, reçut les cérémonies du baptême ; ayant le Roy pour parrain et Madame pour marraine ; et il fut nommé Louis. M. le duc d’Orléans et toute la Cour assistèrent à cette cérémonie, qui fut faite par M. l’évêque de Metz, premier aumônier, en présence du curé de St-Germain-l’Auxerrois.
À l’instigation de la princesse de Conty, seconde douairière, de qui le directeur de conscience appartenait à la compagnie célèbre fondée par Ignace de Loyola, Louis-François, quand il fut en état de commencer ses études classiques, fut placé au collège Louis-le-Grand. Il avait neuf ans. Il est assez curieux de constater que ce prince qui devait être dans la suite le plus indévot de sa race et qui, seul peut-être de tous les Bourbons, mourut sans confession, fut éduqué par les Jésuites. Il est vrai que Descartes et Voltaire qui ne se signalèrent point comme des modèles de piété, étaient élèves des mêmes maîtres.
La princesse de Conty, dit Mathieu Marais (décembre 1726) a voulu voir son fils aux Jésuites. Elle a parlé aux RR. PP. et leur a dit qu’elle leur donnerait aussi le second, mais qu’il étoit bien vif et que, d’abord qu’il voyoit une fille, il se jetoit dessus et lui prenoit les tétons. Le P. Sanadon lui a répondu : « Donnez-nous-le, Madame, nous lui ferons bien changer de caractère » .
C’est durant son séjour au collège, que le comte de la Marche devint prince de Conty, par le décès de son père survenu le 4 mai 1727. Louis-Armand de Conty n’avait que trente-deux ans ; mais il avait usé sa vie, hâté sa fin, par ses débauches de tout genre. Il mourait riche et n’était point de ceux qu’avait ruinés le Système, bien au contraire. Ayant su réaliser à la hausse ses actions de la banque de Law sur les brouillards du Mississippi, il avait gagné, en un seul jour, la somme ronde de quatorze millions de livres . Son fils se chargerait d’écorner cette fortune.
Le jeune prince de Conty que nous appellerons dorénavant ainsi, serait vraisemblablement resté à Louis-le-Grand jusqu’au terme de ses humanités sans un beau trait de dignité du Père Porée, professeur de rhétorique à ce collège . Louis-François était pensionnaire. On était alors dans l’usage, quand il s’agissait d’enfants de la très haute volée, que le professeur allât chercher lui-même son élève en son quartier pour l’amener à la classe et qu’il le reconduisît de sa classe au quartier, afin d’éviter les familiarités et quelquefois les vivacités des autres élèves. Le Père Porée s’entêta à refuser cette attention au prince son disciple. Il soutenait qu’un maître ne devait aucun égard à un écolier quelle que fût sa naissance et menaça de ne plus professer si on voulait l’assujettir à une déférence qu’il jugeait humiliante.
La fermeté du professeur fut cause que Louis-François sortit du collège. La princesse de Conty, seconde douairière, très entichée de son nom, ne put digérer la fierté intempestive de ce pédagogue et elle retira son petit-fils, malgré tous les efforts faits pour le retenir par les chefs de l’établissement .
L’auteur du libelle auquel nous empruntons ce détail ajoute :
Le prince de Conty ne fut pas fâché de l’évènement (sa sortie de Louis-le-Grand). Ennuyé d’être renfermé dans les murs d’un collège et d’être soumis aux règles d’une vie monotone, d’obéir dix fois le jour au son d’une cloche, il rentra avec joie dans le sein de sa famille.
Dès lors il renonça aux livres et à l’étude pour se livrer à des dissipations qui étaient plus de son goût et de son âge. Son inclination se tourna du côté des armes, il apprit la malice de l’épée sous les premiers maîtres d’escrime. Il parvint à un degré de force et de subtilité qui le mettoit en état de se mesurer avec les spadassins les plus redoutés.
Il partageoit ses instants entre les plaisirs de la chasse et la société des femmes qui savoient qu’il falloit le dispenser des soupirs .
Cela n’est pas tout à fait exact, ainsi qu’on va le voir et le libelliste se trompe complètement lorsqu’il écrit que la princesse de Conty fut irritée de la fierté du Père Porée au point qu’elle ne voulut plus recevoir chez elle de Jésuites et qu’elle témoigna son ressentiment à son confesseur en lui ôtant la direction de sa conscience. La princesse gardait si peu rancune aux Jésuites de l’opiniâtreté d’un des leurs, qu’elle choisit comme précepteur, pour continuer en famille l’éducation du prince, précisément un autre Jésuite, le Père Ducerceau.
Jean-Antoine Ducerceau n’avait point la valeur du Père Porée, comme éducateur. Mais il était peut-être plus réputé, à cause de ses comédies qu’on jouait un peu partout en France, dans les collèges. Il était surtout plus répandu, plus mondain. Il collaborait au Mercure et on le citait comme l’auteur des factums remarquables composés pour ses collègues dans la fameuse affaire de Brest, qui occupa l’opinion, de 1717 à 1723. C’était un homme aimable et lettré, qui n’avait d’autre tort que de se croire un grand poète et de vouloir embrasser tous les genres littéraires. Il était, en tout cas, excellent professeur et la renommée qu’il s’était acquise dans l’art de former d’habiles élèves lui valait d’être appelé à surveiller les études du Prince. Hélas ! il ne les surveilla pas longtemps.
En 1730, le Prince revenait avec sa mère d’une tournée dans le Midi qui avait été une suite ininterrompue de fêtes et de galas. À Carpentras par exemple, où ils arrivèrent le 22 mai, la princesse de Conty et son fils avaient été reçus par l’évêque, porté à leur rencontre dans un carrosse à six chevaux. À une lieue de la ville, ils avaient été salués par le corps des maîtres-marchands, quarante hommes parfaitement montés, tous en habit rouge, avec des bandoulières aux couleurs des Conty, qui s’étaient offerts à leur servir de gardes du corps. Et c’est précédés de trompettes, de timbales et d’un étendard à leurs armes qu’ils avaient fait leur entrée dans la ville, au bruit des boîtes d’artifices et des décharges de mousqueterie . À Marseille, la réception n’avait pas été moins pompeuse et le jeune Prince, promu par le Roi chevalier du Saint-Esprit au mois de février dernier, le jour de la Chandeleur, avait pu faire admirer aux populations méridionales, sous les arcs de triomphe et les guirlandes de verdure, le cordon bleu qu’il étrennait avec un naïf orgueil.
De retour au mois de juin, on était allé se reposer à la campagne des fatigues de ce voyage, en Touraine, au château de Véretz qui appartenait à M. du Plessis-Richelieu. Dans la matinée du 4 juillet, le Père Ducerceau se promenait à travers le parc avec son élève. Celui-ci venait d’obtenir de sa mère son premier fusil de chasse qu’elle lui avait longtemps refusé. Ivre de joie, il tournait, retournait en tous sens l’arme qui était chargée… Soudain le coup part et le précepteur tombe roide, tandis que Louis-François se sauve affolé en criant : « J’ai tué le Père Ducerceau ! » On chercha à celer la cause de ce lamentable accident et l’on raconta que le Jésuite était mort d’apoplexie . Mais la vérité perce toujours à la longue.
Et, plus tard, les ennemis de Conty lui reprocheront comme un crime volontaire ce qui n’était qu’un malheur imputable à la pétulance de la jeunesse et, bien plus encore, à l’imprudence de ceux qui avaient mis une arme à feu aux mains d’un enfant de douze ans et demi .
Le Père Ducerceau fut immédiatement remplacé auprès de Louis-François par le Père Simon de La Tour, également Jésuite, professeur de philosophie à Tours et, plus tard, principal du collège Louis-le-Grand . C’est seulement à cette époque, c’est-à-dire, vers l’âge de treize ans et demi que le prince commença, selon l’expression du libelliste par nous citée plus haut, « à se livrer à des dissipations » qui étaient plus de son goût. Entendez par là que tout en terminant ses humanités, il acquit les connaissances jugées alors indispensables à tout gentilhomme, en équitation, en gymnastique, en escrime, etc. Le directeur de cette éducation physique fut le capitaine des chasses du feu prince de Conty, un colonel réformé, nommé Ricard de la Chevaleraye. C’était, à l’opinion du cardinal Fleury, un méchant homme, athée, esprit fort et libertin . Son élève pensait autrement de lui puisqu’il lui accorda pour son fils la survivance de son emploi de capitaine des chasses et que ce fils, Edouard-Gédéon de la Chevaleraye, mourut au service du prince, en 1746, à L’Isle-Adam, où nous avons retrouvé son nom sur les registres de l’état civil. L’enseignement du colonel fit de Louis-François un cavalier remarquable, un chasseur intrépide, et surtout un escrimeur émérite. Le prince fréquenta aussi l’Académie Du Gard, où il se perfectionna.
À Paris, sous Louis XV, les Académies tenaient la première place pour l’instruction de la noblesse. L’élève y entrait vers treize ou quatorze ans ; « des écuyers habiles le conduisaient au manège ; des maîtres en mathématiques le fortifiaient dans les équations et le guidaient dans les ténébreuses difficultés des problèmes compliqués et des théorèmes transcendants ; le maître à dessiner l’initiait aux merveilles des couleurs, des pastels, des crayons et des lavis ; le maître à danser lui apprenait la bonne tenue, la grâce du menuet ou de la pavane ; et le maître en fait d’armes lui montrait l’élégance du salut, le rompait aux fatigantes leçons et aux violents assauts dans le bruit des appels et le cliquetis des lames qui se froissent ? » .
Il y avait à Paris trois Académies : celles de Vaudeuil, rue des Canettes ; celle de La Guérinière, rue de Vaugirard, auprès du Luxembourg et celle des Du Gard, père et fils, rue de l’Université. Cette dernière, fondée en 1725, était la plus recherchée des trois, et les spectacles qu’elle donnait étaient fort appréciés. Le public y assistait aux courses de bagues et de têtes avec la lance et l’épée ; on y admirait les exercices de haute école de la fille de Du Gard, montant et conduisant son cheval d’une façon admirable. Elle récolta jusqu’aux bravos du cardinal Bentivoglio, tant elle surpassait les autres élèves dressés pourtant par le même maître, son père.
Le prix de la pension dans cette Académie était plus élevé que dans les deux autres. La règle était :
Les exercices des armes qui se faisaient l’après-midi, étaient enseignés par Le Perche cadet.
Mais en outre des internes, l’Académie des Du Gard était fréquentée par une clientèle princière qui venait simplement suivre les leçons, comme aujourd’hui dans les salles d’armes. C’est chez Du Gard que le prince de Conty eut avec le prince d’Épinoy une petite dispute qui se termina par une mystification, que Soulavie nous paraît prendre un peu bien au tragique . Voici le récit de cet auteur :
Une autre fois, allant à l’académie de du Guat (Du Gard), ce prince donna un coup de baguette au prince d’Épinoy, qui ne le prit point en badinant. Conty, voyant que d’Épinoy se fâchoit, recommença ; et celui-ci, pour le faire cesser donna au prince un coup de chambrière assez fort pour lui faire beaucoup de mal : le prince dont la fureur augmentoit à mesure que d’Épinoy montroit son mécontentement, alloit le tuer quand on l’arrêta.
Pour se venger d’une autre manière, il mena d’Épinoy à L’Isle-Adam et le fit loger dans une chambre préparée pour lui jouer un tour terrible ; il fit placer derrière une tapisserie mobile une rangée de têtes de mort éclairées par des bougies allumées dans les têtes, et l’appareil fut préparé de telle manière que, par le moyen de diverses coulisses, les spectres hideux avançoient ou reculoient à volonté. D’Épinoy s’étant endormi, on tira les rideaux ; on fit avancer l’épouvantable machine avec toutes ces rangées de têtes lumineuses. On croyoit encore aux revenants ; et d’Épinoy qui avoit perdu son père depuis peu, en fut si saisi de terreur qu’il s’efforça de l’appeler et qu’il ne le put jamais. Frappé de stupeur et d’effroi, il ne put articuler une seule parole Revenu à lui, il appela ses gens et se traîna dans une autre pièce tandis qu’on profitoit de son absence pour fermer les rideaux de son lit et remettre la tapisserie bien tendue comme auparavant. Tout le château ayant accouru au bruit qu’il fit, on fut étonné de voir d’Épinoy si alarmé pour un songe. D’Épinoy se laissa persuader qu’il avoit été travaillé d’un rêve bien orageux ; mais il en eut une maladie pendant laquelle le prince de Conty, qui n’en fut loué ni applaudi, racontoit cette cruelle aventure .
Cependant Louis-François allait sur ses quinze ans ; fils aîné, il était aussi fils unique depuis la mort prématurée du comte d’Alais, son cadet ; il était grand et vigoureux ; on voulut marier sans plus attendre ce précieux rejeton de sa race, qui seul pouvait désormais préserver le nom des Conty de s’éteindre. La princesse, sa mère, qui cherchait une alliance capable d’honorer sa maison, la trouva telle chez les Orléans, en la personne de mademoiselle de Chartres, Louise-Diane d’Orléans, fille de feu le Régent. Louis-François étant, par sa mère, neveu de Monsieur le Duc (Bourbon-Condé), les Condé et les Conty, par ce mariage, se rapprochaient encore du trône, puisque mademoiselle de Chartres était arrière-petite-fille de Louis XIII et le Roi arrière-petit-fils de Louis XIV.
Louis XV ayant donné son agrément à cette union, fixa lui-même la cérémonie des épousailles au 22 janvier 1732. Le marié avait exactement, ce jour-là, quatorze ans, cinq mois et neuf jours ; la mariée, née le 18 juin 1716, était âgée de quinze ans, sept mois et quatre jours. Elle fut baptisée à Versailles le 19 janvier, avant-veille de son mariage, auquel, par ordre du Roi, le marquis de Dreux, grand maître des cérémonies, invita, de la part de Sa Majesté, les princesses et les princes du sang ainsi que les princes légitimés .
Le 21 au soir, jour de la signature du contrat et des fiançailles, les Princes se trouvèrent vers les six heures dans le cabinet du Roy, où la Reine, avertie par le grand maître des cérémonies, arriva quelque tems après, étant accompagnée des Princesses et Dames de la cour qui s’étoient rendues dans son appartement. Le prince de Conty donnoit la main à Mlle de Chartres, dont la mante était porté par Mlle de Sens . Lorsque le contrat de mariage eut été signé de Leurs Majestés et des Princes et Princesses qui étoient dans le cabinet du Roy, le cardinal de Rohan fit les fiançailles ; Monseigneur le Dauphin et Mesdames de France étoient auprès de Leurs Majestés pendant cette cérémonie.
Le 22, au midi, le Roy et la Reine précédés du grand maître et de l’aide des cérémonies et accompagnés des Princes et Princesses, allèrent à la chapelle et lorsque Leurs Majestés furent arrivées le Duc d’Orléans, la Duchesse de Bourbon, douairière, le Duc et la Duchesse de Bourbon, le Comte de Charolais, le Comte de Clermont, la Princesse de Conty, troisième douairière, Mlle de Beaujolais, Mlle de Charolais, Mlle de Clermont, Mlle de Sens et Mlle de la Roche-sur-Yon, prirent leurs places suivant leur rang, à la droite et à la gauche du Roy et de la Reine ; le Prince de Dombes, le Comte d’Eu et le Comte et la Comtesse de Toulouse se placèrent derrière les princes et princesses du sang. Madame la Duchesse d’Orléans n’ayant pu accompagner Leurs Majestés étoit dans la tribune, ainsi que le Duc de Chartres. Le Prince de Conty et Mlle de Chartres qui précédoient le Roy dans la marche, s’étoient avancés en entrant dans la chapelle jusqu’au près de l’autel. Leurs Majestés suivies des Princes et Princesses s’en étant approchées, le Cardinal de Rohan fit la cérémonie du mariage, en présence du curé de la paroisse de Versailles, qui, la veille, avoit assisté aux fiançailles.
Le soir Leurs Majestés soupèrent en public avec les Princesses, dans l’appartement de la Reine ; la Duchesse de Bourbon, douairière, la Princesse de Conty, troisième douairière, Mlle de Beaujolais, Mlle de Clermont et Mlle de la Roche-sur-Yon étoient à la droite de Leurs Majestés. La Duchesse de Bourbon, la Princesse de Conty, Mlle de Charolais, Mlle de Sens et la Comtesse de Toulouse étoient à la gauche. Après le souper, le Roy fit l’honneur au Prince de Conty de lui donner la chemise, et la Reine fit le même honneur à la Princesse de Conty.
Le lendemain, après-midi, Leurs Majestés allèrent voir la Princesse de Conty, qui reçut le même jour la visite de Monseigneur le Dauphin et de Mesdames de France, et de tous les Princes et Princesses. Il y a très longtems que la Cour n’avoit paru si brillante et si nombreuse. On ne peut rien ajouter à la magnificence des habits, pour lesquels les plus riches étoffes et du meilleur goût ont été employés, relevées encore par l’éclat des pierreries .
En somme, hors la pompe des habits et la qualité des témoins, il n’y eut, à l’occasion de ce mariage, aucune réjouissance spéciale à la Cour. Le soir, la comédie se donna ainsi qu’à l’ordinaire, et c’est seulement après le spectacle que le Roi offrit à souper, chez la Reine, à la mariée et à neuf dames, tant princesses que duchesses.
On remarquera que seule la princesse de Conty, troisième douairière, c’est-à-dire la mère du marié, assistait à la cérémonie. La seconde douairière, Marie-Thérèse de Bourbon, veuve du Grand Conty et grand-mère de Louis-François, était alors trop malade pour subir ces fatigues ; elle mourut un mois jour pour jour après les noces, le 22 février. Quant à la première douairière, grand-tante du marié, la fille légitimée de Louis XIV et de Mlle de Lavallière, la grande Conty, ainsi qu’on l’appelait à la Cour à cause de sa haute taille, nous ignorons le motif de son absence…
Le prince de Conty et Mlle Quoniam. – Guerre de la succession de Pologne. – Naissance du comte de La Marche. – Mort de la princesse de Conty, la jeune. – Retraite du Prince à L’Isle-Adam. – Guerre de la succession d’Autriche. – Départ subreptice pour l’armée. – Conty général en chef en Italie et en Allemagne. – La campagne des Flandres. – Démêlés du Prince avec le maréchal de Saxe.
La lune de miel du prince de Conty s’écoula sans nuages. Il n’était point follement amoureux de sa femme, son mariage ayant été, comme toutes les unions princières, bien plus de convenance que d’inclination. Au mois de juin 1733, sollicité d’accompagner le Roi à Compiègne, Louis-François, sans effort, se séparait de sa jeune épouse qu’il laissait aux soins de la duchesse d’Orléans, à Bagnolet .
Sous la tutelle de son gouverneur La Chevaleraye, le prince avait eu déjà des maîtresses d’occasion ; il continua d’en avoir, étant marié. La première dont la chronique nous ait transmis le nom lui fut comme léguée par son oncle, le prince de Bourbon-Condé, comte de Clermont, qui, bien qu’abbé et renté, à ce titre, de 200 000 livres de bénéfices, ne menait pas une conduite édifiante. Clermont devait plus de deux millions dans Paris et changeait souvent de maîtresse. Pour l’instant, il avait à sa solde une jolie brune, la demoiselle Quoniam, qu’il avait quittée et reprise deux ou trois fois. Mais, depuis peu, il venait de se charger de Mlle Camargo, danseuse à l’Opéra, et il cherchait quelque soulagement à ses finances tant obérées. Au cours d’un souper avec le prince de Conty, il proposa à son neveu de lui céder Quoniam et la proposition fut agréée par les intéressés d’un commun accord aussi simplement qu’elle avait été faite. Louis-François n’était pas à l’âge prudent où l’on entoure ces liaisons de mystère. Tout Paris sut, au bout de huit jours, que la Quoniam était au prince de Conty. Et la chose parvint aux oreilles de la duchesse d’Orléans douairière, qui donnait dans la grande dévotion, et ne cacha pas son mécontentement. Comme, d’autre part, Mlle Quoniam fut quelques semaines sans se montrer en public, le bruit s’accrédita dans le beau monde qu’elle avait été enlevée de force par ordre du duc d’Orléans et séquestrée en lieu sûr. Bruit mal fondé : on le vit bien, lorsque Quoniam reparut avec éclat, dans les premiers jours de juillet :
Dimanche 5 (dit l’avocat Barbier), Mlle Quoniam alla à l’Opéra, dans une loge, et aussitôt qu’elle fut aperçue des jeunes gens du parterre, ils claquèrent des mains pour marquer la joie publique sur la fausseté de la nouvelle. Le soir, elle alla aux Tuileries, où étoient toutes les princesses de la maison de Condé, ce qui faisoit faire une haie quand elles passoient. On en faisoit une pareille sur le passage de Mlle Quoniam, à qui on faisoit un compliment général par gaîté .
Aussi bien, les évènements politiques allaient fournir aux Orléans le sûr moyen de détacher Conty de sa maîtresse sans rigueurs inutiles. Frédéric-Auguste, roi de Pologne, étant mort en février, Stanislas Leckzinski, ancien roi détrôné et beau-père de Louis XV, avait essayé de récupérer sa couronne. Mais la Russie et l’Autriche avaient contrecarré ce projet et Stanislas, quoique régulièrement élu par la diète des magnats polonais et ouvertement appuyé par la France, avait dû fuir devant les armées russes. L’insulte exigeait réparation. Après s’être assuré de la neutralité de l’Angleterre et de celle des Pays-Bas, Louis XV se rapprocha de l’Espagne et forma une alliance où entra la Sardaigne.
On ne pouvait songer à attaquer les Russes, perdus là-bas dans leurs glaces. Les alliés décidèrent de faire porter sur l’Empereur tout le poids de leurs armes. Le roi de France se chargea seul de mâter l’Autriche et d’aider le roi de Sardaigne en Lombardie, pendant que le roi d’Espagne ferait la conquête des Deux-Siciles. La guerre fut déclarée par un acte du 10 octobre 1733, dans lequel Sa Majesté Très Chrétienne ordonnait à tous Français « de courre sus aux sujets de l’Empereur ».
L’occasion s’offrait propice aux parents de Louise-Diane d’Orléans pour éloigner de Paris le prince de Conty en l’expédiant à la frontière. Le cardinal Fleury, omnipotent sur l’esprit du Roi depuis la disgrâce de M. le Duc, entra d’autant plus volontiers dans le plan des Orléans que, parmi tous les princes, Conty et Charolais étaient, avec le duc du Maine, ceux qu’il détestait et redoutait le plus . À la suggestion de son ministre, le Roi désigna premiers Charolais et Conty pour suivre le maréchal de Berwick sur le Rhin.
Conty accueillit avec transports l’ordre royal, ne pensa plus à Mlle Quoniam et ne s’inquiéta que de son équipement. Quoi de plus charmant que la guerre pour un colonel de seize ans ? Mais sa tante, Mlle de la Roche-sur-Yon, qui avait de la religion, estima nécessaire d’appeler sur cette première campagne de Louis-François les bénédictions célestes en l’associant à quelque œuvre pie. Presque à mi-chemin, entre le village de L’Isle-Adam dont Conty était seigneur châtelain et le village de Vauréal dont elle-même était baronne, se dresse, dominant l’Oise, le haut clocher de l’église Saint-Maclou, perle architecturale de Pontoise. Mlle de la Roche-sur-Yon voulut offrir à Saint-Maclou une cloche dont elle serait marraine et dont son neveu serait parrain. Cette cloche, la plus grosse de l’église, fut commandée au maître fondeur Renault, de Paris, qui cisela dessus cette inscription, en relief :
« L’an 1733, je fus nommée Louise par très haute, très puissante et très excellente princesse Louise-Adélaïde de Bourbon-Conty de la Roche-sur-Yon, princesse de sang royal, dame baronne de Veauvrolle [ Vauréal ] et autres lieux et par très haut, très puissant et très excellent prince Son Altesse Monseigneur Louis-François de Bourbon, prince de Conty, prince du sang, pair de France, chevalier des ordres du Roy, lieutenant-général de ses armées et gouverneur pour S.M. des provinces du haut et bas Poitou, etc. » .
Tandis que le vieux Villars se disposait, en Italie, à se rendre maître du Milanais, le maréchal de Berwick gagnait le Rhin, où il donnait le signal des opérations. Son armée, qu’on appelait « l’armée des princes », parce qu’elle comptait, outre Conty et Charolais, le prince de Dombes, le comte d’Eu et le comte de Clermont qui avait obtenu un bref du Pape lui permettant de porter les armes, passa le fleuve le 14 octobre 1733. Le 12, le maréchal avait détaché en avant le comte Maurice de Saxe, entré depuis peu au service de la France.
Le soir même du 14 octobre, le fort de Kehl était investi. Après douze jours de tranchée, les assiégeants tentèrent un assaut général qui ne réussit pas. L’attaque fut remise au 28. Mais le général Phul, qui commandait le fort, fit battre la chamade le 27 et la capitulation fut signée le lendemain. Nous n’avions perdu que cent cinquante hommes. Encore, sur ce nombre, étaient quatre-vingts soldats qui furent pendus pour avoir maraudé malgré les défenses expresses du maréchal.
C’est que M. de Berwick était inexorable sur ce point de discipline. Le lendemain du jour que ses troupes avaient passé le Rhin, il avait fait publier un ban à la tête de l’armée, interdisant sous la peine capitale aux soldats d’aller en maraude et de faire aucun dégât. Certains pourtant contrevinrent à l’ordre. Ils auraient tous été pendus si le prince de Conty n’eût intercédé pour ceux de son régiment. Et ce ne fut qu’après s’être bien fait prier que le maréchal accorda au jeune colonel la grâce de faire tirer les coupables au sort pour n’en brancher qu’un seul . On ne reconnaît guère, dans cette intervention de Conty, la « terrible adolescence » dont parle Soulavie.
L’hiver s’annonçait exceptionnellement pluvieux. On pataugeait nuit et jour dans la boue. Les opérations militaires étaient paralysées. Le maréchal de Berwick laissa le commandement à son plus ancien lieutenant-général, M. de Quadt, et reprit, le 20 novembre, la route de Paris, avec les princes de son état-major. M. de Quadt, devant la persistance des pluies qui comblaient nos ouvrages, repassa le Rhin et prit, sur la rive gauche, ses quartiers d’hiver qui furent à peine troublés par quelques escarmouches de cavalerie. On aimait, en ce temps-là, se battre au sec, avec toutes ses aises.
Le prince de Conty, rentré à Paris fin novembre, avait totalement oublié Mlle Quoniam et il donna à la princesse sa femme des preuves immédiates de sa tendresse, puisqu’en mai suivant, lorsqu’il repartit à l’armée du Rhin, il la laissait enceinte de cinq mois.
L’opération capitale de notre campagne de 1734 en Allemagne fut, après une série de marches savantes à tromper le prince Eugène lui-même, la prise de Philipsbourg, qui fut investi le 25 mai et qui capitula le 18 juillet. Conty escortait, avec les autres princes, le maréchal de Berwick, lorsque celui-ci, le 8 juin, reconnut les abords de la place pour l’endroit de la première attaque. C’est encore le régiment de Conty qui descendait de la tranchée, le 12 juin, quand un boulet tua net M. de Berwick. Cette mort n’arrêta pas les travaux du siège et le commandement passa à M. d’Asfeldt, promu maréchal de France, en même temps que Conty était nommé maréchal-de-camp. La Gazette de France signale les « grands exemples de valeur » que donnèrent les princes lors de l’assaut de l’ouvrage couronné, le 14 juillet .
Sans attendre le reste de l’état-major qui abandonna l’armée vers le milieu de septembre, à cause du mauvais temps, Louis-François regagnait Paris au mois d’août, par permission spéciale du Roi, pour assister aux couches de la princesse.
Le 1er septembre 1734, à huit heures du soir, naquit Louis-François-Joseph, le nouveau comte de La Marche. La délivrance de Mme de Conty fut laborieuse. La princesse resta plus de quatre heures dans un travail douloureux et risqua d’y perdre la vie. Pendant ces crises, on agitait secrètement sur le parti à prendre. Le chirurgien-accoucheur ne savait à quoi se résoudre. Il se faisait fort de délivrer la mère en sacrifiant l’enfant ou de sauver l’enfant aux dépens de la mère. Mais on voulait épargner l’un et l’autre. Dans cette perplexité, le prince de Conty, témoin des souffrances de la princesse et de l’embarras de l’opérateur, fut consulté. Partagé entre la tendresse conjugale et la tendresse paternelle, également attaché à la conservation de sa femme et de son fils, il vit sa sensibilité mise à une rude épreuve. Un effort de la nature, aidé par la dextérité de l’accoucheur, calma enfin ses angoisses .
Louis-François-Joseph, né si difficilement, était d’une complexion débile et plusieurs fois, dans son jeune âge, il ne dut la vie qu’aux soins constants de sa nourrice.
La princesse de Conty ne se remit jamais complètement de cette précoce et pénible maternité. Pourtant, malgré son état de langueur, on la croyait hors de danger lorsque le Prince endossa le harnais pour retourner à l’armée d’Allemagne, sous les ordres, cette fois, de M. de Coigny.
Malgré l’emploi subalterne de Louis-François, sa conduite au siège de Philipsbourg avait attiré sur lui l’attention publique. Un poète de carrefour salua son départ de ce quatrain prometteur :
En dépit de ces pronostics, la campagne de 1735 fut peu fertile en évènements militaires. Des bruits de prochaine paix commençaient à se répandre et les généraux, sentant venir les diplomates, restaient dans une prudente expectation. L’armée du roi de France borna son action à une promenade militaire du camp de Weinholsheim à celui de Bermesheim, du camp d’Eppenheim à celui d’Oguersheim. L’avancement d’ailleurs ne souffrit point de cette espèce d’armistice et, le 18 juillet, Conty ceignit l’écharpe de lieutenant-général. On sait comment les pourparlers, engagés tandis que nos soldats prenaient leurs quartiers d’hiver, aboutirent en 1788 au traité de Vienne qui, en échange de la renonciation de Stanislas Leczinski au trône de Pologne, lui accordait les duchés de Lorraine et de Bar, réversibles sur la couronne de France.
La guerre terminée, Conty reprit à Versailles son rôle de prince du sang. Nous l’apercevons aux côtés du Roi à toutes les cérémonies où l’appelle son rang. Quand il ne chasse pas dans le parc avec Sa Majesté, quand il ne passe point sur la place d’armes quelque revue des mousquetaires, il assiste aux processions dont Louis XV est friand ; il sert les plats sur la table royale en compagnie des autres princes, à la Cène traditionnelle de la semaine sainte ; les soirs d’Opéra, il a son pliant dans la loge du monarque et son couvert est mis aux soupers des petits cabinets .
Un deuil cruel interrompit ces travaux d’étiquette. La princesse de Conty, la jeune, succomba aux suites de ses couches le 26 septembre 1736. Elle mourut au château d’Issy, propriété des Conty, à onze heures du matin, et fut inhumée le 2 octobre dans l’église Saint-André-des-Arcs, à Paris. Son cœur, placé dans une urne, fut porté à la Chapelle du Val-de-Grâce. La veille de l’inhumation, Mlle de Clermont, nommée par la Reine pour aller jeter l’eau bénite sur le corps de la défunte, s’acquitta de cette mission avec tout l’apparat et toute la minutie désirables.
Mlle de Clermont, dit le duc de Luynes, partit de Versailles dans son carrosse avec Mme la duchesse de Boufflers, Mme la comtesse de Mailly (dames du palais de la Reine) et Mme de Ribérac, sa dame d’honneur. Elle étoit habillée en grand deuil, avec une mante de sept aunes de long. Elle descendit aux Tuileries et entra dans l’appartement de M. Bontemps, gouverneur de ce château. Elle y resta quelque temps pour attendre que M. de Dreux, grand maître des cérémonies, vint l’avertir. M. de Dreux, vêtu d’un grand manteau à queue traînante, étant arrivé, Mlle de Clermont sortit et trouva dans la cour deux carrosses de la Reine, huit gardes du corps à cheval qui mirent l’épée à la main quand elle parut. Ils étoient commandés par un exempt, vêtu de deuil, en pleureuse et à cheval. M. Coulon, écuyer ordinaire, donna la main à Mlle de Clermont, qui monta dans l’un des carrosses et se mit seule dans le fond de derrière. Mme la duchesse de Boufflers se mit dans le fond de devant avec Mme de Mailly, et Mme de Ribérac étoit à l’une des portières. M. de Dreux et M. Coulon montèrent dans l’autre carrosse et marchèrent devant celui où étoit Mile de Clermont. Celui-ci étoit suivi de huit gardes, et l’exempt à cheval à la portière. Elle arriva à Issy dans la maison de M. le prince de Conty. Les Cent-Suisses garnissoient la cour des deux côtés. Mlle de la Roche-sur-Yon, suivie de Mme de Bussy, dame d’honneur de Mademoiselle, mais qui lui servoit alors de dame d’honneur, attendoit Mlle de Clermont au bas du perron qui est à l’entrée de la maison. Mme la comtesse d’Alègres, dame d’honneur de Mlle de la Roche-sur-Yon, y étoit aussi ; mais elle représentoit alors la dame d’honneur de feu Mme la princesse de Conty. Mme la marquise de Créquy, qui l’étoit, ayant demandé à se retirer quelque temps avant la mort de cette princesse et n’ayant pas encore été remplacée. Mlle de la Roche-sur-Yon étoit en mante, et étoit suivie de toute la maison de M. le prince et de Mme la princesse de Conty, en grand manteau . Mlle de Clermont fut conduite dans une chambre en bas et en traversant plusieurs autres. Il y avoit dans ladite chambre plusieurs fauteuils noirs ; Mlle de Clermont se mit dans le premier, l’exempt derrière elle ; Mlle de la Roche-sur-Yon assise à gauche sur un pliant, à ce que l’on croit, au moins cela devoit être. Cependant toutes les dames, non seulement Mme de Boufflers, mais les autres qui n’étoient point titrées, étoient assises, ce qui n’est point régulier, puisque Mlle de Clermont représentoit la Reine. On croit qu’en entrant dans la chambre où étoit le corps, on auroit dû annoncer la Reine, ce qui ne fut point fait. Mme de Mailly avoit pris la queue de la mante en descendant du carrosse. M. de Dreux avertit Mlle de Clermont, il la conduisit dans la chambre où étoit le corps. Elle y trouva un prie-Dieu et un fauteuil. Elle se mit à genoux dessus ce prie-Dieu, et l’exempt des gardes derrière le fauteuil. L’abbé de St-Aulaire, aumônier ordinaire de la Reine, se mit à genoux devant le prie-Dieu, suivant l’usage. Aussitôt on chanta le De Profundis. Il y avoit quatre ou cinq hérauts d’armes, mais il n’y en eut que deux qui parurent avec le roi d’armes. Ces deux hérauts étoient à côté du corps. L’aide des cérémonies fit le premier les révérences au corps et à Mlle de Clermont, ensuite M. de Dreux, puis le roi d’armes et les deux hérauts d’armes ; après quoi elle se leva et, suivie de Mme de Mailly, qui reprit la queue de la mante, elle s’avança, prit le goupillon qui lui fut présenté par l’abbé de St-Aulaire, qui l’avoit reçu du roi d’armes, et, suivie aussi de l’officier des gardes, elle jeta de l’eau bénite ; elle se remit aussitôt à sa place, après avoir rendu le goupillon à l’abbé de St-Aulaire, qui le remit dans le bénitier. Mlle de la Roche-sur-Yon se remit sur le carreau, près de Mlle de Clermont, à côté du drap de pied, et Mme la duchesse de Boufflers sur un autre, auprès d’elle. Les hérauts d’armes et le roi d’armes ayant refait les mêmes révérences, Mlle de Clermont se leva et fut reconduite, dans le même ordre, dans la chambre où elle avoit été reçue en entrant. Comme elle devait aller jeter de l’eau bénite comme princesse du sang, pour éviter l’embarras et la peine de revenir une seconde fois à Issy. M. de Dreux lui proposa de s’acquitter aussitôt de ce devoir .