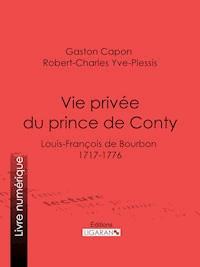Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Les Capitulaires de Charlemagne offrent, chez nous, le premier exemple d'une sévérité excessive contre la prostitution : la prison, le fouet, l'exposition au carcan; faisaient partie des peines infligées aux Ribaudes et à ceux qui leur donnaient asile..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le siècle de Louis XV nous apparaît comme l’époque de la galanterie gracieuse, ou tout un monde poudré et musqué s’agite dans le lointain de nos évocations.
Glissant légèrement leurs souliers, rehaussés du talon rouge, sur les parquets cirés des palais ou des petites maisons, les nobles personnages, dignitaires ou protégés, vieilles souches ou nouveaux anoblis, sont pour nous, avec le recul d’un siècle et demi, de jolis pantins, coquets, parfumés, bichonnés, toujours courbés en de séduisantes révérences, le tricorne sous le bras, la canne haute et légère à la main, ils semblent incarner la grâce et la séduction.
Les femmes survivent en nous comme d’agréables poupées, aux coiffures savantes et fragiles, poudrées à frimas, la figure finement fardée, sur laquelle une mouche bien placée en augmente la joliesse et la coquetterie ; le costume lui-même, robes à falbalas, corsage baleiné, étroit, se prolongeant en pointe jusqu’à l’endroit suggestif où il fait place alors à l’ampleur des paniers ; tous ces atours viennentajouter à l’illusion que nous avons de cette époque. Il n’est pas jusqu’à la rue, que nous ne voyons encombrée de carrosses dorés et peints de fraîches couleurs, avec la majesté imposante des cochers et des laquais, rigides sous leurs tuniques à manteaux, ou de chaises à porteurs, boîtes mignonnes, satinées, ornées de dorures et décorées par les maîtres ; véhicules lourds de richesse ou légers et coquets, circulant dans les rues sans trottoirs entre de vieux hôtels aux façades majestueuses.
Il n’est pas jusqu’à l’animation d’un quartier populaire que nous n’aimions à nous représenter, en évoquant l’inévitable garde française lutinant une ravaudeuse accorte, ou le jeune seigneur pinçant le menton d’une mignonne dentellière.
Et tous ces souvenirs nous reviennent en contemplant les œuvres de Nattier, de Moreau le Jeune, Watteau, Lancret, Boucher, etc., qui nous montrent ce règne comme l’ère d’une frivolité excessive et d’une naïveté charmante.
Poudre de riz, mouches, tabatières, miniatures, dorures, parfums, dentelles, voilà tout ce qu’il nous reste de cette vie futile évoquée dans un décor féerique.
Hélas ! la réalité brutale surgit sitôt que l’on examine de près la vie et les mœurs du XVIIIe siècle. On est de suite déçu lorsqu’on étudie en détail, les documents secrets, les dossiers, les comptes, les rapports qu’ont laissés les personnes approchant ou vivant au milieu des grands seigneurs, fréquentant les petits marquis, ayant commerce avec la bonne compagnie, recevant les confidences des dames de naissance et les secrets des filles du monde. En fouillant tous ces papiers on s’aperçoit que cette Société, perçue jusqu’alors comme le règne de la galanterie, cachait, sous la mièvrerie de ses dehors, les vices honteux la pire corruption, la débauche sale et basse des fins d’orgie.
Les jolis pantins poudrés ne sont plus que de vulgaires noceurs, le visage barbouillé de tabac, la roupie au nez, les mignons abbés de cour, des pervertis infâmes, quand ils ne sont pas d’affreux souteneurs ; les Don Juan comme Richelieu, Fronsac, Grammont, achètent leurs conquêtes à prix d’or chez des proxénètes menteuses et voleuses qui leur donnent pour filles de haute volée, des prostituées que tout le monde peut se procurer pour quelques écus. Ils cachent leurs décorations sous de vieilles redingotes pour fréquenter librement chez les filles, trafiquant leurs croix de diamants pour assouvir des curiosités et des désirs malsains.
Ce sont aussi d’ignobles marchés, des enfants des deux sexes vendus et livrés à des satyres immondes à la recherche de fruits verts, les honteux marchandages d’un grand seigneur venant chercher chez l’entremetteuse un étalon pour suppléer à son impuissance auprès de sa femme afin de pouvoir perpétuer son nom.
Tous ces gentilshommes ignoraient que leurs démarches, leurs marchés, étaient consignés avec une rigoureuse exactitude par les courtiers d’amour, les appareilleuses sous le manteau, les tenancières d’académies de filles, qui enregistraient scrupuleusement les moindres offres qu’elles recevaient. Ce sont ces documents que je soumets aujourd’hui au public, tels que je les ai recueillis, avec leur naïvetéou leur cynisme selon la perversion du rédacteur ; les commentaires, quand il y en a, sont très courts, ayant voulu laisser le lecteur se renseigner et commenter lui-même les dessous de cette époque où l’on peut retrouver le chancre qui devait ronger et abattre, dans une révolution unique au monde, cette société en décomposition.
G.C.
Les Capitulaires de Charlemagne offrent, chez nous, le premier exemple d’une sévérité excessive contre la prostitution : la prison, le fouet, l’exposition au carcan, faisaient partie des peines infligées aux Ribaudes et à ceux qui leur donnaient asile ; mais tout ce formidable arsenal de pénalités fut abandonné pendant les trois ou quatre siècles qui suivirent, et les maisons de débauche se multiplièrent librement, jusqu’au moment où les ordonnances de Saint-Louis renouvelèrent les prohibitions.
En 1254, les femmes publiques devaient être chassées tant des villes que de la campagne, leurs biens étaient confisqués et ceux qui leur livraient asile risquaient fort de perdre leurs propriétés.
Deux ans plus tard, autre ordonnance pour les femmes « folles et ribaudes qui seront expulsées de toutes les cités et ceux qui leur auront loué leurs maisons paieront le loyer d’une année ».
La rigueur même de ces textes, exécutés à la lettre, ne tarda pas à produire, contrairement à ce qu’on en attendait, des effets tout opposés au but poursuivi ; les filles, traquées et punies comme criminelles, quittèrent leur costume distinctif où les robes à collet renversé et à queue, ainsi que la ceinture dorée étaient prohibées ; enfreignant ces défenses, on les vit adopter les insignes des femmes honnêtes auxquelles elles parvinrent à se mêler et amenèrent ainsi une confusion qui gêna fort la police de l’époque ; quant aux dames, elles s’en consolèrent en répandant la phrase devenue proverbiale : « Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée ».
Le désordre fut tel, et en peu de temps le mal devint si grand, que le roi comprit la nécessité de rapporter ses propres édits, se résignant à permettre l’exercice de cette plaie honteuse dans des lieux spéciaux.
Saint Louis toléra la prostitution ne pouvant la détruire.
Deux asiles de Ribaudes furent alors autorisés dans la rue de l’Abreuvoir-Macon et rue Froidmanteau, près le clos Bruneau. Il ressort de l’esprit des ordonnances de Saint Louis, que toute femme était libre de son corps et pouvait en faire trafic à son gré, pourvu qu’elle ne s’abandonnât au péché, que dans les « anciens bordeaulx et rues à ce ordonné d’ancienneté ».
En 1381, une lettre de Paris, datée du 3 août, porte, défense de louer à des femmes publiques dans des rues autres que celles de Beaubourc, Gieffroy-l’Angevin, des Jongleurs, de Symon-le-Franc, de Saint-Denis et Maubuée.
Dès lors, les lieux de débauche s’accrurent, restant, toutefois, cantonnés dans les voies sombres et fétides qui, du reste, n’ont jamais cessé d’être hantées ou habitées par les filles publiques.
Cependant, il arrivait parfois que, sur une plainte, on interdisait une maison. C’est ainsi que le 12 janvier 1565, Charles IX rendit un mandement contre le bordeau de la rue du Hulleu, avec défense aux propriétaires de louer à d’autres qu’à des gens de bien.
Au surplus, faisant droit sur la requête verbale des dicts gens du roy, que défenses sont faictes à tous manans et habitans de cette ville et faux bourgs de Paris et autres, de souffrir en leur maison bordeau secret ne public sur peine de 60 livres parisis d’amende pour la première fois, et de 6 livres parisis pour la seconde, et pour la troisième fois de privation de propriété de la maison.
Cette ordonnance qui fermait les portes de la maison du « Grand Huleu » eut un grand retentissement ; la mère Cardine, tenancière de ce mauvais lieu, fut chantée et sa complainte déplore l’abolition de sa maison où l’on prenait « l’amoureuse pâture », où
Une autre facétie célébra aussi la Cardine, sous le titre de : L’Enfer de la mère Cardine, traitant de la cruelle bataille qui fut aux enfers, entre les diables et les maquerelles de Paris, aux nopces du portier Cerberus et de Cardine.
Cette longue pièce donne plus d’un renseignement curieux, entre autres le nom des matrones de l’époque : La Passeuse, du faubourg Saint-Michel, Madelon, La Chaussée, Largerie, Marguerite Remy, surnommée « aux gros yeux », la Maquignonne et sa fille boiteuse, Paquette, La Picarde, Robillarde, Anne au petit bonnet, la Normande, la Ragouye, l’Englesche, Ivonne, la grosse Jacqueline, la Saintionne, la Chaperonnière, Gillette la gaillarde et Michelle, sa sœur, et combien encore qui justifient les vers de la complainte de la mère Cardine :
De tout temps, les tenancières de maisons servirent d’objet à la verve poétique des bardes, troubadours, bohèmes et autres poètes crottés ; Gringoire, Villon, Marot, Régnier, Rabelais les tournèrent en ridicule, multipliant odes, ballades, priapées, stances, lais ; chantant la maquerelle en rimes railleuses :
Néanmoins on trouvait tout de même à utiliser les connaissances spéciales des matrones et des sages-femmes pour les affaires de viol et autres procès intimes ; pénétrées de leur importance, elles élaboraient gravement un procès-verbal de leur visite dont voici un curieux spécimen, véritable merveille de technique :
Nous Marie Teste, Jane de Meaux, Jane de la Guingans et Madeleine la Lippue, matrones jurées de la ville de Paris, certifions à tous qu’il appartiendra que, le 14e jour de juin dernier (1616), par ordonnance de ladite ville, nous nous sommes transportées en la rue de Frépault, où pend pour enseigne la Pantoufle, où nous avons veu et visité Henriette Peliciere, jeune fille aagée de 18 ans environ, sur la plainte par elle faicte a justice, contre Simon le Bragard, duquel elle dict avoir été forcée et déflorée, et le tout veu et visité au doigt et à l’œil, nous trouvons, la babole estoit abatue, l’arrière-fosse ouverte, l’entre-fesson ridé, le guillevart eslargy, le braquemart escrouté, la babaude relancée, le ponnant débiffé, le halleron demis, le quilbuquet fendu, le lipion recoquillé, la dame du milieu retirée, les toutons devoyéz, le lipondis pilé, les barres froissées, l’enchenard retourné ; bref pour le faire court, qu’il y avoit trace de v. . ; d’où vient que toute la curée que j’y aye pu apporter et nonobstant la peine que j’aye prise à recoudre son canipani brodimaujoin, elle est demeurée despucellée. »
À la fin du XVIIe siècle, Louis XIV, sous l’influence hypocrite de Mme de Maintenon redoubla de sévérité. Une ordonnance du 20 avril 1684, spécifie que :
« Les femmes de débauche et prostitution publique et scandaleuse ou qui en prostituent d’autres seront renfermées dans un lieu particulier, destiné pour cet effet dans la maison de la Salpêtrière. Elles entendront la messe, les dimanches et fêtes et seront traitées des maladies qui leur pourront survenir, sans sortir du lieu où elles seront enfermées qu’en cas d’une nécessité indispensable. Elles prieront Dieu toutes ensemble un quart d’heure le matin et autant le soir. »
Toute la journée on leur faisait la lecture soit du catéchisme ou d’autres livres de piété pendant le travail qu’on leur donnait à faire ; travail toujours pénible. Elles étaient habillées de tiretaine et chaussées de sabots ; pour nourriture : du pain, du potage et de l’eau ; une paillasse, des draps et une couverture formaient toute leur literie. Quand elles manquaient aux règlements on leur supprimait le potage et en aggravation elles étaient mises au carcan.
À la fin de la même année il est ordonné que les filles trouvées en compagnie de soldats auront le nez et les oreilles coupés, ces ordres barbares furent exécutés strictement.
Ainsi le lundi 7 juillet 1687, le sieur Duplessis apportait à la Salpêtrière une lettre de cachet du roi pour y recevoir les nommées Catherine Carbon et Antoinette de Cambron lesquelles avaient eu le nez coupé par jugement du Conseil de guerre à cause de leur mauvaise vie.
Au commencement du XVIIIe siècle, la police pourchasse activement les filles d’amour, « celles qui scandalisent le public, font gloire de leur dérèglement et non contentes de s’abandonner au premier venu, engagent les maris à quitter leurs femmes et à oublier leur famille, et aussi celles qui poussent les jeunes gens au déshonneur ».
Une simple liaison pouvait entraîner pour la femme un châtiment dont le plus doux était l’exil ; les filles entretenues et les prostituées se trouvaient traitées sur le même pied dès qu’il y avait scandale.
Les dénonciations étaient suivies des précautions habituelles : transport du commissaire de police au domicile de l’inculpée, interrogatoire des voisins et des domestiques.
Celles qui, au contraire, cachaient leur prostitution, pouvaient vivre en paix, à condition de ne point abuser de leur influence sur leurs amants.
Après la mort de Louis XIV, le monde galant respira ; le Régent, roi des roués, sut fermer les yeux sur tous les scandales et même utiliser les renseignements que pouvait lui fournir la Fillon, proxénète, sur les étrangers fréquentant chez elle.
Avec Louis XV, malgré les mœurs déréglées de son époque, on retrouve de nombreuses investigations policières, plutôt pour la curiosité vicieuse du monarque que pour sa sévérité. Cependant, quelques exécutions eurent lieu, comme celle de Marie Drouïn, femme de François Laurent, déjà bannie de Paris pour vol et pour « lieux de prostitution qu’elle y tenoit ».
Revenue, on l’arrêta de nouveau le 5 juin 1736.
En 1750, l’avocat Barbier nous donne une idée de la police des mœurs dans notre bonne ville de Paris.
« Il y a eu de tout temps, dans la ville de Paris, des putains et des mauvais lieux, les uns plus fameux que les autres, et cela est absolument nécessaire dans une aussi grande ville. Tant qu’il n’y a pas de désordre et de tapage, cela est toléré par la police. De temps en temps, les commissaires font des visites dans leur quartier et enlèvent les filles de petits bordels du commun, pour faire conduire ces filles qui sont gâtées à l’hôpital pour les faire guérir, ensuite on les relâche.
Mais des filles seules dans leur chambre, qui ne font ni bruit ni scandale, ne sont guère inquiétées ; et, à l’égard des filles entretenues par des particuliers, dont la police est instruite, on ne leur fait aucun incident. À l’égard des filles de spectacles, elles ont un état qui les met à couvert de toute recherche de la police, quelque libertinage qu’il y ait. »
Le même Barbier raconte aussi qu’une femme nommée Jeanne Moyon, maquerelle publique, ayant été sollicitée par un « homme comme il faut, chevalier de Saint-Louis » pour lui fournir une petite fille de onze ans environ, rôda autour de Saint-Germain-l’Auxerrois pendant le catéchisme, y aperçut une fille assez jolie dont elle entendit le nom. Quelques jours après, elle s’y transporta de nouveau et demanda la jeune fille, prétendant, disait-elle, la venir chercher de la part de sa mère ; on lui confia l’enfant tout simplement ; elle la mit dans un fiacre et la conduisit chez elle, où se trouvait déjà l’amateur éhonté.
Elle l’a déshabillée en chemise et fait passer dans sa chambre, où était l’homme, et l’a engagée à faire ce qu’il vouloit… Qu’il ne s’est rien passé, n’ayant peut-être pas pu en venir à bout, qu’elle l’a ensuite remise dans un fiacre et ramenée dans son quartier ; la petite fille, arrivée, a conté tout à sa mère, laquelle a rendu plainte sur l’indication qu’elle a dressée à peu près du quartier où elle avoit été menée, on l’y a promenée et fait des perquisitions ; on a découvert la dame Moyon, près la porte Saint-Michel, qui a été arrêtée. »
Le 11 juillet 1750, Jeanne Moyon fut exécutée ; c’est-à-dire qu’elle fut conduite depuis le Grand-Châtelet jusqu’à la porte Saint-Michel, sur un âne, coiffée d’un chapeau de paille, la tête tournée vers la queue de l’animal, portant un écriteau où on lisait cette inscription : MAQUERELLE PUBLIQUE.
Elle suivit, au milieu des huées, le Pont-Neuf, la rue de la Comédie et les Fossés-Monsieur-le-Prince. À la porte Saint-Michel, elle fut fouettée et marquée de la fleur de lys. Après l’exécution, on la mit dans un fiacre pour être conduite hors Paris pour le bannissement auquel elle était condamnée. Ces exécutions divertissaient, paraît-il, beaucoup le peuple.
Ordinairement, les femmes arrêtées pour prostitution ou pour trafic de filles étaient conduites à l’Hôpital Général.
L’Hôpital ! ce mot avait la même signification qu’aujourd’hui Saint-Lazare ; l’Hôpital, c’était la Salpêtrière, Bicêtre et Saint-Martin.
Souvent l’arrestation avait lieu sur un simple rapport de l’inspecteur conçu de cette façon :
« C’est avec justice que M. le commissaire Langlois a donné avis qu’il y a dans une maison rue Pagevin occupée par le bas par un marchand de vins, des filles de débauche qui causent même beaucoup de scandale et qu’il y arrive assez souvent du bruit et dans le cas qu’on ordonne au commissaire d’y faire une visite, il n’y a pas grand choix à faire dans cette maison. »
L’inspecteur et le commissaire se rendaient alors en carrosse au domicile signalé, faisaient sortir les demoiselles et les embarquaient pour Saint-Martin. Cette prison située dans l’abbaye Saint-Martin était composée de six chambres et deux espèces d’écuries, appelées communément corps-de-garde, donnant sur une cour ; les captives restaient sous la surveillance d’un concierge et d’un guichetier ; là, celles possédant un peu d’argent se trouvaient assez bien traitées, autrement les malheureuses sans ressources, couchaient dans des auges garnies de paille puante, n’ayant pour toute nourriture qu’une mauvaise livre de pain par jour et de la soupe une fois par semaine.
Naturellement, matrones et filles laissaient des greluchons qui s’ingéniaient souvent l’esprit pour communiquer avec les prisonnières ; différents moyens étaient employés dont le plus simple, consistant à introduire des lettres dans des petits pains, n’offrait que peu de sécurité ; le concierge habituellement retors flairait la supercherie et interceptait sans scrupule la communication ; mais l’ingéniosité, que l’on trouve chez tout prisonnier, ne s’arrêtait pas devant un échec et les captives utilisaient une gargouille donnant dans la rue du Vertbois ; celui qui était en liberté mettait son billet à l’extrémité d’une baguette d’osier de trois pieds et demi puis il introduisait cette badine dans le tuyau et la correspondance arrivait à destination par l’évier de la prison, apportant des nouvelles du dehors ; la détenue rendait réponse par la même voie.
Saint-Martin, comme beaucoup d’abbayes du reste, recevait aussi les enfants dont les parents avaient à se plaindre, on remettait les mauvais sujets au concierge et moyennant 30 livres par mois, le portier ou sa femme se chargeaient de les nourrir, généralement très mal, et de leur donner la correction, ce dont ils s’acquittaient probablement très bien.
Le dernier vendredi du mois les prisonnières, tenancières et filles, passaient à la police, c’est-à-dire qu’elles recevaient à genoux la sentence qui les condamnait à être transférées à la Salpêtrière pour des motifs ordinairement libellés de la sorte : Commerce de filles – fameuse trafiqueuse de filles. Nota : a une fleur de lys – accusée de maquerellage – débauche avec un seul homme – débauche avec un homme marié – débauche et prostitution publique et très scandaleuse – prostitution scandaleuse dans les rues… etc..
Le lendemain, on les chargeait dans un long chariot découvert. Elles se tenaient debout et pressées l’une contre l’autre ; le véhicule se mettait alors péniblement en marche, allant au pas de promenade jusqu’à la Salpêtrière. Au passage les malheureuses étaient huées par les gamins qui leur faisaient la conduite au milieu d’un charivari infernal. Les unes pleuraient, les autres plus sceptiques bravaient crânement les cris et les sifflets.
Les plus huppées obtenaient, toujours moyennant finance, la permission de faire ce trajet dans une voiture fermée, échappant ainsi à la promenade infamante. Arrivées à l’Hôpital on les visitait soigneusement ; puis on les séparait, conservant celles qu’on reconnaissait de bonne santé pour rester à la Salpêtrière ; quant aux autres, reconnues pour être infectées d’un mal vénérien, on les envoyait à Bicêtre, passer ce qu’on appelait alors : les Grands Remèdes. Bicêtre sous l’ancien régime était à la fois hospice, hôpital, pensionnat, maison de force et de correction. Les galanteries ou, autrement dit, tous les coups de pied de Vénus depuis les pires jusqu’aux anodins y recevaient les soins en usage à l’époque ; consistant en un traitement spécial et de quelque durée désigné sous le nom de Grands Remèdes.
La malade étant bien préparée, saignée, baignée, évacuée, quarante-huit heures après le purgatif, on lui faisait prendre un bain dans la matinée, et le soir avant de se coucher, elle se frottait avec de l’onguent mercuriel la partie interne de l’une des deux jambes depuis la malléole jusqu’au genou ; le lendemain elle prenait un bain, et le surlendemain elle faisait une friction semblable sur l’autre jambe ; deux jours après elle en pratiquait une autre sur un avant-bras, puis au bout du même laps de temps, une quatrième sur un bras. Elle passait ensuite au membre pectoral du côté opposé et revenait à la jambe par laquelle elle avait commencé, procédant suivant le même ordre pendant tout le traitement et laissant toujours entre les frictions un jour d’intervalle, durant lequel elle prenait un bain. Cependant lorsqu’elle était arrivée à la moitié du traitement, elle ne prenait des bains que tous les quatre jours. Dès que chaque friction était terminée, on couvrait la partie enduite d’un bas, d’un caleçon ou d’un gilet de toile qu’il fallait conserver jour et nuit, tant pour ne pas salir les draps que pour ne pas perdre d’onguent. Les parties sur lesquelles on appliquait la poudre devaient être rosées et on devait suivre surtout l’ordre indiqué. On n’épargnait aucune partie du corps si ce n’est le dos et la poitrine ; et l’on terminait par une application à la région lombaire appelée le coup de grâce parce que la salivation devenait plus abondante. Dans l’intervalle on donnait des boissons délayantes et adoucissantes, puis l’usage voulait que l’on purgeât les malades avant de cesser complètement les frictions. »
Après quoi on les soumettait au régime pénitentiaire de la prison, jusqu’à l’expiration de leur peine ou bien elles étaient envoyées aux Îles si l’incarcération devait être de longue durée.
Lorsque Berryer de Renonville succéda au lieutenant général de police Feydeau de Marville, en 1747, il innova, en habile artisan, une nouvelle façon d’intéresser le roi et de l’amuser en lui rendant un compte fidèle, agréablement rédigé, des escapades, des relations intimes, de la vie secrète des gentilshommes plus ou moins de son entourage ; les filles cotées, les demoiselles ayant de nobles entreteneurs furent alors activement surveillées. Il s’adjoignit pour cette besogne un inspecteur tout à fait digne de cet emploi dont les premiers rapports datent de 1748 ; ce policier, nommé Meusnier, avait toutes les qualités nécessaires pour se rendre en peu de temps indispensable à ce genre de besogne. En quête de tous les scandales intimes ou publics, il obligea les tenancières de maisons à lui fournir un journal détaillé, jour par jour, et même heure par heure, de tout ce qui se passait dans leur entourage, de tous les marchés passés chez elles et par leur intermédiaire, insistant sur les détails les plus intimes, les plus secrets, les obligeant à dévoiler les passions de chacun de leurs clients. Muni de ces notes précieuses, Meusnier les agrémentait, enjolivant leur brutalité souvent obscène, d’un tour de phrase ingénieux, trouvant toujours le mot juste ; puis ses bulletins journaliers étaient revus par Berryer, qui se chargeait d’en donner connaissance à Louis XV. Bien qu’affectant un profond mépris pour les femmes, Meusnier ne négligeait pas les nombreuses occasions qui lui étaient offertes, choisissant de préférence les primeurs comme en témoigne cette note de la Lafosse, courte, mais claire : « Meusnier a b… la petite Perrin pour un louis ».
Après la mort de Meusnier en 1757, Louis Marais fut chargé de prendre la suite de ces rapports ; il se montra digne en tous points de son prédécesseur, sous les ordres duquel il avait fait son apprentissage. Il connaissait à fond tout le monde galant, aussi fut-ce sans embarras qu’il entra en fonction. À son tour il devint la terreur des petits maîtres et des débauchés de toute espèce ; lui-même écrit : « Tous nos jeunes seigneurs ont dit qu’ils craignoient le lever du roi parce que toutes leurs démarches, dans le chemin couvert de la galanterie, étoient connues. »
Toutefois, à son début, il eut à lutter contre quelques matrones rebelles, en correspondance directe avec le lieutenant général de police, et la dame Payen qui tenait maison, raconte ainsi sa première entrevue avec le nouvel inspecteur.
Le 20 mars 1757. – J’ai été cherché M. Marais, officier de police, rue Saint-Honoré, vis-à-vis le cul-de-sac de l’Orangerie, chez un parfumeur au 2e à 9 h. 1/2, suivant l’avis qu’il m’en avoit donné la veille, et c’étoit pour me dire qu’il remplissoit la place de feu M. Meusnier, je ne le connois pas, néanmoins j’ai répondu à ses questions suivant que l’occasion le requeroit ; mais sans le mettre au fait de la vérité ; il m’a ajouté que s’il venoit des moines ou abbés chés moi qu’il falloit que je l’en fasse avertir sur le champ. Je lui ay dit que je n’en voyoit pas, il a ajouté à cela qu’il donneroit 6 livres à la personne que j’enverrois à cet effet, je ne lui ai pas fait connoître le fond de ma répugnance à ce sujet mais je crois qu’il n’est pas naturel d’attirer chés soi des gens qui n’auroient fait d’autre mal que de b… des filles ; pour après leur causer de grands chagrins.
L’appareilleuse qui tenait ce langage ne devait pas être quitte sitôt des exigences du nouvel inspecteur de police, lequel du reste ne mettait tant d’insistance que pour plaire à Berryer qui attachait sur les pas de tous ecclésiastiques toutes ses troupes de commissaires, d’inspecteurs et de mouchards ; ces agents suivaient leur proie jusque dans des maisons de débauche ; là, se présentant la plume et l’écritoire à la main, ils faisaient au prêtre surpris les questions les plus indiscrètes et dressaient séance tenante procès-verbal des faits et actions dans lesquels les hommes, même ceux qui n’ont pas fait de vœux, aiment le moins à être troublés.
Quelques mois après Marais renouvelle ses tentatives près de la Payen pour avoir sa confiance et obtenir des renseignements sur les moines paillards et les religieux en partie galante.
La matrone reprend alors ses doléances.
Le 19 mai 1757, j’ai été sur les 5 heures chez M. Marais, pour lui dire que je ne savois rien de nouveau, je l’ay trouvé plus doux et plus poli que cy-devant mais toujours dans l’intention que je lui fasse faire capturer des moines, je lui ay dit que je verrois comme je pourrais m’y prendre avec le temps.
Mais au mois d’octobre la brouille est tout à fait complète et la Payen dévoile positivement les intrigues de Marais dans une lettre au lieutenant général de Police, Berryer.
12 octobre 1757,
« Monseigneur,
Monsieur Marais mange quelquefois chez Mme Deshongrais, rue du Coq et cela fait mauvais effet car les filles en parlent désavantageusement. Il ne devrait aller chez les femmes du monde qu’incognito, surtout quand il veut passer une heure d’amusement, les toupies ont des langues de vipère, l’on ne sauroit trop se cacher d’elles en toutes choses. Il va aussi chez Mme Millet, il n’y mange pas mais il b… les filles lorsqu’il en trouve une de son goût, aussi bien que M. son commis qui est d’une jolie figure, ils ne donnent tous deux que trente-six sols, il y a apparemment, que l’état de l’un et la beauté de l’autre doivent les dispenser de bien payer ; à l’égard de la santé des filles, M. Marais s’en rapporte à sa connaissance, car il les visite lui-même, avant que de s’en servir ; et à l’égard des abbés qu’il arrête chez ces dames, c’est fort bien fait : mais ce n’est pas conduit assez adroitement, ni assez secrètement, M. Meunier n’en arrêtoit pas moins mais cela n’éclatoit pas tant, ainsy que M. de la Villegaudin qui prenoit plus de mesure, il semble que l’avidité que le sieur Marais a de gagner promptement de l’argent luy fait manquer d’attention en choses essentielles. S’il vient quelque jour chez moi des moines ou abbés je leur servirai de toupie ou au moins je leur en donnerai une dont je suis sûre de la discrétion de ce côté-là. La dernière fille que M. Marais a eue chez Mme Millet, n’avoit que 16 ans, elle est brune, les yeux bleus, assez bien faite, de belles dents, mais la bouche un peu grande ; autrefois il étoit moins délicat et payoit mieux ; car quand il demeuroit chez M. de Saint-Séverin, il b… une fille, négresse, et lui donnoit souvent 9 liv. et quelquefois il n’en donnoit que six. Il faut, suivant les apparences, devenir inspecteur de police pour désirer de s’enrichir et dépenser moins pour les filles. Il n’aime pas les femmes qui ne lui procurent pas de gagner de l’argent, à mon particulier si j’en avois l’occasion je le ferois, et peut-être ne se le persuade-t-il pas ; c’est cependant mon intention. »
L’inintimité entre la matrone et l’inspecteur continua, même après le départ de Berryer et l’on voit la Payen se lamenter toujours auprès de son successeur, relatant dans ses rapports :
« Il m’a paru que M. Marais continuoit de me haïr et je crois que c’est à la recommandation de Mme Renault et peut-être de celle de Mme Lefebvre, de la Barrière Sainte-Anne, à cause qu’elles sont amies elles disent l’une comme l’autre. Mme Renault s’est mis dans la tête que j’avois débauché sa servante pour me venir servir et cela n’a jamais été vrai, mais elle se le persuade et malgré tout ce que j’ai pu lui dire de vrai ; elle m’a dit que j’étois une garce, une f… b… et si et cela, et qu’elle me serviroit sur les deux toi ( ?). M. Marais m’a dit que j’avois mené une fille habillée en garçon chez des moines. Je luy ai dit que non ; cependant il m’a semblé le croire, je ne lui ai pas dit ma pensée, mais je crois qu’il fait et qu’il pourra faire des rapports contre moi à la police, qui sûrement, seront composés de plus de la moitié de mensonges et de calomnies ; le premier mobile de sa haine est venu sûrement de ce qu’il ne m’a pas trouvée aussi souple qu’il aurait pu se l’imaginer, le jour qu’il est venu chez moi avec le nommé Grondar, je n’ai cependant pas manqué de politesse, quoiqu’il ne m’ait pas dit trois paroles sans jurer ; il a été sans doute surpris de voir que son mauvais ton ne me déconcertoit pas et encore plus de me trouver des sentiments qui ne cadroient pas à ses instructions. Aussi, m’a-t-il dit : Votre façon de penser ne vous enrichira pas. Je lui ay dit : Cela est vray, mais je ne peux pas penser autrement ; ces Messieurs là ne mettent point de distance d’une femme à une autre, mais ils en mettent une très grande entre une femme et eux. »
Les plaintes de la Payen contre Marais n’empêchaient nullement celui-ci de poursuivre la débauche et le vice, avec, semble-t-il, un malicieux plaisir à détailler les aveux qu’il recevait ou les racontars qu’il écoutait ; les ecclésiastiques surtout le trouvaient inflexible ; à toute heure du jour ou de la nuit, on le voyait surgir dans les maisons louches, flanqué du commissaire du quartier ; surprenant un bon père dans la besogne amoureuse ; alors, avec joie il rédigeait un rapport dans le genre du suivant que M. de Sartine savourait le matin à sa toilette.
22 octobre 1759, 6 h. 1/2 du soir.
« Est arrivé cejourd’hui une aventure au sieur abbé Berthier, et Jacques est son nom de baptême, âgé de quarante ans, natif d’Avalon en Bourgogne, diocèse d’Autun, prêtre et doyen des chanoines de la collégiale de Vézelas, y demeurant ordinairement, mais à présent à Paris, logeant chez M. de Sauvigny, l’intendant, son parent.
Voici en bref le récit de la chose :
Le sieur Marais, inspecteur de la police, venant d’apprendre qu’il y avait un ecclésiastique chez la dame Soret, femme du monde, tenant une académie de filles d’amour, rue Saint-Honoré, à l’hôtel d’Angleterre ; il a été avertir le commissaire Sirebeau, rue de l’Échelle, de venir avec lui pour surprendre ledit ecclésiastique et voir ce que c’est.
Étant arrivés chez la dame Soret, on les a introduits tout de suite dans la chambre, où ils ont trouvé l’ecclésiastique ; et le commissaire lui ayant dit le sujet de son transport, l’abbé lui a déclaré ses noms et qualités comme ci-dessus en présence d’une demoiselle appelée mademoiselle Grozellier, grande et bien faite et qui avoit la gorge entièrement nue ; et il a dit être venu de son propre mouvement dans l’endroit pour s’y faire manualiser, pendant lequel temps il avoit une autre demoiselle qui l’a fouetté avec des verges, ce qui l’a fait éjaculer un instant avant l’arrivée de M. le commissaire, sur quoy, la demoiselle Soret a déclaré que mondit sieur l’abbé commençoit toujours comme cela pour après, avoir communication charnelle avec ladite Grozellier ; laquelle de son côté est convenue des faits ; et quant à l’autre demoiselle à la poignée de verges que mondit sieur commissaire a voulu se faire représenter, on l’a cherchée partout l’appartement sans pouvoir la trouver, et une petite fille d’environ onze ans, qui fut trouvée là, a dit qu’elle étoit aller souper parce qu’elle devoit partir la nuit par le coche, dont et de ce que dessus, a été dressé procès-verbal par ledit commissaire Sirebeau, qui a fait relaxer M. l’abbé après lui avoir fait signer le procès-verbal. »
Marais s’attachait, ainsi que son prédécesseur, à argumenter ses rapports de licences qui devaient produire un effet sûr pour les auditeurs connaissant les personnalités dont il était question ; et quand, par hasard, les glanes de notre policier ne sont pas abondantes, on le voit se lamenter :
On ne sçait absolument ce que devient le monde qui avoit coutume de fréquenter les spectacles ; jamais les femmes qui tiennent maison n’ont si peu fait et toutes nos demoiselles meurent de faim. Je m’en suis fait informer par les femmes ; les hommes leur répondent que comme il n’y a point de spectacles, ils ne peuvent se dispenser de faire la partie de jeu dans les maisons où ils vont manger, et, qu’en outre, ils n’osent pas sortir avec leurs chevaux par le temps qu’il fait ; et, effectivement, le peu de personnes qu’ils voient viennent en fiacre et sont transis de froid. »
Dans le prostibule où vivaient en communauté nombre de filles, leur existence peut se généraliser de la façon suivante :
Le matin, vers 8 heures, ces dames se levaient, passaient à la salle de bains et procédaient à l’immersion exigée par l’hygiène. Vers 9 heures, une collation les attendait, qu’elles prenaient toutes ensemble. À 10 heures, elles livraient leurs têtes au talent de leurs coiffeurs, et cette partie de la toilette n’était pas la moindre. Ensuite elles se revêtaient d’étoffes légères, transparentes ; leurs extrémités étaient soigneusement entre tenues ; les bras, les épaules, la gorge, la jambe, les pieds paraissaient entièrement nus. Un corset de soie, un maillot léger, souple, adhérent, de couleur chair, venait caresser, mouler et dessiner leurs formes. Une gaze cristalline les enveloppait complètement, se balançant avec amour et mollesse en des torsions qui semblaient venir baiser les charmants contours de ces prêtresses de Vénus, laissant apercevoir par instants juste ce qu’il fallait pour exciter les désirs.
Dans le superbe salon où elles se rendaient une fois leur toilette terminée, elles s’occupaient à divers travaux de femmes, quelquefois aussi à chanter, en s’accompagnant de la harpe ou de la guitare. Jusqu’à ce moment, on n’admettait auprès de ces dames que les assidus de la maison, en général les greluchons inévitables dans ces sortes d’établissements.
Après le dîner, le monde, gens de cour, jeunes seigneurs, vieux libertins, affluaient pour les glaces et rafraîchissements ; chacun choisissait librement sa favorite, et, dès qu’on avait compté à la mère abbesse trois louis pour le souper et le coucher, la fille ne devait voir ni recevoir personne jusqu’au lendemain.
Dès ce moment, elle devait satisfaire son seigneur et maître dans tous ses caprices, toutes ses fantaisies, et même les extravagances que peuvent suggérer les accès passionnels, en un mot elle devenait la chose dont le possesseur pouvait disposer à sa volonté.
Bien souvent, le soir, quelques-unes de ces filles, non retenues, se rendaient à tour de rôle, dans les différents spectacles de la capitale, afin de trouver une bonne occasion et de faire un peu de réclame à la maison.
D’autres fois même, la matrone sortait avec elles, les conduisant au bal ou dans les jardins publics pour attirer les galants ; en ce cas, elles ne paraissaient plus dans les salons après dîner.
Lorsque quelqu’un voulait fréquenter ces maisons incognito pour des raisons quelconques, il s’engageait dans un escalier dérobé que possédaient et que possèdent encore les lieux de débauche, la mère abbesse allait au-devant du personnage et le recevait dans une espèce de parloir réservé, dont les murs étaient garnis de cordons de sonnettes correspondant avec chaque demoiselle. Après les compliments d’usage, la matrone lui remettait un gros in-folio, relié en maroquin et doré sur tranches, ayant pour titre : Livre des beautés.
Il contenait le portrait moral et physique de chaque pensionnaire, car chaque maison sérieuse possédait un spécimen du tempérament et de la beauté féminine sous tous ses aspects d’esthétique et de luxure ; on y voyait : la façonnée, l’artificielle, la niaise, l’alerte, l’éveillée, l’achalandée, l’émerillonnée, l’éventée, la superbe, la follette, la fringante, l’attisée, la pimpante, la mignonne, la grasse, la maigre, la pâle, la tendre, la mutine et jusqu’à la boiteuse.
Le client discret choisissait celle qui lui agréait le plus ; alors, la matrone recevait d’avance l’offrande, qui était ordinairement d’un louis pour la passe, y compris le bouillon-restaurant ou des rafraîchissements. Pour un petit supplément, le paillard qui avait besoin d’excitants pouvait consulter le registre des passions, lequel contenait, en images et en texte, les différentes jouissances connues et usitées en ces lieux ; comme chacune comportait certains ustensiles de détail, tous les boudoirs étaient arrangés en conséquence. Une fois que la mère abbesse connaissait le goût de son client, elle tirait le cordon de la sonnette avertissant la demoiselle désirée et une autre indiquant la passion du visiteur. À ce signal, la préférée se rendait sur le champ, par un couloir secret, dans le boudoir désigné ; et, couchée négligemment sur un sofa, elle attendait l’amateur qui ne tardait pas à la rejoindre.
Quelquefois les enragés débauchés usaient le matériel comme le constata un jour l’inspecteur Marais :
« Aujourd’hui, dit-il, il n’y a point de maisons publiques où on ne trouve pas force pognée de verges toutes prêtes pour donner aux paillards refroidis ; la cérémonie, c’est-à-dire le terme ; et cette passion domine singulièrement les gens d’Église ; j’en ai trouvé dans ces sortes de maisons nombre qui se faisoient étriller de la bonne façon, entre autres le bibliothéquaire des Petits Pères de la place des Victoires, du règne de M. Bérryer, sur lequel deux femmes, après avoir usé sur son corps deux ballets entiers, furent encore obligées, faute de verges (de prendre) un paillasson de jonc qu’elles avoient déficelé ; quand j’entrai dans ce lieu, tout son corps ruisseloit de sang. »
Heureusement ces cas, sans être rares, n’étaient pas toujours poussés à cet excès et on les surprenait généralement en des postures plus naturelles.
(Dite la « PRÉSIDENTE »)
Malgré la sévérité de Louis XIV et l’austérité affectée de Mme de Maintenon, vers la fin du règne du Roi-Soleil, une proxénète habile réussit à monter une maison de débauche connue de toute la cour.
Anne Fillon, fille d’un porteur de chaises, fut la première qui mêla son commerce avec la politique, en faisant l’espionnage pour le compte du cardinal Dubois. On la connaissait sous le nom de Présidente, qui lui fut donné à la suite d’une aventure assez amusante.