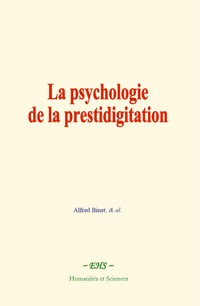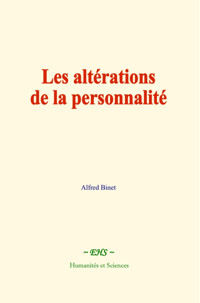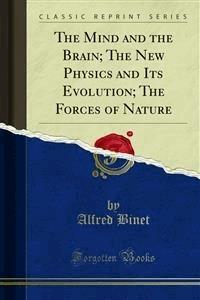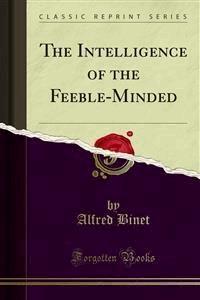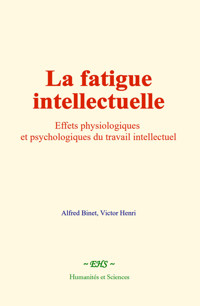
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Ce livre a pour objet de décrire et d’analyser les effets psychologiques et physiologiques du travail intellectuel.
Les effets produits par le travail intellectuel peuvent être divisés en deux groupes : d’une part, il se produit des modifications dans les fonctions physiologiques de l’organisme, telles que la circulation, la respiration, la température, l’alimentation, les sécrétions : ce sont les effets physiologiques ; d’autre part, le travail intellectuel produit une fatigue de l’attention plus ou moins forte et influe sur différentes fonctions intellectuelles et morales : ce sont les effets psychologiques. Tous ces effets seront plus ou moins accentués suivant la durée et l’intensité de l’effort mental.
Cette distinction, qui est commode pour l’exposition des faits, nous servira à diviser notre livre en deux parties ; la première partie sera consacrée aux effets physiologiques du travail intellectuel, et la seconde partie aux effets psychologiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La fatigue intellectuelle.
La fatigue intellectuelle
Effets physiologiques et psychologiques du travail intellectuel
Avant-propos
La Bibliothèque de pédagogie et de psychologie que nous inaugurons aujourd’hui en publiant ce premier volume sur la Fatigue intellectuelle, est destinée à faire profiter la pédagogie des progrès récents de la psychologie expérimentale.
Ce n’est pas, à proprement parler, une réforme de la pédagogie ancienne qu’il faut tenter, mais la création d’une pédagogie nouvelle.
L’ancienne pédagogie, malgré de bonnes parties de détail, doit être complètement supprimée, car elle est affectée d’un vice radical : elle a été faite de chic, elle est le résultat d’idées préconçues, elle procède par affirmations gratuites, elle confond les démonstrations rigoureuses avec des citations littéraires, elle tranche les plus graves problèmes en invoquant la pensée d’autorités comme Quintilien et Bossuet, elle remplace les faits par des exhortations et des sermons ; le terme qui la caractérise le mieux est celui de verbiage.
La pédagogie nouvelle doit être fondée sur l’observation et sur l’expérience, elle doit être, avant tout, expérimentale. Nous n’entendons pas ici par expérience ce vague impressionnisme des personnes qui ont beaucoup vu ; une étude expérimentale, dans l’acception scientifique du mot, est celle qui contient des documents recueillis méthodiquement, et rapportés avec assez de détails et de précision pour qu’on puisse, avec ces documents, recommencer le travail de l’auteur, le vérifier, ou en tirer des conclusions qu’il n’a pas remarquées.
Les expériences de pédagogie psychologique peuvent être divisées en deux groupes : 1° celles qui sont faites dans les laboratoires de psychologie, et 2° celles qui sont faites dans les écoles.
En pédagogie ce sont surtout les expériences du deuxième groupe qui sont appréciées, mais il ne faut pas négliger pour cette raison les expériences de laboratoires. En effet, dans les laboratoires de psychologie on fait des recherches sur un petit nombre de personnes qui en général viennent au laboratoire pour apprendre la psychologie, et se prêtent par conséquent avec beaucoup de bonne volonté aux expériences. Avec ces personnes comme sujets, on peut faire des examens très minutieux, on peut étudier l’influence des différentes causes d’erreur, chercher si telle méthode peut donner quelque résultat ou non, essayer de nouvelles méthodes et les perfectionner de façon à les rendre pratiques et simples.
Ce sont en somme des recherches de méthodes ; elles sont en général très longues et très minutieuses, car d’une part on étudie des personnes patientes qui peuvent consacrer à la science plusieurs mois ; et d’autre part, ces sujets d’élite étant très peu nombreux, — six à dix en moyenne dans les laboratoires les plus fréquentés — on est obligé de répéter sur eux un très grand nombre de fois les mêmes expériences, pour être bien certain de ne pas commettre d’erreur. Il sort de ce long travail de préparation un plan de recherche pour les écoles, plan pratique où toutes les questions de méthode sont déjà élucidées, où les principaux points à traiter, ceux qui ont paru les plus importants, sont mis en pleine lumière.
La recherche commencée au laboratoire se poursuit donc dans les écoles ; elle prend, en changeant de milieu, un caractère tout différent. Remarquons d’abord qu’on transporte rarement dans les écoles les appareils compliqués qui servent au laboratoire ; l’instrumentation est réduite au maximum de simplicité, pour des raisons faciles à comprendre. Mais ce qui domine avant tout les recherches scolaires, c’est la rapidité d’exécution. Admis à faire des recherches sur des enfants qui sont envoyés à l’école uniquement pour s’instruire, et auxquels on ne doit pas faire perdre un temps précieux, le psychologue ne peut les traiter comme ces adultes bénévoles qu’on examine à loisir pendant plusieurs mois. Il faut apporter dans les écoles le moins possible de dérangement, ne pas y faire de bruit, ne pas gêner les cours spéciaux, ni indisposer le personnel enseignant qui ne comprend pas toujours la raison de ces recherches ; c’est avant tout affaire d’expérience et de tact. Du reste, une autre raison encore doit engager l’expérimentateur à se presser. Les élèves intéressés par une recherche qui débute donnent leur maximum d’attention ; mais bientôt ils deviennent distraits, et si l’expérience se prolonge, elle paraît monotone, ennuyeuse, et les élèves cherchent à s’y soustraire.
On fait les expériences scolaires de deux manières principales, collectivement ou individuellement : 1° collectivement ; on arrive dans la classe avec le directeur, on explique en quelques mots l’expérience à laquelle on va procéder, — épreuve de mémoire, par exemple, ou d’imagination — et on fait l’expérience sur-le-champ ; elle dure en moyenne un quart d’heure ; puis on fait ramasser les copies, et on se rend dans une autre classe pour recommencer. La leçon des élèves n’a été interrompue que pendant un quart d’heure ; nous pensons qu’une interruption aussi courte, surtout si elle ne se renouvelle pas plus de deux fois dans le cours d’un mois, n’apporte aucune espèce de trouble dans les études ; parfois même l’expérience est pour les élèves un exercice de style ou d’écriture. Pendant cette interruption d’un quart d’heure, l’expérimentateur a pu rassembler une quarantaine de copies, qu’il examine à loisir après avoir quitté l’école, et dont il peut toujours tirer des conclusions instructives si l’expérience a été bien conçue ; 2° individuellement ; certaines recherches ne peuvent pas être faites collectivement, parce qu’elles exigent un examen individuel du sujet. Pour la mesure de la force musculaire, par exemple, et pour certaines expériences psychologiques de mémoire et de comparaison où il faut interroger le sujet et analyser ses réponses, on est obligé d’examiner chaque élève isolément. Un cabinet isolé, le plus souvent le cabinet du directeur, est mis à la disposition de l’expérimentateur ; les élèves y sont appelés un par un, ou deux par deux, ou par groupes plus importants, suivant les convenances ; quand l’examen d’un élève est terminé, il rentre en classe, et il est remplacé par un camarade, d’après un roulement convenu d’avance avec le professeur. Comme l’examen de chaque élève ne se prolonge jamais au delà de cinq à dix minutes, c’est pour lui une perte de temps insignifiante, d’autant plus insignifiante que cet examen ne se renouvelle guère souvent ; et quant au cours de la leçon, il ne peut être troublé par la sortie de deux ou trois élèves.
En somme, les expériences de pédagogie que l’on fait dans les écoles prennent peu de temps aux élèves, elles n’apportent aucun trouble dans l’ordre des études ; et si l’on songe qu’il suffirait de faire chaque mois une expérience d’un quart d’heure sur chaque élève, en comprenant dans cette recherche une dizaine d’écoles et de lycées, pour résoudre pratiquement un grand nombre de questions pédagogiques de la plus haute importance qui sont encore discutées, il semble que l’Administration devrait encourager de tout son pouvoir des recherches de ce genre, en les confiant surtout à des savants exercés.
En France, nous avons le regret de le constater, l’Administration se montre généralement peu disposée à accorder des autorisations de ce genre, bien qu’elle se rende bien compte qu’il s’agît de recherches inoffensives, et véritablement pédagogiques, n’ayant rien de commun avec les pratiques de la suggestion et de l’hypnotisme ; mais dans les autres pays, notamment en Allemagne, en Amérique, en Suède, en Danemark, ces autorisations de faire de la pédagogie expérimentale sont très librement accordées aux personnes compétentes, et la plupart des travaux que nous possédons actuellement ont été faits dans ces pays étrangers. Il y a plus. À plusieurs occasions, c’est l’Administration qui dans les pays étrangers a pris l’initiative des recherches expérimentales dans les écoles ; quand une question de pédagogie pratique se présentait, l’Administration s’est adressée aux psychologues en les invitant à faire des recherches sur cette question ; et en même temps, les portes des écoles leur étaient ouvertes et les élèves des écoles étaient soumis à leur examen. C’est ainsi qu’il y a un an à peine, les magistrats de la ville de Breslau, anxieux de savoir si les programmes d’enseignement dans les écoles et lycées de la ville n’étaient pas exagérés et ne produisaient pas un surmenage intellectuel parmi les élèves, chargèrent officiellement un psychologue de rechercher quel est le degré de fatigue intellectuelle éprouvé par les élèves des différentes classes a la fin de leur journée de travail.
En fondant notre Bibliothèque de pédagogie et de psychologie nous espérons démontrer la nécessité de l’expérimentation pour la pédagogie. Notre premier volume est consacré à la Fatigue intellectuelle ; dans ce volume nous avons réuni tout ce qui a été fait sur la question de l’influence produite par le travail intellectuel sur l’organisme et sur différentes fonctions psychiques ; nous montrons que la question du surmenage scolaire, tant débattue et par les pédagogues et par les médecins, est loin d’être résolue. On se trouve en réalité bien plus loin du but qu’on ne croyait l’être il y a une dizaine d’années ; c’est que l’on a fait depuis cette époque des recherches qui ont permis de comprendre exactement les difficultés de la question et de voir toutes les complications qu’elle présente.
Nous montrons de plus dans notre premier volume que si la question du surmenage n’est pas encore résolue à l’époque actuelle, il existe déjà des méthodes permettant d’étudier expérimentalement les effets de la fatigue intellectuelle, ce qui est un espoir pour l’avenir.
Dans les volumes qui suivront nous passerons en revue les différentes questions de la pédagogie en nous servant toujours de la méthode expérimentale. Le deuxième volume, qui est en préparation, traite de l’Éducation de la mémoire.
CHAPITRE I
LA DISCUSSION SUR LE SURMENAGE
A l’Académie de Médecine.
En 1886 et en 1881, l’Académie de médecine de Paris fut saisie par un de ses membres, le Dr Lagneau, d’une question qui à cette époque provoquait une vive discussion dans la presse : la question du surmenage intellectuel.
De mai à août 1887, l’Académie de médecine maintint cette question à l’ordre du jour ; et, comme c’est l’usage, une commission fut nommée, un des membres de la commission fit un rapport, et les conclusions de ce rapport, après avoir été discutées et votées, furent envoyées au ministre de l’Instruction publique.
Nous pensons qu’il est utile de résumer et de discuter ici des arguments qui furent présentés à cette époque pour ou contre le surmenage intellectuel. Ce sera la meilleure introduction à nos propres études.
Définissons d’abord le problème qu’il s’agit de résoudre, et qui fera le sujet de notre livre. Nous n’avons nullement l’intention d’étudier la fatigue et le surmenage chez les adultes, savants, artistes ou hommes de lettres ; de montrer quelles maladies il engendre et quelles précautions on doit prendre pour arrêter le mal aux premiers symptômes. Ce sont là des questions d’hygiène privée, qui ont été traitées avec tous les développements nécessaires, par Tissot d’abord, puis par Réveillé-Parise et beaucoup d’autres auteurs. Nous nous mettons ici au point de vue de la pédagogie ; nous examinons la fatigue chez les enfants et les jeunes gens, la fatigue qui se produit à l’école et qui résulte des travaux intellectuels imposés aux élèves par les programmes d’enseignement et d’examen. Même après avoir reçu cette limitation, le problème reste encore très vaste, et c’est un des plus importants qu’on puisse se poser, car une foule d’autres problèmes scolaires en dépendent ; par exemple l’étendue des programmes d’enseignement et d’examen, la limite d’âge pour les admissions à certaines écoles et à certains examens, la réglementation du travail dans les écoles et les lycées, la distribution des heures de classe, de récréation, de gymnastique et de sommeil.
Le point de savoir si, dans un cas donné, les enfants et jeunes gens éprouvent de la fatigue après la classe du soir ou après les examens, et si cette fatigue est insignifiante ou si elle est assez forte, ou trop forte et par conséquent dangereuse, tout cela est une question de fait, et doit être résolu par la méthode expérimentale. Le seul moyen de se rendre compte de la fatigue des élèves est d’aller dans les écoles pour voir les élevés et les soumettre à des épreuves capables de déceler la fatigue mentale et d’en mesurer le degré. Il nous semble qu’en avançant cette proposition, nous formulons une simple vérité de bon sens, une vérité si évidente que toute personne doit l’admettre.
Examinons comment l’Académie de médecine envisagea la question. Elle en avait été saisie, avons-nous dit, par l’opinion publique ; un cri d’alarme avait été poussé par la presse scientifique et autre ; on accusait l’école et les nouveaux programmes de provoquer chez les enfants le « surmenage intellectuel », mot emprunté à la médecine vétérinaire, et qui, appliqué aux élèves des écoles, signifiait une fatigue très grave, une fatigue vraiment pathologique, préparant le terrain à des maladies redoutables, comme la phtisie et la fièvre typhoïde.
Nous n’avons pas eu le plaisir d’assister aux débats de la docte assemblée mais nous avons lu avec soin dans les bulletins de l’Académie le compte rendu des séances ; ce compte rendu est aussi complet que celui d’une séance à la Chambre des députés ; il reproduit intégralement les discours, l’allure des discussions, avec les réponses, les répliques, les échanges de mots vifs, les questions personnelles, les ergoteries sur les phrases d’une conclusion que l’on met aux voix ; tout y est, même les applaudissements qui soulignent la phase finale de chaque discours. Un grand nombre de médecins prirent part aux débats : ce sont Lagneau, Dujardin-Beaumetz, Ferréol, Javal, Perrin, Lacaze-Duthiers, Collin d’Alfort, Peter, Hardy, Brouardel, Lancereaux, Rochard, Marc Sée.
La discussion s’ouvrit en 1886 par des communications de Lagneau et de Dujardin-Beaumetz mais le débat ne prit tout son développement que l’année suivante ; il remplit huit séances, depuis le 17 mai jusqu’au 9 août. Les orateurs ne se cantonnèrent pas, cela va sans dire, dans la question à l’ordre du jour ; le thème général des développements était le surmenage intellectuel ; mais chemin faisant, on rencontra beaucoup d’autres questions, dont les unes se rattachent au surmenage intellectuel, tandis que d’autres y sont complètement étrangères ; ainsi, on parla de la sédentarité, de l’hygiène dans les grandes agglomérations urbaines ; on parla aussi des matières enseignées dans les écoles et les lycées ; on discuta la question de savoir s’il faut enseigner le grec, et s’il ne faudrait pas supprimer l’histoire naturelle, ou s’il ne serait pas utile de modifier le programme du baccalauréat ès sciences complet. Nous ne comprenons pas très exactement comment les très honorables médecins formant l’Académie de médecine, comme Hardy et Ferréol, avaient la compétence nécessaire pour trancher ces questions d’enseignement. Négligeons ces parties accessoires ou la discussion semble avoir un peu dévié.
Le premier point de fait à résoudre, celui qui dominait tous les autres, celui qu’il fallait par conséquent examiner avec le plus grand soin, était, de savoir si bien réellement, en 1887, les élèves des écoles et lycées étaient surmenés par les programmes d’enseignement et d’examen. En relisant avec soin toutes les discussions, pour rechercher cette preuve de fait, on est un peu surpris de ne rien rencontrer de bien positif.
Presque tous les médecins qui ont pris la parole ont admis implicitement ou ont affirmé que les enfants des écoles sont surmenés et qu’il faut faire quelque chose pour eux. C’était, semble-t-il, une affaire convenue. On n’a pas discuté cela comme un point de fait ; on n’a pas établi de distinction entre les écoles ; on n’a pas dit : les enfants sont surmenés à l’école de la rue de Jouy, ils ne le sont pas au lycée Louis-le-Grand, etc.
Du reste, la plupart de ceux qui ont contesté le surmenage se sont contentés aussi d’invoquer leur conviction personnelle, sans donner de preuves à l’appui.
Un autre moyen de persuasion qui a été beaucoup employé est l’épithète, l’expression pittoresque.
En parlant des enfants des écoles, un orateur les désignait toujours par le nom de victimes scolaires ; on les appelait aussi des amputés de l’intelligence, des forts en thème tuberculeux, des condamnés aux travaux forcés ; l’enseignement de l’Université était un enseignement homicide. Parlant d’une école normale d’institutrices, Peter disait « Nous avons nos femmes savantes, mais avec la fièvre typhoïde en plus. » Le même orateur demandait une loi Rousselle pour les enfants contre le surmenage. Dans un de ses discours, il trouva un bel effet oratoire en disant : « J’ai eu le bonheur, étant petit enfant, d’être trop pauvre pour être mis au collège, j’en serais mort. » C’est encore lui qui a crée une espèce nosologique nouvelle, la céphalalgie scolaire. Nous insistons quelque peu sur ces procédés de discussion, parce qu’ils n’ont pas servi d’accessoires, et qu’ils ont fait véritablement le fond de beaucoup de discours ; une conviction très vive et quelques images très saisissantes sur les effets du surmenage, c’en était assez pour composer un discours applaudi.
On a ensuite fait le procès des programmes d’enseignement ; on les a accusés d’être disproportionnés, encyclopédiques ; on a énuméré avec complaisance les titres des matières enseignées, en supposant trouver dans cette énumération une preuve de la surcharge intellectuelle qui serait imposée aux élèves. Il n’est pas douteux que ce procédé permet d’arriver facilement à de bons effets oratoires. « Qu’on jette un coup d’œil, s’écrie Dujardin-Beaumetz, sur les programmes des cours primaires des jeunes filles professés rue de Jouy, et l’on verra qu’outre l’histoire, la géographie, la langue française, l’arithmétique, l’on y enseigne la psychologie, le droit commercial, la philosophie historique, l’économie politique, l’instruction morale et physique, le droit usuel, les sciences physiques, technologie, cosmographie, chimie, physique, toutes les sciences naturelles, etc., etc. ; et, dans ce programme, je ne compte pas l’enseignement du dessin, qui comprend six variétés : celui d’ornement, d’art, d’académie, de modes, industriel, linéaire ; plus le chant, la gymnastique, les langues étrangères, la coupe et la couture, la lecture, etc. »
Il a semblé à l’orateur que ce programme suffisait pour prouver le surmenage ; mais, à la réflexion, que de critiques ne pourrait-on pas faire à cette manière de raisonner ! Que signifie le simple titre d’une matière d’études ? Que prouve-t-on en disant : on enseigne la physique ? C’est parler pour ne rien dire, car il y a trente-six façons d’enseigner la physique, depuis la plus élémentaire jusqu’à la plus approfondie ; et il en est de même pour tout le reste. En outre, quand même on saurait bien exactement ce qu’un programme comporte de travail intellectuel, quelle conclusion pourrait-on en tirer ? Il ne suffit pas de connaître le travail intellectuel fourni par une personne pour savoir si elle est surmenée ou non ; il faut en outre connaître ses capacités de travail ; sans cela toute la série de raisonnements reste théorique.
Aussi ne pouvons-nous souscrire au rapport de la commission qui déclare que « le travail intellectuel sédentaire, de huit à vingt ans, ne doit pas être de plus de trois à huit heures. Si le travail intellectuel excède cette durée quotidienne, il devient fatigant et profite peu à l’instruction ». Ce n’est là qu’une règle arbitraire, qui manque de fondement. « La durée des classes, continue le rapporteur, de vingt à trente minutes pour les enfants, ne doit pas excéder une heure ou une heure et quart pour les jeunes gens. » Nouvelle affirmation gratuite, que rien ne justifie. Il se peut que le rapporteur soit tombé juste, mais ce serait tout à fait par hasard, car les idées préconçues et le bon sens ne peuvent pas remplacer la recherche expérimentale. Et du reste, à l’affirmation du rapporteur, on pourrait tout aussi bien opposer l’affirmation de Berthelot, disant : «… le nombre d’heures consacrées aujourd’hui aux classes et aux études n’a rien d’excessif… ». Une des affirmations vaut l’autre, ou plutôt elles ne comptent pas plus l’une que l’autre.
Beaucoup d’orateurs ont cru traiter la question du surmenage en parlant de l’encombrement des carrières libérales, qui est en effet une des plaies de notre époque. Ils mettent en parallèle le nombre de candidats et le nombre d’admis, et comme la disproportion entre ces deux nombres est fantastique, il est naturel de déplorer cette dépense bien inutile de force intellectuelle : mais ce n’est pas la question du surmenage. Voici quelques-uns des documents produits aux débats ; par eux-mêmes ils sont bien instructifs :
« En 1887, la direction de l’enseignement primaire n’a pu disposer que de 115 nominations, 55 pour les hommes et 60 pour les femmes. Or, pour ces 115 places, il y avait 7 000 postulants. Et encore, de ces 115 places, il en est pris déjà, par les élèves des écoles normales d’instituteurs et d’institutrices : 40 pour les hommes et 25 pour les femmes, et enfin pour les suppléants et suppléantes. Il en est de même pour les 20 000 postulants des autres départements.
« Dans l’enseignement secondaire, le nombre des licenciés des deux sexes et celui des concurrents à la licence augmentent chaque année, et en disproportion absolue avec le nombre des places disponibles.
« Cette multiplicité de concurrents a pour conséquence fatale d’exagérer les programmes, pour rendre l’obtention du titre plus difficile : de là le surmenage intellectuel.
« Pour l’enseignement primaire, près de 30 000 individus, après avoir obtenu leurs titres et leurs brevets, réclament des places, et le plus grand nombre échouent. »
On comprend par cette citation l’espèce d’association d’idées qui est suivie par les orateurs : concurrence énorme ; cette concurrence excite l’émulation ; cette émulation devient effrénée, désespérée… on ne ménage pas ses forces, on se surmène. Au point de vue logique, il n’y a rien à dire contre ce raisonnement, qui est très correct. Mais combien il serait préférable d’avoir une bonne statistique, ou une sérieuse étude expérimentale !
Il s’est souvent produit dans les idées d’un même orateur une contradiction dont il ne s’apercevait pas : d’une part, il déplorait le nombre immense et disproportionné des candidats aux examens, car de cette concurrence peut sortir le surmenage ; d’autre part, il déplorait en termes non moins vifs la difficulté des examens et l’étendue des programmes. Cependant il nous semble que ce sont là deux termes qui se tiennent. Si on rend les programmes plus faciles, le nombre des candidats augmentera, et alors on sera bien obligé, pour choisir entre eux, d’augmenter la difficulté des épreuves. Javal a dit spirituellement à ce propos : « À supposer qu’on ne demande que l’arithmétique pour l’admission à l’École polytechnique, comme il y aura le même nombre de candidats, ils auront besoin de travailler tout autant que par le passé pour devenir les plus forts en arithmétique. »
Si les arguments développés à l’Académie de médecine se réduisaient à ceux que nous avons exposés jusqu’ici, les débats auraient eu peu de portée et auraient ressemblé à une joute littéraire plutôt qu’à une discussion scientifique. Il nous reste à parler des documents les plus sérieux et les plus importants qui ont été produits : ce sont les cas pathologiques.
Pour montrer les effets funestes du surmenage, plusieurs médecins ont rapporté les observations les plus frappantes de maladies souvent mortelles qu’ils ont recueillies dans leur clientèle ; il s’agit dans ces observations, non pas d’écoliers suivant régulièrement les cours d’une école ou d’un lycée, mais de jeunes gens se préparant à des examens difficiles, par exemple pour l’admission à des écoles du gouvernement.
Cette matière a été traitée de deux façons ; certains orateurs ont apporté des statistiques, d’autres ont eu des observations personnelles. Nous devons traiter distinctement ces deux formes de la méthode pathologique.
1° Lagneau et Dujardin-Beaumetz sont ceux qui ont le plus demandé à la statistique. Le discours de Lagneau contient une énumération soigneuse de tous les troubles pathologiques qui ont été observés dans les écoles ; l’auteur les attribue à plusieurs causes, la sédentarité, les positions vicieuses et le surmenage. Nous extrayons de son rapport ce qui a trait à ce dernier point.
« Des lésions dentaires, particulièrement la périostite alvéolo-dentaire, fréquemment observée chez les jeunes gens au moment de la préparation de concours, d’examens, coïncident souvent avec ces troubles digestifs, et sont surtout attribuables à l’état d’hyperhémie céphalique, déterminé par une contention intellectuelle trop forte et trop prolongée.
« Dans les lycées d’internes, dans les écoles spéciales d’instituteurs, lorsque sévissent des maladies épidémiques déjà favorisées par l’encombrement humain, la surcharge intellectuelle, déprimant l’organisme, prédispose aux atteintes de ces maladies.
« La phtisie, qui se montre si fréquemment parmi les habitants sédentaires des villes, se manifeste trop souvent chez nos jeunes gens les plus studieux, qui, toujours penchés sur leur table, ne respirent qu’incomplètement. À cette cruelle maladie, contractée lors des fatigues de la préparation du concours de prix ou d’examens, succombent, quelques années plus tard, bien des lauréats, bien des élèves des écoles spéciales.
« Des troubles nerveux, céphalalgie, hyperesthésie, neurasthénie, lenteur intellectuelle, altération profonde des facultés cérébrales, sont trop souvent la conséquence de la surcharge, de la contention intellectuelle prématurée, excessive et prolongée, à laquelle se soumettent des jeunes gens en vue de concours, des élèves des écoles spéciales, des instituteurs, des institutrices.
« Les infirmités en général se montrent en proportion plus élevée chez les garçons et les filles des écoles supérieures, chez les jeunes gens instruits que chez les autres jeunes gens. »
Quelle conclusion pratique pourrait-on donc tirer d’un rapport où dominent les trop souvent et les bien des cas ? Une fois sur mille, est-ce trop souvent ? Bien des cas, cela veut-il dire dans la moitié des cas ? On peut soupçonner que ces expressions vagues ont été employées par un rapporteur qui ne voulait pas se compromettre en avouant son ignorance, car il n’avait pas fait une étude méthodique de la question.
La statistique a été invoquée avec plus de précision, par Lancereaux et Marc Sée, médecins de lycées, qui après avoir compulsé les registres où sont inscrites les maladies graves ou légères qui amènent à l’infirmerie les pensionnaires de ces établissements, déclarent n’avoir rencontré sur ces registres aucune maladie imputable au surmenage :
« Mon attention, dit Marc Sée, s’est arrêtée particulièrement sur les derniers mois de l’année scolaire, ceux qui précèdent les concours, pendant lesquels l’ardeur des bons sujets se surexcite parfois à un degré extraordinaire. Eh bien, même alors, les effets du surmenage ne se manifestent nulle part. Ce qu’on observe, en dehors de quelques légers traumatismes, ce sont des rhumes, des bronchites, des angines, des douleurs rhumatismales, des fièvres éruptives, des fièvres muqueuses, devenues excessivement rares depuis ces dernières années, etc., etc., des affections, en un mot, qui n’ont aucun lien de parenté avec le surmenage intellectuel. J’ai rencontré aussi, il est vrai, quelques cas de céphalalgie ; mais ils étaient tous sans gravité et n’avaient retenu les élèves à l’infirmerie qu’un ou deux jours, plusieurs fois une demi-journée seulement. De telles indispositions s’observent chez tous les jeunes gens et ne sont nullement imputables à un travail intellectuel forcé. »
Lancereaux dit de même :
« Désirant me rendre compte du degré de fréquence de la tuberculose, de celle des centres nerveux en particulier, dans le lycée auquel je suis attaché, j’ai demandé le relevé des principales maladies qui y ont été soignées depuis vingt ans. Or, dans ce lycée, qui prépare spécialement à l’École normale et à l’École polytechnique, où, par conséquent, le cerveau des élèves est surexcité par le travail, savez-vous combien de cas de méningite ont été observés, depuis cette époque, sur un personnel de cinq cent cinquante à six cent quatre-vingts internes ? Un seul. Pendant la même période de temps, sept élèves ont été atteints d’hémoptysie, mais sur ces sept, six accusaient des antécédents tuberculeux. Ajoutons qu’un créole est retourné dans son pays où il est mort de phtisie. On compte en outre, dans cet établissement, pour le même nombre d’années, quarante cas de fièvre typhoïde, déclarés presque uniquement chez les jeunes gens venus depuis quelques mois seulement au lycée, pour terminer leurs études. Ce chiffre est relativement peu élevé, vu surtout les graves épidémies qui ont sévi dans la capitale pendant ces dernières années, et on admettra avec moi que la santé de nos lycéens est moins menacée qu’on ne paraît le croire. »
Ces statistiques sont certainement plus probantes que les énumérations vagues de Lagneau ; elles ne sont pas cependant satisfaisantes : car d’une part il est possible que beaucoup d’enfants et de jeunes gens soient réellement surmenés, éprouvent une fatigue très forte, dangereuse, et n’aillent pas à l’infirmerie, par conséquent ne figurent pas sur les registres des malades ; d’autre part, on doit admettre comme possible que des maladies d’épuisement peuvent naître au lycée et n’éclater que plus tard, quand les enfants sont revenus dans leurs familles ; dans le second cas, comme dans le premier, les registres de maladie seront muets.
Enfin, il faut bien savoir que la méthode pathologique ne peut indiquer que les excès considérables de fatigue, elle ne donne pas la mesure de la fatigue.
2° Les observations particulières de maladies survenues à la suite de travaux intellectuels excessifs ont quelque chose de plus éloquent que les froides statistiques. Peter est l’orateur qui a versé dans le débat le plus grand nombre de documents de ce genre, et il les a commentés avec une verve extraordinaire. Voici deux de ses observations, choisies parmi les meilleures. La première est celle d’une jeune fille. La mère de cette jeune victime du surmenage intellectuel écrit ceci :
« Voici comment la maladie de ma fille a commencé : il lui restait trois mois encore pour terminer sa dernière année d’études (1884) quand elle fut prise de violents maux de tête et de forts saignements de nez, bientôt accompagnés de fièvre. L’appétit et le sommeil avaient disparu.
« Le médecin du couvent craignait une fièvre typhoïde (et je me permets ici de dire que cette crainte était très naturelle, de tels accidents ressemblant à ceux de la fièvre typhoïde, à cela près de la brusque hyperthermie).
« Après huit jours les saignements de nez et la fièvre avaient diminué. Le médecin était d’avis que ma fille prît quelques jours de repos. Mais après ces quinze jours de vacances les maux de tête continuaient et tout travail était impossible.
« L’infirmière ainsi que la supérieure me conseillèrent d’emmener ma fille jusqu’à la fin des grandes vacances, ce qui faisait quatre mois de repos ; repos que ces dames savaient nécessaire, car le cas s’était présenté plusieurs fois déjà parmi leurs pensionnaires.
« Le médecin a conseillé pour ma fille l’air des montagnes ; nous avons passé ces quatre mois en Suisse, où les maux de tête ont toujours continué par accès avec de fortes courbatures de tout le corps. C’est au retour de ce voyage que, ne voyant aucune amélioration, je suis venue vous consulter. Le mal n’était jamais général ; elle souffrait plus fortement tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, en contournant irrégulièrement le tour de la tête. Tout travail de la tête, lecture ou autre, lui occasionnait des douleurs insupportables. »
Seconde observation : il s’agit d’un « jeune homme des plus robustes, né à Beaune, de parents vigoureux qui sont actuellement pleins de santé, ayant une sœur également bien portante, mais qui est restée avec ses parents dans sa ville natale.
« Le jeune homme, lui, s’est tuberculisé à Paris, dans les conditions suivantes : il travaillait chaque jour de six heures du matin à dix heures du soir, avec un répit de deux heures, dont une partie était consacrée à la « réfection corporelle », comme dit Rabelais. C’est-à-dire que ce jeune homme travaillait quatorze heures par jour dans sa petite chambre de l’École normale, immobile, lui bien musclé, et à la portion congrue d’un air confiné, lui de souche campagnarde. »
Il est utile de publier ces documents. Ce sont des démonstrations frappantes des effets produits par les excès intellectuels ; et il est bon qu’on puisse, au besoin, faire lire ces observations aux jeunes gens imprudents, pour leur donner la sensation du danger auquel ils s’exposent, en faisant des excès de travail intellectuel. Pour beaucoup, ces observations seront un avertissement salutaire.
Maintenant il convient d’ajouter que ces faits si graves doivent être discutés sérieusement ; on ne peut accorder de créance à ceux qui sont rapportés de troisième main, encore moins à ceux qui se réduisent à des on dit et à des anecdotes ou à des lettres écrites par des malades que personne n’a jamais vus. Un travail de critique doit se faire pour séparer les faits précis, authentiques, et les légendes si fréquentes en médecine. Enfin, même en restant sur le terrain médical, il faut bien avouer que l’observation la mieux prise, la plus topique, doit être interprétée, et on ne peut pas attribuer un désordre pathologique quelconque à un surmenage intellectuel avant d’avoir démontré la réalité de ce rapport de cause à effet. La discussion à l’Académie de médecine a montré que dans certains cas on a attribué à la fatigue cérébrale un état morbide produit par la présence d’un tænia dans l’intestin (Javal) ou par un vice de conformation de l’œil (Perrin). De plus il ne faut pas oublier, comme Lancereaux l’a bien montré, que certains désordres pathologiques proviennent d’influences héréditaires ou de mauvaises conditions hygiéniques qui n’ont rien à voir avec le surmenage.
Les discussions qui ont été établies sur ce point à l’Académie de médecine nous semblent avoir prouvé que les cas de méningite, de fièvre typhoïde et de tuberculose qu’on a attribués au surmenage sont des cas individuels, trop rares et trop spéciaux pour servir de base à une réglementation générale.
Après avoir beaucoup réfléchi à ce sujet, nous sommes d’avis que la méthode pathologique ne peut servir à élucider la question du surmenage intellectuel.
La réglementation des heures de classe, de repos et de sommeil, et de la durée de l’effort intellectuel que l’on demande aux écoliers ne pourrait être faite qu’arbitrairement, en se servant des cas de maladies. De ce qu’un individu a succombé à la fièvre typhoïde après un examen difficile qui l’avait surmené, nous ne voyons aucune conclusion pratique à tirer pour la réglementation de cet examen. La maladie et la mort d’un condisciple surmené peut être un salutaire exemple pour les autres, exemple qui devra surtout être médité par ceux qui ont une constitution délicate ou des prédispositions héréditaires. Mais du moment qu’on ignore généralement l’état des forces de l’individu qui a succombé, on ne peut pas savoir si sa constitution personnelle n’était pas responsable de sa mort ; de plus, on ignore quelle quantité de travail intellectuel il a produit, comment il s’est préparé à l’examen, quelle dose de connaissances il avait déjà avant de concourir ; et ce serait une perte de temps de chercher à préciser tous ces petits faits, qui le plus souvent échappent à l’investigation. La pédagogie a bien peu de chose à attendre de ces cas exceptionnels, d’autant plus qu’on en ignore le plus souvent la fréquence. La répétition de ces accidents dans une école ou au lendemain d’un examen doit être un avertissement pour les pouvoirs publics ; c’est un signe qui indique la nécessité d’une révision des programmes ; mais l’étude de ces accidents eux-mêmes ne peut servir de base à une réforme.
Nous sommes donc conduit tout naturellement, en finissant cette étude, à regretter que l’Académie de médecine se soit bornée à un échange d’opinions sur le surmenage, et qu’elle n’ait pas eu l’idée bien simple de résoudre la question qu’elle agitait, en faisant un appel à la seule méthode qui pouvait donner une solution : la méthode expérimentale. Pour savoir quel degré de fatigue et de surmenage était provoqué chez les enfants et les adultes par des programmes d’enseignement et d’examen dans les écoles, il fallait nommer une commission chargée, de mesurer cette fatigue et ce surmenage. Aucune théorie, aucun raisonnement ne valent des faits bien observés. Aussi l’Académie de médecine, en voulant absolument s’en tenir à la théorie, n’a-t-elle pas pu aboutir, et les conclusions qu’elle a votées pour clore ses débats sont remarquables par leur défaut de précision ; elles sont tout à fait typiques ; donnons-les comme exemple d’une vieille méthode qui, espérons-le, paraîtra bientôt aussi fausse que démodée. Voici ces conclusions :
« L’Académie de médecine appelle l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité de modifier, conformément aux lois de l’hygiène et aux exigences du développement physique des enfants et des adolescents, le régime actuel de nos établissements scolaires.
« Elle pense :
« 1° Que les collèges et lycées pour élèves internes doivent être installés à la campagne ;
« 2° Que de larges espaces bien exposés doivent être réservés pour les récréations ;
« 3° Que les salles de classes doivent être améliorées au point de vue de l’éclairage et de l’aération.
« Sans s’occuper des programmes d’études, dont elle désire d’ailleurs la simplification, l’Académie insiste particulièrement sur les points suivants :
« 1° Accroissement de la durée du sommeil pour les jeunes enfants ;
« 2° Pour tous les élèves, diminution du temps consacré aux études et aux classes, c’est-à-dire à la vie sédentaire, et augmentation proportionnelle du temps des récréations et exercices ;
« 3° Nécessité impérieuse de soumettre tous les élèves à des exercices quotidiens d’entrainement physique proportionnés à leur âge (marches, courses, sauts, formations, développements, mouvements réglés et prescrits, gymnastique avec appareils, escrime de tous genres, jeux de force, etc.). »
Il n’y a rien à retenir de formules aussi vagues que celle de « simplification des programmes » ou « diminution du temps des classes ». Ces mesures ne sont pas plus justifiées que précisées ; et nous pensons que si la discussion était née au sujet de la faiblesse des études au lieu d’être provoquée par le surmenage, l’Académie aurait pu voter, avec aussi peu de motifs, des conclusions pour « le relèvement des programmes » et « l’augmentation des heures de classe ».
Ce que l’Académie de médecine n’a pas pu faire, la science impersonnelle est en train de le faire en ce moment. Pendant ces dix dernières années, des hommes de science ont étudié dans le laboratoire et aussi dans les écoles les effets du travail intellectuel sur l’esprit et sur le corps. Ces recherches ont eu lieu et se poursuivent encore dans tous les pays, et surtout en Allemagne. On est dans la bonne voie, car ce sont des études rigoureusement expérimentales. On ne discute pas des théories, on observe, on mesure, on pèse. On choisit comme objet d’expérimentation un travail intellectuel quelconque, par exemple le calcul mental ou des additions, et on recherche quelle est l’influence que cette contention d’esprit a produite dans les fonctions organiques de l’individu ou dans ses fonctions intellectuelles ; ou bien on expérimente dans les écoles, ce qui est une nouveauté pour la psychologie ; on recherche sur des écoliers quels sont les effets produits par la classe du matin ou par la classe du soir, ou par une leçon de gymnastique. Nous possédons aujourd’hui de précieuses monographies ; elles ne nous donnent pas encore une connaissance complète du sujet, car toute recherche expérimentale est lente et longtemps partielle ; mais on sait déjà qu’il existe des méthodes capables de constater la fatigue intellectuelle et dans des cas où l’observation directe n’apprend rien. Nous allons exposer ces différents travaux, en insistant particulièrement sur les méthodes.
CHAPITRE II
DÉFINITION DU TRAVAIL INTELLECTUEL
Puisque ce livre a pour objet de décrire et d’analyser les effets du travail intellectuel, nous devons d’abord définir le travail intellectuel. Les mots changent de sens suivant les gens qui les emploient et suivant les matières auxquelles on les applique. En psychologie le terme de travail intellectuel, comme celui d’intelligence, a une signification très vague. Nous ne devons pas envisager la question au point de vue spécial de la psychologie, et chercher à tenir compte du rôle joué par les différentes facultés intellectuelles, comme la mémoire, l’attention, etc. Notre point de vue actuel est celui de la pédagogie ; aussi devons-nous comprendre par travail intellectuel toute espèce de travail que les élèves accomplissent à l’école, soit pendant la classe, soit pendant l’étude. Dans ce cas, le travail intellectuel s’oppose au travail physique, au travail musculaire, auquel les élèves se livrent soit pendant les récréations, dans leurs jeux ou dans leurs leçons de gymnastique, soit encore dans certaines parties des leçons d’art manuel. La distinction du travail intellectuel et du travail physique est simple en théorie ; dans tout travail intellectuel il y a une partie de travail physique, et dans tout travail physique il y a une part de travail intellectuel ; mais ce qui caractérise le travail physique, c’est que le rôle joué par les mouvements et par le système musculaire est prépondérant, tandis que dans le travail intellectuel, ce qui prédomine, c’est la concentration de l’attention et le jeu de l’intelligence.
Le travail intellectuel n’est pas un, il est extrêmement variable ; on peut, sans faire pénétrer bien avant l’analyse, distinguer différentes formes du travail intellectuel. Ces distinctions ne sont pas inutiles à indiquer ici ; elles serviront à délimiter notre sujet et à donner plus de précision à nos développements.
1° Le travail intellectuel peut être court ou prolongé ; il peut durer à peine une seconde, ou plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois ; et nous verrons que les effets physiologiques du travail intellectuel dépendent de sa durée. Le travail intellectuel scolaire, le seul qui doit nous occuper, est un travail assez long, qui dure plusieurs heures ; nous dirons cependant quelques mots du travail intellectuel court, durant à peine quelques minutes, afin de rendre notre étude plus complète ; mais nous ne parlerons pas du travail intellectuel très court, qui dure à peine quelques secondes. Ce travail si court consiste dans une fixation momentanée de l’attention. Écrire la psycho-physiologie de ce travail serait donc faire une étude du mécanisme de l’attention ; ce n’est pas notre intention.
2° Le travail intellectuel peut être intense ou modéré, et présenter une foule de degrés intermédiaires. Le travail intellectuel modéré est connu de tous, même de ceux qui n’ont pas appris à travailler intellectuellement, et à faire de vigoureux efforts d’esprit.
Il est en effet, pour une personne normale, difficile de rester à l’état de veille pendant longtemps sans faire aucun travail intellectuel ; continuellement on pense à quelque chose, on observe ce que l’on voit, on fait des projets sur ce que l’on va faire ou on réfléchit à ce que l’on vient de faire ; en somme, notre intelligence travaille continuellement, et c’est ce travail continuel qui constitue la marque principale de l’état de veille et le distingue de l’état de sommeil. Tout autre est l’état de travail intellectuel dans lequel on fait un vigoureux effort d’attention, pour comprendre un point obscur, ou pour rappeler un souvenir rebelle, ou pour apprendre quelque chose de nouveau. C’est le travail intellectuel intense, et chacun peut s’en faire une idée personnelle en essayant de calculer mentalement. Le travail scolaire tient le milieu entre ces deux extrêmes ; il exige de temps en temps des efforts intenses, puis il comprend de longues phases de travail très modéré.
Une distinction analogue à la précédente est celle du travail intellectuel volontaire et automatique. Le premier consiste à faire quelque chose de nouveau, le second consiste dans une application de souvenirs ; c’est une routine que l’on trouve dans tous les métiers, les plus intellectuels comme les plus mécaniques. Le travail intellectuel volontaire et nouveau exige un double effort, l’un pour concentrer son attention sur le travail en train, l’autre pour empêcher les idées étrangères à ce travail de se développer. Pour étudier les effets du travail intellectuel automatique, il suffit de comparer les effets du sommeil à ceux de l’état de veille.
Ce sont les influences produites par un travail intellectuel volontaire qui nous intéressent dans ce livre ; en effet, c’est le travail volontaire qui est exigé des élèves dans les écoles et c’est ce travail qui produit des effets de fatigue mentale qui, en augmentant d’intensité, sont si nuisibles à l’organisme entier.
Nous allons indiquer brièvement quelles sont les principales formes d’activité intellectuelle qui ont été étudiées jusqu’ici.
D’abord, le calcul mental. On peut dire que le calcul mental, sous forme de multiplication, est un des meilleurs procédés pour obliger une personne à faire un effort intellectuel court et intense ; l’effort consiste non seulement à multiplier, mais à retenir les données et les produits partiels ; on a aussi, dans certains cas, à décomposer l’opération et à remplacer une multiplication difficile par deux multiplications équivalentes et plus faciles. Le calcul mental offre aussi l’avantage d’être une pierre de touche pour la sincérité de l’effort. Il y a des personnes qui, même lorsqu’elles se savent en expérience, ne veulent pas se donner la peine de faire un effort mental ; elles font semblant de chercher, froncent les sourcils, restent immobiles un moment, mais elles ne font pas de travail intellectuel. Comme il faut un effort réel pour trouver une solution juste avec le calcul mental, il est tout indiqué de soumettre au calcul mental les individus dont la bonne volonté est sujette à caution. Le calcul mental a été employé dans les expériences de Mosso et de presque tous les autres expérimentateurs.
Un avantage considérable présenté par le calcul mental consiste en ce fait qu’on peut facilement faire varier la difficulté et par conséquent la durée de ce travail intellectuel. On peut en effet, chez un adulte, donner à calculer de tête des multiplications de difficulté très variable ; depuis une multiplication de un chiffre par un chiffre, telle que {\displaystyle \scriptstyle 7\times 8}7x8, qui prend en général deux à trois secondes de temps, jusqu’à une multiplication d’un nombre de deux chiffres par un nombre de trois chiffres, telle que {\displaystyle \scriptstyle 473\times 67}473x67, qui chez un individu moyen nécessite un temps de quelques minutes ; pendant ce travail mental le sujet reste immobile, il ne parle pas, il ne fait en somme que du travail intellectuel ; c’est là un avantage sur les autres travaux intellectuels, qui nécessitent presque tous des mouvements de parole ou autres.
On a aussi employé souvent, dans les recherches sur les effets que le travail psychique produit sur la circulation du sang, la méthode des problèmes d’algèbre et de géométrie ; mais ces problèmes ne peuvent être résolus que par des personnes en petit nombre, qui ont une culture spéciale.
Un autre exercice du même genre consiste à faire répéter de mémoire une série de chiffres. On récite devant le sujet cinq à dix chiffres, sans rythme, avec une vitesse de deux chiffres par seconde ; il doit les écouter attentivement, puis les répéter après une seule audition ; il doit faire un effort pour les répéter tous exactement, et dans l’ordre où on les lui a dits. Cette répétition exige un très sérieux effort d’esprit. Cette expérience a un avantage : on peut la faire même sur des personnes ignorantes, qui ne savent pas calculer de tête, qui ne savent pas leur table de multiplication, sur des individus qui ne savent ni lire ni écrire. Malheureusement, il y a une cause d’erreur : le sujet est obligé de répéter à haute voix les chiffres entendus, et par conséquent cet exercice de la parole vient ajouter au travail intellectuel un certain nombre de phénomènes moteurs qui en altèrent la nature : la respiration, par exemple, est modifiée par la parole. Il est presque impossible d’éviter cette erreur en priant le sujet de faire un effort pour retenir les chiffres et de ne pas les répéter ; car, du moment que le sujet sait qu’il n’aura pas à répéter les chiffres, il ne fait pas d’ordinaire un aussi grand effort pour les retenir que s’il doit les répéter devant témoins.
Quelques expérimentateurs ont imaginé d’autres expériences de mémoire, un peu plus compliquées : par exemple évoquer un souvenir ancien, se rappeler tel passage d’un auteur connu, ou exposer de mémoire une théorie philosophique. Mentz et Kiesow ont employé des épreuves de ce genre. En général, elles ont le défaut d’exiger un exercice de la parole, par conséquent le sujet fait des mouvements, ce qui complique les effets du travail intellectuel.
On peut encore signaler comme épreuves de travail intellectuel rapide la lecture. C’est un exercice que l’on peut faire seul et sans aide, et qui permet par conséquent d’expérimenter sur soi-même. C’est un très grand avantage, car alors on travaille seul dans une pièce isolée, et on est bien tranquille. Gley, pour étudier l’influence du travail intellectuel sur le pouls carotidien, lisait des pages de science ou de métaphysique. En graduant les lectures, on peut augmenter à volonté l’intensité de la contention d’esprit ; mais en général cette intensité est moindre que celle du calcul mental ; il est rare que l’on fasse pendant une lecture un effort mental aussi vigoureux que lorsqu’on cherche à faire de tête une multiplication un peu compliquée.
Tels sont les principaux procédés qui ont été imaginés jusqu’ici pour l’étude du travail intellectuel court et intense ; c’est une étude qui a été entreprise le plus souvent à un point de vue physiologique, pour connaître les effets du travail intellectuel sur le cœur, ou sur la chaleur animale, ou sur la force musculaire. Quand le travail est court et intense, et surtout quand il prend la forme d’une recherche, il s’accompagne souvent d’un sentiment d’anxiété ; on craint de s’embrouiller et de ne pas trouver la solution juste, de ne pas répéter exactement les chiffres. L’émotion augmente si, comme il arrive souvent, le sujet n’est pas isolé, et si l’expérience se fait devant plusieurs témoins. Les effets de cette émotion s’ajoutent à ceux du travail intellectuel et l’expérience n’est pas bien faite. Un auteur allemand, Kiesow, ayant remarqué cette cause d’erreur, a prétendu que le travail intellectuel ne produit d’effet sur la pression du sang que s’il est accompagné d’émotion ; mais cette conclusion est certainement exagérée. Il vaut mieux se borner à signaler cette cause d’erreur, et faire des efforts pour l’éviter.
Les recherches sur un travail intellectuel long, prolongé pendant plusieurs heures, sont moins nombreuses que les précédentes ; il y en a peu qui aient été faites dans les laboratoires de psychologie. On a employé en Allemagne, dans le laboratoire de Kraepelin, la méthode des additions ; on plaçait sous les yeux du sujet plusieurs colonnes de chiffres, et il devait les additionner et écrire les additions ; c’est un travail mental, et c’est aussi une fatigue d’écriture pour la main. Nous aurons du reste à regarder de très près ces recherches, pour en faire la critique. Plusieurs auteurs, qui avaient un article à écrire, des notes à compulser, des documents à étudier, en ont profité pour faire du travail intellectuel ; c’est de cette manière, par exemple, qu’on a étudié les effets du travail intellectuel sur la sécrétion urinaire. Le défaut de ce travail intellectuel est de manquer d’uniformité ; à certains moments, on fait un très grand effort d’esprit ; puis on dépense beaucoup de temps à lire distraitement des choses insignifiantes et à faire de la rédaction automatique. Pour provoquer un travail intellectuel plus continu et assez uniforme, nous pensons qu’on pourrait essayer de jouer une partie d’échecs à l’aveugle, pendant une heure ou deux.
Quelques auteurs n’ont point imaginé un travail intellectuel spécial, mais ont profité du travail intellectuel que leurs sujets exécutaient spontanément. C’est ainsi qu’ont été faites les si nombreuses recherches sur la fatigue intellectuelle dans les écoles ; on étudiait la fatigue provenant des heures de classe et des heures de gymnastique. Certainement, ce sont ces études qui sont les plus intéressantes pour la pédagogie. Nous relaterons dans le cours de cet ouvrage les observations, encore inédites, que nous avons recueillies sur la consommation du pain pendant une année scolaire dans une école normale ; le travail intellectuel des élèves consistait dans le cours normal des études, et il s’y est joint, vers la fin de l’année scolaire, un état d’anxiété produit par la préparation des examens.
Mosso, qui a surtout mis en lumière les effets du travail psychique sur la force musculaire, a expérimenté sur ses collègues quand ceux-ci venaient de faire un cours public, ou quand ils avaient fait passer des examens de médecine pendant plusieurs heures. Ce sont là de fortes dépenses d’activité intellectuelle, mais elles s’accompagnent de beaucoup d’émotion et aussi de mouvements.
On voit par ces exemples qu’il est assez difficile de provoquer un travail intellectuel qui soit, au gré de l’expérimentateur, continu, uniforme, prolongé, d’une intensité voulue, et surtout pur de tout élément émotionnel et moteur. Nous aurons pour chaque cas particulier à tenir compte des causes d’erreur qui auront pu se glisser dans les expériences, et dont les auteurs eux-mêmes n’ont pas toujours eu la claire conscience.
Après avoir donné une idée générale des différentes espèces de travail intellectuel qui ont été soumises jusqu’ici à l’expérimentation, il importe d’indiquer quels sont les effets de travail intellectuel qui ont été observés.