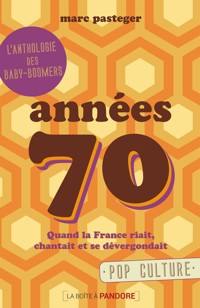Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Boîte à Pandore
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Laissez la magie de Noël entrer dans votre vie...
À 19 ans, Wilhelm ne connaît pas son père. On lui a juré cent fois qu’il était mort ; il ne l’a jamais cru. Et si, après d’innombrables recherches, ce 24 décembre 1962, les efforts et les espoirs de ce jeune homme étaient enfin récompensés ? Parti pour réveillonner chez sa fiancée, Maurice laisse chez lui une bouteille de champagne dans le frigo. Il s’agit d’un oubli. Qui va sauver un être cher ! Anna-Maria, 76 ans, a décidé que, pour Noël, elle aurait une cuisine neuve. Et ne recule devant rien, pas même une prise d’otages... Donna, 55 ans, est ensevelie dans une tempête de neige. Quatre jours plus tard, on la retrouve indemne grâce à un chien...
Incroyables, émouvantes ou drôles, voici « Les plus belles histoires vraies de Noël » glanées aux quatre coins du monde !
EXTRAIT :
Lorsque ce vendredi 19 décembre 2008, Donna Molnar quitte son domicile de la ville d’Ancaster (Ontario), elle ignore que, dans peu de temps, on parlera d’elle aux quatre coins du monde. Âgée de cinquante-cinq ans, Donna, épouse et mère de famille, vêtue d’une veste d’hiver, portant bottes et mitaines, monte dans son solide pick-up de couleur blanche. Et démarre. But de la sortie : effectuer quelques banales emplettes. Pourtant habituée aux dures conditions climatiques de sa région du Canada, Donna ne craint évidemment pas la neige. Cependant, la tempête qui, brutalement, se déclenche au-dessus d’Ancaster la prend de court. Rapidement, la route devient impraticable et le véhicule de Donna s’immobilise. Alors, sans doute la conductrice pense-t-elle avoir davantage de chance à pied et s’éloigne de la voiture.
Les heures s’égrènent. David, le mari, s’inquiète d’une absence aussi longue et alerte les secours. Des battues sont immédiatement organisées. On trouve le pick-up vide, mais aucune trace de Donna.
Le soir venu, les recherches sont interrompues. L’angoisse puis le désespoir gagnent petit à petit David Molnar et son fils de vingt ans. Autour d’eux, on veut encore garder espoir. Pourtant, le temps passe. Douloureusement. Jusqu’au jour où un secouriste volontaire, Ray Lau, parcourt un champ en compagnie de son chien, Ace. Subitement, l’animal s’arrête et aboie. Sous ses pattes – et soixante centimètres de neige ! – gît Donna Molnar. Bloquée dans cette prairie durant quatre jours et trois nuits par une température moyenne de moins quinze degrés – seuls sa tête et son cou ont échappé à l’ensevelissement –, elle vit encore !
Consciente, Donna a été plongée dans un coma artificiel dès son arrivée à l’hôpital. C’est là que ses proches l’ont veillée durant toute la période de Noël, surveillant son état qui, lente¬ment, s’améliore. Interrogé par la presse, David Molnar parlera d’une « intervention divine ». Et, aussi, canine...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les + belles histoires vraies de Noël
Marc Pasteger
Au souvenir de mes parents
Introduction
Depuis trente ans, je collectionne les histoires ayant trait à Noël. Pas les contes ou les légendes, uniquement les histoires vraies, courant sur plusieurs siècles, mélangeant grands personnages, célébrités d’aujourd’hui ou parfaits inconnus. Pour certains de ces derniers, et par respect de leur vie privée, j’ai changé des patronymes ou des noms de lieux. Comme dans de précédents ouvrages, j’ai pu romancer la forme, le fond, lui, demeurant rigoureusement authentique.
En ce qui concerne le choix des sujets, j’ai laissé la magie de Noël me guider. Puisse-t-elle être communicative…
M.P.
Perdue dans la tempête
Lorsque ce vendredi 19 décembre 2008, Donna Molnar quitte son domicile de la ville d’Ancaster (Ontario), elle ignore que, dans peu de temps, on parlera d’elle aux quatre coins du monde.
Âgée de cinquante-cinq ans, Donna, épouse et mère de famille, vêtue d’une veste d’hiver, portant bottes et mitaines, monte dans son solide pick-up de couleur blanche. Et démarre. But de la sortie : effectuer quelques banales emplettes. Pourtant habituée aux dures conditions climatiques de sa région du Canada, Donna ne craint évidemment pas la neige. Cependant, la tempête qui, brutalement, se déclenche au-dessus d’Ancaster la prend de court. Rapidement, la route devient impraticable et le véhicule de Donna s’immobilise. Alors, sans doute la conductrice pense-t-elle avoir davantage de chance à pied et s’éloigne de la voiture.
Les heures s’égrènent. David, le mari, s’inquiète d’une absence aussi longue et alerte les secours. Des battues sont immédiatement organisées. On trouve le pick-up vide, mais aucune trace de Donna.
Le soir venu, les recherches sont interrompues. L’angoisse puis le désespoir gagnent petit à petit David Molnar et son fils de vingt ans. Autour d’eux, on veut encore garder espoir. Pourtant, le temps passe. Douloureusement. Jusqu’au jour où un secouriste volontaire, Ray Lau, parcourt un champ en compagnie de son chien, Ace. Subitement, l’animal s’arrête et aboie. Sous ses pattes – et soixante centimètres de neige ! – gît Donna Molnar. Bloquée dans cette prairie durant quatre jours et trois nuits par une température moyenne de moins quinze degrés – seuls sa tête et son cou ont échappé à l’ensevelissement –, elle vit encore !
Consciente, Donna a été plongée dans un coma artificiel dès son arrivée à l’hôpital. C’est là que ses proches l’ont veillée durant toute la période de Noël, surveillant son état qui, lentement, s’améliore.
Interrogé par la presse, David Molnar parlera d’une « intervention divine ». Et, aussi, canine…
Tout le monde le croit mort, sauf son fils
Les dix-neuf premières années de Wilhelm Heinen n’ont pas été de tout repos. Le garçon naît en 1943, à Cologne, ville alors fréquemment bombardée. Afin de se sentir davantage en sécurité, sa mère emmène le bébé en Belgique. En 1945, Fritz, le père, est fait prisonnier par les Anglais. Et, ensuite, considéré comme mort.
À Bruxelles où le petit Wilhelm a trouvé refuge, le malheur frappe encore. À l’arrivée des Alliés, le gamin se voit privé de sa maman et placé dans un orphelinat. Heureusement, grâce à l’aide de la Croix-Rouge, un an plus tard, il retrouve celle qui constitue sa seule famille.
Au lendemain de la guerre, désireuse de commencer une nouvelle existence, la mère épouse un Belge. En grandissant, Wilhelm cultive la mémoire d’un papa qu’il n’a pas connu mais qu’il refuse d’accepter enterré quelque part en Angleterre ou ailleurs. Lorsque son beau-père propose de l’adopter, il refuse. Car, pour lui – appelez ça une intuition, une certitude ou une idée fixe, peu importe ! –, Fritz Heinen est vivant.
Wilhelm ne se trompe pas. La captivité de son paternel a duré six ans. En 1951, Heinen revint à Cologne où ses proches avaient tous disparu.
En 1962, Wilhelm a dix-neuf ans et s’engage dans l’armée belge, caserné à Dueren, en Allemagne. La Croix-Rouge – qui, par le passé, lui avait déjà rendu sa mère –, aidée cette fois par les services diplomatiques, lui apporte la preuve que son père habite en Allemagne, à la Palanterstrasse, à Koeln-Suelz.
Profitant d’une permission le 24 décembre, Wilhelm fonce à l’adresse tant attendue. Son cœur bat très vite lorsqu’il pousse sur le bouton de sonnette. Hélas, personne ne répond. Un peu triste, le jeune homme griffonne quelques mots sur un bout de papier qu’il confie à une voisine. Puis rentre à Dueren.
Fritz regagne son domicile tard dans la soirée, découvre le message, saute dans sa voiture et débarque à la caserne en pleine nuit. Ils n’ont pas besoin de se parler : Fritz et Wilhelm ont compris qui ils sont et qu’en cette superbe nuit de Noël, le bonheur les a enfin choisis.
Les premières phrases, ils les ont prononcées en anglais, langue apprise à l’école pour le plus jeune, chez l’ennemi d’hier pour l’aîné.
Et, très vite, Wilhelm a juré :
— Je reste ici, papa, je ne te quitte plus.
Sauvée par un prince charmant
— Cette année, on passera Noël ici ! Avec un peu de chance, il neigera et nos sapins seront tout blancs !
Étendu en maillot de bain sur la pelouse de sa maison de campagne, Gérard Bassinet, quarante-six ans, cadre dans une compagnie d’assurances parisienne, savoure ses vacances du mois d’août 1967 et, en pensée, déjà celles de décembre.
À un mètre de lui, Évelyne, son épouse, vient de faire la grimace, mais Gérard ne l’a pas vue. Comme elle a déjà partagé trois prises de bec avec son cher époux depuis ce matin et qu’il n’est même pas quinze heures, elle se dit que les belligérants ont droit à une sieste paisible.
Le problème, c’est que, dormant ou somnolant, Gérard parle quand même…
— Tu sais pertinemment que nous ne profitons pas suffisamment de cet endroit !
Plongée dans la lecture d’un roman policier et le visage dissimulé par les larges bords d’un chapeau de paille et par une paire de lunettes solaires, Évelyne Bassinet, quarante-deux ans, mère au foyer, fait celle qui n’écoute pas. Et, contrairement à l’un des personnages féminins du bouquin avec lequel elle est justement occupée en page 84, elle ne nourrit pas encore d’envies meurtrières… Mais il ne faudrait tout de même pas que son Gérard abuse, sinon, comme une certaine Rita dans le polar, elle pourrait ne plus répondre de rien !
Il faut préciser que, depuis deux années, la vie des Bassinet a changé. Aux yeux de Gérard, en bien ; à ceux d’Évelyne, en mal.
Jugeant Paris de plus en plus étouffante, leur appartement du VIIe arrondissement trop exigu et rétrécissant au fur et à mesure que Clarisse et Nicolas (respectivement âgés en 1967 de huit et six ans) grandissaient, Gérard décréta que, sauf à vouloir mourir d’un manque d’oxygène, il fallait aux Bassinet une résidence secondaire !
— D’ailleurs, ajouta-t-il, bon nombre de mes collègues ou copains y songent aussi quand ils ne sont pas déjà passés aux actes.
Ce à quoi, Évelyne répondit ironiquement :
— Si tout le monde émigre vraiment à la campagne, restons en ville ; il y fera plus calme !
Gérard haussa les épaules car aucune objection – et surtout pas une hypothèse aussi ridicule – ne viendrait perturber l’élaboration de son projet. Après avoir compté et recompté ses économies, vu son banquier, négocié et obtenu une augmentation que son patron lui promettait depuis des mois, Bassinet s’attaqua – pacifiquement – à la Normandie.
Ses parents l’y emmenaient en vacances et, de façon à la fois naturelle et pas originale pour deux sous, Gérard agit de même avec sa progéniture.
— Il y a tout en Normandie ! s’enflammait-il. La campagne, la mer, de belles villes, des villages superbes, l’Histoire et la modernité…
La Normandie aurait-elle eu besoin d’un chantre qu’en la personne de Gérard Bassinet, elle l’aurait déniché…
Parisienne comme son mari, Évelyne se sentait plus attachée au bitume qu’attirée par les petits oiseaux et l’odeur du foin. Et la Normandie lui inspirait des sentiments pour le moins mitigés.
Ainsi, une année avait-elle suscité la colère de Gérard parce que, coincée dans une auberge à Honfleur à cause d’une météo défavorable – un euphémisme car il tombait des cordes depuis trois jours et trois nuits –, elle avait eu l’audace de constater :
— À tout prendre, je préfère la pluie à Paris. Elle est moins triste et nous coûte moins cher…
Gérard lui avait vertement répliqué que les gouttes rebondissant sur les bateaux du port de plaisance ou les toits en chaume des alentours apportaient une indéniable dimension poétique à des paysages ayant d’ailleurs inspiré d’innombrables artistes, qu’ils fussent peintres ou écrivains ! Et enfilant le costume – ne correspondant pourtant pas à ses mensurations – de Pic de la Mirandole, Gérard porta l’estocade par ces mots un rien blessants :
— Mais, évidemment, ma pauvre Évelyne, tu ne peux pas comprendre !
La jolie Évelyne, taille fine, cheveux châtains et yeux verts, rêvait de se prélasser en bikini sur du sable fin et de nager dans l’océan. En lieu et place de quoi, elle pataugeait dans les flaques, accrochait son parapluie à ceux d’autres touristes et regardait d’un air envieux les plus prévoyants ayant jeté dans leur valise un pull à col roulé…
Si, par la suite, Évelyne a finalement accepté le déménagement en Normandie, c’est essentiellement pour ses chères têtes blondes.
Au début de l’aventure, elle a même pris du plaisir à jouer à la dînette. La petite maison en dehors de Deauville sur la route de Pont-l’Evêque est coquette, pratique, entourée d’un verger ni immense, ni minuscule.
Bonne joueuse et, au moment de l’achat, enthousiaste, Évelyne a reconnu :
— Mon chéri, tu as décroché le gros lot !
Le chéri, peu doué pour la modestie, en a profité pour vanter son flair dans les affaires, son talent à faire jaillir la bonne idée au bon moment et la sorte de symbiose existant entre lui et la Normandie ! Un peu délirant, tout ça. En ce printemps 1965, une sorte d’euphorie règne au sein de la famille Bassinet.
Officiellement inaugurée à Pâques, la propriété ne désemplit quasiment pas de tout l’été. Gérard effectue des allers et retours en juillet avant de s’installer en seigneur des lieux au mois d’août. On convie les copains, ceux ayant antérieurement acquis une résidence secondaire afin de leur montrer que, désormais, on parle d’égal à égal, et les autres, dans le but de susciter la jalousie et, plus encore, l’admiration. Car Gérard, petit bonhomme maigrichon d’un mètre soixante-cinq (ce qui, à la toise, marque une différence de cinq centimètres en sa défaveur par rapport à Évelyne) se montre bêtement fier de sa bicoque normande, autant, par exemple, que de sa Citroën DS noire, autre signe incontestable, sur son échelle des valeurs, d’une vraie réussite sociale.
Septembre offre encore de belles occasions de week-ends, mais l’automne et l’hiver aux journées courtes et sombres ne donnent pas nécessairement envie de quitter la chaleur du nid parisien.
Pourtant, juste avant Noël, Gérard s’est exclamé :
— Et pourquoi n’irions-nous pas voir à quoi ressemblent les fêtes en Normandie ?
Évelyne l’a rapidement rembarré.
— Nous sommes le 10 décembre et je te rappelle que nous avons déjà lancé des invitations.
L’année suivante à pareille époque, Gérard lui-même a accepté de rejoindre un couple d’amis à Reims. Mais voilà : pour 1967, le dessein d’un Noël campagnard revient – et la proximité de l’hippodrome de Deauville n’y étant pour rien – au grand galop !
Il reste qu’en deux ans, l’excitation d’Évelyne par rapport à son « petit palais » poussé dans la verdure s’est lentement transformée en rejet, sinon total, au moins très partiel.
Autrefois ménagère à temps complet dans l’appartement du VIIe, elle avait droit à des périodes de repos, principalement au mois d’août. Dans un hôtel – fût-il normand –, elle goûtait aux joies de se faire servir.
Depuis que Gérard Bassinet casse les oreilles de toute personne à laquelle il peut placer son titre de « propriétaire à Deauville » (même si c’est juste à côté), Évelyne trimballe les seaux, les brosses et la bouffe de quatre personnes trois cent soixante-cinq jours sur trois cent soixante-cinq.
Elle déclencherait bien une grève, mais aucun syndicat ne soutiendrait une brave dame incapable de fournir la moindre fiche de paie et n’ayant versé des cotisations qu’à des trucs sympa comme la Croix-Rouge, les Amis des Chiens et un vague club de passionnées de tricot.
Un soir de grand découragement, elle a émis le désir de travailler. Ce à quoi, toujours aussi charmant, Gérard a répliqué :
— Mais tu ne sais rien faire !
Manager, et très efficacement, deux résidences devrait pourtant prévaloir sur bon nombre de diplômes quelquefois décrochés sans mérite ou qui mériteraient d’être reconnus d’inutilité publique.
Durant l’été 1966, Évelyne se montre déjà quelque peu amère. En insistant, elle obtient un repas pris à l’extérieur. Mais, souvent, son égoïste de mari a le toupet de répondre :
— On est si bien chez nous ! Pourquoi sortir ?
Un soir, il a franchi les bornes de la bienséance. Et l’a regretté :
— Moi, des gueuletons en dehors de chez moi, je m’en tape en série pour le boulot. Alors, ras-le-bol ! C’est aussi les vacances pour moi !
À ces mots, Évelyne a explosé :
— Y a pas que toi qui es crevé ! Moi, je bosse du matin au soir, sans répit et sans gagner un radis. Alors, tu fais ce que tu veux mais, aujourd’hui, je ne mange pas ici. Depuis que tu nous as imposé ta bicoque pourrie, tes oiseaux qui chambardent et nous réveillent à la fine pointe de l’aube ainsi que le déluge quatre jours sur cinq qui fait pousser les mauvaises herbes deux fois plus vite que dans n’importe quelle région de France, je ne me repose plus jamais ! Et là aussi, ça va changer !
Gérard avait beau avoir décrété il y a longtemps que le centre du monde se situait juste à l’emplacement de son nombril, il comprit que s’il ne voulait pas se retrouver vraiment seul à le contempler, il avait intérêt à adopter un profil plus bas ce qui, comme disait un de ses copains, vu sa taille, n’exigeait pas une grande souplesse…
Pendant une semaine, Gérard multiplia les attentions, les déjeuners et dîners dans les alentours. Il offrit une robe et un collier à Évelyne, emmena les enfants à la plage pendant que son épouse se laissait bichonner dans un institut de beauté. En rentrant à Paris fin août 1966, l’orage conjugal ne constituait plus qu’un mauvais souvenir.
Mais, ce 6 août 1967, avec cette perspective de grelotter autour de la cheminée parce que le chauffage (que l’on pouvait soupçonner de dater de l’époque de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie !) aurait rendu l’âme laissait subitement présager de nouvelles grosses perturbations…
**
— Tu n’as pas répondu…
Court silence. Sans quitter son bouquin des yeux, Évelyne demande :
— Tu m’as posé une question ?
— Bien sûr ! s’agace Gérard. Nous passerons Noël ici.
— Ah, bon !
— Je savais que tu avais entendu !
— Oui, mais c’était une affirmation, pas une question…
— De toute façon, si nous calculions à combien nous revient cette maison par rapport au temps où nous l’occupons, nous nous rendrions sans doute à l’évidence qu’il s’agit d’un gouffre financier.
— Mais il s’agit évidemment d’un gouffre financier. Raison de plus pour nous en séparer !
Gérard aurait été attaqué par une horde de guêpes en colère qu’il n’aurait pas sauté plus précipitamment car il a compris qu’Évelyne ne plaisante pas.
— Vendre ? Jamais ! En revanche, nous allons vivre plus souvent ici.
Évelyne, elle, ne hausse pas le ton et ironise.
— On pourrait même en faire notre résidence principale et dénoncer le bail à Paris. Les enfants iraient à l’école au village voisin, peut-être qu’il y a encore une voiture tirée par des chevaux qui assure le ramassage scolaire. Moi, je confectionnerais des confitures aux pommes et me réchaufferais en sirotant du calva. Quant à toi, tu sonnerais aux portes en tentant de filer tes assurances. Vu le nombre d’habitants dénombrés dans le coin, t’aurais intérêt à beaucoup bouger et, surtout, à être patient, ce qui – dois-je te le rappeler ? – ne constitue pas ta principale qualité…
— N’importe quoi ! s’énerve Gérard.
— À moins que tu ne deviennes un grand voyageur, que tu ne partes d’ici au chant du coq et que tu ne reviennes de Paris alors que les poules seront couchées depuis longtemps…
Bondissant comme un cabri, Gérard éructe.
— Je vais réorganiser notre temps. Désormais, nous serons campagnards au moins quatre mois sur douze !
— Alors, réplique Évelyne tranquillement, je t’autorise la bigamie. Je resterai ton épouse parisienne et, dans ce beau bocage normand, tu te trouveras une autochtone grâce à qui, d’ailleurs, tu t’intégreras encore mieux à ta région d’adoption… Sur ce, je vais rechercher les enfants au club de tennis. Tu devrais m’y accompagner. Il y a là quelques jolies monitrices, sans parler de la fille du bar, qui – sait-on jamais ? – pourraient rêver de devenir mon alter ego de province…
**
23 décembre 1967. Depuis l’été dernier, on a beaucoup parlé chez les Bassinet et pas nécessairement dans la plus parfaite sérénité.
Âpre à la négociation, Gérard campait sur ses positions. Évelyne n’en demeurait pas moins déterminée. Elle consentit deux week-ends d’automne, mais pas davantage. Gérard, lui, exigeait Noël en Normandie et n’en démordait pas !
Malin, il mit les enfants dans le coup en leur décrivant un réveillon féerique allant même, sinon jusqu’à leur promettre, au moins à leur laisser croire que la neige serait probablement au rendez-vous…
Au bout de quelques jours, Évelyne, esseulée, admit qu’elle n’était pas de taille à lutter contre trois personnes. Il lui fallait rendre les armes. Non sans avoir posé une ultime condition.
— D’accord pour Noël en Normandie…
Sans prononcer un mot, Gérard ne pouvait dissimuler une intense jubilation.
Évelyne n’avait pourtant pas achevé sa phrase.
— …mais nous emmenons Maman !
In cauda venenum ! Et, pour Gérard, aucune autre expression ne pouvait d’ailleurs mieux convenir car il considérait sa belle-mère comme un véritable poison ! Bien sûr, il exagérait. Odette, soixante-quatorze ans, n’avait rien d’un monstre ; elle se montrait seulement parfois encombrante. Et, aux yeux de Gérard, Odette l’était dès qu’elle montrait le bout du nez !
— Moins je la vois, mieux je me porte !
Cette belle-mère-là possédait aussi un certain sens de la repartie, ce qui ne plaisait guère à Gérard aimant avoir le dernier mot. Depuis deux ou trois ans pourtant, la qualité d’ouïe d’Odette laissait à désirer. Ce qui, à la fois, limitait un peu les conversations, et notamment celles pouvant mal tourner, mais agaçait également Gérard qui se sentait obligé de répéter ses propos à plusieurs reprises.
Odette, taille moyenne, cheveux gris, jamais négligée, a toujours bon pied, bon œil. Veuve, elle habite seule dans un appartement bourgeois du XVIIe arrondissement et n’attend pas l’autorisation de son gendre pour rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants.
Rituellement, à Noël, Odette reçoit ou est reçue par Évelyne et les siens.
— Pas de Noël sans Maman ! a tranché Évelyne de façon catégorique. L’an dernier, même les Drinquier l’ont invitée avec nous à Reims.
Gérard aurait voulu trouver la faille du système. En vain.
— Ta mère ? Mais elle ne supportera pas le voyage !
— C’est le Père Noël qui habite au Pôle Nord, ironisa Évelyne. Nous, nous allons seulement à Deauville.
— Et si elle attrape froid là-bas ? Elle n’aura pas un toubib dans son immeuble comme à Paris…
— Elle a une santé de fer et nous enterrera tous !
— Ne parle pas de malheur ! rétorqua Gérard qui, brusquement, changea de ton. Et si j’avais envie d’un Noël sans ta mère ?
— Tu en aurais parfaitement le droit, concéda Évelyne. Mais, dans ce cas, ce serait aussi sans moi.
Gérard comprit que le combat était vain. Le Noël de 1967 serait bien normand, mais avec belle-maman…
Ce 23 décembre, vers 11 heures, M. Bassinet n’est pas à prendre avec des pincettes. Odette, à qui l’on avait fixé rendez-vous à 10 h 45 a débarqué à 9 h 50 !
Sans même lui dire bonjour, quand Gérard l’a découverte dans la cuisine sirotant une tasse de café, il a grommelé :
— Z’êtes déjà là ?
De bonne humeur, elle, Odette a rétorqué :
— Non, c’est ma doublure qui répète mon rôle !
— Dix jours comme ça, a menacé Gérard entre ses dents, et je l’étrangle !
Clarisse et Nicolas ont compris dès le lever qu’il ne s’agissait pas d’un jour pour rigoler et qu’il était conseillé de filer droit. La veille, au cours du dîner, leur père a expliqué :
— Grand-mère s’installera entre vous deux. Vous pouvez quand même emporter des jouets et des peluches.
Puis, ricanant un peu sadiquement :
— Ce sera l’occasion de lui faire subir des tests respiratoires grandeur nature. Si elle résiste aux nounours et aux lapins qui traînent dans vos chambres à longueur d’année, et parfois sur le tapis, c’est que ses bronches sont en bon état…
Gérard remarque les deux grosses valises d’Odette disposées dans l’entrée puis crie en direction de la propriétaire des bagages :
— Je n’aurai jamais assez de place pour tout votre fourbi. Je tire au sort. Pile, j’embarque la noire ; face, ce sera la brune !
Odette accourt, inquiète.
— Je n’emporte rien de trop !
Évelyne vole à son secours.
— Ce ne sont quand même pas des malles !
— Ok, enchaîne Gérard, en fixant Odette d’un air mauvais. Je les descends toutes les deux, mais je vous laisse ici !
— Il plaisante ! rassure Évelyne.
— À deux jours de Noël, seule à Paris, ce serait cruel, enchaîne Gérard. J’ai une autre idée. Comme il paraît que vous avez une santé du tonnerre, vous allez courir derrière la voiture !
Évelyne hausse les épaules.
— Il te taquine, Maman !
Gérard s’énerve.
— Tout le monde dans cette famille croit que j’ai acheté une voiture élastique !
Il est 11 h 15 quand après avoir effectué plusieurs allers et retours entre le parking et l’appartement, Bassinet constate qu’Odette entame une troisième tasse de café. Gérard voit rouge.
— Elle boit deux litres si elle le veut, grogne-t-il face à Évelyne, mais, moi, je ne m’arrête pas toutes les dix minutes. J’ai une moyenne à tenir !
Odette n’a perçu que quelques syllabes :
— Il m’accuse de mentir ?
— Pas du tout ! s’étonne Évelyne.
— J’ai entendu « La doyenne a l’air de mentir ! »
— Ne te tracasse pas, Maman ! Il n’y a aucun problème. À chaque départ en vacances, le stress de Gérard se traduit par un flot de paroles encore plus important qu’en temps habituel, mais il n’a pas eu de mot déplacé à ton égard…
Et Évelyne se retient d’ajouter :
— Enfin, pas encore !
Dès la sortie de Paris, les Bassinet se querellent sur l’itinéraire à emprunter.
— La dernière fois, tu as reconnu que tu ajoutais quinze kilomètres ! jure Évelyne.
— Si je t’écoutais, on rejoindrait Deauville par Bordeaux sous prétexte qu’il y a moins de feux rouges !
À l’arrière, Odette propose à Nicolas et Clarisse de chanter des titres de circonstance.
« Mon beau sapin, roi des forêts, que j’aime ta verdure… »
Puis, c’est :
« Belle nuit, sainte nuit, tout s’endort, plus de bruit… »
Gérard grogne.
— Si ça pouvait être vrai…
— Tu n’aimes pas l’art ! ricane Évelyne.
— Si, justement !
— Les enfants chantent juste ! proteste Évelyne à voix basse.
— Un don qui ne leur vient pas de leur grand-mère maternelle, ironise le conducteur.
Vers midi quinze, Odette fait savoir qu’elle a faim.
— Et sans entrer dans les détails, j’ai un besoin urgent à satisfaire…
— C’est quoi ça ? demande Nicolas.
Gérard élude la réponse.
— Vous attendrez bien encore un peu…
— Tout se situe dans la notion de « un peu »…
— Deux bonnes heures ! affirme Gérard sérieux.
— Évelyne, supplie Odette, ce ne sera pas possible !
— Tu ne te rends pas compte qu’il te fait marcher ?
— J’aurais bien aimé ! s’exclame Gérard. Si vous aviez trottiné derrière la voiture comme je vous l’avais suggéré afin de laisser davantage de place à vos bagages, vous auriez pu vous autoriser toutes les pauses pipi que vous vouliez !
Puis, jouant au sadique.
— Avouez que vous regrettez !
— Il dit qu’on va s’arrêter ? interroge Odette un rien fébrile.
— Avant Deauville, non ! surenchérit Gérard.
— Pas de panique, Maman ! intervient Évelyne. On arrive bientôt à l’auberge que nous avons choisie pour déjeuner.
Le repas ne se déroule pas dans une ambiance idyllique. Gérard a un œil dans l’assiette et l’autre sur la montre.
— D’habitude, le service est plus rapide ! râle-t-il.
— En été, il y a davantage de personnel, souligne Évelyne.
— M’en fous ! Moi, en toute saison, je garde ma moyenne !
La belle-mère ne se montre pas plus satisfaite.
— La côte à l’os est coriace !
— Qui se ressemble, s’assemble ! grince le gendre.
Odette poursuit.
— Je me demande s’il n’y a pas plus de gras que de viande. Et chez vous, ça va ? lance-t-elle à la cantonade.
Nicolas et Clarisse jugent leurs boulettes « assez bien » mais guettent surtout les desserts.
Évelyne n’émet aucun commentaire particulier sur le saumon, ce qui n’est – évidemment – pas le cas de Gérard.
— Dès que je choisis le même poisson que toi, c’est moi qui ramasse toutes les arêtes ! Et toi, tu n’en as pas une seule. Même pas une petite pour me faire plaisir ?
Évelyne sourit en secouant négativement la tête.
— Je me demande, intervient Odette, si, à cause d’un bout d’os, je ne me suis pas décalé le dentier !
— La prochaine fois, tranche Gérard narquois, on ne vous commandera que la purée !
— Qu’est-ce qu’il raconte ? lance Odette à Évelyne.
— Des bêtises !
— Il se fout de ma pomme, c’est ça ?
Gérard lève les yeux au ciel.
— Terminez votre côte sans l’os et ne traînez pas ! Pensez à ma moyenne !
En multipliant involontairement les grimaces, Odette inspecte sa bouche avec la langue.
— J’ai l’impression qu’un truc sur le côté gauche est de travers…
— Y a pas que sur le côté gauche ! grommelle Gérard qui prend un coup de coude, discret, de son épouse.
— Tu as mal quelque part ? demande Évelyne.
— Un peu sur le côté gauche, oui.
— Cet hiver, les côtes à l’os sont agressives, on en a parlé à la radio, tente de plaisanter Gérard.
— Ah, bon ! s’étonne Nicolas.
— À cause du froid qu’elles ne supportent pas, sans doute, répond son père en lui faisant un clin d’œil.
Odette n’achève pas son plat. Et, au moment des desserts, s’abstient.
— Même pas une petite panade ? risque Gérard que sa femme gratifie cette fois d’un coup de pied dans la cheville droite.
Tandis que les enfants optent pour une glace, Évelyne et Gérard font cuiller séparée dans la même coupe (bien) remplie de mousse au chocolat.
Les Bassinet adorent ça et pourraient établir une sorte de guide tellement ils en ont goûté dans d’innombrables restaurants. Tout en avalant un café puis en réglant l’addition, ils continuent à disserter sur les qualités et les défauts de ce qu’ils viennent de déguster, parient sur la marque du chocolat, critiquent le manque de légèreté de la chantilly. Parallèlement, Nicolas et Clarisse se sont déjà installés dans la limousine et jouent avec des figurines.
Cela fait un bon quart d’heure que les Bassinet font assaut de souvenirs gastronomiques.
— Et tu te souviens de …
— Oui, on y était allé juste après chez Machin…
— Qui ne vaut pas le dixième de Truc que nous avions testé six mois plus tôt dans la même région…
Subitement, une petite voix, celle de Clarisse, intervient.
— Personne ne trouve bizarre que Mamy ne soit toujours pas là ?
Court silence. Évelyne fronce les sourcils.
— Avec son problème de dentier, elle est allée s’examiner face à un miroir. Je lui ai dit qu’on l’attendait dans la voiture.
Gérard consulte sa montre.
— Y a cinq bonnes minutes !
— Non, s’autorise Clarisse, plus de vingt… Quand nous sommes sortis, j’ai regardé l’horloge sur la façade de l’auberge. Elle indiquait quatorze heures cinq…
Oubliant ses bavardages autour de la mousse au chocolat, Gérard bondit de la DS.
— Je parie qu’elle s’est enfermée dans les toilettes dans le seul but de bousiller ma moyenne. Je vais la chercher par la peau du dos !
Quatre minutes plus tard, Bassinet revient à la voiture, se laisse tomber sur son siège et fulmine :
— Madame ta mère se lance dans les farces et attrapes !
— Tu l’as vue ?
— Non. Personne ne l’a vue ! Donc, elle joue à cache-cache !
— C’est rigolo, ça ! remarque Nicolas. On peut chercher grand-mère ?
Gérard explose.
— Non ! Vous ne sortez pas d’ici ! Et si, dans deux minutes, Odette n’a pas montré le bout de son chignon, je démarre et elle fêtera Noël dans le bois derrière le restaurant.
— Dans le bois ? répète Clarisse inquiète.
— Et si le loup la mange ? interroge Nicolas.
— Il en crèvera ! jubile Gérard.
— Je ne te permets pas de parler de Maman en ces termes, le reprend Évelyne très vertement. Et surtout pas devant les enfants !
Elle sort du véhicule, claquant la portière et va à son tour se renseigner.
Mais, in fine, elle est forcée de se rendre à l’évidence : sa mère a disparu !
— Tu lui avais bien dit qu’on l’attendait dans le parking ?
— Bien sûr ! jure Gérard. Et, pendant que nous évoquions nos orgies de mousse au chocolat, j’ai même avancé de vingt mètres afin de lui épargner un bout de chemin.
Et, en prononçant ces mots, Bassinet n’ironise plus car il constate l’angoisse de son épouse.
— Le patron a inspecté avec moi tous les endroits où elle aurait pu rester coincée ou avoir un malaise…
Silence dans la DS.
— Il ne reste qu’une solution à envisager, sanglote Évelyne : on l’a enlevée !
Nicolas est stupéfait.
— Comme dans les films à la télé ?
— Mais non ! rectifie Clarisse, l’aînée, en haussant les épaules. Ici, c’est pour de vrai !
Gérard éprouve de grosses difficultés à garder son sérieux.
— Qui en voudrait à ta mère ?
— Tu lis un peu les journaux ? On s’en prend aux vieux pour leur piquer leur argent !
Gérard ne se montre pas convaincu.
— Et ton kidnappeur, par où serait-il sorti ?
— Si tu avais observé les lieux aussi attentivement que moi, lui envoie Évelyne dans les gencives avec une certaine délectation, tu aurais remarqué qu’il existe une autre porte, à gauche, et que nous ne voyons pas d’où nous nous trouvons.
— Et quelqu’un aurait pu embarquer Odette aussi aisément qu’une boîte de biscuits !
— Par cette issue latérale, on peut très bien s’éclipser discrètement.
— Mais, enfin, Odette ne se serait jamais laissé faire !
— Elle est sourde.
— Quand ça l’arrange !
— Quel est le rapport ?
— Et celui de sa surdité avec le fait qu’elle suive un inconnu sans protester ?
— Elle aurait pu comprendre que la personne qui lui voulait du mal venait de notre part…
— Donc, s’amuse Gérard, cette personne nous connaîtrait ! Peut-être que c’est un voisin ou un cousin qui mijotait son affaire pour détourner l’héritage et qui nous suivait depuis Paris ! Téléphone à l’ORTF : tu tiens une bonne idée de feuilleton !
Évelyne ne relève pas.
— Je veux que nous nous rendions au poste de police ou de gendarmerie le plus proche ! exige-t-elle d’un ton ferme.
Gérard soupire.
— Parce que tu crois que ces gens, payés par l’État, ont reçu comme mission dans leur feuille de route : « Surveiller étroitement Odette Berger. » ?
Et, là, Évelyne explose.
— Gérard, je sais que tu ne supportes pas ma mère et que toutes les occasions te semblent bonnes pour te moquer d’elle !
— Si on ne peut plus rire…
— Tu confonds humour et méchanceté !
— Si je n’étais pas sympa avec elle, j’aurais profité du fait qu’elle s’attardait dans le restaurant et j’aurais démarré en trombe !
— Et tu continues ! crie Évelyne.
— Exact ! Je ne change rien ni à mon comportement, ni à ma façon de plaisanter, sinon, dans moins de cinq minutes, tu m’accuseras d’avoir organisé le kidnapping !
Évelyne se calme. Les enfants n’osent plus en placer une. Gérard leur propose :
— Venez avec moi jusqu’au bois ! Quelquefois que mamy aurait voulu se dégourdir les jambes et qu’elle se serait perdue…
Clarisse et Nicolas galopent devant. Évelyne suit Gérard, puis revient à sa hauteur.
— Je suis désolée de m’être emportée, dit-elle en lui serrant le bras…
Et lui qui, pourtant, ne cesse de monter sur ses grands chevaux sous n’importe quel prétexte, rétorque :
— Tout le monde ne possède pas la capacité à maîtriser ses nerfs… Mais ce n’est pas grave !
Une trentaine de minutes s’écoulent et la famille Bassinet demeure bredouille. La grand-mère n’ayant pu se lancer dans un sprint effréné sur plusieurs kilomètres, il convient de tirer les conclusions qui s’imposent.
En mettant le moteur de la limousine en marche, Gérard admet qu’il va bien falloir s’adresser aux forces de l’ordre.
Une dizaine de kilomètres et bien des palabres inutiles plus tard, Gérard et Évelyne Bassinet expliquent à un gendarme que Madame Odette Berger, soixante-quatorze ans, s’est brusquement volatilisée, sinon entre la poire et le fromage, en tout cas entre le café et la reprise de la route.
Leur interlocuteur écoute, note et ne manifeste aucun sentiment. Puis pose des questions qui surprennent Gérard et agacent Évelyne.
— À votre connaissance, Mme Berger a-t-elle un amant avec qui elle aurait pu s’enfuir ?
— Nous ne la retenions pas prisonnière ! proteste sa fille, outrée.
— A-t-elle toujours toute sa tête ?
— Évidemment ! s’offusque Évelyne. Elle fait même preuve d’une grande vivacité d’esprit.
Gérard ne peut s’empêcher de faire une moue que le gendarme remarque.
— Et d’après vous, monsieur, votre belle-mère pourrait-elle se comporter bizarrement ?
— Bizarrement ? répète Gérard se retenant de jurer : « Mais tout est bizarre chez cette vieille rombière ! »
Il chasse sa vilaine envie, se racle la gorge puis précise.
— Euh… Non… Parfois, elle n’entend pas très bien…
— Elle est sourde, en conclut l’autre qui écrit cette phrase.