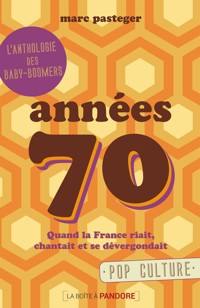Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jourdan
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Les curiosités qui ont fait l'actualité de notre plat pays, du Moyen Age à nos jours! Notre plat pays a été le témoin d'événements qui ont soulevé de nombreuses questions. Affaires criminelles, assassinats manqués de justesse, chasses au trésor maudites ou couronnées de succès, conflits interminables, toutes ces aventures ou mésaventures appartiennent à notre passé. Des histoires vraies et palpitantes: - Saint Lambert, victime d'une femme? Il est mort assassiné en 705, vraisemblablement sur ordre d'Alpaïde, la concubine de Pépin de Herstal, qui craignait que l'évêque de Liège fasse rentrer son amant dans le droit chemin conjugal... - Le vol incroyable, au VIIIe siècle, du trésor de Childéric, enterré à Tournai. - L'histoire étonnante de l'odyssée du cercueil de saint Idesbald, qui s'est déroulée de 1237 à... 1968! - À Liège, vers 1670, la Brinvilliers, célèbre empoisonneuse française, s'est cachée, se jouant ainsi de la justice pendant trois ans. - Au XVIIe siècle, les frères Duquesnoy, artistes sculpteurs, défrayent la chronique. Le second est soupçonné d'avoir empoisonné le premier. Et le second se voit plus tard condamné à mort dans une sombre affaire, sans doute parce qu'il est homosexuel... - L'affaire Sartorius, au XVIIIe siècle, à Visé. Une jeune femme enceinte est assassinée. Huit ans d'enquête pour aboutir à une erreur judiciaire... - 8 décembre 1949. Deux enfants de 6 et 7 ans, originaires d'Eupen, disparaissent dans les Fagnes. La nouvelle inquiète la région puis le pays entier... Découvrez une multitude de petites histoires qui ont parsemé la grande et parcourez les faits divers populaires qui ont marqué les Belges, parfois pendant plusieurs siècle! EXTRAIT Henri IV, au temps de sa splendeur surnommé le Vert Galant, est ce soir-là bien vert. Mais de rage. Nous sommes le 29 novembre 1609. Il est environ vingt-trois heures quand le roi de France apprend une nouvelle qui le met hors de lui. Sans hésiter, il convoque ses proches conseillers et ordonne à Sully, son Premier ministre qui s'était couché de bonne heure, de sortir de son lit. La guerre viendrait d'être déclarée inopinément à la France par l'un de ses voisins que le souverain n'agirait pas autrement. Car c'est bien une cellule de crise, comme l'on ne disait pas à l'époque, qu'Henri IV organise à la hâte au Louvre. La réunion du jour ne porte pourtant que sur l'éloignement du pays d'une jeune femme, Charlotte-Marguerite de Montmorency, récemment mariée à Henri II de Bourbon, prince de Condé. Mais voilà: Henri IV est follement tombé amoureux de la belle et lui a fait épouser son neveu qui ne devait pas s'y intéresser. Problème pour le peu visionnaire Henri IV: le mari n'a rien de conciliant et encore moins de partageur... Au bout de quelques mois dominés par des scènes assez grotesques, le prince de Condé a littéralement enlevé sa femme pour la conduire en une ville jugée sûre par lui: Bruxelles! À PROPOS DE L'AUTEUR Marc Pasteger est journaliste et collabore notamment au Soir Magazine et aux quotidiens de SudPresse. Il a publié de nombreux livres de curiosités dont Et toque! - Petite anthologie de l'esprit à table qui a obtenu le Prix Epicure 2012 de la Ville de Saumur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Belg-O-Belge
Bruxelles
http ://www.belgobelgeeditions.be
ISBN : 978-2-39009-334-3– EAN : 9782390093343
Toute reproduction ou adaptation d’un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie ou microfilm, est interdite sans autorisation écrite de l’éditeur.
Marc Pasteger
Suspense en Belgique
Des histoires vraies et palpitantes
À Séverine et Tania
Avertissement
Affaires judiciaires, faits divers, conflits de toutes sortes, les histoires vraies qui suivent, souvent méconnues ou oubliées, ont eu lieu en Belgique ou, pour quelques-unes, ont concerné des Belges sur d’autres territoires.
Dans certains récits, par souci du respect de la vie privée, des patronymes ou des noms de lieux ont été changés ou n’ont pas été mentionnés.
Rendez-vous dans la cabane
Rodolf Romberts est devenu bûcheron parce son père et son grand-père étaient bûcherons. Et il ne s’en plaint pas. En ce mois de février 1921, alors qu’il vient de fêter ses quarante-cinq ans, Rodolf Romberts peut se targuer de jouir d’une bonne situation. Contrairement à ses prédécesseurs, il a compris que afin de gagner davantage d’argent, il ne fallait pas nécessairement travailler davantage soi-même mais faire plus travailler les autres. Et c’est ainsi que Rodolf a pu engager un puis deux ouvriers.
Son (petit) domaine, dont il se montre très fier, se situe dans la région d’Audenarde. Rodolf aime dire qu’il possède le plus grand terrain de toute la rue et même des cinq rues constituant son hameau. En fait, Rodolf nourrit un vrai complexe vis-à-vis de ce que l’on appelle la bourgeoisie et à laquelle il n’appartient pas. Son père et son grand-père, humbles et bosseurs, sont « restés à leur place » comme on dit à l’époque. Et contrairement à Rodolf, ils n’ont jamais eu de rêve de splendeur pas plus que la folie des grandeurs. Le représentant de la troisième génération, lui, n’envisage pas son métier de la même façon. « L’après-guerre a tout bouleversé, pérore-t-il. Moi, je suis prêt pour grandir encore ! »
Le problème de Rodolf, c’est que sa croissance, il la veut à n’importe quel prix, quitte à écraser les autres. Une réputation peu flatteuse précède le personnage et quand ils subissent ses longs discours, souvent creux, ses ouvriers ricanent sous cape : « Pour grandir encore, il faudrait surtout trouver de nouveaux clients, c’est-à-dire des gens acceptant de traiter avec un monstre… » Les deux gars exagèrent peut-être un rien parce qu’ils subissent de mauvais traitements de la part d’un patron qu’ils ne jugent pas honnête et qu’ils décrivent comme un type trop orgueilleux, trop colérique, trop injuste. Et ils partagent cette appréciation avec bon nombre de personnes ayant eu à fréquenter Rodolf Romberts.
Chez lui, le gaillard fait preuve de la même autorité, on s’en doute. Face à lui, sa femme, Hilde, et leurs trois enfants adolescents, Jozef, Liesbeth et Gerard, n’ont pas grand-chose à dire. Lorsque Rodolf rencontre des contrariétés dans son boulot, c’est à la maison que ça barde le plus. Et le réceptacle de sa très mauvaise humeur s’appelle Hilde. Jolie femme blonde de quarante ans, elle encaisse tout. Y compris, dit-on, les coups qui peuvent pleuvoir lorsque Rodolf rentre un peu saoul et qu’il doit se défouler.
Hilde n’a pas l’habitude de protester, ni de se plaindre. Aime-t-elle encore cet homme qui l’impressionnait tant vingt ans plus tôt par sa stature (un mètre quatre-vingt-cinq), sa prestance et sa logorrhée dont elle aurait plutôt dû se méfier ? Regrette-t-elle parfois d’avoir consacré sa vie à cet être au cœur de pierre ne lui adressant jamais un mot agréable et aimant à la moindre occasion l’accabler de tous les reproches ? Imagine-t-elle de temps à autre, elle, issue d’une bonne famille, ce qu’elle aurait pu construire au côté de quelqu’un de sympathique et de cultivé ?
Les enfants ont appris à filer doux et, grâce à leurs grands-parents maternels, ont eu accès à des études qui les feront sans doute sortir du carcan professionnel de leur père. Ce qui n’a pas manqué de créer des tensions supplémentaires. Rodolf a beuglé : « Les garçons seront bûcherons, comme moi ! Et la fille se trouvera un mari, comme toi ! »
Hilde a une fois encore laissé passer la tempête. D’autant que, dans le même temps, Rodolf a eu une attention à son égard. Un soir, il lui a annoncé : « Je vais embaucher une cuisinière qui t’aidera dans ton travail. »
Afin que son épouse prenne ça pour une pure gentillesse à son endroit, il a ajouté que, aux yeux des voisins, des copains et des clients, c’était un signe de richesse supplémentaire ! Romberts ne craignait décidément rien, pas même le ridicule.
La demoiselle, Anke, censée contribuer à l’ordre de la famille, finit par y semer un vrai désordre. Aveugle les premiers mois, Hilde ouvre un jour les yeux et comprend que l’employée de maison est devenue la maîtresse de son mari. Et au fil de ses pensées très amères, Hilde se demande même si son scélérat de mari n’a pas fait entrer Anke chez lui parce qu’il était déjà son amant.
Vingt-sept ans et affichant des rondeurs mettant visiblement le mâle bûcheron en appétit, Anke satisfait ses désirs dans une cabane située à huit cents mètres de l’habitation. Romberts y a installé une sorte de bureau qu’il a équipé d’un divan confortable pour ses ébats.
C’est par hasard que Hilde a découvert le pot aux roses. Un jour de juillet particulièrement chaud, elle cherchait son mari dont le fermier d’à côté réclamait la présence pour un problème urgent. À cinquante mètres de la cabane, elle vit Anke sortir en courant à moitié nue et, juste derrière elle, Rodolf, dans la même tenue légère, la rattrapant en riant…
Traumatisée, Hilde s’assit sur un tronc d’arbre et éclata en sanglots. Le choc était particulièrement rude. « Pauvre sotte ! », s’insulta-t-elle peu après. « Comment n’as-tu rien vu plus tôt ? Et combien de temps vas-tu pouvoir endurer un tel affront ? »
Ce jour-là, quelque chose a radicalement changé dans la tête de Hilde. Son mari étant souvent absent, elle a donc tout le loisir de réfléchir et de laisser mûrir des pensées qu’elle veut positives.
Prétextant une mauvaise grippe contractée par sa mère, elle retourne à Bruges, sa ville natale, afin de prendre conseil auprès de ses parents et cousins. La tendance forte qui se dégage de ses conversations : « Faire constater l’adultère et ensuite quitter cette brute. »
Mais, si, au fond d’elle-même, Hilde est bien décidée à ne plus se laisser maltraiter comme la dernière des idiotes, elle craint encore les réactions violentes de son mari. Et, au début du vingtième siècle, les femmes qui osent combattre la stupide domination masculine ne sont pas légion. Dès lors, Hilde convient qu’il faut agir plus finement. Rien dans son comportement vis-à-vis de Rodolf et d’Anke ne peut prouver qu’elle est au courant de leur liaison. Forte et digne, Hilde attend son heure…
À l’entrée de l’hiver, Rodolf commence à se plaindre de douleurs au ventre à telle enseigne que lui, le colosse jamais malade, appelle le médecin. « Un solide microbe dans les intestins ! », diagnostique l’homme de science. « Il y a plusieurs cas du même genre dans le coin. Pas de quoi t’inquiéter ! »
Pour la première fois depuis qu’il a repris l’affaire de son père, Rodolf ne met pas le nez dehors pendant une semaine. Lorsqu’il s’y aventure de nouveau, c’est toujours en étant patraque. Trois jours se passent ainsi. Romberts a mauvaise mine et fait revenir le docteur qu’il connaît de longue date. « Tu dois rester au chaud. Il fait particulièrement froid en ce moment, il gèle toutes les nuits et en commettant des imprudences, tu ralentis ta guérison. D’ailleurs, regarde, maintenant tu as de la fièvre ! »
Rouge, en sueur, courbaturé lorsqu’il se hasarde à se lever, Rodolf s’impatiente. « Du vin chaud, voilà ce qu’il me faut ! » Le docteur ferait des bonds s’il entendait pareille commande mais Hilde s’exécute en ajoutant même : « Mon papa m’a appris à mitonner le meilleur ! »
Anke ne sait comment réagir. Quand elle croit être seule avec son amant, elle le cajole en lui susurrant des mots doux. Hilde, qui ne la perd jamais de vue, suit le spectacle avec une sorte de masochisme.
Prévenante, attentionnée, compatissante, l’épouse déploie une patience angélique. Et lance à sa rivale : « Si vous avez une idée de petit plat qui ferait plaisir à Monsieur, n’hésitez surtout pas ! Il a bien besoin de bonnes choses en ce moment… » Et, du coup, Anke se coupe en quatre pour mijoter des recettes originales qui vont quelque peu atténuer la grisaille dans laquelle son homme, ou plus exactement celui qu’elle partage avec sa patronne, est tombé.
Dès qu’il semble se porter un peu mieux, Rodolf n’hésite pas à sauter dans ses bottes et à arpenter les forêts qui le revigorent. Il a également hâte d’aller secouer ses ouvriers qui doivent se la couler douce pendant qu’il a gardé le lit. Ce qui, d’ailleurs, est faux. Consciencieux, les gars ont assuré leur part de travail et même davantage sachant que Romberts était malade. Mais Rodolf restera éternellement soupçonneux et ne pourra jamais estimer les honnêtes gens respectant leurs engagements. Les êtres fondamentalement mauvais sont-ils capables d’admettre que d’autres puissent adopter des comportements à l’opposé des leurs ?
Tant bien que mal, Rodolf reprend le contrôle de ses affaires mais ne déploie plus la même énergie que par le passé. « Ce fichu virus ne m’a pas encore quitté », décrète-t-il.
Le toubib de campagne qui s’occupe de lui n’ose pas avouer qu’il ne comprend pas pourquoi ce pépin de santé s’éternise. Il se lance dans une explication un rien vaseuse qui agace l’intéressé : « Tu n’es plus tout jeune, Rodolf ! Ton organisme résiste moins bien et un virus tenace te touche plus profondément que lorsque tu avais vingt ou trente ans… Sois patient et n’abuse pas des sorties qui, visiblement, ne te réussissent pas. »
Déprimé, Rodolf décide de ne plus quitter son lit tant qu’il ne sera pas parfaitement rétabli. Au fil des jours, au lieu de constater une amélioration de son état, il réalise que la fièvre qui s’emparait de lui occasionnellement le paralyse presque complètement. Ses intestins le font souffrir comme jamais. « J’ai l’impression qu’on me les triture avec des cisailles… » Bigre !
Hilde et le brave médecin dépassé par les événements conviennent qu’il faut changer de traitement. Un confrère ayant longtemps travaillé dans divers hôpitaux débarque dans les quatre heures qui suivent et semble bien pessimiste : « Le virus n’a pas été soigné à temps et a commis de très gros dégâts. Si la fièvre ne faiblit pas dans les quarante-huit heures, je crains le pire… » Et se tournant vers Hilde : « Ah, si votre mari avait pris son mal au sérieux dès qu’il l’a remarqué, nous n’en serions pas là… »
Les remèdes prescrits ne font aucun effet. Rodolf a sombré dans une sorte d’agonie. De temps à autre, il ouvre un œil et regarde fixement Hilde. Il balbutie : « Sais-tu exactement ce que j’ai ? » Impassible, l’épouse répond : « Rien de plus que tu ne saches. »
Le lendemain, il l’interroge à nouveau : « Crois-tu que je vais m’en sortir ? » Et sur un ton glacial, Hilde réplique : « Non. Cette fois, tu as perdu. »
Rodolf voudrait riposter mais il ne le peut plus. Ce qu’il vient d’entendre lui a vraisemblablement donné le coup de grâce. Moins de douze heures plus tard, il meurt.
Hilde joue à merveille la veuve éplorée entourée de ses trois enfants. Dès l’enterrement terminé, elle congédie Anke mais le plus poliment du monde et sans jamais songer à régler avec elle le moindre compte : « Vous comprenez maintenant, je vais devoir veiller à réduire les dépenses. Et puis, franchement, je ferai bien la cuisine moi-même, comme avant votre arrivée…»
La maîtresse quitte la maison en larmes et se joint à la comédie générale en embrassant chaudement la veuve. « Je prierai pour vous ! », ose-t-elle même lancer.
Ensuite, Hilde convoque les deux bûcherons qui s’attendent à devoir trouver du boulot ailleurs. « J’ai confiance en vous », leur affirme-t-elle à leur grande surprise. « Vous allez m’apprendre les rudiments du métier. Non pas que je me prenne pour ce que je ne serai jamais et que je ne veux d’ailleurs pas devenir, je vous rassure ! Non, je veux comprendre certaines choses afin de mieux gérer l’entreprise. Héritière de la maison Romberts, je souhaite la faire vivre avec vous. Êtes-vous d’accord, Messieurs ? »
Et ainsi commença une nouvelle ère pour beaucoup de gens qui n’allaient pas tarder à s’en émerveiller.
Il se murmura bien plus tard que le décès du premier mari de Hilde (elle se remaria quatre ans après le drame) n’était peut-être pas naturel. C’est l’un de ses cousins alors très âgé qui éveilla une vague et courte curiosité limitée à deux intimes en relatant un souvenir assez précis : « Juste après avoir appris son infortune conjugale, Hilde est venue chez ses parents, à Bruges, et a demandé à voir la bibliothèque très fournie de l’un de leurs amis, exerçant la profession de pharmacien ; il a disparu depuis. Elle voulait se changer les idées, ce que chacun comprenait parfaitement. Aujourd’hui, je suis le seul à savoir que Hilde a passé des heures plongée dans de gros volumes sur les poisons en prenant de nombreuses notes. Mais, curieuse et intelligente comme elle l’a toujours été, vu le désarroi dans lequel elle se trouvait alors, peut-être songeait-elle alors simplement à se lancer dans de nouvelles études… »
Trois frères louches et une charmante voisine
20 décembre 1771, non loin de Visé. Le corps sans vie d’une jeune femme enceinte est repêché dans la Meuse et crée rapidement un attroupement. Parmi les nombreuses personnes qui s’intéressent de près au cadavre, on remarque deux des frères Sartorius.
La famille Sartorius est bien connue dans la région. Le père, Henri-Eustache, occupe le poste d’échevin et a été bourgmestre de la ville de Visé. Ferdinand-Jean, l’un des frères, fréquente quotidiennement la collégiale en tant que chanoine (mais non prêtre) et chantre. Quant au troisième, il jouit d’une belle réputation d’avocat. Et puis, il y a encore Henri-Eustache junior, un drôle de type, raconte-t-on, que l’on ne voit pas souvent à Visé. Il habite à Liège et on se méfie de lui, sans doute depuis l’époque où, clerc dans les études des Prélocuteurs de Liège, il ne s’amusait jamais autant qu’en se montrant cruel. Par exemple, Sartorius aimait piquer ses camarades avec des épingles ou bien avec la pointe d’un couteau à ressort dont il ne se séparait jamais.
Ce sont Ferdinand-Jean et Henri-Eustache que l’on observe dans la foule autour de celle rapidement identifiée comme étant Marie-Madeleine Warrimont, vingt-trois ans, portant un fils depuis environ huit mois. L’assassinat a été particulièrement sauvage. Les médecins qui analyseront le corps relèveront de nombreux coups et concluront que, in fine, Marie-Madeleine a été étranglée.
À Visé, ce drame atroce fait grand bruit. Pourquoi Marie-Madeleine Warrimont, jolie femme pleine de gaieté, a-t-elle ainsi perdu la vie ? Qui aurait pu lui en vouloir au point de la tuer ? Très vite, un nom est sur toutes les lèvres : Sartorius.
Au sein de l’opinion publique, l’affaire paraît simple à résoudre. Et pourtant, elle va connaître des lenteurs et des rebondissements pendant huit années !
Le 27 décembre 1771, l’officier public, grand bailli de la Hesbaye, ouvre une enquête qui ne peut être commune, compte tenu de la notoriété de la famille Sartorius.
Dans la population, on se montre bien plus rapide et surtout plus catégorique que la justice. La mère de la défunte – une veuve relativement fortunée – et de plusieurs autres enfants, ainsi que les amis des Warrimont crient vengeance.
Celui que l’on montre du doigt, c’est Henri-Eustache Sartorius junior. On jure qu’il n’a pas de cœur. Il a séduit la ravissante Marie-Madeleine qui a cru à ses sornettes et, le jour où il s’est rendu compte de sa grossesse, le lâche a commencé à prendre ses distances.
Les premiers mois, le ventre de la demoiselle passait inaperçu mais, plus l’accouchement approchait, plus on commençait à jaser. Y compris chez les Sartorius. On apprend en effet que peu de temps avant l’assassinat, la maman même d’Henri-Eustache a quitté Visé pour Liège. Elle a rendu visite à son fils et l’a sommé de prendre ses responsabilités face à la situation de Marie-Madeleine. Cet élément pèse évidemment lourd dans la balance.
C’est encore de la maison Sartorius que sort une autre information essentielle : depuis le jour du drame, un grand couteau a disparu de la cuisine ; une servante en met sa main… à couper !
Une autre domestique assure que, dans la soirée du 19 décembre, elle a vu rentrer Henri-Eustache « une manchette tachée de sang », qu’elle s’en est étonnée, qu’il lui a ordonné de se taire et de laver le vêtement immédiatement…
Du côté des Warrimont, on accrédite la thèse de la préméditation. Plusieurs jours avant l’issue fatale, Marie-Madeleine s’était félicitée d’une excellente tarte aux pommes offerte par Sartorius. Mais, dans les heures qui suivirent, elle fut prise de vomissements et de malaises divers. D’aucuns chez elle mirent ces troubles sur le compte de la grossesse. Après sa mort, il ne fait plus aucun doute aux yeux de sa mère, de ses frères et sœurs qu’il s’agissait d’une tentative d’empoisonnement.
Une femme passant non loin du lieu du crime, le soir fatidique, rapporte qu’elle a entendu une voix étouffée supplier : « Je vous demande pardon, bien-aimé… » Puis : « Jésus, Jésus, Seigneur, mon Dieu… »
L’assassinat de Marie-Madeleine Warrimont tourne autour des Sartorius, en y incluant Nicolas Hennet, le cousin, ainsi que l’homme de confiance de la famille, François Giet.
Au fil des années, l’étau se resserre considérablement autour d’Henri-Eustache. Son frère, avocat, vole à son secours, envoie des lettres anonymes accusant de faux coupables. Mais le pot aux roses est découvert car son écriture reconnue ! Et, bizarrement, un tel scandale demeure sans suite car le monsieur continue à exercer tranquillement son métier.
À un moment, ayant entendu que l’on pourrait l’expédier dans un cachot, Henri-Eustache va se réfugier dans le couvent liégeois de l’un de ses oncles. Fausse alerte ! Il sort de son trou mais, finalement, afin de mieux assurer sa défense, décide de se constituer prisonnier. La tactique, dictée par son frère, a de quoi surprendre. D’autant que ses complices, Hennet et Giet, passés à la question, ont parlé.
Sartorius croit visiblement toujours en sa bonne étoile. Même quand il est condamné à mort, il pense que le prince-évêque lui accordera sa grâce. Celui-ci hésite car le dossier qu’on lui remet ne lui paraît pas très solide. Pourtant, in fine, ne considérant que l’ignominie du crime commis, il rejette la requête. Sans doute trop sûr de lui, Henri-Eustache a perdu la partie.
Comme le pire des bandits, il va « être traîné sur une claie à Visé, et être tenaillé avec des pincettes ardentes, à trois différentes fois, savoir la première en sortant de la prison, aux bras droit et gauche, la deuxième à Vivegnis, aux jambes droite et gauche, et la troisième fois aux seins droit et gauche au lieu du supplice ». Il aura ensuite « les cuisses et jambes rompues avec une barre de fer, puis son corps (sera) exposé sur une roue ; et un quart d’heure après, s’il se trouve encore en vie, il (sera) étranglé tant que mort s’en suive. » « Pour l’exemple d’autres », conclut le texte de la condamnation.
Henri-Eustache Sartorius ne saura pas à quel point il aura suscité la haine des foules. Des milliers et des milliers de personnes applaudissant comme au spectacle se massent à différents endroits où le cortège funèbre de Sartorius passe.
Pourtant, très vite, l’opinion se retourne. Et, bientôt, on entend un peu partout : « On a tué un innocent… »
Il faut dire qu’on comptait déjà des indécis parmi ceux ayant rendu la justice. D’autant qu’il y a eu en février 1777 cette confession surprise émanant du chanoine Sartorius. Dans une longue lettre, Ferdinand-Jean s’est accusé du meurtre de Marie-Madeleine. Mais, à ce moment-là, ce coup de théâtre a été pris pour une énième tentative de diversion afin de gagner encore du temps et permettre à Henri-Eustache et son avocat de frère de trouver d’autres subterfuges.
Néanmoins, à peine le dernier soupir d’Henri-Eustache rendu, il se trouve subitement de nombreuses personnes pour éclairer cette affaire d’un jour nouveau. Huit ans après les faits !
Et cette nouvelle version va faire couler beaucoup d’encre car reprise et développée dans diverses publications. Que dit-elle ?
Ferdinand-Jean Sartorius a séduit Marie-Madeleine Warrimont qui a succombé très vite au baratin de l’homme d’Église (mais pas ordonné prêtre, rappelons-le). Comme ils étaient voisins, le chanoine se faufilait discrètement par les jardins et rejoignait sa maîtresse avec qui il passait des moments voluptueux. La demoiselle comprenait que la discrétion s’imposait. Mais, un jour, elle se rendit compte qu’elle attendait un bébé. Elle pensait que son bonheur allait encore grandir et qu’un arrangement pourrait être trouvé avec le papa. Aux yeux éblouis de Marie-Madeleine, un tel amour allait résister à tous les obstacles…
Le chantre déchanta sans en parler à sa belle dont il continuait à profiter quand l’envie d’une petite visite lui prenait. Sartorius savait cependant que cette situation, qu’il avait par le passé jugée idyllique, ne pourrait se poursuivre bien longtemps. Il fallait en finir avec cette fille qui, désormais, le gênait.
Ferdinand-Jean eut une première explication face à Marie-Madeleine, peut-être le jour où elle reçut en présent une tarte aux pommes… Il lui fixa un autre rendez-vous durant lequel ils parleraient de leur avenir. Ce fut celui de ce funeste 19 décembre 1771 en début de soirée.
Sartorius avait, pensait-il, bien préparé son coup. Il jeta le corps dans la Meuse, persuadé que le courant l’emporterait vers Maastricht et que l’on ne le reverrait plus. Ce soir-là, le fleuve était calme et rejeta le cadavre pas très loin de l’endroit où l’assassin s’en débarrassa. Le chanoine l’ignorait évidemment quand il regagna la maison familiale. Et c’est finalement sur lui que la servante aurait trouvé des taches de sang… Ensuite, il se changea et fila à une réunion mondaine où il but et mangea copieusement.
Le chantre de la collégiale de Visé reprit une vie normale, trop content que la justice, autant que l’opinion publique, s’acharne sur son frère. Jusqu’au jour, où, rongé par les remords, il coucha ses terribles révélations sur le papier. Il y précisait qu’il avait agi sans la moindre complicité.
Ces divers éléments nourrirent les sentiments antireligieux de plus en plus répandus chez ceux ne supportant plus les pouvoirs et privilèges multiples de l’Église catholique. À les en croire, si Ferdinand-Jean avait pu mener une existence tranquille pendant les années noires de son frère, c’est parce qu’il était protégé par ses fonctions.
D’aucuns, plus tard, en profitèrent pour affirmer que le chanoine était resté en place après l’exécution d’Henri-Eustache. C’est faux ; il prit la fuite dès qu’il eut déposé sa déclaration chez un notaire.
Si l’on se réfère à un document évoqué par La Gazette de Liège en 2008, cinq armuriers de Wandre, qui suivaient Napoléon au fil de ses batailles, tombèrent sur Ferdinand-Jean Sartorius quelque part en Espagne, en 1810. Celui-ci les aurait chargés de relater leur rencontre à leur retour au pays.
En 1798, à Londres, l’avocat Sartorius fit paraître un long Mémoire dans lequel il démontrait, mais avec des arguments parfois contestables, qu’Henri-Eustache avait payé pour son autre frère, seul coupable de la mort de Marie-Madeleine Warrimont.
Entrée dans la catégorie des causes judiciaires sur lesquelles planeront toujours un énorme doute, en 1941, l’affaire Sartorius a encore interpellé un avocat à la cour d’appel de Liège, Me Willy Vandevoir, qui, dans un livre, avança une explication totalement inédite. Henri-François Eustache Sartorius était bien l’amant de Marie-Madeleine Warrimont mais, un jour, celle-ci céda aux avances de Ferdinand-Jean. Et le premier Sartorius à avoir conquis la jolie voisine comprit par la suite que l’enfant qu’elle attendait avait toutes les malchances de ne pas être de lui. D’où sa colère et son horrible geste…
Dans ce cas, pourquoi le chanoine aurait-il renoncé à une belle situation bâtie au fil du temps en livrant brusquement une version des faits le transformant en monstre pour l’éternité ?
Entre autres bizarreries, au fil des lignes que le chanoine a consignées, on se demande comment cet homme plutôt fluet aurait pu commettre l’irréparable sans aucune aide. Il s’agit d’un des nombreux secrets dont plus personne, depuis longtemps, ne possède la clef.
Deux belles Belges et un beau parleur
Elle s’appelle Maria Reusens, est belge et, dit l’un de ses contemporains qui l’a connue à l’époque de sa splendeur parisienne, « belle et plantureuse, un Rubens avec des dents magnifiques, un fort accent et peu d’usage ». Et d’ajouter : « Elle était dans le compotier mondain, pareille à un fruit mûr et magnifique. »1