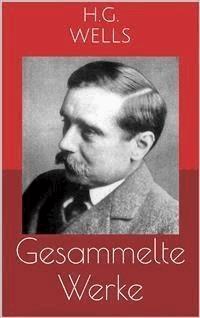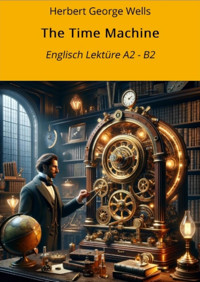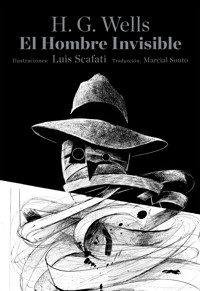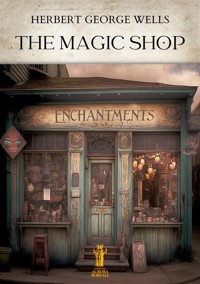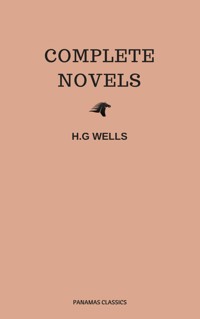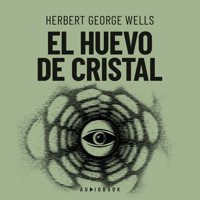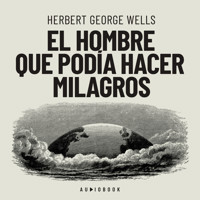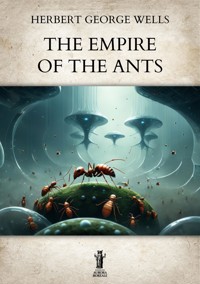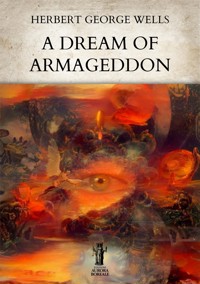3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Bedford et Cavor, grâce à la «Cavorite», voyagent jusqu'à la lune, et découvrent les Sélénites. L'aventure ne fait que commencer...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Les Premiers hommes dans la Lune
Les Premiers hommes dans la LuneCHAPITRE PREMIER. M. BEDFORD RENCONTRE M. CAVOR A LYMPNECHAPITRE II. PREMIERS ESSAIS DE LA CAVORITECHAPITRE III. LA CONSTRUCTION DE LA SPHÈRECHAPITRE IV. DANS LA SPHÈRECHAPITRE V. EN ROUTE POUR LA LUNECHAPITRE VI. L'ARIVEE DANS LA LUNECHAPITRE VII. UN LEVER DE SOLEIL SUR LA LUNECHAPITRE VIII. UNE MATINÉE LUNAIRECHAPITRE IX. À LA DECOUVERTECHAPITRE X. PERDUS DANS LA LUNECHAPITRE XI. LE BÉTAIL LUNAIRECHAPITRE XII. LA FACE DES SELÉNITESCHAPITRE XIII. CAVOR FAIT DES SUPPOSITIONSCHAPITRE XIV. ENTRÉE EN RELATIONSCHAPITRE XV. LA PASSERELLE VERTIGINEUSECHAPITRE XVI. POINTS DE VUECHAPITRE XVII. LE COMBAT DANS LA CAVERNE DES BOUCHERS LUNAIRESCHAPITRE XVIII. AU SOLEILCHAPITRE XIX. M. BEDFORD SEULCHAPITRE XX. DANS L'ESPACE INFINICHAPITRE XXI. DESCENTE À LITTLESTONECHAPITRE XXII. L' ETONNANTE COMMUNICATION DE M. JULIUS WENDIGEECHAPITRE XXIII. EXTRAITS DES SIX PREMIERS MESSAGES TRANSMIS PAR M. CAVORCHAPITRE XXIV. L'HISTOIRE NATURELLE DES SÉLÉNITESCHAPITRE XXV. LE GRAND LUNAIRECHAPITRE XXVI. LE DERNIER MESSAGE DE M. CAVORPage de copyrightLes Premiers hommes dans la Lune
Herbert George Wells
CHAPITRE PREMIER. M. BEDFORD RENCONTRE M. CAVOR A LYMPNE
En m'asseyant ici pour écrire, à l'ombre d'une treille, sous le ciel bleu de l'Italie méridionale, il me vient à l'esprit, avec une sorte de naïf étonnement, que ma participation aux stupéfiantes aventures de M. Cavor fut, en somme, le résultat du plus simple accident. La chose eût pu advenir à n'importe quel autre individu. Je tombai au milieu de tout cela à une époque où je me croyais à l'abri des plus infimes possibilités d'expériences troublantes. J'étais venu à Lympne parce que je m'étais imaginé que Lympne devait être le plus paisible endroit du monde.
« Ici, au moins, m'étais-je dit, je trouverai le calme si nécessaire pour travailler. »
Ce livre en est la conséquence, tant la Destinée se plaît à embrouiller les pauvres petits plans des hommes.
Je puis, peut-être, dire ici que je venais alors de perdre de grosses sommes dans certaines entreprises malheureuses. Entouré maintenant de tout le confort de la richesse, j'éprouve un certain plaisir à faire cet aveu. Je veux même admettre encore que j'étais, jusqu'à un certain point, responsable de mes propres désastres. Il se peut que, pour diverses choses, je sois doué de quelque capacité, mais la conduite des affaires n'est certes pas de ce nombre.
En ce temps-là j'étais jeune – je le suis encore, quant aux années – mais tout ce qui m'est arrivé depuis a effacé de mon esprit ce qu'il y restait de trop juvénile. Que j'en aie acquis quelque sagesse est une question plus douteuse…
Il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail des spéculations qui me débarquèrent à Lympne, dans le comté de Kent. De nos jours, les transactions commerciales comportent une certaine dose d'aventure ; j'en acceptai les risques, et, comme il y a invariablement dans ces matières une certaine obligation de prendre ou de donner, le rôle m'échut finalement de donner – avec assez de répugnance. Quand je me crus tiré de ce mauvais pas, un créancier désobligeant trouva bon de se montrer intraitable. Il me parut, en dernier lieu, que la seule chose à faire pour en sortir était d'écrire un drame, si je ne voulais me résigner à gagner péniblement ma vie en acceptant un emploi mal rétribué. En dehors des transactions et des combinaisons d'affaires, nul autre travail qu'une pièce destinée au théâtre n'offre d'aussi opulentes ressources. À vrai dire, j'avais dès longtemps pris l'habitude de considérer ce drame non encore écrit comme une réserve commode pour les jours de besoin, et ces jours-là étaient venus.
Je m'aperçus bientôt qu'écrire une pièce est un travail beaucoup plus long que je ne le supposais. D'abord, je m'étais donné dix jours pour la faire, et, afin d'avoir un pied-à-terre[1] convenable pendant qu'elle serait en cours d'achèvement, je vins à Lympne. Je m'estimai heureux d'avoir découvert une sorte de petit pavillon ayant toutes ses pièces de plain-pied, et je le louai avec un bail de trois ans. J'y disposai quelques rudiments de mobilier, et, pendant la confection de mon drame, je devais préparer aussi ma propre cuisine, et les mets que je composai auraient, à coup sûr, fait hurler un cordon-bleu. J'avais une cafetière, un plat à œufs, une casserole à pommes de terre et une poêle pour les saucisses et le lard. Tel était le simple appareil de mon bien-être. Pour le reste, je fis venir à crédit un baril de bière, et un boulanger confiant m'apporta mon pain quotidien. Ce n'était pas là, sans doute, l'extrême raffinement du sybaritisme, mais j'ai connu des temps plus durs.
Certes, si quelqu'un cherche la solitude, il la trouvera à Lympne. Cette localité se trouve dans la partie argileuse du Kent, et mon pavillon était situé sur le bord d'une falaise, autrefois baignée par la Manche, d'où la vue s'étendait par-dessus les marais de Romney jusqu'à la mer. Par un temps pluvieux, le village est presque inaccessible et l'on m'a dit que parfois le facteur faisait les parties les plus boueuses de sa route avec des bouts de planches aux pieds. Je ne l'ai jamais vu se livrer à cet exercice, mais je me l'imagine parfaitement.
À la porte des quelques cottages et maisons qui constituent le village actuel, on dispose de gros fagots de bouleau sur lesquels on essuie la glaise de ses semelles, détail qui peut donner quelque idée de la contexture géologique du district. Je doute que l'endroit eût encore existé, sans quelques souvenirs affaiblis de choses anciennes, disparues pour toujours. À l'époque romaine, c'était le grand port d'Angleterre, Portus Lemanus, et maintenant la mer s'est reculée de plus de sept kilomètres. Au long de la pente se trouvent encore des roches arrondies par les eaux et des masses d'ouvrages romains en briques, d'où la vieille route, encore pavée par places, file comme une flèche vers le nord.
Je pris l'habitude d'aller flâner sur la colline en songeant à tout cela : les galères et les légions, les captifs et les fonctionnaires, les femmes et les marchands, les spéculateurs comme moi, tout le fourmillement et le tumulte qui entraient et sortaient de la haie, et dont il ne restait plus que quelques moellons sur une pente gazonnée, foulée par deux ou trois moutons – et moi ! À l'endroit où s'ouvrait le port étaient maintenant les bas-fonds du marais qui rejoignait, dans une large courbe, la pointe lointaine de Dungeness, et qu'agrémentaient des bouquets d'arbres et les clochers de quelques anciennes villes médiévales qui, à l'exemple de Lemanus, s'enfoncent peu à peu dans l'oubli.
Ce coup d'œil sur les marais était, à vrai dire, l'une des plus belles vues que j'aie jamais contemplées. Dungeness se trouvait, je crois, à environ vingt-cinq kilomètres, posée comme un radeau sur la mer, et, plus loin, vers l'ouest, contre le soleil couchant, s'élevaient les collines de Hastings. Tantôt elles étaient proches et claires, tantôt effacées et basses, souvent elles disparaissaient dans les brumes du ciel. Les parties plus voisines des marais étaient coupées de fossés et de canaux.
La fenêtre derrière laquelle je travaillais donnait sur l'horizon de cette crête, et c'est de là que, pour la première fois, je jetai les yeux sur Cavor. J'étais justement en train de me débattre avec mon scénario, forçant mon esprit à ne pas quitter cette besogne extrêmement malaisée, et, chose assez naturelle, il captiva mon attention.
Le soleil se couchait ; le ciel était une éclatante tranquillité de verts et de jaunes sur laquelle se découpait, en noir, une fort bizarre petite silhouette.
C'était un petit homme court, le corps en boule, les jambes maigres, secoué de mouvements brusques ; il avait trouvé bon de vêtir son extraordinaire personne d'une cape de joueur de cricket et d'un pardessus qui recouvrait un veston, une culotte et des bas de cycliste. Pourquoi s'affublait-il de ce costume, je ne saurais le dire, car jamais il n'avait monté à bicyclette ni joué au cricket. C'était un assemblage fortuit de vêtements sortant on ne sait d'où. Il ne cessait de gesticuler avec ses mains et ses bras, de balancer sa tête de côté et d'autre, et de ses lèvres sortait un continuel bourdonnement. Il bourdonnait comme une machine électrique. Vous n'avez jamais entendu chose pareille. De temps à autre, il s'éclaircissait le gosier avec un bruit des plus extraordinaires.
Il avait plu, et sa marche saccadée était rendue plus bizarre encore par l'argile extrêmement glissante du sentier. Au moment exact où il se dessina tout entier sur le ciel, il s'arrêta, tira sa montre et hésita. Puis, avec une sorte de geste convulsif, il tourna les talons et s'en alla avec toutes les marques de la plus grande hâte, ne gesticulant plus, mais avançant avec de grandes enjambées qui montraient les dimensions relativement larges de ses pieds, grotesquement exagérées, je me le rappelle, par la glaise qui adhérait aux semelles.
Cela se passait le premier soir de mon séjour ; j'étais gonflé d'ardeur par mon drame, et je considérai simplement l'incident comme une distraction fâcheuse : la perte de cinq minutes. Je me remis à mon scénario. Mais lorsque, le soir suivant, la même apparition se répéta avec une précision remarquable, puis encore le surlendemain, et, à vrai dire, tous les soirs où il ne plut pas, il me fallait, à cette heure-là, un effort considérable pour concentrer mon attention sur le scénario.
« Au diable le bonhomme ! me dis-je. On croirait qu'il s'exerce à imiter les marionnettes. »
Plusieurs soirs de suite je le maudis de tout mon cœur. Puis mon ennui fit place à la surprise et à la curiosité. Pour quelle raison avouable un homme se livrait-il à ce genre de pantomime ?
Le quatorzième soir je ne pus y tenir plus longtemps, et aussitôt qu'il apparut j'ouvris la porte vitrée, traversai la véranda et me dirigeai vers le point où il s'arrêtait invariablement.
Il sortait sa montre comme j'arrivais près de lui. Il avait une figure joufflue et rubiconde, avec des yeux d'un brun rougeâtre – jusque-là je ne l'avais aperçu qu'à contre-jour.
« Un moment, monsieur », fis-je comme il tournait les talons.
Il me regarda, ébahi.
« Un moment, répéta-t-il, mais… certainement, ou, si vous désirez me parler pendant plus longtemps et que ce ne soit pas trop vous demander – votre moment est déjà écoulé –, voudriez-vous prendre la peine de m'accompagner ?
– Avec plaisir, dis-je en me plaçant à côté de lui. – Mes habitudes sont régulières. Mon temps pour la distraction est limité.
– Ceci, je présume, est le temps que vous consacrez à l'exercice ?
– En effet. Je viens ici pour admirer le soleil couchant.
– Vous n'admirez rien du tout.
– Monsieur ?
– Vous ne le regardez jamais.
– Je ne le regarde jamais ?
– Non, voilà treize soirs que je vous observe et pas une seule fois vous n'avez regardé le couchant, pas une seule fois ! »
Il fronça les sourcils comme quelqu'un qui se trouve tout à coup en présence d'un problème embarrassant.
« Mais… je goûte le soleil… l'atmosphère… je suis ce sentier… je traverse cette barrière, et j'en fais le tour, ajouta-t-il avec un brusque mouvement de tête par-dessus son épaule.
– Pas du tout. Vous n'en avez jamais fait le tour. C'est absurde d'ailleurs, il n'y a pas de sentier. Ce soir, par exemple…
– Oh ! ce soir ! Attendez. Ah ! je venais justement de regarder l'heure et m'étais aperçu que j'avais déjà dépassé de trois minutes ma demi-heure, aussi, décidant que je n'avais plus le temps d'en faire le tour, je m'en retournais…
– C'est ce que vous faites tous les jours. » Il me regarda, pensif :
« Peut-être bien… maintenant que j'y réfléchis…
Mais de quel sujet vouliez-vous m'entretenir ?
– Eh bien, mais… de celui-là !
– De celui-là ?
– Oui, pourquoi agissez-vous ainsi ? Tous les soirs, vous venez en faisant un bruit…
– En faisant un bruit ?…
– Comme ceci. »
J'imitai son bourdonnement. Il écoutait, et il était évident que ce bourdonnement ne le charmait guère.
« Je fais cela ? demanda-t-il.
– Chaque soir que Dieu fait.
– Je n'en avais pas la moindre idée. » Il s'arrêta net et me regarda gravement :
« Est-il possible que j'aie des manies ?
– Ma foi, cela m'en a tout l'air. »
Il prit sa lèvre inférieure entre son pouce et son index, et se mit à considérer une flaque d'eau à ses pieds.
« Mon esprit est très occupé. Alors, vous voulez savoir pourquoi ? Eh bien, monsieur, je puis vous assurer que non seulement je ne sais pas pourquoi je fais ces choses, mais encore je ne savais même pas que je les faisais. En y réfléchissant, c'est absolument comme vous l'avez dit, je n'ai jamais dépassé cet endroit… Et ces choses vous ennuient ? »
Sans me l'expliquer, je commençais à me radoucir envers le pauvre homme.
« Cela ne m'ennuie pas, dis-je, mais figurez-vous un instant que vous écriviez une pièce de théâtre…
– Je ne saurais pas.
– N'importe, quelque chose qui réclame toute votre attention.
– Ah ! fit-il, oui certes. »
Il demeura méditatif ; son expression me révéla si éloquemment sa détresse que je m'attendris un peu plus. Après tout, il y a quelque chose d'agressif à demander à un homme que l'on ne connaît pas pourquoi il fredonne sur une voie publique.
« Vous comprenez, dit-il faiblement, c'est une habitude.
– Oh ! je vous l'accorde.
– Il faut que je m'en débarrasse.
– Mais non, si cela doit vous contrarier. Après tout, rien ne m'autorisait… C'est un peu trop de liberté…
– Pas du tout, monsieur, pas du tout. Je vous suis bien obligé. Je devrais m'observer là-dessus. À l'avenir je le ferai. Voulez-vous avoir la bonté, encore une fois, de me refaire… ce bruit ?…
– Quelque chose comme cela : zou, zou, zou, zou, zou, zou, zou, zou. Mais vraiment, vous savez…
– Je vous suis infiniment obligé. En réalité, je le sais, je deviens stupidement distrait. Vous avez tout à fait raison, monsieur, parfaitement raison. À vrai dire, vous me rendez un grand service ; cette chose finira. Et, maintenant, monsieur, je vous ai déjà entraîné beaucoup plus loin qu'il ne faudrait.
– J'espère que mon impertinence…
– Pas du tout, monsieur, pas du tout. »
Nous nous considérâmes un moment. Je soulevai mon chapeau et lui souhaitai le bonsoir. Il me répondit par un geste convulsif, et nous nous séparâmes.
À la barrière, je me retournai et le regardai s'éloigner. Son allure avait remarquablement changé ; il semblait affaissé et rabougri. Le contraste avec l'ancien personnage, gesticulant et fredonnant, éveilla d'une façon assez absurde en moi une sorte de pitié sympathique. Je le contemplai jusqu'à ce qu'il eût disparu. Alors, regrettant sincèrement de m'être mêlé de ce qui ne me regardait pas, je me dirigeai vers mon pavillon et vers mon drame.
Le lendemain, non plus que le surlendemain, je ne l'aperçus. Mais il m'était resté dans l'esprit, et il me vint à l'idée que, comme personnage comiquement sentimental, il pouvait m'être utile dans le développement de mon intrigue. Le troisième jour, il vint me voir.
Pendant un moment je fus fort embarrassé pour deviner ce qui avait bien pu l'amener. De la façon la plus cérémonieuse, il entama une conversation très indifférente ; puis, brusquement, il se décida. Il voulait m'acheter mon pavillon.
« Vous comprenez, dit-il, je ne vous brime pas le moins du monde, mais vous avez détruit une habitude, et cela désorganise mes journées. Je viens me promener ici depuis des années… des années, sans doute, toujours en fredonnant… et vous avez rendu tout cela impossible ! »
J'émis l'idée qu'il pourrait peut-être essayer une autre direction.
« Non ! il n'y a pas d'autre direction ; celle-ci est la seule. Je me suis informé. Et maintenant chaque après-midi, à quatre heures… je me trouve dans une situation inextricable.
– Mais, mon cher monsieur, si la chose vous tient tant au cœur…
– C'est une question vitale. Vous comprenez, je suis… je suis un… chercheur. Je suis lancé dans des recherches scientifiques. J'habite (il s'arrêta et parut réfléchir) juste là-bas, fit-il en lançant tout à coup son doigt dangereusement près de mon œil, la maison avec des cheminées blanches, que vous voyez juste au-dessus des arbres. Ma position est anormale… anormale. Je suis sur le point d'achever l'une des plus importantes démonstrations… je puis vous assurer que c'est une des plus importantes démonstrations qui aient jamais été faites. Cela exige une réflexion constante, une aisance et une activité mentales incessantes. L'après-midi était mon meilleur moment !… le cerveau bouillonnant d'idées nouvelles… de points de vue nouveaux…
– Mais pourquoi ne viendriez-vous plus par ici ?
– Ce serait tout différent. J'aurais conscience de moi-même. Je penserais à vous… travaillant à votre pièce… m'observant irrité… au lieu de penser à mon travail… Non ! il faut que j'aie ce pavillon. »
Je restai rêveur. J'avais besoin, certes, de réfléchir sérieusement à la chose avant de répondre quoi que ce soit de décisif. J'étais généralement assez prêt aux affaires en ce temps-là, et les ventes avaient toujours eu de l'attrait pour moi ; mais, en premier lieu, le pavillon ne m'appartenait pas, et, même si je le lui vendais un bon prix, je pourrais éprouver quelques inconvénients quand il s'agirait de l'entrée en jouissance, surtout si le propriétaire réel avait vent de la transaction ; en second lieu, ma foi… j'étais failli, et passible des tribunaux si je contractais des dettes.
C'était là clairement une affaire qui exigeait un maniement délicat. De plus, l'idée qu'il se trouvait à la poursuite de quelque précieuse invention m'intéressait aussi ; je pensai que j'aimerais en savoir plus long sur ces recherches, sans aucune intention déshonnête, mais simplement avec l'espoir que cela ferait diversion à ma besogne. Je tâcherai de sonder mon homme.
Il était tout à fait disposé à me fournir des indications. À vrai dire, une fois qu'il fut lancé, la conversation se transforma en monologue. Il parlait comme quelqu'un qui s'est longtemps retenu, et qui a maintes fois approfondi son sujet. Il parla pendant près d'une heure, et il me faut avouer que je trouvai son discours singulièrement rebelle à ma compréhension. Mais d'un bout à l'autre j'éprouvai cette satisfaction que l'on ressent quand on se distrait d'un ouvrage que l'on s'est imposé.
Pendant cette première entrevue, je ne réussis à me faire qu'une idée très vague de l'objet de ses recherches ; la moitié de ses expressions étaient des mots techniques entièrement étrangers pour moi, et il prétendit éclaircir un ou deux points avec ce qu'il lui plut d'appeler des mathématiques élémentaires, se livrant à des calculs sur un bout d'enveloppe, avec un stylo, de telle façon qu'il m'était même difficile de faire semblant de comprendre.
« Oui, faisais-je, continuez. »
Néanmoins j'en saisis suffisamment pour me convaincre qu'il n'était pas un simple cancre jouant à l'inventeur. En dépit de son apparence, il se dégageait de lui une force qui rendait cette supposition impossible ; quoi que ce fût, cela devait être une chose comportant des possibilités mécaniques. Il me parla d'un atelier qu'il s'était fait installer et de trois aides, autrefois charpentiers-tâcherons, qu'il avait dressés. Or, d'un atelier de ce genre au brevet d'invention et à l'usine, il n'y a qu'un pas. Il m'invita à aller visiter l'installation. J'acceptai avec, empressement et pris soin, par un ou deux rappels, de ne pas le laisser oublier son offre.
La vente projetée resta fort heureusement en suspens.
Enfin, il se leva pour partir, s'excusant de la longueur de sa visite. Parler de son œuvre, dit-il, était un plaisir qu'il ne goûtait que trop rarement. Ce n'était pas souvent qu'il trouvait un auditeur aussi intelligent que moi, car il fréquentait fort peu les professionnels de la science.
« Tant de mesquinerie, expliquait-il, tant d'intrigue ! Et réellement, quand on a une idée… une idée nouvelle et féconde… je ne voudrais pas manquer de charité, mais… »
Je suis de ceux qui croient à l'excellence du premier mouvement, et je risquai alors ce qui était peut-être une proposition téméraire, mais rappelez-vous que j'étais seul avec mon drame à Lympne depuis quinze jours, et je conservais encore un remords d'avoir bouleversé sa promenade.
« Pourquoi pas, dis-je, faire de ceci une nouvelle habitude à la place de celle dont je vous ai privé ? Du moins… jusqu'à ce que nous soyons d'accord au sujet du pavillon. Ce qu'il vous faut c'est de pouvoir retourner votre œuvre dans votre esprit. C'est ce que vous avez fait jusqu'ici pendant vos promenades de l'après-midi. Malheureusement, tout cela est fini… et vous ne pouvez pas remettre les choses au point où elles étaient. Mais pourquoi ne viendriez-vous pas me parler de vos travaux, vous servir de moi comme d'un mur contre lequel vous jetteriez vos pensées pour les rattraper ensuite ? Il est certain que je ne suis pas assez savant pour vous voler votre idée et… je ne connais pas d'hommes de science. »
Je me tus. Il se mit à réfléchir : évidemment ma proposition paraissait lui plaire.
« Mais j'aurais peur de vous ennuyer, fit-il.
– Vous pensez que je suis trop nul !
– Oh ! non, mais les détails techniques…
– Quoi qu'il en soit, vous m'avez énormément intéressé cet après-midi.
– Certes, ce serait un grand secours pour moi. Rien n'éclaircit autant les idées que de les expliquer. Jusqu'à présent…
– Mon cher monsieur, c'est convenu. N'en parlons plus.
– Mais vraiment vous trouveriez le temps… ?
– Rien ne repose autant que de changer d'occupation », dis-je avec l'accent d'une conviction profonde.
L'affaire était entendue. Sur les marches de la véranda, il se retourna.
« Je vous suis infiniment reconnaissant… », commença-t-il.
Je poussai un grognement interrogatif.
« … de m'avoir complètement guéri de cette habitude ridicule de bourdonner. »
Je lui répondis, je crois, que j'étais très heureux de lui avoir été de quelque utilité, et il s'en alla.
Immédiatement, les pensées que notre conversation lui avait suggérées durent reprendre leur train ; ses bras recommencèrent à s'agiter de la même façon, et l'écho affaibli de ses zou, zou, zou, zou, zou, zou, me parvint, apporté par la brise…
Après tout, cela n'était pas mon affaire…
Il revint le lendemain et le surlendemain et débita chaque fois une longue conférence sur la physique, pour notre mutuelle satisfaction. Il parlait, avec un air d'extrême lucidité, d'éther, de tubes de force, de potentiel gravitationnel, et de choses de ce genre, tandis que je restais allongé dans mon second fauteuil pliant, proférant régulièrement des : oui –, continuez –, je vous suis –, pour le tenir en haleine.
C'était un sujet terriblement difficile, mais je ne pense pas qu'il ait jamais supposé jusqu'à quel point je ne le comprenais pas. Il y avait des moments où je me demandais s'il ne se moquait pas de moi, mais, en tout cas, cela me reposait de ce maudit drame.
De temps en temps, certaines choses s'éclairaient pour moi, l'espace de quelques secondes, pour s'évanouir juste au moment où je croyais les tenir. Quelquefois mon attention fuyait désespérément, et j'abandonnais tout effort pour comprendre, assis devant lui, le regardant fixement et me demandant s'il ne vaudrait pas mieux, après tout, me servir de lui comme de personnage principal dans une bonne farce, sans me préoccuper d'autre chose ; puis le hasard voulait que je comprisse un moment ce qu'il disait.
À la première occasion j'allai visiter sa demeure. C'était une grande maison, meublée à la diable, sans autres domestiques que les trois aides ; le régime et le genre de vie de Cavor se caractérisaient par une simplicité philosophique. Il était végétarien, ne buvait que de l'eau et se soumettait à toutes les disciplines de ce genre. Mais la vue de son installation pouvait éveiller bien des questions. De la cave au grenier cela sentait la science, ensemble déconcertant dans un village si écarté. Les pièces du rez-de-chaussée contenaient des établis et des appareils nombreux. La boulangerie et la buanderie s'étaient transformées en des fours respectablement compliqués, des dynamos occupaient la cave et il y avait un gazomètre dans le jardin. Il me montra tout cela avec l'air confiant d'un homme qui a vécu trop seul. De sa réclusion débordaient maintenant des excès de confidences dont j'avais la bonne chance d'être le bénéficiaire.
Les trois aides étaient d'honorables spécimens de cette catégorie d'hommes à tout faire à laquelle ils appartenaient. Sinon très intelligents, du moins consciencieux, solides, polis, et pleins de bonne volonté. L'un d'eux, Spargus, qui était chargé de la cuisine et de tous les travaux métalliques, avait été marin ; le second, Gibbs, remplissait les fonctions de menuisier, et le troisième, qui avait été jardinier, faisait maintenant office de factotum. Ils étaient chargés exclusivement du travail manuel, et tout l'ouvrage intelligent était fait par Cavor. Leur ignorance était des plus ténébreuses, comparée même à mes notions très vagues.
Maintenant, occupons-nous de la nature de ces recherches. Ici, malheureusement, intervient une grave difficulté. Je ne suis nullement expert en matière scientifique, et s'il me fallait tenter d'exprimer, dans la langue éminemment savante de M. Cavor, le but auquel tendaient ses expériences, je craindrais d'embrouiller non seulement le lecteur mais moi-même, et je commettrais presque certainement quelque balourdise qui m'attirerait les railleries de tous ceux qui sont au courant des derniers développements de la physique mathématique. Le mieux que je puisse faire est, je crois, de donner ici mes impressions dans mon langage inexact, sans essayer de me parer d'une culture scientifique qui m'est absolument étrangère.
L'objet des recherches de M. Cavor était une substance qui devait être opaque – il se servait d'un autre mot que j'ai oublié, mais qui implique l'idée d'opacité – à toutes les formes de l'énergie radiante. L'énergie radiante, m'expliqua-t-il, était tout ce qui ressemblait à la lumière, à la chaleur, à ces rayons Roentgen, dont il a tant été question, depuis quelques années, aux ondes électriques de Marconi, ou à la gravitation.
Tout cela, me dit-il, rayonne autour de centres et agit sur les corps à distance ; de là le terme d'énergie radiante. Or presque toutes les substances sont opaques à une forme quelconque de l'énergie radiante. Le verre, par exemple, est transparent à la lumière, mais il l'est beaucoup moins à la chaleur, de sorte qu'il peut servir à abriter du feu. L'alun est transparent à la lumière, mais bloque complètement la chaleur. D'un autre côté, une solution d'iode dans du bisulfite de carbone intercepte complètement la lumière, mais est parfaitement transparente à la chaleur ; elle vous cachera complètement un feu en permettant à sa chaleur de vous parvenir. Les métaux ne sont pas seulement opaques à la lumière et à la chaleur, mais aussi à l'énergie électrique qui passe à travers la solution d'iode et le verre presque comme si ces derniers n'étaient pas interposés, et ainsi de suite.
Or, toutes les substances connues sont transparentes à la gravitation. On peut employer des écrans de diverses sortes pour intercepter la lumière, l'ardeur et l'influence électrique du soleil, ou la chaleur de la terre ; on peut abriter des objets contre les rayons de Marconi par des plaques de métal, mais rien n'intercepte l'attraction gravitationnelle, que ce soit l'attraction terrestre ou l'attraction solaire. Il est bien difficile d'expliquer pourquoi il n'y a rien, et Cavor ne voyait pas pourquoi une pareille substance n'existerait pas, et, à coup sûr, ce n'est pas moi qui pouvais le lui dire.
Jamais encore je ne m'étais creusé l'esprit sur de pareilles questions.
Il me montra des papiers couverts de calculs que, sans doute, Lord Kelvin, ou le professeur Lodge, ou le professeur Karl Pearson, ou quelqu'un de ces grands hommes de science aurait pu comprendre, mais au milieu desquels je barbotais désespérément ; il prétendait démontrer qu'une telle substance était possible, à certaines conditions… C'était une série de raisonnements ahurissants, mais malgré l'effet qu'ils me produisirent à l'époque, il me serait impossible de les transcrire ici maintenant.
« Oui, répondais-je imperturbablement, oui… parfaitement… continuez. »
Il suffira, pour la clarté de cette histoire, de dire qu'il croyait pouvoir fabriquer cette prétendue substance opaque à la gravitation, au moyen d'un alliage compliqué de métaux et d'une nouvelle chose – un nouvel élément, je suppose – qui s'appelait, je crois, hélium, et qu'on lui envoyait de Londres dans des flacons de grès cachetés. On a émis des doutes sur ce détail, mais j'ai la quasi-certitude que ces flacons cachetés contenaient véritablement de l'hélium. En tout cas, c'était quelque chose d'extrêmement ténu et gazeux.
Si seulement j'avais pris des notes !
Mais comment aurais-je pu prévoir alors qu'il me les faudrait par la suite ?
Tous ceux qui possèdent la moindre imagination comprendront quelles extraordinaires possibilités offrait une pareille substance, et ils sympathiseront un peu avec l'émotion que je ressentis à mesure que je dégageais cette idée du brouillard de phrases abstruses débitées par Cavor.
Intermède comique dans ma pièce, en vérité.
Il me fallut quelque temps pour croire que je l'avais interprété exactement, et j'évitais avec grand soin de lui poser des questions qui lui eussent permis de jauger la profondeur d'incompréhension dans laquelle il déversait continuellement ses explications. Mais aucun de ceux qui liront cette histoire ne pourra sympathiser pleinement avec moi, parce qu'il lui sera impossible, d'après cette narration aride, de se rendre compte de la conviction que j'avais que cette surprenante substance allait positivement être fabriquée.
Je ne me rappelle pas avoir donné à mon drame une heure de travail consécutif après ma visite à sa maison ; mon imagination avait autre chose à faire. Les possibilités de cette matière semblaient être de tous côtés sans limites ; j'en arrivais à des miracles et à des révolutions. Par exemple, si l'on voulait soulever un poids, si énorme soit-il, on n'avait qu'à glisser sous sa masse une feuille de cette substance et on le soulevait alors avec une paille.
Ma première idée fut, naturellement, d'appliquer ce principe aux canons et aux cuirassés, à tous les matériaux et à toutes les méthodes de guerre, et, de là, à la navigation, à la locomotion, à la construction et à toutes les formes imaginables de l'industrie humaine. Le hasard qui m'avait amené au lieu de naissance de ce nouvel âge – une nouvelle ère, rien de moins – était une de ces chances qui se retrouvent une fois tous les mille ans. La chose se déroulait et s'étendait indéfiniment. Entre autres résultats, j'y voyais ma rédemption d'homme d'affaires ; j'y voyais une première société et des filiales en tous genres, des applications ici et là, à droite, à gauche, ailleurs, des syndicats et des trusts, des privilèges et des concessions se propageant, se développant jusqu'à ce qu'une vaste et prodigieuse Compagnie pour l'Exploitation de la Cavorite conquît et gouvernât le monde.
Et j'en étais !
Je voulus aller droit au but. Je savais que je risquais la partie, mais je voulus sauter le pas sans attendre.
« Nous avons en main, absolument, la chose la plus énorme qui ait jamais été inventée, dis-je, en ayant soin d'accentuer fortement le nous. Si vous voulez m'écarter de la combinaison, il faudra que vous le fassiez à coups de canon ! Dès demain, je viens m'installer ici en qualité de quatrième aide. »
Il parut surpris de mon enthousiasme, mais nullement soupçonneux ni hostile, et même il parla plutôt de ses recherches en termes dépréciateurs.
« Mais pensez-vous vraiment ?… dit-il en me regardant d'un air de doute. Et votre drame ?… Diable, mais où en est-il, ce drame ?
– Il n'y en a plus ! m'écriai-je. Ah ! mon cher monsieur, vous ne voyez donc pas ce que nous avons en main ? Ne savez-vous donc pas ce que vous allez faire ? »
C'était uniquement, de ma part, une tournure de rhétorique, mais le fait est qu'il ne se rendait compte de rien.
Tout d'abord je ne pouvais le croire. Il n'avait même pas eu la moindre idée de la chose. Cet étonnant petit bonhomme avait travaillé pendant tout ce temps au point de vue purement théorique !
Quand il disait que c'était la découverte la plus importante que le monde ait jamais vue, il voulait dire, tout simplement qu'elle mettait d'accord un grand nombre de théories et résolvait maint problème douteux ; il ne s'était pas plus soucié des applications de la matière qu'il allait trouver que de sa première culotte. C'était une substance possible et il voulait la fabriquer, voilà tout.
Passé cela, il était puéril ! S'il trouvait cette substance, elle irait à la postérité sous le nom de Cavorite ou Cavorine ; il deviendrait membre de divers Instituts ; son portrait serait donné en prime par La Nature et autres perspectives de cet acabit. C'était tout ce qu'il y voyait !
Ainsi il aurait laissé tomber cette bombe sur le monde, comme s'il avait découvert tout bonnement une nouvelle espèce de moucheron – si, par bonheur, je ne m'étais trouvé là. Et la chose serait restée en cet état, aurait raté comme une ou deux autres petites choses que les hommes de science ont laissées en route.
Quand je me fus rendu compte de cela, ce fut moi qui parlai et Cavor qui répéta : « Continuez, continuez. » Je bondissais, arpentant la pièce et gesticulant comme un jeune homme. J'essayai de lui faire comprendre ses devoirs et ses responsabilités en cette occurrence – nos devoirs et nos responsabilités. Je lui affirmai que nous pouvions acquérir une fortune suffisante pour nous permettre, à notre fantaisie, toutes les révolutions sociales. Nous pourrions posséder et diriger le monde entier. Je lui parlai de compagnies, de brevets et des raisons que nous avions de fabriquer secrètement notre produit…
Tout cela semblait faire sur lui une impression assez semblable à celle que ses mathématiques avaient faite sur moi. Un air de perplexité envahit sa petite figure rouge. Il balbutia quelque chose à propos de l'indifférence pour les richesses, mais j'écartai ces sornettes : il était condamné à être riche et ses balbutiements n'y feraient rien. Je lui donnai à entendre quelle sorte d'homme j'étais et que j'avais une expérience considérable des affaires. Je lui laissai ignorer que j'étais alors un failli insolvable, parce que ce n'était qu'une situation temporaire ; mais je crois que je parvins à concilier mon évidente pauvreté avec mes ambitions financières. Insensiblement, à la façon dont de tels projets se développent, l'accord se fit entre nous pour un monopole de la Cavorite. Il se chargeait de la production de la matière et je devais lancer l'affaire.
Je m'obstinais à employer le nous – je et vous n'existaient plus pour moi.
Il lui vint à l'esprit que les bénéfices dont je parlais pourraient servir à doter des laboratoires de recherches, mais cela, naturellement, était un point que nous aurions à décider plus tard.
« C'est très bien ! C'est parfait ! » m'écriai-je.
La grande question était de se mettre en devoir de fabriquer la chose.
« Voilà une substance dont aucune maison, aucune usine, aucune forteresse, aucun navire n'oserait se passer, plus universellement applicable même qu'une spécialité médicale brevetée ! Il n'y a pas un seul de ces dix mille usages possibles qui ne doive nous enrichir, Cavor, au-delà de tous les rêves de l'avarice !
– C'est vrai, dit-il sentencieusement, je commence à comprendre. C'est extraordinaire comme on obtient de nouveaux points de vue en discutant.
– Et il se trouve que vous vous êtes adressé au bon endroit !
– Je suppose que personne n'est absolument ennemi d'une grande fortune, déclara-t-il. Naturellement il y a… il y a une difficulté… »
Il s'arrêta et j'écoutai sans broncher.
« Il est bien possible, vous savez, que nous ne puissions pas arriver à la fabriquer ! Cela peut être une de ces choses qui sont théoriquement possibles, mais pratiquement absurdes. Ou bien, quand nous en ferons, il pourrait se trouver quelque petite anicroche…
– Nous nous attaquerons à l'anicroche quand elle se présentera », dis-je.
[1] En français dans le texte.
CHAPITRE II. PREMIERS ESSAIS DE LA CAVORITE
Les craintes de Cavor étaient sans fondement, au moins en ce qui concernait la fabrication. Le 14 octobre 1899, cette incroyable substance fut effectivement découverte.
Par un hasard assez singulier, elle se trouva finalement fabriquée par accident et au moment où Cavor s'y attendait le moins. Il avait liquéfié un mélange de métaux et d'autres choses, dont je voudrais bien avoir la formule maintenant, et il se proposait d'entretenir la fusion de la mixture pendant une semaine, puis de la laisser refroidir lentement. À moins d'erreur dans ses calculs, le dernier état de la combinaison devait se trouver atteint quand la matière serait tombée à une température de 16 degrés. Mais il arriva qu'à l'insu de Cavor une discussion s'élève entre les hommes au sujet de l'entretien du fourneau : Gibbs, qui s'en était jusqu'alors chargé, essaya de passer la corvée à celui qui avait été jardinier, sous le prétexte que le charbon faisait partie du sol, puisqu'on l'en extrayait, et que, par conséquent, il n'entrait pas dans les attributions d'un menuisier ; le jardinier allégua, à son tour, que le charbon était une substance métallique ou un minerai, qui intéressait le cuisinier. Mais Spargus insista pour que Gibbs continuât son office, puisqu'il était menuisier et que le charbon est notoirement une matière végétale fossile.
En conséquence, Gibbs cessa d'alimenter le fourneau et personne ne s'en soucia plus ; Cavor était trop absorbé par certains problèmes intéressants, concernant une machine volante actionnée par la Cavorite (annulant la résistance de l'air et un ou deux autres points), pour s'apercevoir que quelque chose clochait. La naissance prématurée de son invention eut lieu juste au moment où il était à mi-chemin de mon pavillon, en route pour trouver son thé et sa conversation de chaque après-midi.
Je me rappelle ce jour-là avec une extrême netteté. L'eau du thé bouillait et tout était prêt : le bruit de son « zou, zou » m'amena jusqu'à la véranda. Son active petite personne se découpait, noire, sur le couchant d'automne, et, vers la droite, les cheminées de sa maison s'élevaient au-dessus d'un groupe d'arbres aux teintes magnifiques. Plus loin se dressaient les collines de Wealden, indécises et bleutées, tandis que sur la gauche le marais brumeux s'étendait spacieux et paisible.
Alors…
Les cheminées bondirent dans le ciel, se brisant, dans leur élan, en plusieurs longs chapelets de briques, suivies par le toit et par le mobilier. Puis, les rattrapant, une immense farine blanche s'éleva. Les arbres d'alentour se balancèrent, tourbillonnèrent et s'arrachèrent en morceaux qui sautèrent aussi vers la flamme. Je fus complètement assourdi par un éclat de tonnerre qui m'a laissé sourd d'une oreille, et tout autour de moi les fenêtres se fracassèrent d'elles-mêmes.
Je fis trois pas hors de la véranda, dans la direction de la maison de Cavor, et au même instant survint la rafale.
Les pans de ma redingote furent instantanément relevés par-dessus ma tête, et je me mis, malgré moi, à avancer par sauts et par bonds à la rencontre de Cavor. Au même moment, il était lui-même saisi, roulé en tous sens et lancé à travers l'atmosphère résonnante. Je vis l'une de mes cheminées s'abattre sur le sol, à six pas de moi ; je fis une vingtaine de bonds qui m'amenèrent irrésistiblement vers le foyer de la déflagration.
Cavor, dont les bras, les jambes et le pardessus battaient l'air, retomba, roula plusieurs fois sur lui-même, se remit sur pied, fut soulevé et transporté en avant à une vitesse énorme, et il disparut finalement au milieu des arbres secoués et agités qui se tordaient autour de la maison.
Une masse de fumée et de cendres et un carré de substance bleuâtre et brillante se précipitèrent vers le zénith. Un large fragment de clôture vola auprès de moi, tomba de côté, heurta le sol, s'aplatit, et le plus mauvais de l'affaire fut passé. La commotion aérienne ne fut plus qu'une forte rafale, et je constatai, en fin de compte, que je respirais et que j'étais sur pied. En tournant le dos au vent, je parvins à m'arrêter et à rassembler les quelques idées qui me restaient.
En ces quelques secondes, la face entière des choses avait changé. Le tranquille coucher de soleil avait disparu, le ciel était obscurci de nuages menaçants, et tout était renversé, agité par la tempête. Je jetai un coup d'œil en arrière pour voir si mon pavillon tenait encore debout ; puis je m'avançai en trébuchant vers les arbres entre lesquels Cavor avait disparu et à travers les branches dénudées desquels s'apercevaient les flammes de la maison incendiée. J'entrai dans le taillis, butant contre les troncs et m'y cramponnant, mais mes recherches furent assez longtemps vaines.
Enfin, au milieu d'un tas de branches et de treillages brisés qui s'étaient accotés au mur du jardin, j'entrevis quelque chose qui remuait ; j'y courus, mais avant que j'y fusse arrivé, un gros objet brun foncé s'en sépara, se dressa sur deux jambes boueuses et avança deux mains languissantes et ensanglantées. Quelques vêtements flottaient encore au gré du vent autour de cette masse.
Je finis par reconnaître, dans cet être glaiseux, Cavor, tout trempé de la boue dans laquelle il avait roulé. Il se pencha pour faire tête au vent, frottant ses yeux et sa bouche pour les débarrasser de la terre qui les recouvrait.
Il me tendit une sorte de moignon et trébucha d'un pas vers moi. Sa figure était bouleversée d'émotion et de petites écailles de boue s'en détachaient. Il paraissait aussi endommagé et aussi pitoyable qu'une créature humaine pouvait l'être, et sa remarque en la circonstance m'ahurit au-delà de toute expression.
« … plimentez-moi, bégaya-t-il, complimentez-moi !
– Vous complimenter, dis-je, et pourquoi donc ?
– Ça y est !
– Ça y est ? Qui diable a pu causer cette explosion ? »
Un coup de vent emporta des bribes de ses phrases. Je devinai qu'il disait que ce n'était pas du tout une explosion. Une rafale me lança contre lui et nous demeurâmes cramponnés l'un à l'autre.
« Essayons de rentrer chez moi », lui hurlai-je dans l'oreille.
Il ne m'entendit pas et me cria quelque chose dont je saisis seulement : « Trois martyrs – la science » ; et aussi ce fragment de réflexion : « Pas fameux en somme. » Il était en ce moment sous l'impression que ses trois aides avaient péri dans la trombe. Heureusement, il n'en était rien. Aussitôt leur patron sorti, ils s'étaient dirigés de concert vers l'unique cabaret de Lympne pour discuter la question des fourneaux devant de rafraîchissantes consommations.
Je répétai mon invitation à venir chez moi et cette fois il comprit. Nous nous cramponnâmes bras dessus, bras dessous, et partîmes pour nous réfugier enfin sous le peu de toit qui me restait. Nous demeurâmes assez longtemps affalés dans des fauteuils et pantelants. Toutes les vitres étaient cassées et tous les menus objets étaient en grand désordre, sans qu'il y eût de dommages irréparables. Par bonheur, la porte de la cuisine avait résisté, de sorte que ma vaisselle et mes ustensiles étaient intacts. La lampe à alcool brûlait encore, et je mis de l'eau à bouillir pour le thé. Cela fait, je pus écouter les explications de Cavor.
« C'est exact, c'est parfait, insistait-il. Ça y est et tout va bien.
– Comment, protestai-je, tout va bien ? Mais il n'y a pas une meule, ni une clôture, ni un toit de chaume qui ne soit endommagé à trente kilomètres à la ronde.
– Mais si, vraiment, tout va bien. Je n'avais naturellement pas prévu ce petit chavirement. Mon esprit était préoccupé d'un autre problème et je suis assez enclin à faire peu de cas de ces résultats pratiques et inattendus. Mais tout va bien.
– Ne croyez-vous donc pas, mon cher monsieur, m'écriai-je, que vous avez occasionné des millions de dégâts ?
– Pour ce qui est de cela, je m'en remets à votre discrétion. Je ne suis pas un homme pratique, certes, cependant ne pensez-vous pas qu'on regardera la chose comme un cyclone ?
– Mais l'explosion…