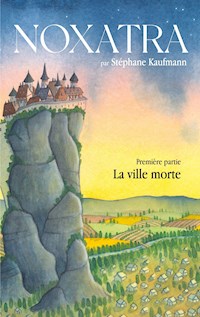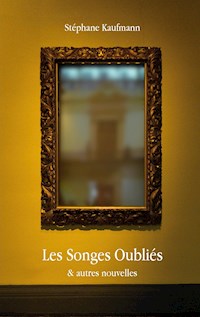
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Il y a du beau monde, dans ce recueil de nouvelles : un ours sur le champ de bataille de Waterloo, une femme qui pond des oeufs, un intrigant projectionniste de cinéma ou encore une agente immobilière androïde. Avec eux, passez du fantastique à l'historique, du rire au grincement de dents, au travers de vingt nouvelles dont l'écriture s'étale sur dix ans.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Du même auteur :
Romans :
Stanley, 2014
Noxatra, livre premier : La ville morte, à paraître, 2020
Livre jeunesse :
Le Manège de Papa,
à paraître, 2021, illustré par Laura Hédon
Sommaire
Préface
Le petit joueur d’échecs
Un homme heureux
Dorian
Une veuve mange au cochon cornu
Fantasme alsacien
Tomber de rideau
Le puits de Hougoumont
La boulangère
Les timbres voyageurs
Train de banlieue
Au chant du coucou
A propos
Etat des lieux
Madame Chantègre
Un chien et son maître
Corps étrangers
Le diable de Seebach
Un tribut au Roi de fer
La cloche et le koala
Les songes oubliés
Remerciements
Préface
A l’origine, ce livre portait un autre nom.
Qui lit mon blog The King Barry se souvient de l’annonce d’un recueil de nouvelles baptisé Le coffre à jouets pour la fin d’année 2015. Je crois même avoir été enthousiaste à ce sujet et pour cause : toutes les nouvelles étaient terminées et nécessitaient « seulement » une relecture.
Puis vint le silence radio.
Qu’on se rassure, je n’ai pas passé les cinq dernières années enfermé chez moi, à relire ce recueil (je pense même l’avoir plus souvent allongé d’une histoire que remanié, n’en déplaise à Boileau qui conseille de « vingt fois sur le métier [remettre] votre ouvrage, [… d’]ajoute[r] quelquefois, et souvent [d’] efface[r] »). Seulement, j’ai été un peu lâche : au moment de terminer le polissage d’une nouvelle, je prenais chaque fois conscience de l’énorme énergie déployée et me décourageais d’engager une quantité identique tout de suite, pour la suivante… d’autant que j’œuvrais aussi à mon deuxième roman, dont chaque nouvelle page écrite m’apportait une satisfaction chiffrable, rassurante.
Alors Le coffre à jouets s’est glissé dans un tiroir où il a pris la poussière, et ces nouvelles, comme de vieux songes, ont été oubliées.
En rouvrant le fameux tiroir, en cette étrange année, j’ai senti une pointe de tristesse : personne, en cinq ans, n’avait pu découvrir aucune de ces histoires. Or, j’avais du temps à passer chez moi, assez pour terminer le travail trop souvent procrastiné. C’est de cet élan qu’est né le livre que vous tenez désormais entre les mains. Les parties qui le composent n’ont de cohérence ni en style, ni en longueur, encore moins en genres ou thématiques abordés. Elles n’ont en commun que leur auteur et le besoin urgent d’être contées. J’espère que vous leur prêterez un œil bienveillant !
Massy, 2020
Le petit joueur d’échecs
Une main sur sa casquette en tweed, l'autre crispée sur les quotidiens qu'il transporte, le porteur de journaux remonte la rue d'un pas lourd. Le vent d'avril est coriace, bagarreur, et si le vieil homme ne fait pas attention, sa marchandise pourrait s'envoler en un rien de temps. Alors il veille, plaquant les journaux contre sa poitrine même si le cœur n'y est pas. Un peu plus loin sur l’avenue Sheridan, le kiosque qu'il cherche se dessine enfin et il ahane en franchissant les derniers mètres. La journée sera longue et il n’a déjà plus envie de marcher. Il y aura dix autres avenues à traverser, cent autres kiosques à ravitailler et il en soupire d'avance tant depuis le matin il n’a envie de rien. Il s’est réveillé avec l’annonce de la radio et il a tout de suite su qu’il devrait la porter toute la journée, la traîner de kiosque en kiosque, qu’elle serait placardée sur chaque devanture : Franklin Roosevelt est mort et l’Amérique pleure.
Le vieillard qui tient le kiosque n’a pas l’allure des beaux jours non plus : avachi sur son présentoir, il observe la rue d’un œil morne, ne relève même pas la casquette quand il salue l’arrivant. Ça leur arrache un sourire timide à tous les deux : ils se comprennent. Ils sont tristes, c'est ainsi, mais, au milieu de la rue, entourés des unes qui proclament ce décès qui les mine, ils peuvent au moins l’être ensemble.
En déballant la nouvelle, en se passant les liasses imprimées, ils relisent les titres : pour une fois, les voix dissonantes des médias ont oublié Hitler et la guerre. C’était vraiment étrange de les entendre si intimes, au réveil, ces voix qui suivent le train où repose le président disparu. Roosevelt est parti à sa résidence de Warm Springs la semaine précédente et il fait déjà le chemin du retour. La foule est immense, paraît-il, pour entourer la locomotive au point que la radio a eu honte de ne pouvoir compter tout le monde. Un commentateur a dit que le regard de l’Amérique, habitué aux champs d’Europe depuis quelques temps, retrouve ses routes sinueuses, les rails sur lesquelles son commerce, son identité se sont construites. Mais le porteur de journaux a trouvé ça déplacé, trop compliqué en regard de cette vérité immense : c'est un guide que le peuple américain a perdu et il lui témoigne sa reconnaissance une dernière fois.
Les deux hommes continuent de se passer les quotidiens mais le buraliste a presque l’air en colère maintenant. Le porteur de journaux n’a pas besoin de lui demander ce qui se passe : il lève un sourcil, le bonhomme répond d’un signe de tête et indique un gamin assis sur un banc, quelques mètres plus bas. À peine trop jeune pour avoir pu être envoyé au front, il sourit insolemment en caressant l’objectif d'un appareil photo posé sur ses genoux. À le voir ainsi, le porteur de journaux ressent une bouffée de hargne l'envahir à son tour. Le gamin ne devrait pas crâner, son seul droit, c’est le silence, l’humilité de ceux qui ont échappé de peu au désastre, encore plus aujourd’hui !
« Mon garçon, grogne-t-il en s'approchant, c'est pas un jour à faire le mariole. Aujourd’hui, on pleure, et si t’es trop bête pour ça, baisse au moins les yeux. Sinon tu finiras avec un poing dans la figure. »
Le gamin sursaute. La semonce du porteur de journaux le prend au dépourvu car il s'exclame : « Mais je suis triste, monsieur !
– Ah vraiment ? C'est bien la première fois que je vois un malheureux sourire de toutes ses dents.
– Non ! s'insurge-t-il. Si je souris, ce n’est pas pour me moquer, c'est parce que j'admire le coup que vient de jouer la vie, un coup sublime même s'il fait mal. Je suis beau joueur, moi !
– Beau joueur ? » répète le porteur de journaux.
Il adresse un regard perplexe au buraliste pour voir s'il comprend mieux que lui mais le vieil homme accroche ses journaux, perdu dans ses pensées.
« Oui monsieur, beau joueur ! reprend le jeune homme. Et c'est très objectif de dire ça. Regardez : le corps de Roosevelt, ce corps qui a porté la foi de toute l’Amérique, qui a tremblé avec toute notre indignation devant les autres chefs d'État... Eh bien, paf ! En un rien de temps, il se corrompt ! » Il a l’œil bizarre en disant ça et il s’enflamme en prenant la main du vendeur de journaux : « Sa main, comprenez, cette même main qui nous a envoyés sur les champs de bataille retourne à la terre avant la proclamation de la victoire ! Il n’y aura que les vers de terre pour la célébrer avec lui et, au milieu des embrassades, son cadavre sera bel et bien là, inavoué ! Pire, sa décomposition continuera ! L’odeur de sa chair pourrie se mêlera à celle du vin qu'on débouchera au retour des soldats. Et je suis sûr qu'en allant à Washington, maintenant, on verrait les passants forcer le pas devant la Maison Blanche, en fronçant le nez de peur que la putréfaction de Roosevelt ne l'ait déjà précédé ! »
Le gamin s'est excité à chaque phrase, le porteur de journaux lui trouve même l'air menaçant. L'énergie qu'il dégage irradie maintenant de tout son corps, alors quand il retombe sur lui-même, le visage sombre, le porteur de journaux a peur de ce qu’il va dire.
« C’est ça, un échec et mat. Toutes les forces du jeu n’étaient même pas encore à terre, nos cavaliers et nos tours font encore des ravages à l’heure qu’il est. Mais le roi, lui, a chuté et c’est la pièce qui commande toutes les autres. La seule pièce. Demain, c'est sûr, on recommencera une nouvelle partie, qu'on gagnera. Mais on n’oubliera pas cette défaite, monsieur, ni ce silence ! »
Sa voix devient un murmure puis elle s'éteint complètement. Le porteur de journaux ne sait pas s'il doit répondre, encore moins quoi dire. Il n'est plus question de sermonner le gamin : ratatiné sur son banc, accroché à son Graphlex comme à la dernière ration de pain du mois, il paraît si misérable... Oh ! Le porteur de journaux n'a pas tout compris à ce qu'il a dit mais la tristesse de son regard fait mal au cœur. Alors il se racle la gorge, mal à l'aise. Puis soudain, le garçon relève la tête, l’œil fiévreux.
« Mais moi, monsieur, à dix-sept ans je n’aime toujours pas perdre. C’est pour ça que j’ai toujours un coup d’avance aux échecs. Et je lui dis à la vie : la partie, tu ne l’as pas tout à fait gagnée ! Je vais la mettre dans ma boîte, ta tristesse, la rendre si belle qu'elle disparaîtra d'un coup. Je la vendrai, pour que les journaux étalent sa beauté partout, pour qu'on ne voie qu'elle et qu'elle nous transporte ! » Son visage est exalté, sa respiration haletante. « Oui, conclut-il, si je la vends, ma photo, c’est moi qui gagne la partie : la vie me donne la tristesse et moi, je refuse de me soumettre, au contraire, je la sublime… Un joli coup, c’est sûr… Mieux, une victoire ! Une victoire signée Stanley Kubrick ! »
Le petit joueur d’échec, dans sa transe, a lâché le vendeur de journaux pour saisir sa boîte à images. Le crépitement d’un flash et le méfait est accompli : il l'a prise sur le fait, la peine du buraliste accoudé à son kiosque ! Et le voilà déjà qui s’enfuit sur le pavé de New York sous le regard incrédule du porteur de journaux. Celui-ci hausse finalement les épaules en le voyant disparaître au coin de la rue et il échange un regard qui en dit long avec le buraliste. Ils ont au coin des lèvres un même sourire : celui de la vieillesse qui se rappelle l’insolence et l’espoir.
Palaiseau, 2011
Un homme heureux
Il y avait sur le flanc d'une montagne un arbre solitaire que l'hiver avait épargné. Vint un bûcheron que le froid menait en ce lieu. L'arbre étant laid et tordu comme un monstre, le bûcheron n'aurait pas eu de scrupules à l'abattre, n'eut été qu'il parlait, étrangeté qui retint son bras.
« Ton nom m'est inconnu, dit l’arbre au bûcheron, mais je connais ta nature. Tu n'es pas le premier qui convoite ma ramure pour en faire une flambée. Sache toutefois que tes congénères me laissèrent la vie, en échange d’une histoire dont en rentrant près du feu, ils puissent régaler leur marmaille.
– C'est sans doute que le froid n'était pas aussi rude qu'aujourd'hui ! répliqua le bûcheron. Mes enfants n'entendront pas ton histoire, tant ils claquent fort des dents … En quoi quelques mots remplaceraient-ils le confort d'une bûche ?
– Qui suis-je pour comprendre le choix des hommes ? Je ne fais que dire ce qu’il s’est passé… peut-être les autres ont-ils pensé qu'il y a d'autres arbres centenaires dont l’écorce crépiterait aussi bien dans leurs foyers ?
– Hélas, répondit le bûcheron. J’aimerais suivre leur exemple, mais nos forêts ont tant reculé… ne crois-tu pas que si j'avais rencontré quelque sapin, sur ma route, je me serais fait une joie de l’abattre puis de rebrousser chemin ? Hélas, durant l'ascension, seules les pierres me regardaient marcher, dressées si droites et si serrées les unes contre les autres qu'aucune racine n'aurait pu s'y glisser. Tu es le seul de la région !
– Bien tristes paroles, soupira l'arbre. Eh bien soit… Mais avant de frapper, écoute mon dernier conte et applaudis-le, qu'ainsi, j'abandonne dignement la vie que Dieu m'a confiée ! »
Le bûcheron ne sut refuser cette dernière volonté et il déposa sa hache contre une pierre puis s'assit.
« Cette histoire est celle d'un homme heureux, entendit-il.
Cet homme était fossoyeur, installé dans une grande et riche ville portuaire, si grande qu'on y mourait souvent, et si riche que les familles des trépassés leur offraient toujours des enterrements en grande pompe. Le fossoyeur se faisait un plaisir de leur livrer, clé en main, l'inhumation la plus digne et fastueuse possible. Par ailleurs, au-delà du soulagement que son aide apportait aux familles endeuillées, il se portait garant d’une certaine image de la dignité et s’enorgueillissait de n’avoir jamais reçu aucune plainte d'un client.
Malheureusement le cours des événements entrava la dynamique de ses affaires : au fil des ans, la ville portuaire devint un lieu touristique de plus en plus couru si bien que des vacanciers assiégèrent ses rues et ses plages. Or, ces étrangers ne témoignaient ni fascination ni respect pour les rites mortuaires : il n'était pas rare qu'un silence de cortège funèbre ne soit brisé par les rires gras proprement déplacés. Ne pouvant ni empêcher les habitants de mourir en été, ni bannir les touristes du trajet entre le cimetière et le temple, qui se trouvait être une des curiosités de la ville, le fossoyeur risquait fort d'être abandonné par ses clients, désireux d’être enterrés dans une ville plus calme. Il prit donc des mesures radicales.
Notre homme se targuait d'avoir contemplé toute sorte de cadavres. Il n'y avait personne dans la région qui connut les marques d’une lutte contre le cancer ou qui reconnut au premier coup d’œil un mort par étouffement. A vrai dire, son expérience dépassait celle du plus chevronné des médecins légistes, si bien que ceux-ci recouraient à ses conseils pour aiguiller leur diagnostic. A ses heures de loisirs, il avait ainsi établi le profil du meurtre parfait, les marques et les coups exacts à asséner pour maquiller un meurtre en accident ou en suicide sans qu'aucun des incompétents avec lesquels il travaillait ne lève un sourcil. N'était-il pas temps de mettre ce savoir à contribution ?
Néanmoins, il faudrait choisir soigneusement les cibles. Même si la brigade criminelle locale manquait de finesse, le commissaire se poserait des questions si une épidémie d'« accidents » frappait les touristes. A la quantité, le fossoyeur privilégia donc l’exemplarité. Tuer une ou deux personne âgées ? Peut-être, elles seraient retrouvées en pleine rue pour qu'on en parle. Un enfant noyé ? Bien sûr, un événement aussi tragique lui vaudrait une publicité nationale, si le corps était découvert à l’heure de grosse affluence sur la plage. Et pourquoi pas une intoxication alimentaire de grande ampleur dans l'hôtel que possédait le maire, qui avait fait obstacle aux plaintes déposées par le fossoyeur au conseil municipal ? Beaucoup en réchapperait, le fossoyeur y veillerait, mais pas tous…
Ainsi débuta l'année noire de la ville portuaire : en cinq incidents regrettables, l'une des destinations touristiques les plus prisées fut rebaptisée « mortifère », « inhospitalière » par les journaux – on parla même de malédiction. Mais si l'enfant noyé n'avait été le fils d'un ambassadeur, l'affaire n'aurait sans doute pas fait tant de bruit : celui-ci joua de ses relations pour démolir la réputation des hôtels où il avait logé, et dont le personnel aurait dû surveiller son fils durant sa baignade. La dernière une consacrée avant longtemps à cette petite ville côtière montrait un fossoyeur devant une tombe ouverte et titrait : « ici, on enterre le tourisme ». Seul un lecteur averti aurait noté le bourgeon de sourire de l'homme sur la photo.
Malheureusement pour le fossoyeur, ces drames ne ramenèrent pas la ville à son bonheur d'antan mais la plongèrent dans une durable crise économique. Aux fermetures d’hôtels répondit la faillite des commerces et une vague d'émigration massive s’ensuivit. Au début du printemps, la ville avait déjà perdu la moitié de ses habitants et, désertée, elle devint lugubre. Certes, plus un bruit ne venait troubler les enterrements mais de quels enterrements parlait-on ? Ceux-ci se faisaient de plus en plus rares et, qui plus est, personne n’engageait plus les sommes astronomiques que le fossoyeur facturait durant l’âge d'or.
Mais ce n’est pas la diminution de ses revenus qui toucha cet homme le plus durement : derrière ses dehors austères et sa moralité douteuse, il cachait un attachement profond à sa ville. C'est dans ce cimetière qu'il avait mis en terre son père et son grand-père, des pêcheurs dont les barques avaient sillonné la région jusqu'à en connaître chaque recoin et il se souvenait avec un pincement au cœur du faste de leurs enterrements où la ville entière s'était donnée rendez-vous. Pouvait-il sciemment abandonner ces lieux ? Et ces rues que peuplait sa mémoire de cris de pleureuses, cette cathédrale ou l'orgue entonnait la marche funèbre avec une grâce à faire tomber les vitraux ? De telles réflexions peuplaient ses longues marchent solitaires sur les remparts de la ville. Nourrissait-il aussi quelques remords pour ses victimes ? Plutôt de la tristesse à l'idée qu'elles aient bénéficié des dernières sépultures décentes de la ville, laissant notre homme face à un sentiment d'inachevé d'autant plus poignant qu'il le savait irréversible.
Laissons-le déambuler, avec le vague à l'âme qui gonflait dans sa poitrine dès qu'il n’officiait plus au cimetière. Laissons-le pousser chaque jour ses pérégrinations plus loin, au-delà des frontières de la ville. Alors, nous comprendrons pourquoi il disparut, purement et simplement. L’amertume avait guidé ses pas sur des sentiers inconnus et il ne trouva plus le chemin du retour.
S'il dormit lors de son errance, ce fut contre son gré, car la mélancolie l'avait atteint trop profondément pour qu'il distingue la réalité du songe. Il y eut pourtant un matin où il dut sortir de sa torpeur. Le printemps où il avait abandonné sa ville à la ruine avait peu à peu cédé la place à l'été, puis les feuilles de l'automne tardif commençaient à maculer l'herbe de taches sanguinolentes quand on interpella.
« Fossoyeur » l’appela-t-on.
L’homme sursauta : non qu'il eut peur, mais il était surpris d'entendre une voix humaine après tant de jours de solitude. Regardant autour de lui, il ne vit personne et rien ne bougea alentours, sinon les nuages. Mais la voix reprit, impérieuse : « Fossoyeur ! » et il la localisa cette fois-ci : son propriétaire s'était terré dans une fosse un peu plus loin, si profonde qu'elle le dissimulait au regard extérieur. Et tandis que notre homme s'avançait vers le trou, un bruit lui arracha un sourire : le raclement d'une pelle plongée dans la terre.
C'est l'outil à la main que le fossoyeur rencontra la Mort et il n'y eut jamais d'honneur plus grand que de voir la Faucheuse relever sa bure sur ses genoux pour creuser le tombeau d’un homme.
« Fossoyeur, voici ta tombe ! » dit la Mort.
Quelques instants, l’homme demeura ébahi : passé depuis des semaines au rang des spectres, il avait oublié sa nature mortelle. Mais contre toute attente, dressé face à l'abîme, ce retour au réel fit naître de la colère en lui car il voyait trop clairement les conditions de sa future inhumation : un vague trou, pas de cercueil et pas l'ombre d'une pierre pour marquer l'emplacement de sa sépulture. Ce dont il se plaignit à la Mort avec un langage fleuri qui le surprit lui-même.
« Tu te plains de ta tombe, le coupa la Mort, mais pourquoi ne t’en es-tu pas occupé toi-même ? Depuis des semaines, tu t’enfonces dans la montagne sans manger ni boire. J'ai retardé ton trépas, en hommage au travail admirable que tu as fait en mon nom mais, même moi, je ne peux différer éternellement l'heure de la fin… Tu devras te contenter de mon trou : au moins ne seras-tu pas la proie des charognards.
– Faucheuse, répliqua le fossoyeur, toi seul décide de notre fin et tu prétends ne plus pouvoir différer la mienne ? Je ne peux pas y croire. L'enterrement que tu m'infliges est un caprice ! Laisse-moi vivre assez longtemps pour rejoindre ma ville et y dresser une tombe convenable. Alors je rechignerai plus à retourner à la poussière.
– Et qu'y gagnerai-je ?
– Je me rattraperais à tes yeux. J’ai des amis que j'ai abandonnés dans ma vie natale : contre mon salut, je retournerai leur offrir l'enterrement qu'ils méritent, pour qu’éclate ta gloire aux yeux de tous. Après cela, si tu juges que je n’ai pas été à la hauteur de tes attentes, je reviendrai ici me jeter dans ce trou. »
La détermination inébranlable de cet homme, que la Mort avait pensé impressionner mais qui n'en manifestaient rien, suscita chez elle un sentiment nouveau : la curiosité. Aussi dit-elle :
« Après tout, pourquoi pas ? Et qui sait, si tu te révèles aussi utile qu’autrefois, peut-être prolongerai-je encore ton existence, plutôt que de te laisser construire ta tombe ? »
Trente ans passèrent. Puis l'éditorial d'un journal de la ville portuaire où a commencé cette histoire, titra l'article suivant :
« Ici, nous le savons, la mort est une histoire de famille : celle de la famille Keller. Chacun se souvient comment Keller senior, le patriarche, a reconstruit notre cité en déréliction autour de ses pompes funèbres. Chacun se rappelle aussi ses services, si sérieux, si soignés et si peu chers, qu’il a su réduire ses concurrents aux abois puis les racheter pour une bouchée de pain. Quant aux visages de ses fils, placés chacun à la tête de l'une de ses filiales, tous les connaissent, bien qu’ils aient augmenté sensiblement leurs tarifs depuis la retraite paternelle.
J’habite en face de la maison du patriarche et j’ose dire que c'est le seul endroit de la ville où il n'est pas inquiétant de voir se garer un corbillard – l’homme, dit-on, ne sait pas décrocher du métier et aime contrôler les standards qu'il a mis tant d'années à instaurer. Mais lorsque tous les corbillards de la famille sont stationnés sur le parking d’en face, sans même avoir déchargé leurs marchandises, lorsque les chauffeurs grillent leurs cigarettes en attendant que les patrons reviennent, la mine inquiète, c'est que quelque chose ne colle pas. Oui, messieurs dames, Keller senior, le roi de l'enterrement, est mourant. Quel espoir alors pour nos futurs enterrements ? Seront-ils de la même qualité ? »
On le voit, depuis son retour dans sa ville, la personnalité du fossoyeur avait fait grande impression sur la ville, que l’annonce de son trépas suscita l’effervescence de toute la région. Seuls les fils de Keller y semblaient étrangers, trop habitués à traiter des questions de décès pour s'en émouvoir. Tout au plus avaient-ils froncé les sourcils de le voir si faible et amaigri quand il leur avait annoncé la nouvelle. Par contre, ce qu’il leur dit ensuite les troubla profondément :
« Depuis les premiers jours où j'ai commencé la restauration de ce cimetière je pense à ma mort : elle plane au-dessus de chacun de mes mouvements, elle a dominé chaque cérémonial auquel j'ai présidé. Quand j'enterrais les autres, je croyais voir mon propre visage et je me demandais : est-ce ainsi que tu t'en iras ? Mais trente ans, mes enfants, c’est un temps trop long pour réfléchir, et aujourd'hui, je suis las d’imaginer la fin… C'est à vous, mes enfants, que j’ai donc décidé de m'en remettre car mes enseignements ont fait de vous des juges aussi dignes que moi de la conduite à suivre. Regardez au fond du cimetière et voyez l'immense parterre resté vierge. On y mettra ma tombe. Libre à vous de la dessiner pour moi. »
Ce ne fut qu’une fois la porte de la maison familiale refermée, cependant, que les quatre frères donnèrent libre cours à leur émotion :
« Pour une surprise, c’est une surprise ! dit le premier. Méticuleux comme il est, j’aurais cru qu’il avait arrêté ce genre de décision depuis longtemps, et jamais qu'il nous laisserait voix au chapitre !
– Parle pour toi, ricana le second. De mon côté, cela fait quelques mois qu’il me laisse libre de tous mes choix funéraires. De là à penser qu’il reconnaît mon talent et m’appellera à son chevet, pour son propre service, il n’y a qu’un pas !
– Et pourquoi t’aurait-il appelé, toi spécifiquement ? railla le troisième. Tu n'es bon qu'à faire des crémations et ce n’est pas ce qu’il souhaiterait. Qu'est-ce qu'une urne quand on peut avoir un cercueil, rien moins qu'une rose solitaire en face d’une couronne !
– Si tu penses ainsi, autant établir nos plans chacun de notre côté, répliqua son frère, piqué au vif.
– C’est sans doute la meilleure solution, intervint le dernier frère qui était resté silencieux jusqu’ici. En ce qui me concerne, je ne veux travailler avec aucun d'entre vous. Je vois vos travaux depuis des années et jamais je n'y ai décelé le génie que mérite notre père ! Voilà un accord : chacun établira son plan et Papa décidera lequel lui convient. Rendez-vous dans une semaine pour affronter nos projets, marché conclu ? »
Ce qu’ayant dit, ils topèrent et regagnèrent séparément les églises où des prêtres terrifiés les attendaient depuis une heure déjà aux côtés de familles en deuil déboussolées par ce retard inhabituel.
Durant les sept jours qui suivirent, le comportement de quatre frères dérouta grandement leurs employés. Les deux premiers jours, ils déléguèrent le travail à leurs meilleurs contremaîtres et s'enfermèrent dans leur bureau, obéissant au premier conseil de leur père : ne pas agir sur une première impulsion, même lorsqu'elle semble bonne, pour laisser le temps aux bonnes idées de germer. Quatre bureaux furent donc couverts, ces jours-là, de papier griffonnés où s’affrontèrent les idées les plus baroques ou farfelues. Mais en vérité, malgré leurs fanfaronnades aucun des fils n'avait d'idée précise de ce qu'il voulait édifier et la perspective d'être battu par les autres les tétanisait.
Le premier à n’y plus tenir fut le cadet : le troisième jour, il appela les meilleurs tailleurs de pierre de la région et commanda toutes leurs réserves d’un gré fin et de marbres précieux, leur demandant de livrer le tout à l'autre bout de la région dans un entrepôt connu de lui seul. Si cette commande mettait ses finances à mal, il savait qu’elle entraverait les velléités de l'aîné, au cas où il voudrait s’inspirer de l'édifice dont leur père avait le plus vanté les mérites et qui requérait de tes matériaux. Ce fut le premier coup bas d'une longue série, chaque frère devinant l'implication que les autres prenaient dans le sabotage de leurs idées. La déferlante de méchanceté fut telle qu’au matin du septième jour, il ne restait qu'une solution :
« Creuser un trou et enterrer Papa comme un moins que rien ! » grinça le deuxième fils en regardant la pelle dans sa main, tandis qu’ils se tenaient tous les quatre en face de la parcelle vierge que leurs imaginations arides auraient dû remplir.
« Si l'un d'entre vous n'avait pas mis le feu à mon arrière-boutique, nous pourrions au moins espérer lui dresser une stèle, siffla l’aîné, appuyé sur sa pelle, comme tous les autres.
– Ou une belle urne, si vous n'aviez touché à mon arrière-boutique » répliqua le plus jeune.
Chacun d’eux terminait à l’instant son service du jour et l'orage, qui se dessinait tandis que les familles remontaient l’allée centrale, était le miroir de leur humeur. Bientôt, ils furent seuls sous les trombes d'eaux qui transformèrent le lieu en boue et, alors seulement, au moment où le royaume de leur père se muait en marécage, leur colère éclata. Deux heures plus tard, quand soleil luit à nouveau, ce fut pour révéler quatre cadavres lézardés de coups de pelle aux deux témoins qui entraient dans le cimetière.
Le fossoyeur s'était étonné de ne pas voir ses fils revenir du travail et avait traîné sa carcasse jusque-là : c’était le premier des deux. Le second, c’était la Mort, venue faire son office et son regard sévère fixait le vieil homme à ses côtés, avec sévérité.
« Ainsi, dit-elle, tu as essayé de te jouer de moi et faire creuser ta tombe ici, plutôt qu’à l’emplacement dont nous avions convenu ? Pour cet affront, le destin de tes fils est une juste récompense. Qui penses-tu être pour trahir une parole donnée à la Mort ? »
Le fossoyeur, cependant, ne se troubla pas.
« La vanité, répondit-il, c’est l'apanage des hommes tels que mes fils, ceux qui ne savent pas combien leur vie est fragile. Moi, j'aime simplement finir les entreprises que j'ai entamées. Je t’avais promis de laisser derrière moi de bons successeurs… et les contremaîtres des mes fils, que j'ai moi-même formés, seront de dignes et respectueux officiers. Quant à mes enfants… je peux faire de leur sépulture mon dernier chef-d’œuvre. Je savais que la jalousie les monterait les uns contre les autres. Cet emplacement, depuis toujours, leur est destiné. Suis-moi et tu verras les plans que j’ai dessinés pour eux. Dans mes entrepôts se trouvent les matériaux nécessaires à leur érection. Cette tâche terminée, je te suivrai, comme promis. »
La mort ne dit rien, mais son plaisir était manifeste. Et ainsi, quelques jours plus tard, le fossoyeur orchestra son dernier enterrement et lui seul de l'assemblée ne pleura pas. Puis, quand tout fut fini, il plaça la pelle sur son épaule et s'élança aux côtés de la mort pour son dernier voyage. »
L'arbre se tut. Au loin, le petit jour poignait sur la montagne et un silence tranquille planait. Tout accaparé par le long récit, le bûcheron n'avait pas senti le froid engourdir ses membres et il s'était abandonné peu à peu aller à une étrange torpeur. Or, maintenant que l’histoire était terminée, il s'autorisa le sommeil et rendit son dernier soupir à l'heure où le coq aurait chanté.
Assis un peu plus loin, la Mort se leva et observa l'arbre qui avait poussé là où aurait dû se trouver la tombe du fossoyeur. Comment la Faucheuse lui avait-il donné la parole ? Bien simplement, en vérité : un vieil homme descendit d’une branche pour démentir toute idée d'un maléfice. Les années avaient certes ridé le fossoyeur mais elles ne l'avaient pas tant changé. Au vu des pierres tombales qui parsemaient les environs et que la neige recouvrait pour l’heure, en tous cas, il n'avait pas chômé.
Tout en saisissant sa faux, la Mort s'adressa à son compagnon :
« J'ai ses enfants à récupérer, je serai bientôt de retour. »
Mais le fossoyeur, déjà, ne l'écoutait plus : sa tâche l'attendait et c'est en fredonnant qu'il s'y attela, dans le silence du petit matin. Cette histoire, après tout, est celle d'un homme heureux.
Avec la collaboration de Marie Bieth,
Palaiseau, 2011
Dorian
Majd Soutine esquissa un bâillement et par réflexe l’escamota aussitôt de la main. À sa montre, il était dix-neuf heures trente mais l'arrivée de la nuit lui donnait toujours envie de sauter sous les draps et de dormir. Pour ne rien arranger, les minutes s'étiraient interminablement dans ce couloir vide. Il avait cru que le passage d'une femme de ménage le sauverait de l'ennui mais celle-ci ne lui avait pas même adressé un regard : un casque sur les oreilles, elle était passée en fredonnant un air de blues et Majd n'avait pas osé l'interpeller. Quelle était sa chanson ? I Got Plenty of Nothing ou Nobody Knows the Trouble I’ve Seen ? Tout en grommelant contre sa mémoire, Majd se redressa une énième fois et il sentit une piqûre familière au bas des reins : certaines tiges d'osier de son siège abîmé s'enfonçaient dans la peau de son dos et lui arrachèrent un grognement. Il tâtonna de sa vieille main pour trouver l'endroit meurtri et s'offrit un massage rapide. Ceci fait, il retomba en léthargie.
Au bout de deux minutes d'inaction, il décida qu'il avait assez attendu et voulut se lever. Ce qui lui demanda trois tentatives. Pour chacune, il ramena ses coudes le long du corps puis donna une impulsion comme s'il s'apprêtait à plonger dans le bassin d'une piscine. Sous le coup de son élan, son corps se souleva et l'espace d'une seconde indécise, resta suspendu, les deux jambes flageolantes. Puis il retomba en arrière et les tiges d'osier s'enfoncèrent à nouveau dans son dos. Le troisième essai fut le bon : au moment où il était en équilibre en l'air il eut l'idée de tendre ses genoux et – un peu comme les animaux des livres en relief – son corps se déplia d'un seul coup. Emporté par ce mouvement, Majd fut précipité vers l'avant jusqu'à ce que son corps se fige avec un bruit sec : le vieil homme avait fiché sa canne sur le sol.
Majd resta immobile pendant que sa respiration recouvrait un rythme normal. Puis, très lentement, il se mit à observer le couloir afin de choisir la nouvelle direction à prendre. Il remarqua qu'un peu plus loin, une porte était entrebâillée et un mince rai de lumière filtrait par l'interstice. N'ayant rien de mieux à faire, il s'avança dans sa direction à petits pas précautionneux et parvenu à destination, il ouvrit la porte d'une poussée extraordinaire.
La première chose qui frappa Majd en entrant fut la fraîcheur : un frisson parcourut le vieil homme qui resserra machinalement les pans de sa veste. Alors seulement, il remarqua l'étrangeté de la scène sous ses yeux : la pièce était plongée dans la pénombre sinon pour deux projecteurs dont les rayons se croisaient, éclairant un objet monumental que Majd ne distinguait pas correctement. Trop éblouissant. Curieux, il s'avança dans la pièce pour obtenir un meilleur angle d’observation du… meuble, de la forme ou qu’en savait-il ? Quand il ne fut plus qu'à deux mètres, il s'arrêta avec une mine perplexe. Il avait cru, dans un premier temps, que ce n'était qu'un seul objet mais, en réalité, il y en avait deux. Le premier était une cadre monumental et vide, d'une facture simple et veinée d'or, retenu au plafond par deux filins en titane ; il servait d’ornement au second objet, un buste de marbre placé sur un piédestal qui, si l'on se trouvait face au cadre, en occupait le centre.
Majd fronça les sourcils en observant la poitrine marmoréenne. Sa vue s'était beaucoup détériorée depuis vingt ans mais il avait été un spécialiste de la sculpture, si bien qu’il remarquait la mauvaise facture de celle-ci : la forme des pectoraux était grossière et – détail qui lui arracha un petit soupir condescendant – on en avait oublié les tétons. Quant au visage du buste, il était dépourvu de vie. Sous les traits d'un jeune homme avec des cheveux rabattus sur le front, des yeux éteints, des joues trop creuses.
Le vieil homme en était là de ses réflexions lorsqu'une voix sépulcrale murmura : « Bonjour Majd ».
Majd sursauta, recula, manqua de trébucher à plusieurs reprises mais parvint miraculeusement à ne pas s’étaler sur le parquet gris.
« Qui… Qui est là ?
– Tu ne m'as pas oublié, Majd, pas encore ? » Le ton respirait le cynisme et Majd eut un étrange pressentiment. De la sueur inonda ses paumes, rendant la canne glissante dans sa main.
« Qui est là ? répéta-t-il pitoyablement. Vous êtes… Où êtes-vous…
– Le buste ! » le coupa sèchement la voix et au moment où cette réplique tombait, Majd le regardait justement. Il nota le mouvement de la mâchoire quand la statue parlait et de surprise, sa canne lui échappa des mains, roula hors de portée.
« Eh bien ! Tu n'as pas seulement perdu la mémoire mais ta langue, on dirait !
– Comment … comment vous me connaissez ?
– Creuse un peu ta cervelle, Majd. Les dernières fois tu t'es souvenu de moi rapidement. Un indice : je m’appelle Dorian. »
Le nom, hélas, n’évoquait rien à Majd et la sensation de ne savoir que faire fit encore grimper son appréhension. Après quelques secondes d’indécision, il pivota sur lui-même dans un mouvement pour s'en aller, jugeant qu’une statue ne pouvait pas lui courir après.