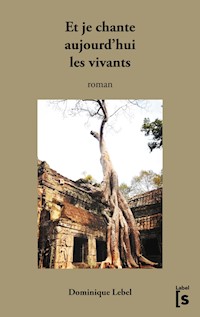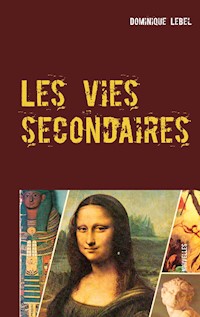
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Il existe entre le tableau et l'oeil du spectateur un espace dans lequel il peut arriver n'importe quoi - des existences par exemple, celles de ces personnages inconnus du public , qui ont pu frôler les artistes et sont demeurés quasi invisibles. Des ombres, une présence sous les pigments. Ces deux nouvelles racontent leur histoire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Sfumato
Louise
« Et qu’est-ce qui vous est arrivé ?
— Je me suis plantée devant les tableaux et suis restée là, sans bouger. Ou à peine, un déplacement des mains, un pas de côté, un coup d’œil vers la fenêtre. Rien d’important.
— Et alors ?
— Alors à un moment, j’ai senti leur présence. Comprenez bien, je ne les ai pas vus distinctement ni entendus comme je peux vous entendre, vous. Non, c’était différent. Mais ils se trouvaient là, j’en étais sûre. Sous les glacis, sous les pigments. Très en-dessous, avec leur petite vie. Bien tenus à l’intérieur.
— Et les peintres les connaissaient ?
— Non, bien sûr que non. Enfin, je ne crois pas, il me semble que c’est là une chose impossible. Les peintres étaient bien assez occupés avec leur existence, si compliquée. La nécessité dans laquelle ils se trouvaient de vendre leurs toiles, de se faire aimer aussi, de se faire aimer avec leur sale caractère. Alors dans ces conditions, des ombres qui passaient…et puis cette insignifiance affichée.
— C’est pourquoi vous avez voulu raconter leur histoire. Rappeler leur nom, leur accorder la lumière.
— Il fallait bien que quelqu’un s’y colle. Imaginez une seconde qu’on décide de nettoyer les tableaux, c’est une chose qu’on décide parfois dans les réunions officielles, vous savez. On hésite longtemps et puis un beau jour, on s’en va chercher les solvants. On choisit ceux qui conviennent, il ne s’agit pas de dénaturer les chefs d’œuvre. Mais qui alors s’occupe d’eux, si profondément cachés ? Qui devine à temps leur existence et crie au massacre ?
Un jour on nettoiera les surfaces encrassées et alors, ils disparaîtront tout à fait.
Resteront alors ces pages, qui leur sont consacrées. »
Sfumato
Emi, un mètre soixante, pour commencer. Elle se tient debout devant l’entrée du Carrousel, adossée à l’un des murs. Elle fume sa dernière cigarette, puis jettera le paquet dans une poubelle. Ou bien l’offrira à quelqu’un, un Parisien qui passe, un touriste avec un sac à dos, dira à l’un ou l’autre, de sa voix à peine voilée, ce paquet est pour vous mais prenez-en soin surtout, prenez soin de ces cigarettes que je n’ai pas fumées et n’allez pas les jeter à votre tour. Ne faites pas une chose pareille, je les ai tant aimées, si vous saviez. Pour l’instant elle s’applique comme elle le fait en toute chose, inspire à mort et souffle lentement et le plus fort possible, les lèvres à peine entrouvertes, les yeux presque fermés. Deux petites fentes, deux ailes d’hirondelle sur un visage très pâle, un dessin à l’encre projeté sur un mur de pierre.
C’est le moment de sa pause et Emi en a profité pour sortir. À la Yogurt factory ils sont trois vendeurs en ce moment, tous Japonais à cause de la clientèle. Trois vendeurs c’est peu aux heures d’affluence et Emi se plaint, elle est fatiguée. Et vaguement écœurée aussi par ces Bubble Waffles que les clients regardent avec des yeux écarquillés, tout brillants d’envie quand ils rentrent. Ils poussent la porte et plus rien ne compte alors pour eux que ces gaufres géantes en forme de cornets de frites, avec leurs boursouflures de pâte. Ils en oublient le Musée, le circuit en autobus à étage à travers Paris, les boutiques des Champs- l’Arc de triomphe -la Grande Roue-la Seine-la tour Eiffel, leur vie. Emi leur tend l’assemblage de petits macarons amalgamés, et qu’est-ce que je vous mets à l’intérieur ?
De la glace à la vanille
Ces bonbons-là, un peu. Pas trop, que ça ne déborde pas, qu’on n’en mette pas partout.
Des fruits secs.
Du coulis par-dessus, s’il vous plaît. Ou du chocolat.
Mais vous pouvez vous servir vous-même.
Emi a été engagée à la Yogurt factory il y a six mois, elle parlait encore mal le Français mais il y a tant d’étrangers dans cette galerie, de toute façon. Au début ils étaient deux à aller fumer dehors, le manager et elle, à présent elle est seule et là, dans cette solitude urbaine dont on pourrait faire un roman, elle pense à des choses. À Naha et à la maison de bois où vivent encore les siens, au manager qui a changé d’étage, qui fait semblant de ne pas la voir quand ils se croisent. À sa présence ici, dont elle ne saurait pas trop quoi dire si on l’interrogeait, car elle fait partie de ces individus qui se laissent porter, comme le bois flotté dans la mer.
—Le Carrousel j’y suis beaucoup, si je compte. Et quand j’arrive le matin, il y a les lumières, le sol qui brille.
Dans la galerie, l’éclairage est ce qu’Emi préfère et si elle lève la tête vers les lustres en forme de lampions, alors elle la voit, Elle. Elle voit son visage, reproduit en sérigraphie et répété en enfilade. Les autres l’appellent la Joconde, ni sa mère ni son père ne la connaissent, ils vivent si loin et sur le Port de Naha on s’occupe surtout d’installer les nasses, de vendre la pêche et de découper les poissons. Ou bien l’on part avant le lever du soleil vers la Haute mer, on lève les filets et l’on attrape les thons. Emi connaît le nom du peintre italien et elle pense que ses parents et ses grands-parents ont dû l’entendre un jour, qu’ils l’ont oublié à cause des poissons et du restaurant. Elle sait que tout le monde s’interroge sur le sourire de cette femme, que la question se trouve en suspension quelque part dans les airs, un peu partout au-dessus de la planète. Elle n’a pas la réponse car c’est un problème insoluble, mais elle connaît une autre femme qui sourit, dans un tableau japonais. C’est une femme avec un éventail, qu’elle trouve jolie et très japonaise.
—La Joconde, je la vois tous les matins quand j’arrive, dit-elle, je vois sa tête sur les lampions.
Et elle en est plutôt fière, se vante d’une forme d’intimité avec le chef-d’œuvre.
Devant le Carrousel encore peu fréquenté -ils arriveront tous vers midi- Emi, le dos appuyé contre le mur, s’entoure d’un halo de fumée. Les volutes d’abord à peu près dessinés -spirales et tourbillons- se transforment bientôt en un écran diffus, on sait qu’on pourrait passer la main au travers ou même passer de l’autre côté, sortir de cette histoire dans laquelle elle occupe déjà une place de choix, tout compte fait. En attendant, elle souffle la fumée de ce qu’elle pense être sa dernière Marlboro filtre -elle se trompe- et brouille la vision autour d’elle, se floute au regard des autres, petite silhouette fragile. Elle efface la possibilité de dessiner les contours de son visage, de son corps de ses mains et si le manager qui arrive l’aperçoit de loin, alors il pourra organiser sa fuite -presser le pas, baisser la tête, entrer sans la regarder. Prétendre qu’il ne l’a pas vue, ou pas reconnue. Affirmer qu’elle n’est pas non plus le centre du monde, ni la seule fille mignonne à Paris.
Dans un mois, pas très loin d’Emi et du Carrousel, on déplacera la Joconde et ce sera toute une histoire, on en parlera dans les journaux, on dira que c’est à cause des travaux dans la Salle des Etats, qui vieillit mal. La file d’attente pour voir enfin Mona Lisa ira alors du contrôle des billets jusqu’aux premiers escalators, ce sera une attente sans fin, un chemin de croix et toutes les voix étrangères feront une tour de Babel à l’intérieur de l’ancien Palais, quelque chose de très bruyant. Mais dans un mois il y aura aussi le drame, c’est le mot qu’on emploiera, comme on le fait chaque fois pour ce genre d’évènement. Le mot à faire peur circulera quelques jours dans les couloirs du Musée aux heures les plus tranquilles, il se propagera dans les étages, se faufilera dans les vestiaires, puis on ne le prononcera plus. On aura oublié.
Pour l’instant la Joconde se trouve encore à sa place, une main posée sur l’autre.
Mais il y a autre chose aussi, il y a ce paysage derrière elle, qui ressemble à la campagne toscane. On ne le remarque pas au premier abord, puisqu’on vient avant tout regarder le fameux sourire, dont tout le monde parle. D’ailleurs ce n’est pas à proprement parler un paysage. La rivière ne la cherchez pas, ce n’est pas une rivière, la roche que vous voyez n’est pas une roche, pas du tout. Ou pas tellement.
Les rivières ce sont des veines, c’est ce que vous expliquerait le peintre en montrant ce qui serpente derrière sa Madone, et il ajouterait d’autres choses, qui vous surprendraient. Il parlerait d’un corps débarrassé de sa peau, regardé de l’intérieur.
Tout autre chose finalement qu’un simple paysage. C’est exactement cela, exactement répèterait-il et vous l’écouteriez, la bouche ouverte et les yeux braqués sur sa barbe si longue.
—Un corps écorché puis ouvert, dépiauté. Et je sais de quoi je parle.
Derrière cette femme assise qu’a peinte Léonard de Vinci s’étend donc ce qui lui ressemble. Des os avec des aspérités, des veines gorgées de sang et des veinules fragiles, des muscles allongés en faisceaux, des matières qui suintent sur le chef d’œuvre qu’on vient aujourd’hui voir de si loin et c’est quand même une drôle d’histoire, là. La vie qui foisonne sur un panneau de bois, la connossione.
Connossione qu’est-ce que ça signifie en Italien?
Souvent le peintre se fâchait dans sa langue si belle, il disait que personne ne comprenait rien à rien dans cette ville tenue par des banquiers, qu’il ne pouvait pas livrer ses tableaux avant de les avoir achevés, que peindre la vie même demandait du temps, des années.
— Rien n’est jamais fini avec lui, se plaignaient les Florentins qui attendaient. Il n’est jamais content.
Et Salaï venait et faisait ce qu’il fallait pour le calmer en l’absence des élèves qu’on avait congédiés. Il tentait quelques caresses favorites, souvent répétées. Un effleurement d’abord. Puis quand il soulevait cet affreux burnous arabe que le Maître s’obstinait à porter et qu’il le pénétrait parmi les chevalets, les coupelles de peinture, les palettes souillées et les panneaux de bois, alors on entendait un cri, le cri de plaisir du génie.
Les rivières immenses ce sont des veines, vous croyez le peintre sur parole et il vous suffit sans doute de vous y aventurer. Alors commence une marche à petits pas, très particulière et très surprenante.
Vous en avez pour un moment.
Les couloirs et les salles du Louvre, si on les réunit, constituent un parcours de quatorze kilomètres, les équipes de nuit les ont comptés, mais à l’intérieur du tableau on peut s’en aller toute une vie, c’est un chemin jamais terminé, un pèlerinage sans fin. Cette rivière-là qui serpente n’est toutefois pas si grande, on peut la traverser à pied, il y a des pierres. Et la roche hérissée qui renvoie à la nuit des temps, à une création du monde, peut paraître tendre si l’on s’approche. Il suffit d’y aller lentement, d’y croire. Quant au petit pont sur la droite -on le discerne à peine- certains voudraient le reconnaître et parlent du Ponte Buriano près d’Arezzo, mais ce n’est pas écrit. Ce n’est pas précisé par le peintre. Il faut prendre la tangente en tout cas, sortir des clous et passer derrière la Madone. S’engager assez loin d’elle, à un bon kilomètre où se trouve ce qui est resté à l’intérieur, ce qui est invisible à l’œil au premier abord et qui échappe au cadre. C’est sauvage et beau, avec des parfums peu ordinaires. Du musc surtout, mêlé à l’odeur des pins et à celle des vernis. Il arrive même qu’il y ait du vent et que l’eau remue, encore plus loin, totalement hors champ.
Dans les arbres du fond on trouve même des nids de mésanges, des écureuils qui courent sur les branches et des mouches qui tournent, sans doute faudrait-il qu’on nettoie une bonne fois le tableau du Maître, avec des solvants puissants.
Il y aurait alors le vert des arbres et le bleu du ciel et le ton pourpre des manches de Mona Lisa qui sauterait aux yeux, et l’ocre de la terre et la couleur sable des chemins. Mais le tableau deviendrait différent, vous vous sentiriez floué, ce ne serait plus votre Joconde, votre Mona Lisa prise dans la pénombre des huiles encrassées et si craquelée, si fragile, en danger.
— Les rivières ce sont les veines et les rochers qui se dressent…
Il y a des siècles, le peintre a tendu des fils sur sa toile pour y établir ses lignes de fuite et aujourd’hui ce sont ces corps rapprochés qu’on dirait collés les uns aux autres, ces vestes en lainage froissées dans le dos, ces pullovers sombres et ces robes à manches, ces bras levés qui hissent des smartphones dans le brouhaha qui monte. Les conférenciers expliquent aux visiteurs des choses qu’ils ne comprennent pas bien mais qu’importe, ils la regardent. Elle, et ce n’est pas une contemplation, plutôt une curiosité collective, un besoin de participation qui les a fait tenir debout une heure dans la file d’attente, à piétiner, à se retourner sur les autres. Ils la trouvent petite, un peu perdue sur son grand mur et prisonnière de sa vitre. Ils se taisent un instant au moment où ils s’approchent, oublient qui ils sont, où ils habitent et l’adresse de leur hôtel, le prix du taxi, le numéro de la ligne de métro qu’ils devront prendre ensuite. Ils sont entrés dans l’histoire de la peinture et cherchent de toutes leurs forces l’enchantement, le miracle de l’âme qui s’en va rejoindre la toile, tout ce baratin qui les a conduits là à dix heures du matin, un peu sonnés parce que la chambre d’hôtel était bruyante, à Paris ils ne dorment jamais ?
Ils viennent de Madrid, de Tokyo, d’Amsterdam, de Montréal avec leur accent qu’on ne comprenait pas à l’accueil, ils ont attendu sous la Pyramide bruyante de voix dès le matin, puis ils ont suivi le plan du Musée, sont passés vite fait devant la Victoire de Samothrace, qu’ils ont trouvée géante, plutôt somptueuse. Ils voulaient absolument voir ce tableau dont on parle partout, afin de se sentir habitants du Monde, enfin à leur place. Seuls les Pyramides d’Egypte, l’Empire State building et la grande muraille de Chine peuvent leur procurer ce sentiment-là, ce délicieux sentiment d’appartenance. Ou alors un concert des Rolling Stones. Ensuite ils iront faire un tour du côté des antiquités égyptiennes pour voir le buste d’Akhenaton et snoberont les objets d’art et les salles romaines. Ils iront déjeuner dans le restaurant du Musée puis prendront le métro pour Orsay.
— Avec tout ce qu’on a encore à voir on n’est pas rendus, diront-ils dans toutes les langues.
Les rivières ce sont les veines et voilà Bertrand. Son costume de gardien est trop grand, les épaules surtout mais il faudrait qu’il se lève pour que vous remarquiez ce détail. Là, il n’écoute pas les conférenciers qui parlent, ne se penche pas, ne tourne pas la tête, se tient droit sur sa chaise comme il le fait toujours, incroyablement droit comme savent le faire les enfants. Il ne s’est jamais intéressé au paysage campagnard derrière Mona Lisa, il n’aime que les rues passantes et bruyantes, le bitume sombre des trottoirs, les tours, l’odeur des villes. Et il l’aime, Elle. Oh oui. Il est son gardien attitré depuis des années, a été nommé responsable de son sourire étrange, du regard qui vous suit quand vous vous déplacez.
— Vu vos états de service, on vous la laisse, ont-ils dit à la Direction du musée. On vous laisse Mona Lisa, la Salle des Etats, vous ne bougerez pas de là. Prenez-en soin, nous vous faisons confiance, bien sûr.
Il en aurait pleuré.
La Salle des Etats a une grande verrière qui laisse passer la lumière du jour et le plâtre de ses murs a été recouvert d’un stuc couleur terre de Sienne. Elle dans sa prison de verre, à trois mètres des visiteurs, est une femme aux mains jointes dont on ne voit ni la taille ni les hanches, ni les jambes et c’est dommage, vers 1503 au moment de la commande du tableau, Lorenzo le jeune commis de Francesco del Giocondo vous l’aurait dit, c’était quelque chose de merveilleux à toucher et Francesco lui-même, l’époux de Lisa, aurait dit de son côté que c’était une chose merveilleuse à pétrir à deux mains dans l’obscurité de la chambre, à embrasser avec des lèvres qui bavent.
— Je préfère rester seul avec elle, a dit le peintre à ses élèves.
Et quand il voudra commencer parce que Lisa del Giocondo sera enfin arrivée tout essoufflée, désolée et repentante et quand elle se sera assise, elle se trouvera gênée par quelque chose, les plis de sa robe sans doute et fera mine de se relever.
— Reste, lui dira le peintre.
Alors elle aura ce geste, une main sur l’autre qui cherchait un appui, reste tranquille répètera le Maître et les mains ne bougeront plus, elles prendront leur position définitive, l’une sur l’autre.
Lisa del Giocondo est restée assise trois heures durant et la douleur à la cuisse très tôt apparue lui a vite paru insupportable.
— Arrête de balancer ton pied, a dit le peintre. S’il te plaît.
Elle a senti le feu monter le long de l’os en une ligne d’incandescence, comment appeler cet os, quel nom déjà? Elle peut imaginer à quoi ressemble un squelette, elle en a vu un encapuchonné sur une gravure, dans la boutique de Cesare Vitti, via Porta Rosa. Elle a demandé ce que c’était, pourquoi il tirait ainsi sur une corde devant le vieillard assis et Francesco a éclaté de rire, on voit que tu n’es qu’une enfant a-t-il dit, on voit que tu n’as jamais vu la mort, que tu n’y penses même pas parce qu’à ton âge on croit que la vie ne finira pas, jamais. Elle s’est approchée, de la Mort on ne voyait que les poignets, les mains, le visage et à partir de là, de cette image, elle peut aujourd’hui se figurer l’os qu’elle a à l’intérieur de sa cuisse. Elle connaît les chairs épaisses, un peu flasques à cet endroit de son corps, la peau très douce que la main de Francesco caresse puis prend à pleines mains en lui faisant mal. Elle pense à sa langue d’homme imbibée de salive, à sa bouche qui remonte le long du ventre, des seins, je voudrais te dévorer dit-il chaque fois, je voudrais te manger, je t’aime tellement amore mio. Les mêmes mots dans un ordre identique, comme un rituel, comme si c’était cela l’amour, cette litanie mais doucement murmure-t-elle, tu vas réveiller nos fils. Elle ne connait pas le nom de l’os à l’intérieur de sa cuisse et ne peut que l’imaginer. Cette partie d’elle qu’il ne peut pas toucher, qui n’est pas à lui. Qu’elle voudrait offrir à Lorenzo, le commis. Le blond, il n’y a pas tant de blonds à Florence. Elle voudrait lui faire ce cadeau avec la chair qui l’entoure et la peau avec ses grains de beauté et son cœur et son âme aussi. Son âme à l’intérieur. L’os de sa cuisse semble un incendie, combien de temps va-t-il encore la faire rester sur cette chaise, celui qui peint ? Parce qu’il y a cette brûlure à l’intérieur d’elle et elle ignore qu’un jour des siècles plus tard, combien elle ne peut pas le savoir, elle n’est pas devin qui prédit l’avenir, elle ignore, donc, qu’un historien nommé Silvano Vinceti exhumera ce fémur qui la brûle. Avec un os de sa cheville tout près mais pas son crâne, quel dommage ont-ils tous dit autour de lui, c’était le crâne que nous cherchions ainsi comme des fous, le crâne de Lisa del Giocondo, la Joconde!