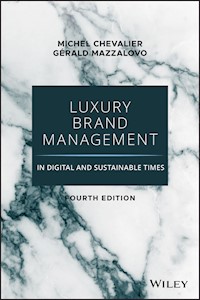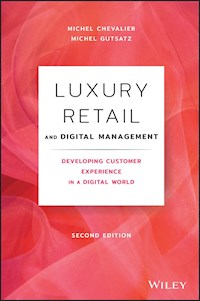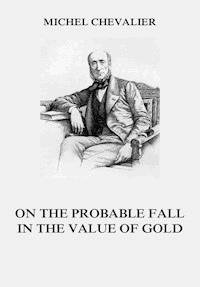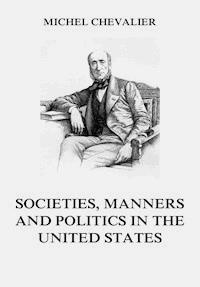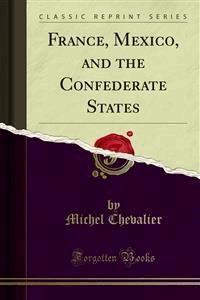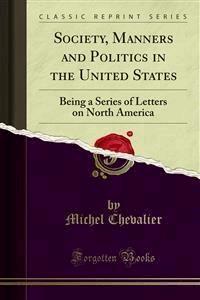Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Extrait: " Pendant qu'à Paris on parle de chemins de fer, ici l'on en fait. Celui de Londres à Birmingham est en commencement d'exécution; il aura quarante-cinq lieues; et la totalité des actions, montant à 62 millions et demi a trouvé des souscripteurs. Ce chemin sera suivi d'un autre presque aussi long, de Birmingham à Liverpool..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La civilisation à laquelle appartiennent les peuples de l’Europe marche sur le globe terrestre d’orient en occident. Du fond de la vieille Asie et de la haute Égypte, qui furent son double berceau, elle s’est avancée par une série de stations jusque sur le littoral de l’Atlantique, le long duquel elle s’est rangée, depuis l’extrémité méridionale de la péninsule espagnole jusqu’à la pointe septentrionale des îles Britanniques et de la presqu’île Scandinave. Elle semblait au terme de son voyage, lorsque Christophe Colomb lui apprit le chemin d’un nouveau monde.
À chaque station, elle a adopté d’autres croyances et d’autres mœurs, d’autres lois et d’autres usages, une autre langue, un autre costume, un autre régime hygiénique et alimentaire, une autre vie publique et privée. À chaque fois, la grande question des rapports de l’homme avec Dieu, avec l’homme et avec l’univers, celle de la hiérarchie politique et sociale, celle de la famille, qui toutes avaient reçu une solution au commencement de la halte, ont toutes été remises en discussion après un certain temps, et alors la civilisation, rentrant en marche, est allée leur donner une solution nouvelle, un peu plus loin, vers l’occident.
Ce courant, qui s’avance ainsi de l’est à l’ouest, résulte de la réunion de deux autres qui dérivent des deux grandes races de la Bible, celle de Sem et celle de Japhet, et qui, venus pour se confondre, l’un du midi, l’autre du nord, se renouvellent de leurs sources respectives à chaque période de notre civilisation, pendant les épisodes qui coupent et varient ce majestueux pèlerinage.
Tour à tour chacune des impulsions du nord et du midi, dont la résultante constitue la force motrice qui pousse l’humanité en avant, l’a emporté sur l’autre. De là vient que notre civilisation, au lieu de s’avancer en ligne droite d’orient en occident, s’est balancée du nord au sud, et du sud au nord, décrivant ainsi une ligne sinueuse, et ramassant alternativement des gouttes plus pures du sang de Sem et de celui de Japhet. Il y a pourtant cette différence entre le nord et le midi, que le midi a le plus souvent agi sur le nord en lui envoyant les germes de la civilisation, sans lui imposer sa race, et que le nord, pour réveiller la civilisation endormie dans le midi, lorsque les populations s’y étaient énervées, y a vomi des essaims d’énergiques barbares, « audax Japeti genus. » C’est ainsi que s’accomplit sans cesse la grande prophétie sur Japhet, « et inhabitet in tabernaculis Sem. »
Indépendamment de notre civilisation, il en existe sur la terre une autre qui embrasse des populations non moins nombreuses, car elle compte par centaines de millions. C’est celle de l’orient le plus reculé, celle dont les avant-postes sont au Japon, et le corps d’armée en Chine.
Au rebours de la nôtre, celle-ci a marché d’occident en orient. Sa faculté de locomotion sur le globe est très limitée. On pourrait presque comparer les vitesses respectives des deux civilisations à celles des deux grandes révolutions du globe : la révolution annuelle, et celle qui produit la précession des équinoxes.
La civilisation orientale s’est régénérée à diverses époques, tout comme celle de l’occident, par un nouveau mélange des hommes du nord avec ceux du midi. La race de Japhet, qui nous a donné nos barbares, avant les barbares, les Pélasges, les Scythes, les Celtes et les Thraces, après eux les Turcs et les Slaves, lui a fourni à elle ses Mongols et ses Mantchoux. Il est même arrivé une fois que la famille de Gengis-Kan, qui l’avait conquise, ait fait en même temps apparaître ses hordes jusque dans le voisinage du Rhin.
La civilisation d’orient, moins mobile et moins active que celle d’occident, probablement parce qu’elle n’a pas assez de sang de Sem, et qu’elle en a trop de celui des races inférieures, ne s’est pas élevée au même degré de perfection que sa sœur. Il faut cependant lui rendre cette justice d’avouer qu’à elle appartient la gloire de beaucoup d’inventions capitales, telles que la boussole, l’imprimerie, la poudre à canon, dont nous nous faisons honneur. Il faut surtout reconnaître qu’elle a résolu le problème de maintenir sous une seule loi, pendant une suite indéfinie de siècles, une population plus considérable que celle de l’Europe. L’empire romain, qui était moins peuplé que la Chine, n’a subsisté dans son intégrité que trois cents ans. L’autorité purement spirituelle des papes s’est étendue sur un moindre espace que celui de l’empire romain, et elle n’a positivement été reconnue que depuis Charlemagne jusqu’à Luther.
Les deux civilisations occidentale et orientale, ramassées en faisceaux serrés aux deux extrémités de l’ancien continent et se tournant le dos, étaient séparées par un espace immense, avant que la première ne fût allée s’établir en Amérique. Aujourd’hui plus de la moitié de la distance est franchie ; le Mexique et l’Amérique du sud sont couverts de rejetons de la civilisation occidentale, aussi bien sur le versant qui regarde l’Asie, que sur celui qui est en face de nous ; les États-Unis ne peuvent tarder longtemps à s’étendre, eux aussi, d’une mer à l’autre ; les îles de la mer du sud commencent à se peupler d’Européens.
De ce point de vue, il est clair que l’Amérique, posée entre les deux civilisations, est réservée à de hautes destinées, et que les progrès réalisés par les populations du nouveau monde importent au plus haut degré au progrès général de l’espèce.
La mise en rapport des deux civilisations, occidentale et orientale, est sans contredit le plus large sujet dont l’esprit humain puisse s’occuper ; c’est l’évènement qui, aux yeux d’un ami de l’humanité, est le plus gros d’espérances ; elle embrasse :
Politiquement, l’association de tous les peuples, l’équilibre du monde, dont l’équilibre européen n’est qu’un détail ;
Religieusement, la loi de la famille humaine tout entière, le véritable catholicisme ;
Moralement, le balancement le plus harmonique des deux natures opposées qui partagent chaque race, chaque sexe, chaque peuple, chaque famille, et que la Bible a représentées par les deux figures de Caïn et d’Abel ;
Intellectuellement, l’encyclopédie complète et la langue universelle ;
Industriellement, un plan définitif de l’exploitation du globe.
De nos jours, cette question cesse d’être purement spéculative. Désormais, c’est plus qu’une pâture pour les rêves des philosophes ; ce doit être un sujet de méditation pour les hommes d’État.
Depuis Louis XIV, les commerçants, qui sont les pionniers de la politique, étaient à essayer, avec une ardeur toujours croissante, d’ouvrir des relations avec la Chine, parce qu’ils sentaient l’importance d’un système régulier d’échanges entre l’Europe et une masse de producteurs et de consommateurs qui s’élève à deux cents millions.
L’émancipation de l’Amérique du nord et, tout récemment, la suppression du monopole de la compagnie anglaise des Indes, ont donné aux efforts du commerce une intensité insurmontable. Devant lui, les lois qui ferment le céleste Empire sont sans force. La Chine est cernée, au sud par les Anglais de l’Inde ou par leurs tributaires ; au nord, par les Cosaques, avant-garde de la Russie ; les flottes britanniques et les escadres américaines l’épient du côté de l’Océan ; les Espagnols assoupis du Mexique et des Philippines, qui se souviennent des galions, tiennent sur elle leurs yeux entrouverts. Le genre humain vient d’entrer en possession de nouveaux moyens de communication qui raccourcissent les distances dans une proportion inespérée. Les deux civilisations ne tarderont pas à se joindre et à se mêler. Ce sera le plus grand fait de l’histoire de l’espèce humaine.
Avant le perfectionnement de l’art de la navigation, avant Christophe Colomb et Vasco de Gama, l’Europe avait eu, indépendamment des caravanes qui traversaient l’Asie centrale, des communications avec la Chine, par l’intermédiaire des Arabes. Conquérants et missionnaires, les Arabes, posés entre les deux civilisations, s’étaient tour à tour épanchés à l’orient et à l’occident. Ce peuple, si remuant par intervalles, a été pour l’orient le messager de l’occident, pour l’occident surtout, le courrier et le facteur de l’orient. Malheureusement, depuis que la civilisation occidentale a commencé à briller du plus vif éclat dans notre Europe, la société arabe n’a plus jeté que de faibles lueurs ; depuis que la Providence a mis en nous une activité dévorante, les peuples arabes sont tombés dans un profond engourdissement : de ce côté donc, les communications, qui n’avaient jamais été fort multipliées, ni fort rapides, sont presque nulles aujourd’hui.
Mais si, comme quelques personnes le supposent, la race arabe est sur le point de se relever de son long affaissement, à la voix et par les soins de l’Europe occidentale, l’Europe aura en elle un puissant auxiliaire dans ses efforts, soit pour saisir l’Asie et l’étreindre, soit pour transmettre à celle-ci l’instrument avec lequel elle se remaniera ; et cette race illustre contribuera ainsi puissamment au mariage des deux civilisations.
Notre civilisation, dans sa marche vers l’occident, s’est aussi quelquefois retournée vers l’orient. C’est ainsi qu’elle a eu ses Argonautes, ses Agamemnon et ses Alexandre ; puis, ses héros des croisades et ses capitaines portugais. Ces mouvements, d’un ordre subalterne, n’interrompaient que momentanément sa marche solennelle vers les régions de l’occident ; c’étaient des contre-courants tout à fait comparables aux remous qui existent toujours dans le cours général des fleuves. Jusqu’à nos jours, l’Europe n’avait fondé dans l’antique Asie aucun établissement de quelque valeur et de quelque durée. À mesure que notre civilisation s’avançait vers l’occident, les pays qu’elle laissait derrière elle se dérobaient à son influence, et l’espace s’agrandissait entre elle et la civilisation d’orient. Alexandre est le seul dont la Chine ait pu s’alarmer, et il passa comme un éclair. Les Parthes, les Sarrasins ou les Turcs étaient, pour le fond de l’orient, d’inexpugnables boulevards. La mission de l’Europe était avant tout d’atteindre et de coloniser le nouvel hémisphère.
Maintenant, la supériorité incontestablement acquise aux occidentaux en richesses, en ressources mécaniques, en moyens de transport, dans l’art de l’administration et dans celui de la guerre, leur permet de se faire jour vers l’Asie la plus reculée, au travers de l’ancien monde. Les peuples que nous avons l’habitude d’appeler orientaux, mais qui ne sont que du petit orient, ont cessé d’être pour l’Europe des adversaires redoutables. Ils lui ont rendu leurs épées sans retour à Héliopolis, à Navarin, à Andrinople. Aujourd’hui enfin, la colonisation de l’Amérique est achevée, de la baie d’Hudson au cap Horn. L’Europe peut et doit se mouvoir dans la direction du levant tout aussi bien que vers le couchant. L’isthme de Suez a autant de chances que l’isthme de Panama pour devenir le passage de la civilisation occidentale dans ses expéditions vers le grand orient.
Notre civilisation européenne procède d’une double origine, des Romains et des peuplades germaniques. En faisant, pour un instant, abstraction de la Russie, qui est une nouvelle venue, et qui déjà pourtant égale les plus puissants des anciens peuples, elle se sous-divise en deux familles, dont chacune se distingue par sa ressemblance spéciale avec l’une des deux nations mères qui ont concouru à les enfanter l’une et l’autre. Ainsi, il y a l’Europe latine et l’Europe teutonique ; la première comprend les peuples du midi ; la seconde, les peuples continentaux du nord et l’Angleterre. Celle-ci est protestante, l’autre est catholique. L’une se sert d’idiomes où le latin domine, l’autre parle des langues germaines.
Les deux rameaux, latin et germain, se sont reproduits dans le nouveau monde. L’Amérique du sud est, comme l’Europe méridionale, catholique et latine. L’Amérique du nord appartient à une population protestante et anglo-saxonne.
Dans la vaste entreprise du rapprochement des deux grandes civilisations de l’Europe et de l’Asie, les peuples germains et latins peuvent les uns et les autres trouver une tâche à remplir. Les uns et les autres occupent en Europe et en Amérique, sur terre et au milieu des mers, d’admirables postes avancés et d’excellentes positions autour de cette immobile Asie où il s’agit de pénétrer.
Mais depuis un siècle, la supériorité, qui était autrefois du côté du groupe latin, est passée au groupe teutonique, soit par les efforts des Anglais dans l’ancien monde, et par ceux de leurs fils dans le nouveau, soit par l’affaiblissement des liens religieux et moraux parmi les nations latines. La race slave, qui est récemment apparue, et qui maintenant constitue dans notre Europe un troisième groupe distinct, semble même ne vouloir laisser aux peuples latins que le dernier rang. Il n’y a plus aujourd’hui que les Russes et les peuples d’origine anglo-saxonne qui se préoccupent de l’Asie lointaine, et qui se pressent sur ses frontières de terre ou de mer.
Les peuples de souche latine ne doivent cependant pas rester inactifs dans ce qui se prépare ; ils ne le peuvent pas sans encourir la déchéance. C’est une admirable occasion qui leur est offerte pour reconquérir le rang qu’ils ont perdu.
Dans notre Europe à trois têtes, latine, germanique et slave, deux nations, la France et l’Autriche, se présentent avec un caractère moins spécial et des facultés moins exclusives que les autres. La France participe des deux natures germanique et latine ; en religion elle est catholique par sentiment, et protestante par humeur ; elle réunit le nerf intellectuel des Allemands avec le goût élégant des méridionaux. L’Autriche, par l’éducation et l’origine des populations de ses États divers, est mi-slave, mi-germaine. Elle a un lien avec les Latins par la religion.
La France et l’Autriche sont les intermédiaires naturels, l’une entre les Germains et les Latins, l’autre entre les Germains et les Slaves. L’Autriche a eu aussi pendant fort longtemps et conserve encore la prétention d’étendre son patronage sur plusieurs membres de la famille latine. C’est en vertu de cette tendance au midi, qu’elle retient aujourd’hui le royaume lombardo-vénitien.
Cependant l’Autriche est principalement germaine : de même la France, par l’ensemble de ses traits distinctifs, se range dans le groupe latin.
De la nature mixte de la France et de l’Autriche, on peut conclure que toutes les fois qu’il s’agira de la balance de l’Europe, ou d’harmoniser les efforts de tous les Européens vers un but déterminé, l’une et l’autre exerceront une influence décisive, et que de leur loyal concours résulterait une force irrésistible.
L’Autriche a en Europe une situation plus centrale que la France. Elle possède une plus grande multiplicité de points d’attache avec les divers types de la civilisation occidentale, y compris ceux auxquels s’étaient superposés les Turcs. Mais la France combine les inestimables avantages d’une constitution plus homogène, et d’un tempérament plus flexible ; elle a une physionomie mieux dessinée, une mission mieux arrêtée ; elle a surtout une sociabilité plus forte. Elle forme la sommité du groupe latin ; elle en est la protectrice.
Dans les évènements qui semblent devoir bientôt poindre, la part de la France peut donc redevenir grande. La France est dépositaire des destinées de toutes les nations du groupe latin dans les deux continents. Elle seule peut empêcher que cette famille entière de peuples ne soit engloutie dans le double débordement des Germains ou Saxons et des Slaves. Il lui appartient de les réveiller de la léthargie où ils sont plongés dans les deux hémisphères, de les élever au niveau des autres nations, et de les mettre en mesure de figurer dans le monde. Elle est appelée, peut-être aussi plus que toute autre, à favoriser le développement de la vitalité qui paraît se ranimer parmi les Arabes, et à secouer par eux l’extrême orient.
Ainsi, la scène politique, examinée du point de vue français, offre sur le second plan, à distance encore, le contact des deux civilisations d’orient et d’occident, auquel nous sommes appelés à contribuer par intermédiaires, et, en avant, l’éducation par la France de tous les peuples latins, et d’une grande partie des populations arabes voisines de la Méditerranée.
On peut différer d’opinion sur le degré d’imminence des révolutions dont le fond de l’Asie doit être le théâtre. Je suis pourtant de ceux qui les croient peu éloignées. Je concevrais aussi que l’on voulût rétrécir le cercle de l’influence française, et le réduire aux pays méridionaux de l’Europe occidentale, quoique la France me semble appelée à exercer un bienveillant et fécond patronage sur les peuples de l’Amérique du sud, qui sont encore hors d’état de se suffire à eux-mêmes, et quoique les vieilles traditions des croisades, la conquête d’Alger et les souvenirs de l’expédition d’Égypte, semblent nous promettre un des premiers rôles dans le drame qui doit se passer sur la rive orientale de la Méditerranée.
Quant aux nations européennes de la famille latine, je ne suppose pas qu’il reste de doute à personne sur la suprématie que nous avons à exercer à leur égard, ni sur les devoirs que dans leur intérêt comme dans le nôtre nous avons à remplir vis-à-vis d’elles. Nous sommes notoirement les chefs de cette famille depuis Louis XIV ; nous ne pouvons reculer ni devant les bénéfices, ni devant les charges de notre position. Notre droit d’aînesse est reconnu par les peuples qui la composent ; notre protectorat a été accepté par eux, toutes les fois que nous l’avons offert sans l’arrière-pensée d’en abuser. Heureuse la France, si, satisfaite de cette haute prérogative, ses princes et surtout celui qui a rehaussé l’éclat du nom d’empereur, ne s’étaient obstinés dans des tentatives contre nature, afin d’établir leur suzeraineté sur les nations de la famille germanique !
Depuis que la prépondérance dans l’équilibre du monde est passée aux peuples d’origine saxonne, depuis que la race anglaise l’a emporté sur la France et sur l’Espagne, en Asie, en Amérique et en Europe, des institutions nouvelles, de nouvelles règles de gouvernement, de nouvelles idées et de nouvelles pratiques, touchant la vie sociale, politique et individuelle, se sont développées chez les Anglais, et plus encore chez leurs continuateurs du nouveau monde. Tout ce qui se rattache au travail et à la condition du plus grand nombre des travailleurs, a été perfectionné chez eux à un point inouï. Il semble qu’à la faveur de ces nouveautés, la prééminence des Anglo-Saxons sur les nations du groupe latin tende à s’accroître encore.
Nous Français, nous sommes, de toute la famille latine, les mieux placés, les seuls bien placés pour nous assimiler ces progrès en les modifiant conformément aux exigences de notre nature. Nous sommes pleins d’énergie ; jamais notre intelligence ne fut plus ouverte ; jamais nos cœurs n’ont plus demandé à battre pour de nobles entreprises.
Il est indispensable que nous nous mettions à l’œuvre sans plus de retard. Il le faut, abstraction faite de toute conception sur la politique universelle, et sur le contact plus ou moins prochain des deux grandes civilisations. C’est pour nous un besoin et une nécessité rigoureuse, même en supposant que nous n’ayons point à transmettre aux méridionaux, dont nous sommes les aînés, et aux peuples qui habitent l’est de la Méditerranée, les améliorations que leur situation réclame, et qu’ils sont disposés à recevoir de nous. Il s’agit pour nous-mêmes, dans notre intérieur, d’être ou de n’être plus.
Comment et sous quelle forme parviendrons-nous à nous approprier les innovations de la race anglaise ? Cette question difficile et complexe a été ma principale préoccupation pendant mon séjour dans le nouveau monde. Je ne prétends aucunement à l’honneur de l’avoir résolue, même imparfaitement. Je m’estimerais heureux si les pensées que m’a suggérées le spectacle d’un ordre de choses si différent du nôtre, tombant sous les yeux d’un homme meilleur et plus clairvoyant que moi, pouvaient contribuer à le mettre sur la voie de la solution.
Londres, 1er novembre 1833.
Pendant qu’à Paris on parle chemins de fer, ici l’on en fait. Celui de Londres à Birmingham est en commencement d’exécution ; il aura quarante-cinq lieues ; et la totalité des actions, montant à 62 millions et demi a trouvé des souscripteurs. Ce chemin sera suivi d’un autre presque aussi long, de Birmingham à Liverpool. Liverpool et Londres, dans cinq ans, ne seront donc plus qu’à huit heures de distance. Tandis que les capitalistes anglais réalisent d’aussi vastes entreprises, les capitalistes parisiens qui les voient faire ne s’en émeuvent pas davantage ; ils n’en sont même pas à faire des projets. Aucun d’eux ne paraît avoir encore sérieusement remarqué que déjà, dans l’état actuel des choses, le nombre des voyageurs entre Paris et Versailles est plus que double du nombre des voyageurs entre Liverpool et Manchester, aujourd’hui, en 1833, trois ans après la mise en activité des chemins de fer.
Aussi, à Londres, l’on paraît fort peu compter sur le concours des capitalistes français pour l’établissement du chemin de fer de Londres à Paris. On le désire ; on serait ravi de pouvoir, en quinze heures et à peu de frais, faire le trajet de l’une à l’autre capitale ; dans toutes les classes on s’en fait d’avance une fête. Mais on sent qu’il n’est ni convenable ni possible qu’une pareille œuvre ait lieu autrement que par l’accord des deux pays, et comme l’on n’ose pas croire à la coopération de la France, on en parle peu comme affaire.
Parmi toutes les acquisitions qui, depuis la fin du siècle dernier, ont agrandi le domaine des sciences d’observation, nulle n’a ouvert un champ plus vaste que la conception de Volta sur le développement de l’électricité par contact et sur son mouvement. Les phénomènes résultant de la communication des deux pôles de la pile voltaïque offrent aux savants une mine inépuisable à exploiter. Il n’y a pas dans la science de fait plus général, puisqu’il suffit que deux corps quelconques se touchent pour qu’aussitôt réagissant l’un sur l’autre, ils forment une pile plus ou moins active. Les conséquences de cette inspiration du génie sont incalculables, même après les brillantes découvertes de Davy, les admirables travaux de M. Ampère et les ingénieuses expériences de M. Becquerel. Ce fait physique, matériel, a un analogue évident dans l’ordre moral. Lorsque vous rapprochez deux hommes qui jusque-là avaient vécu éloignés l’un de l’autre, pour peu que ces hommes aient quelque qualité éminente, leur frottement produit inévitablement quelque étincelle. Si au lieu de deux hommes, les deux pôles de votre pile sont deux peuples, le résultat s’élargit dans la proportion d’un peuple à un homme. Si les deux peuples sont l’Angleterre et la France, c’est-à-dire les deux nations de l’univers les plus riches encore en lumières et en puissance, cette espèce de phénomène voltaïque prend une intensité prodigieuse. Il n’implique alors rien moins peut-être que le salut d’une civilisation ancienne ou l’enfantement d’une nouvelle civilisation.
Il est aisé de reconnaître que les qualités et les défauts dominants de la France et de l’Angleterre peuvent être disposés en séries parallèles dont les termes correspondants seraient complémentaires l’un de l’autre. L’Angleterre brille par le génie des affaires, et par les vertus qui l’accompagnent, le sang-froid, l’économie, la précision, la méthode, la persévérance. Le but de la France est bien plutôt le génie du goût et les arts, avec l’ardeur, l’abandon, la légèreté prodigue au moins de temps et de paroles, la mobilité d’humeur et l’irrégularité d’habitudes, qui distinguent les artistes. D’un côté, la raison avec sa marche sûre et sa sécheresse, le bon sens avec son terre à terre ; de l’autre, l’imagination avec son éclatante audace, mais aussi avec son ignorance de la pratique et des faits, ses écarts et ses faux pas. Ici, une admirable énergie pour lutter contre la nature et métamorphoser l’aspect matériel du globe ; là, une activité intellectuelle sans égale, et le don d’échauffer de sa pensée le cœur du genre humain. En Angleterre, des trésors d’industrie et des monceaux d’or ; en France des trésors d’idées, des puits de science, des torrents de verve. Chez la fière Albion, des mœurs réglées, mais sombres, une réserve poussée jusqu’à l’insociabilité ; dans notre belle France, des mœurs faciles jusqu’à la licence, la gaieté souvent grivoise des vieux Gaulois, un sans façon expansif qui frise la promiscuité. De part et d’autre, une énorme dose d’orgueil. Chez nos voisins, l’orgueil calculateur et ambitieux ; orgueil d’homme d’État et de marchand qui ne se repaît que de puissance et de richesse ; qui veut pour le pays des conquêtes, d’immenses colonies, tous les Gibraltars et toutes les Saintes-Hélènes, nids d’aigles d’où l’on domine tous les rivages et toutes les mers ; pour soi l’opulence, un parc aristocratique, un siège à la chambre des lords, une tombe à Westminster. Chez nous, l’orgueil vaniteux, mais immatériel, qui savoure d’idéales jouissances ; soif d’applaudissements pour soi-même, de gloire pour la patrie ; qui se contenterait pour la France de l’admiration des peuples ; pour soi, de châteaux en Espagne, d’un ruban, d’une épaulette, d’un vers de Béranger pour oraison funèbre ; orgueil d’acteur sur la scène, de paladin en champ clos. Au nord de la Manche, des populations qui combinent la religion et le positivisme ; au midi, une race à la fois sceptique et enthousiaste. Ici, un profond sentiment d’ordre et de hiérarchie, qui s’allie avec un sentiment de la dignité humaine exagéré jusqu’à la morgue ; là, un peuple passionné d’égalité, irritable, inquiet, remuant, qui néanmoins est docile, souvent jusqu’à en devenir débonnaire, confiant jusqu’à la crédulité, aisé à magnétiser par des enjôleurs, et se laissant fouler aux pieds comme un cadavre tant que dure la léthargie, et qui est enclin par moments à l’obséquiosité la plus courtisanesque. Chez les Anglais, le culte des traditions ; chez les Français, l’engouement pour la nouveauté. Parmi les uns, le respect à la loi, et l’obéissance à l’homme, à condition que la loi sera sa règle suprême ; parmi les autres, l’idolâtrie des grands hommes et la soumission aux lois, pourvu que l’épée de César leur serve de sauvegarde. D’un côté, le peuple souverain des mers ; de l’autre, l’arbitre du continent : soulevant l’univers quand il leur plaît, l’un par son levier d’or, l’autre du seul bruit de sa voix. Certes, de l’épanchement réciproque de deux peuples ainsi faits et ainsi posés dans le monde, il résulterait de grands effets pour la cause générale de la civilisation, autant que pour leur amélioration propre.
Le développement industriel n’est pas tout le développement humain ; mais, à dater du dix-neuvième siècle, nul peuple ne sera admis à se faire compter au premier rang des nations, s’il n’est avancé dans la carrière industrielle, s’il ne sait produire et travailler. Nul peuple ne sera puissant s’il n’est riche, et l’on ne s’enrichit plus que par le travail. En fait de travail et de production, nous avons beaucoup à emprunter aux Anglais, et c’est un genre d’emprunt qui se fait par les yeux mieux que par l’ouïe, par l’observation mieux que par la lecture. Si donc il y avait un chemin de fer entre Londres et Paris, nous Français, qui ne nous entendons guère à expédier les affaires, nous irions l’apprendre à Londres où l’instinct de l’administration est dans le sang. Nos spéculateurs iraient y voir comment de grandes entreprises se conduisent simplement, vite et sans diplomatie. Nos détaillants et leurs acheteurs ont à savoir des Anglais que surfaire et marchander ne sont pas nécessaires pour bien acheter ou bien vendre ; nos capitalistes et nos négociants, qu’il n’y a pas de prospérité commerciale durable ni de sécurité pour les capitaux là où le crédit n’est pas fondé ; ils verraient fonctionner la banque d’Angleterre avec ses succursales et les banques particulières, et peut-être il leur prendrait envie d’importer dans leur patrie, en les modifiant convenablement, ces institutions fécondes à la fois pour le public et pour les actionnaires. Ils s’imbiberaient de l’esprit d’association ; car, à Londres, il pénètre par tous les pores. Nous tous, nous y verrions en quoi consistent et comment se réalisent ce comfort, ce culte de la personne, si essentiel au calme de la vie ; et probablement alors Paris secouerait cette saleté séculaire qui jadis lui donna son nom, et contre laquelle, dix-huit cents ans plus tard, Voltaire lutta en vain, lui à qui la vieille monarchie et la foi de nos pères ne purent résister. Comme nous sommes un peuple pétri d’amour-propre, nous reviendrions d’Angleterre tout honteux de l’État de notre agriculture, de nos communications et de nos écoles élémentaires, tout humiliés de l’étroitesse de notre commerce extérieur, et nous aurions à cœur d’égaler nos voisins. Je ne m’occupe pas de détailler ce que les Anglais viendraient chercher chez nous : eux-mêmes sont convertis à cet égard, puisqu’ils y arrivent déjà en foule, tandis que l’on pourrait réellement compter, même à Paris le nombre des Français qui sont allés à Londres. Sans dire ce que les Anglais prendraient en France, on peut affirmer qu’ils y laisseraient des souverains en abondance. Pour Paris, ville de consommation et de plaisirs, paradis terrestre des étrangers, ce serait une mine d’or. Et les Anglais s’accoutumant à la France, leurs capitaux s’y acclimateraient aussi et y trouveraient de bons placements en vivifiant des entreprises essentielles.
Le chemin de fer de Paris à Londres serait un établissement commercial de premier ordre ; ce serait encore une fondation politique, un chaînon d’alliance étroite entre la France et l’Angleterre. Mais c’est surtout comme instrument d’éducation qu’il importe de le recommander ; car il n’y a pas à craindre que les deux autres points de vue soient négligés. L’industrie, disais-je, s’apprend particulièrement par les yeux. C’est spécialement vrai pour les ouvriers ; car chez eux, en vertu de leur genre de vie, le monde des sensations domine le monde des idées. Or, l’avancement de l’industrie ne dépend pas moins du progrès des ouvriers que de celui des directeurs et des chefs d’ateliers. Il conviendrait donc d’envoyer un certain nombre d’ouvriers de choix passer quelque temps en Angleterre, tout comme l’administration des ponts et chaussées le pratique régulièrement aujourd’hui pour un petit nombre d’ingénieurs. Le chemin de fer, réduisant de beaucoup les frais et les embarras du voyage, donnerait probablement le moyen d’expédier par caravanes, de France en Angleterre, les ouvriers qui auraient été jugés dignes de cette faveur. Il y a peu de temps, j’ai entendu exposer par un négociant lyonnais, homme de grand sens, qui revenait de visiter l’Angleterre et qui l’avait bien vue, un plan d’où il résultait que, pour une somme assez modique, ces expéditions d’ouvriers pourraient être organisées sur une assez large échelle. Dans son projet, qui était au moins fort ingénieux, ces voyages eussent été des récompenses décernées soit dans les écoles d’adultes, soit par les chambres de commerce ou par les conseils de prud’hommes dans les pays de manufactures, soit par les conseils municipaux ou par les conseils généraux dans les pays agricoles ; le ministre de la guerre eût aussi distribué de ces feuilles de route aux soldats qui auraient eu la meilleure conduite, ou qui auraient montré le plus d’aptitude industrielle ; ces expéditions se fussent ainsi rattachées à l’application de l’armée aux travaux publics. Il concevait un système de réciprocité entre les deux pays, au moyen duquel les ouvriers français ou anglais eussent trouvé de l’ouvrage, les premiers en Angleterre, les seconds en France. Il ne serait pas impossible qu’un jour cette idée formât la base d’une loi additionnelle à notre excellente loi de l’instruction primaire. Mais auparavant il faut que l’on ait le chemin de fer de Paris à Londres.
Dans le petit nombre des Français qui ont visité l’Angleterre, ce n’est encore que la minorité qui a fait le voyage pour affaires d’industrie ou d’art positif. La plupart l’ont entrepris par curiosité vague, par partie de plaisir. Ce qu’ils ont cherché partout, c’est le pittoresque, le poétique. Ils ont visité les ruines gothiques des monastères et des châteaux forts, la grotte de Fingal et les lacs d’Écosse ; ils ont admiré le costume des highlanders, les chevaux et les jockeys des grands seigneurs, le teint rosé des femmes. Ils ont parcouru un ou deux parcs, traversé les serres chaudes où toutes les plantes de l’univers sont réunies, bravant derrière leurs vitrages le ciel gris de la Grande-Bretagne ! Ils se sont promenés sous l’escorte d’un sergent dans les arsenaux militaires, quand ils ont pu en obtenir la permission. Ils ont passé en revue les jeunes beautés des bals d’Almack et les antiquailles de la Tour de Londres. Ils ont fait le voyage d’Angleterre comme on ferait celui d’Italie ou de Suisse. Si l’industrie les a un instant occupés, c’est à la façon d’une décoration d’Opéra. Ainsi, ils sont restés ébahis devant les milliers de vaisseaux dont les mâts s’étendent à perte de vue sur la Tamise ou dans les docks. Ils se sont extasiés sur l’immensité de ces cités manufacturières, sur les dimensions des fabriques et la hauteur de leurs cheminées ; sur cet éclairage merveilleux, sur ces ponts hardis en pierre ou en fer, sur l’aspect fantasmagorique des feux de forge pendant la nuit. Ils ont peu recherché comment l’Angleterre était arrivée à avoir ses innombrables vaisseaux, à multiplier ses manufactures à l’infini, à créer des villes d’une architecture si simple, et pourtant fastueuses par la largeur et la propreté de leurs rues ; ils se sont peu enquis de la source de tant de bien-être et d’opulence.
En Angleterre les monuments et le pittoresque ne sont que des accessoires, pour celui du moins qui va y chercher ce qu’on doit demander à l’Angleterre. Si vous courez après le pittoresque, allez en Suisse ; si vous avez la passion des vieux édifices, jetez-vous en Italie, courez les bords du Rhin, promenez-vous parmi les nefs de la Flandre et de la Belgique ; si vous n’avez pas peur de la peste et des insectes dégoûtants qui étaient en Égypte avant la colère de Moïse, traversez la Méditerranée, allez au bord du Nil, en Orient, en Grèce ; vous grimperez sur les Pyramides, vous vous assoirez au Parthénon, au pied des colonnes qui virent Miltiade et Périclès ; vous ramasserez un peu de la terre sacrée que foulèrent les Scipions et qui but le sang de César. S’il vous faut des cités monumentales, restez sur le continent et parcourez ces capitales d’Allemagne que leurs rois embellissent à l’envi. Si vous aimez les musées, si vous êtes idolâtre de peinture et de sculpture, partez pour la ville éternelle, ou allez voir ce que nous avons laissé de Murillo dans les cathédrales d’Espagne. Si vous préférez les fêtes majestueuses et les cérémonies solennelles, prenez une chaise de poste, et trouvez-vous à Saint-Pétersbourg le jour où l’empereur passe la revue de sa garde ; ou rendez-vous à Rome pendant la semaine sainte, et soyez là quand le successeur de saint Pierre donne sa bénédiction à l’univers ; car c’est encore le plus imposant spectacle qu’il y ait au monde.
Celui qui tient à revenir satisfait d’Angleterre, doit aller la visiter comme la reine de l’industrie. Celui-là doit voir la Cité plus que Regent’s Park, l’hôtel de la compagnie des Indes plutôt que le château de Windsor, s’informer de la Banque avant que de Saint-Paul, du Clearing-House plutôt que du Somerset-Palace ; s’inquiéter plus des docks et de la maison commerciale que des armures déposées à la Tour. Il doit s’introduire dans les magasins et les comptoirs, et courir les ateliers à l’affût du génie de la Grande-Bretagne. Il doit se dérober à la magnifique hospitalité des maisons de campagne anglaises, pour avoir plus de temps à consacrer aux mines et aux forges qui fournissent à l’industrie son pain quotidien, le charbon et le fer. Il doit se frotter à cette population ouvrière si robuste et si active, au moins autant qu’à la société la plus raffinée des salons de la noblesse. Pour moi, je n’ai rien trouvé à Londres qui m’ait paru plus original et m’ait fait plus de plaisir qu’un établissement de vente, situé dans Old-Change, dont les magasins contiennent vingt fois autant de marchandises que le plus grand magasin de Paris, et où il se fait annuellement pour 45 millions d’affaires ; et surtout que la grande brasserie de Barclay, Perkins et Ce près du pont de Londres, dont la distribution et l’ordre sont plus curieux encore que sa vaste étendue.
Me trouvant dans cette brasserie à un étage où étaient rangés, dans une file de bâtiments, 99 foudres dont quelques-uns ont une capacité de 500 000 à 600 000 bouteilles, je me rappelai le fameux foudre d’Heidelberg, que j’avais vu quelques années auparavant. C’est le seul objet qui se soit passablement conservé du délicieux château des comtes palatins, et il reçoit fidèlement la visite de tous les voyageurs qui viennent admirer cette ruine, la plus belle peut-être de toutes les ruines féodales. Quelle différence aujourd’hui entre le vieux château d’Heidelberg avec son tonneau, et la gigantesque fabrique du brasseur anglais avec son bataillon de foudres !
Le vieux château s’écroule ; les riches sculptures gothiques se dégradent. Vainement un dessinateur français (coïncidence bizarre ! ce dessinateur est un autre débris de la féodalité ; c’est un émigré, qui, avec un zèle digne des plus grands éloges, s’est constitué depuis un temps indéfini le gardien et le cicerone de ce beau monument) sollicite du gouvernement badois, à qui le château appartient, quelques mesures conservatrices. Chaque année il y a de nouveaux désastres par le dégel au printemps, par les orages en automne ; bientôt le vieux château sera une masse informe dont on vendra peut-être les pierres de taille à l’encan, et dont il ne restera plus que les dessins heureusement nombreux de M. Charles de Graimbert. La Salle des chevaliers est sans plafond ; les voûtes qui supportent la superbe terrasse d’où la vue s’étend au loin sur le cours du Necker et sur les jolies collines qui le bordent, ces voûtes ébranlées par les barils de poudre de Louvois, s’affaisseront quelque jour. Nul, pas même M. Charles de Graimbert, ne songe à relever la tour fendue du milieu des broussailles où elle gît. Pendant ce temps, la fabrique du brasseur s’enrichit tantôt d’un bâtiment de plus, tantôt d’une nouvelle machine à vapeur. Et s’il arrive quelque dégât, comme l’incendie qui dernièrement en dévora une aile, le mal est réparé aussitôt : à la place de l’édifice brûlé un autre s’est élevé plus splendide, où le fer employé largement préviendra désormais les ravages du feu.
Les statues des électeurs palatins sont renversées dans leurs niches ; nul des fils de leurs vassaux ne prend la peine d’aller les remettre d’aplomb. Chez le brasseur, tout est dans le meilleur ordre. Chaque outil est à son clou, chaque chaudière sur son fourneau, frottée et luisante. Des écuries du noble prince, il ne reste que des masures ; dans les écuries du brasseur, rivales de celles de Chantilly, où le grand Condé donnait à dîner à des rois, 150 chevaux, véritables montures de Goliath, sont l’objet de soins aussi délicats peut-être que ceux qui entourèrent la personne des premiers électeurs et de leurs preux. Le vieux tonneau est vide depuis plus d’un siècle et demi ; les curieux peuvent y descendre et en mesurer les flancs. Une seule fois M. Charles de Graimbert en a vu le vin jaillir ; c’était en 1813, pour l’empereur Alexandre et ses alliés les souverains d’Autriche et de Prusse. Mais ce n’était qu’une fraude pieuse : le vieux tonneau n’était pas plein ; le vin qui coulait venait d’un baril honteux qu’on y avait glissé la nuit précédente. Les 99 tonneaux de Barclay ; Perkinset Cie sont toujours pleins d’une bière qui fermente lentement. La bière qu’ils versent chaque jour et qui se répand dans tout le Royaume-Uni, dans l’Amérique du nord, qui s’expédie jusqu’aux Indes orientales, suffirait à combler le foudre classique du palatin Casimir (250 000 litres).
Le secret de ce contraste est aisé à expliquer : le gros tonneau féodal ne se remplissait que du produit des droits seigneuriaux, tandis que les tonneaux de la brasserie se remplissent par le libre concours de trois cents hommes qui sont assurés de recueillir chaque jour le fruit de leur travail ; le tonneau d’Heidelberg se vidait pour le seul plaisir du prince ou de ses favoris, au lieu que les tonneaux du brasseur ont à étancher la soif d’une population nombreuse qui travaille avec énergie, touche de beaux salaires et paye bien ses fournisseurs.
Le silence et la misère du vieux château, opposés à l’activité et à l’opulence de la brasserie anglaise, figurent un emblème de l’ordre féodal, tel que les temps l’ont fait, comparé à la puissance moderne de la paix et du travail créateur. Tous les peuples, selon qu’ils ont la puissance de transformer leurs vertus de guerriers féodaux en qualités de travailleurs, ou qu’ils sont dépourvus de l’énergie qu’il faut pour se forger ainsi soi-même, peuvent lire leur destinée prochaine dans la condition actuelle de la fabrique florissante, ou dans celle du château désert et croulant. Heureux les peuples qui, comme la France et l’Angleterre, ont eu la force de secouer le passé, et qui, tranquilles sur leurs libertés, n’ont plus qu’à s’occuper de l’avenir ! Malheur au peuple qui ne voudra pas ou ne pourra pas s’arracher au passé ! Celui-là est un peuple usé : il mourra de consomption, et il n’en restera plus que des ruines, qui pourront être poétiques, mais qui n’en seront pas moins des ruines, c’est-à-dire mort et désolation ; à moins qu’un sang nouveau ne s’infuse dans ses veines, c’est-à-dire à moins qu’il ne soit conquis comme l’infortunée Pologne.
Liverpool, 7 novembre 1833.