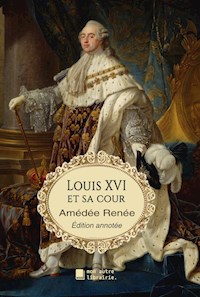
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mon Autre Librairie
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Une exposition fouillée de la politique, nationale et internationale, menée par les cabinets de Louis XVI. Les grands esprits visionnaires sont là, on voit, on comprend, on pense juste. Mais le roi est faible, les ministres incompétents, corrompus ou prévaricateurs, la noblesse acharnée à conserver des privilèges scandaleux. Le peuple épuisé, méprisé, est furieux. Plus rien ne peut se faire en douceur. Une analyse d'une finesse et d'une intelligence rares. (Édition annotée)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Louis XVI et sa cour
Amédée Renée
Édition annotée
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition Firmin Didot, Paris, 1858.
Couverture : Louis XVI par Antoine-François Callet.
Dos : Amédée Renée, Recueil de portraits (photographies, de membres titulaires, correspondants ou lauréats de l'Académie de Caen), FN C 566 / 1-2, bibliothèque de Caen.
https://monautrelibrairie.com
__________
© 2022, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-38371-024-0
Table des matières
CHAPITRE PREMIER.
CHAPITRE II.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
CHAPITRE V.
CHAPITRE VI.
Appendice
Il y a quelques années que je fus appelé à l’honneur inespéré de mettre une dernière main à l’Histoire de Sismondi, ce monument de la science historique que la mort avait laissé inachevé. Le travail complémentaire qui me fut confié comprenait le règne de Louis XVI, jusqu’à la grande époque de la Révolution. C’est cet ouvrage que je réimprime, après avoir soumis le fond et la forme à une révision laborieuse, et l’avoir en quelque sorte renouvelé par des recherches et des documents nouveaux.
Je ne me suis point senti la confiance de poursuivre cet ouvrage jusqu’à la mort de Louis XVI ; car, du jour où la Révolution commence, l’histoire de Louis XVI n’est plus en réalité que celle de la Révolution : et celle-ci ne s’arrête pas à la mort d’un homme ; cette époque n’appartient pas à Louis XVI, c’est plutôt Louis XVI qui lui appartient. L’histoire de la Révolution a été faite ; et c’est une tâche que je n’ai point la présomption de recommencer.
A. Renée
CHAPITRE PREMIER.
Avènement de Louis XVI. – État des esprits en France. – Gouvernement. Société. – Coup d’œil sur l’Europe. – Le roi, la reine ; leur éducation, leur genre de vie. – Le comte de Maurepas devient premier ministre ; MM. de Vergennes, du Muy, Turgot, entrent au conseil ; leurs antécédents, leurs portraits. – Doctrines et premiers actes de Turgot. – Rappel de l’ancien parlement ; la cour et le ministère partagés sur cette question. – Les frères du roi, les princes du sang ; leur caractère. – Émeute des farines. – Sacre de Louis XVI ; opinions de Maurepas et de Turgot à ce sujet. – Entrée au ministère de Malesherbes et du comte de Saint-Germain ; leur caractère. – Réformes de Turgot. Suppression de la corvée. Abolition des maîtrises et jurandes. Projets de constitution politique. – Opposition de la cour, de la magistrature et des métiers contre Turgot. – Réformes de Saint-Germain. – Retraite de Malesherbes. – Disgrâce et renvoi de Turgot.
La vieille monarchie finit avec Louis XV : comme il s’en était vanté un jour, cette monarchie avait duré autant que lui, mais elle ne pouvait durer davantage. La France avait accepté ce mot comme une vérité consolante : aussi la mort de Louis XV fut-elle accompagnée d’un sentiment de délivrance et de joie qui fit un ardent accueil à son héritier. Ce jeune prince cependant n’avait joué aucun rôle important sous son aïeul ; il ne marquait ni par les actions, ni par les qualités qui promettent la gloire ; rien n’avait mis sa jeunesse en vue avant l’heure de son avènement. Il tenait sa popularité seulement du contraste qu’il offrait avec Louis XV : contraste de la vie privée et des mœurs.
La nation pourtant se sentit profondément émue devant ce règne qui allait s’ouvrir : ce fut un moment de foi et d’attente. Toutes les aspirations vers un ordre meilleur en politique et en morale s’y étaient ajournées ; ce qu’on attendait, ce n’était plus un règne à la manière des précédents. L’idée de cet avenir était confuse ; mais le mouvement qui y portait était immense et généreux. On croyait à une transformation, on ne croyait pas encore à une ruine.
Ce fut le sentiment d’une vie nouvelle, de la vie politique, qui saisit la France à ce moment ; à aucune époque elle n’avait eu encore une telle faculté d’espérer. Elle attendait de ce règne naissant tout le bien qu’on ne demandait plus à Louis XV. Elle y comptait pour relever le pouvoir royal de la honte ou il était tombé ; elle y comptait pour s’élever elle-même. Dans un autre sens, le mot de Louis XIV, L’État c’est moi, devenait juste, et la nation commençait à le prononcer à son tour. L’avènement de Louis XVI était son avènement à elle ; son règne aussi allait s’ouvrir.
Un redoublement d’activité, mais d’une nature plus arrêtée et plus pratique, est le fait caractéristique du temps. Le dix-huitième siècle détournait visiblement le cours de ses études : la métaphysique, la philosophie générale, s’étaient épuisées. La pensée, moins occupée d’elle-même, travaillait davantage au profit direct de la société. L’éclat était moindre du côté des hommes ; les plus grands avaient disparu ou étaient sur leur déclin ; mais la société tout entière gagnait en lumières et en force. L’influence que les talents supérieurs avaient exercée n’appartint plus, après eux, qu’à l’opinion ; ce fut la société qui, à son tour, fit la loi aux écrivains ; à aucune époque peut-être l’esprit général n’entra si pleinement et si souverainement dans les livres. Cet esprit, qui remplissait les conversations, les harangues, les correspondances épistolaires, suscitait et conduisait la littérature ; et à défaut d’institutions régulières, on s’acquittait d’écrire comme d’une fonction qui relevait de la société.
Ainsi donc, ce qui marque le début du règne de Louis XVI, c’est comme une fièvre d’application immédiate en toutes choses ; déjà les idées, les théories pour elles-mêmes ne contentaient plus. Il y avait moins d’attaque, moins de combat du côté des questions religieuses et de la haute philosophie ; on commençait à mettre en cause l’autorité civile. Les sciences politiques et morales semblaient se constituer du même coup que toutes les autres sciences. D’une part naissait la chimie, de l’autre l’économie politique, et la méthode qui conduisait aux découvertes dans les sciences physiques semblait garantir aussi tous les progrès dans l’état social. Il faut recommencer la société humaine, disait-on, comme Bacon avait dit « qu’il fallait recommencer l’entendement humain. » L’esprit éprouvait dans sa course une telle ivresse, et se voyait déjà parvenu si loin, que l’on croyait aux facultés de l’homme comme à un dogme nouveau. L’autorité, l’infaillibilité même, semblaient avoir passé du côté de la raison.
On eût dit que les institutions seules bravaient l’influence de cette raison publique qui parlait de si haut. Elle avait rompu avec la tradition en toute chose, et le gouvernement ne connaissait, n’invoquait que la tradition. Sur toute la surface du pays l’image du passé se montrait encore : partout des monastères et des édifices féodaux. Dans les provinces on trouvait à chaque pas l’empreinte choquante de la société du Moyen-âge. Cette France, si fière d’elle-même, de l’ascendant de ses écrivains et des lumières qu’elle dispensait autour d’elle, rougissait devant l’étranger de son état politique. Champfort disait : « La vraie Turquie d’Europe, c’est la France ; ne lit-on pas dans tous les almanachs anglais : les pays despotiques, tels que la France et la Turquie. » Rapprochement plus insultant que réel.
Cette royauté de Louis XI et de Richelieu avait fait une dépense excessive de forces : le déclin en était manifeste, et partout on en avait conscience. Ce grand pouvoir, à vrai dire, n’avait jamais joui d’une constitution bien solide au fond. Il avait hérité de l’ancienne société, il avait mis la main sur toutes choses ; mais il les avait gardées telles1 : aussi ce régime monarchique resta-t-il dans une sorte de provisoire qui n’était pas fait pour lui garantir une très longue durée ; et l’on a pu comparer la France au domaine privé d’un oisif livré aux intendants. La limite de tous les pouvoirs y demeura indécise, la source de l’autorité flottante et contestée ; point de démarcations bien établies ; nul principe n’y prit de fixité. La royauté, la noblesse, le clergé, les parlements, restèrent en présence sans accord, sans fusion. La royauté avait prévalu ; mais les autres pouvoirs, contenus par la crainte, n’étaient point intérieurement soumis ; rien ne donnait à l’État cet équilibre, cette harmonie qui fait la force et la durée des gouvernements. L’administration des provinces était pleine surtout de ces incohérences : agrégées successivement à la monarchie, elles y étaient entrées et continuaient de s’y mouvoir avec leurs diversités d’organisation ; leur incorporation était restée comme en suspens. Si forte qu’elle a été, la royauté absolue ne sut pas faire en plus d’un siècle ce grand travail que la Révolution consomma en y portant seulement la main.
Ce qu’il y avait de particulier dans l’état social de l’ancienne France, c’est qu’à tous les inconvénients du despotisme se mêlaient ceux du régime féodal antérieur. La noblesse, écartée du pouvoir politique, s’en dédommageait par des restes de souveraineté locale ; il y avait ainsi double oppression. Le prince pesait sur la nation par l’impôt et les mille caprices du pouvoir arbitraire, le seigneur par les servitudes humiliantes de la féodalité. La couronne n’avait donc rendu qu’à moitié ce grand service qui aurait pu faire excuser ses empiétements ; elle n’avait abattu de la féodalité que ce qui la gênait : elle avait réduit le vassal puissant qui dominait une province, et laissait faire le petit tyran qui n’inquiétait que le hameau. Sans doute, l’élite des classes moyennes échappait de fait, par l’influence de la richesse et des talents, au joug vermoulu de cette hiérarchie ; mais là encore, comme l’a dit un écrivain, « cette inégalité des rangs était d’autant plus pesante qu’elle n’avait plus de fondements réels et qu’elle semblait porter à faux.2 »
L’opinion alors était si vive, qu’elle communiquait tout l’attrait de la mode aux problèmes les plus graves de la science politique. La société tenait dans ses mains une telle puissance d’éducation, que la noblesse elle-même ne put y échapper. Il y avait là pour elle de la nouveauté, du mouvement, un passe-temps dans sa vie désœuvrée ; la science et la liberté de la pensée, comme une dernière ressource, lui venaient en aide dans son ennui. Cette noblesse s’y laissa prendre, et ne trouva rien de mieux que de se persifler elle-même, se prenant aussi pour un préjugé.
Et pourtant il entrait quelque chose de plus sérieux dans la tête des ordres privilégiés. Ils étaient conduits aux idées de réforme par d’autres motifs encore ; ils étaient las de leur nullité politique. Le rôle que les institutions anglaises donnaient à l’aristocratie tentait la haute noblesse de France ; d’ailleurs, le siècle tout entier était fort occupé de l’Angleterre ; c’était la tendance des politiques avancés, comme on dirait à présent. Voltaire, Montesquieu avaient mis en vogue la constitution de ce pays. Il suffisait de voir le chemin que l’Angleterre avait fait, tout ce qu’elle avait conquis, tout ce que la France avait perdu, pour concevoir la plus haute idée du gouvernement britannique. L’orgueil et l’intérêt des grands seigneurs attiraient naturellement les plus capables et les plus fiers vers ce genre de gouvernement ; l’attitude des lords anglais, leur influence pouvait séduire un Montmorency, un La Rochefoucauld, plus que la domesticité de Versailles ou le régime des lettres de cachet. Les écrivains, les avocats, tous les hommes d’étude trouvaient dans le bruit qui leur venait des grands débats parlementaires un souvenir de la liberté antique et la perspective d’une gloire nouvelle. Et quelle émotion ces hommes n’en devaient-ils pas ressentir, puisqu’une femme, vivant au milieu d’eux et nourrie de leurs opinions, s’écriait avec enthousiasme : « J’aimerais mieux être le dernier membre de la chambre des communes d’Angleterre, que d’être même le roi Frédéric ; il n’y a que la gloire de Voltaire qui pourrait me consoler du malheur de n’être pas Anglais.3 »
La noblesse et le clergé des provinces, s’ils participaient à ce mouvement de réforme, tournaient leur vœu d’un autre côté. Bien plus familiers avec le passé qu’avec les institutions du dehors, ils avaient plutôt à cœur les coutumes représentatives de l’ancienne France, quelques traditions de libertés provinciales, où l’aristocratie locale jouait son rôle, qu’un changement de système dans le gouvernement de l’État. Le vœu de la petite bourgeoisie se tenait à peu près dans de pareilles limites, et n’imaginait guère de plus sûrs dépositaires des libertés générales que l’ancienne magistrature dispersée par les édits de Maupeou. On pourrait dire encore qu’animée contre les nobles d’une jalousie invétérée, la classe bourgeoise comptait toujours sur le prince, son ancien auxiliaire contre les grands. Elle semblait moins préoccupée d’institutions que du caractère personnel du roi.
Tel était l’état de l’esprit public au dedans, à l’heure où Louis XVI parvint au trône ; voyons le dehors. L’Europe n’était pas aussi avancée que la France : elle n’avait pas vieilli si vite ; elle n’avait rien de ce profond malaise des peuples qui aspirent aux changements, à la transformation. Elle ne rêvait point de vie nouvelle ; elle n’avait ni la souffrance d’institutions trop anciennes, ni l’impatience d’institutions plus jeunes et meilleures. Parfois les idées lui venaient de France, dans cette langue qu’on entendait partout, et tombaient sur elle comme des semences que l’avenir devait féconder. Mais ces idées, de même que la lumière, qui s’attache d’abord aux sommets, ne pénétraient que les gouvernements et ne plongeaient pas jusqu’aux peuples. Ainsi, Frédéric le philosophe régnait en Prusse ; mais la philosophie dont il était l’hôte ne dépassait pas le seuil de Potsdam. Ainsi, Catherine de Russie faisait d’impériales coquetteries aux libres penseurs de France ; mais, française dans ses lettres à Diderot, elle se maintenait russe et autocrate dans tous les actes de son gouvernement. La société européenne, d’une cohérence très solide encore, se conduisait d’après ses rites séculaires : aristocratique, religieuse, militaire, ne concevant rien de plus grand que des batailles, et pensant peu aux révolutions. Nous ne parlons pas de l’Angleterre : l’Angleterre, détachée du continent, n’était presque pas l’Europe, et elle s’en séparait davantage encore par ses idées et par ses institutions.
Socialement donc, et à peu de choses près quant aux mœurs générales, l’Europe était ce qu’on l’avait vue au Moyen-âge ; mais politiquement, elle différait. Depuis Luther, qui s’était fait l’instituteur des princes, les chefs des États avaient vu clair dans leurs intérêts de gouvernement ; ils avaient cherché partout à concentrer le pouvoir dans leurs mains. L’esprit des aristocraties luttait encore ; mais l’esprit sans le corps ne suffit pas. Tout ce qui avait été distingué, tout ce qui avait été illustre, s’était efforcé de ramener le pouvoir à l’unité, même par le despotisme et l’abus. En France, l’œuvre s’était faite grandement, rapidement, par Louis XI, Richelieu, Louis XIV. En Europe, cela se faisait, au moment où le travail accompli en France ne convenait plus aux besoins et aux perfectionnements nouveaux. Contraste frappant : en Europe, les gouvernements en savaient plus long que les peuples, et par conséquent, ils étaient toujours dignes de les conduire. En France, l’opinion était plus instruite que le pouvoir ; elle avait donc droit de le réformer.
Et sans cette opinion éclairée la France perdait son rang en Europe. Quand on compare son gouvernement à ceux qui l’entouraient alors, il n’est pas un seul de ces gouvernements qu’on ne préférât pour sa patrie ; l’opinion seule empêchait que la France de Louis XV ne fût au-dessous de la Russie de Catherine II.
Ce sentiment public, qui sauvait la France de l’abjection, l’avènement de Louis XVI en fit tout à coup une espérance qui entra dans les transports publics autant que le besoin des améliorations intérieures. Des traités meurtriers avaient été signés par nous, contre nous ; l’Angleterre nous avait tenu la main et forcés de mettre notre nom, en 1763,4 au bas des stipulations les plus honteuses. Nos traités de 17565 avec l’Autriche n’avaient été rien en fait d’ignominie auprès de ceux-là. Frédéric s’était cruellement vengé à Rossbach6 des versatilités de notre politique. Il avait donné un nom mérité à notre pays en l’appelant la ferme de la maison d’Autriche ; et cette maison d’Autriche avait comblé le mépris par l’ingratitude ; Marie-Thérèse s’était abaissée jusqu’à nommer la Pompadour son amie ; Choiseul n’avait été, pendant son ministère, que le premier commis du prince de Kaunitz. Tout le poids de l’alliance, la France l’avait porté ; et ce qu’elle en retirait de profit, après tant de durs sacrifices, c’était de voir son parti écrasé par l’Autriche dans Varsovie, et la Pologne mise en pièces sans qu’on tournât seulement la tête pour savoir ce qu’elle en pensait. Tant de revers, et ces noms si grands, après tout, Frédéric, Catherine, Marie-Thérèse, animaient d’un ressentiment jaloux cette opinion qui saluait le jeune Louis XVI ; avec les réformes demandées, on croyait pouvoir répondre par des institutions à ces princes, tels que la maison de Bourbon n’en produisait plus, et qui, comme Marie-Thérèse, Frédéric et Catherine, semblaient à eux seuls des institutions.
En effet, Louis XVI promettait plus par ce qu’il laisserait faire sous son règne que par ce qu’il ferait lui-même. Il était comme la promesse que d’autres devaient tenir un jour ; excepté ses instincts honnêtes, rien personnellement ne le recommandait à l’attention des hommes qui se préoccupaient de l’avenir, ni son éducation, ni son genre d’esprit, ni même cet extérieur qui n’est pas donné en vain aux représentants du pouvoir. Ce n’était point dans le sein des nouvelles idées que Louis XVI avait été élevé. Quelques princes contemporains avaient eu des philosophes pour maîtres. Le petit-fils de Louis XV fut élevé par un courtisan et par un jésuite. Il avait eu pour gouverneur le duc de La Vauguyon, homme de cour, frivole et servile, une espèce de Villeroy, mais chez qui l’esprit et la dignité des formes ne jetaient pas un voile sur les préjugés, et ses préjugés étaient de la plus infime espèce ; il prenait au rebours sa fonction : d’une morale et d’une dévotion étroite et misérable, il élevait un roi à l’inverse de son temps : s’appliquant à énerver sa conscience, à détendre en lui les ressorts du caractère et de la volonté. Rude et disgracieux dans ses manières, cet Alceste malencontreux ne réussit que trop, de ce côté, à faire le prince à son image.
Le Dauphin avait pour précepteur un évêque, M. de Coëtlosquet, qui n’était pas plus prélat de savoir et d’intelligence que La Vauguyon n’était grand seigneur, et qui couvrait l’homme important, l’instituteur réel, l’abbé Radonvilliers.
Les deux frères du roi, les comtes de Provence et d’Artois, avaient été placés dans les mêmes mains. Du vivant de leur père, ces princes avait été l’objet de ses plus grandes sollicitudes ; il avait pris sur lui toute la charge de leur éducation. Le fils de Louis XV vivait à l’écart, relevant silencieusement à Versailles les devoirs du mariage et de la paternité, tout ce que son père avait foulé aux pieds. Certes, le Dauphin était fait pour donner à ses fils, du côté des mœurs, les meilleurs enseignements et les plus purs exemples ; mais son âme manquait de vigueur et s’usait tout entière en scrupules. Fait pour être moine plus que pour être roi, il s’épouvantait de cette charge d’âmes qu’on appelle la royauté, et tremblait prématurément devant sa couronne. Un tel homme n’était fait pour aucune direction : une éducation l’embarrassait autant qu’un royaume ; il ne pouvait transmettre à son élève que sa morale craintive et défiante, et sa peur mélancolique d’être roi. Louis XVI conserva toujours un profond souvenir de son père, et ne se retourna que trop religieusement vers ces vieilles maximes de sa maison que le Dauphin lui prêchait dans ses Mémoires, et qui souvent s’ajustaient mal avec son amour du bien.
L’esprit du Dauphin, après la mort de son père, revint à ses précepteurs officiels, si peu propres à l’affermir, à l’élever. Quant aux études, il montra du goût et de l’application aux plus utiles, à celles-là qui avaient trait directement à des intérêts d’État. Il n’avait pas le sentiment délicat des choses littéraires, ni l’aptitude aux langues anciennes. La géographie, l’histoire, les langues modernes, convenaient mieux à son esprit.
Le nouveau Dauphin, marié dès l’âge de seize ans, vivait à Versailles à la manière de l’autre Dauphin, son père. On revoyait en lui le représentant de la famille, de l’intimité domestique. C’était un salutaire contraste, opposé de nouveau à Louis XV. On parlait de sa vie privée, de ses mœurs simples, de ses promenades sans suite avec la Dauphine, et des occasions qu’ils y trouvaient de se montrer compatissants et généreux. L’opinion publique leur savait gré de tout ce qui les distinguait de l’égoïste et immoral Louis XV.
L’archiduchesse, fille de Marie-Thérèse, que le système d’alliance en faveur depuis 1756 avait unie au Dauphin, ajoutait à cette popularité de l’estime tout ce qui s’attache à la beauté et à la grâce. Le contraste était grand sous ce rapport entre les deux époux ; Louis XVI n’avait rien de royal : « Il n’avait point de majesté, nous dit un homme de l’ancienne cour, point de cette dignité du regard et du maintien que Louis XV avait toujours gardée ; il n’avait ni la grâce qui séduit, ni l’éclat qui impose, ni la fermeté qui contient.7 » L’observateur ajoute avec raison pourtant que ses manières plutôt que sa figure manquaient de noblesse ; car il avait les traits caractérisés des Bourbons.
Marie-Antoinette, au contraire, avait tous les dehors d’une reine ; elle était attrayante et imposante à la fois. L’un des meilleurs juges qui l’ait observée nous la peint ainsi : « Elle était grande, admirablement bien faite, les bras superbes. C’était la femme de France qui marchait le mieux, portant la tête élevée sur un beau col grec. Sa peau était si transparente, dit encore le peintre, qu’elle ne prenait point d’ombres8. » Ainsi, Marie-Antoinette avait toutes les séductions nécessaires aux projets de Kaunitz et au rôle que lui avait tracé sa mère : c’était d’être à la cour de France la gardienne et l’instrument des intérêts de la cour impériale ; c’était de se faire aimer de son mari au profit de l’Autriche. Élevée par une femme qui avait été roi plus que reine, ne devait-elle pas, dans sa fierté de femme et de fille, tenir à honneur d’imiter sa mère ? La contagion de l’exemple des Catherine et des Marie-Thérèse remplissait le siècle, et la jeune Dauphine avait emporté de Vienne de dangereuses leçons. Elle y avait vu la triste attitude de son père, que l’impératrice reine avait comme cloîtré dans un désœuvrement éternel ; de bonne heure elle dut comprendre comment sa mère entendait qu’on régnât. Si elle avait pu l’oublier, on avait mis près d’elle un homme chargé de l’en faire souvenir : c’était son précepteur, l’abbé de Vermond. L’abbé de Vermond, envoyé par le duc de Choiseul à Vienne, y était devenu autrichien9 ; quelques familiarités de la souveraine, qui disait macousine à madame de Pompadour, avaient entraîné et gonflé cette âme subalterne. L’abbé de Vermond avait les défauts des mauvais prêtres de son siècle. C’était un sceptique, un frondeur infatigable, un mélange d’irréligion, d’intrigue et de vanité. Tel était l’instituteur envoyé de Versailles pour former l’esprit de la future Dauphine, pour l’élever à la française. Il s’empara de son élève, qu’il avait faite trop frivole pour le juger ; il était si sûr de sa faveur qu’il recevait insolemment au bain les ministres.10 Habile à manier l’esprit d’une jeune femme pour y exciter d’ardentes ambitions, le tentateur lui soufflait sans cesse qu’il fallait s’augmenter en crédit, en influence, et faire jusque du lit royal un instrument de domination. Ce nouveau directeur de conscience, au service de la maison d’Autriche, était pour cette jeune reine, qu’il égarait, l’infaillibilité vivante.11 Elle avait, elle, tout ce qui attire, mais il lui apprit à repousser, à blesser l’opinion ; cet homme, chargé d’élever une reine de France, l’empêchait d’être Française. Un parti puissant se forma de bonne heure à la cour contre Marie-Antoinette, et la faute en fut surtout à l’intrigant obscur qu’on lui avait donné pour guide.
Dès son début à Versailles, une affaire d’étiquette l’avait compromise, et les nobles lui gardaient rancune d’une prétention inconsidérée, dictée par l’orgueil de sa maison. Deux princesses de Lorraine, ses parentes, avaient pris le pas sur les grandes dames de France aux fêtes de son mariage. On se plaignit avec éclat, et Marie-Antoinette, oubliant qu’elle était dauphine, répondit aux plaintes par des railleries, auxquelles sa position donnait un sens plus blessant et plus cruel. Elle s’en prit à l’étiquette française : c’était pour elle le seul côté de la France qu’elle pût attaquer.12 En cela, elle commençait de gagner le funeste surnom qu’on lui donna plus tard, l’Autrichienne. La France, alors, qui s’inquiétait peu des humiliations et des blessures de l’aristocratie, ne prit pas garde à ce débat, et la Dauphine resta populaire jusqu’à la fin du règne de Louis XV. Elle avait été humiliée à Versailles par madame Dubarry13 ; c’était bien quelque chose pour tout ce qui avait un peu de fierté en France, et la faveur publique l’avait vengée ; cette faveur l’accompagna jusqu’au pied du trône.
Le premier acte politique du nouveau règne devait donner à la reine l’occasion de montrer son pouvoir. Le renouvelle-ment du ministère était inévitable ; les derniers ministres de Louis XV, détestés, avilis, ne pouvaient être maintenus sans ruiner la popularité de Louis XVI. La reine poussa la première au changement. On souhaitait ardemment à Vienne le retour du duc de Choiseul, et Marie-Antoinette y travailla de tous ses efforts. On sait ce qu’avait été Choiseul : il avait négocié le traité de 1758 et le mariage de Marie-Antoinette. C’était un Lorrain, partout vassal de la maison de Lorraine ; il lui avait prêté foi et hommage à Vienne, lors de son ambassade, et lui avait tenu son serment quand il fut ministre à Versailles. La fille de Marie-Thérèse devait bien un peu de reconnaissance à cette fidélité éprouvée ; une circonstance vint l’aider dans ses efforts. La maladie de Louis XV avait jeté l’épouvante, et donnait grande vogue à l’inoculation. Louis XVI et ses frères voulurent s’y soumettre. La reine profita de la retraite pour entreprendre l’esprit du roi ; mais elle y rencontra la plus dure résistance ; le roi était prévenu contre Choiseul par les mémoires et les recommandations de son père. Il avait existé entre le Dauphin et ce ministre une hostilité si flagrante, qu’une sourde accusation fut répandue contre le duc d’avoir abrégé les jours du prince par le poison. On avait fait pénétrer ces noirs soupçons dans l’esprit de Louis XVI. La famille royale, en garde contre l’influence autrichienne, en profita pour triompher de la reine et repousser Choiseul. Mesdames, filles de Louis XV, fort écoutées du roi, leur neveu, s’armèrent contre l’homme d’État des souvenirs hostiles du Dauphin, de ses jugements, de ses mémoires, et des vieilles maximes politiques de leur maison, que Choiseul avait renversées. La reine eut le dessous dans cette lutte, qui fut suivie entre elle et les princesses de blessures vives et de longs ressentiments.
Le duc de Choiseul écarté, les tantes mirent en avant trois candidats, le cardinal de Bernis, M. de Machaut et le comte de Maurepas, anciens ministres tous trois, et disgraciés sous l’autre règne ; ils étaient bien notés dans les instructions du Dauphin. Le premier cependant n’était point sans reproches devant les partisans de la tradition ; il était l’un des premiers fauteurs de l’alliance autrichienne14 ; mais il avait eu bientôt le mérite d’une disgrâce ; il avait failli et s’était montré repentant, ce qui est un grand mérite aux yeux des partis. Le cardinal de Bernis n’était point un politique de l’ordre supérieur. Esprit de second ordre, habile, propre à réussir dans les ambassades par la dextérité et le talent d’exécution, il n’avait ni qualités, ni vues conformes à la situation.
M. de Machaut était un caractère et un esprit d’une plus haute valeur. Il fallait que sa probité eût jeté un grand éclat pour qu’il eût pu, sans se perdre aux yeux du pieux Dauphin, inquiéter l’Église, en portant un regard sévère sur ses revenus.15 M. de Machaut eut des idées de gouvernement ; et il est resté avec tout le prestige de ces idées, parce que les circonstances ne le mirent point en demeure de les appliquer ; quoi qu’il en soit, ses qualités, ses talents étaient réels, et semblent légitimer les regrets. Si le Dauphin, comme on le rapporte, plaça son fils dans l’alternative de se prononcer entre trois candidats si bizarrement réunis, il fit preuve de bien peu de discernement politique, ou il présuma beaucoup de celui de son fils. Louis XVI eut l’instinct assez juste pour se tourner vers Machaut : il se prononçait pour le plus honnête. Mais sa résolution ne tint pas contre de futiles objections ; un dernier mot renversa ce qu’il avait décidé, et fit tourner son esprit du grave Machaut au frivole Maurepas. On rapporte de ce conciliabule secret une particularité singulière qui montrerait bien Louis XVI tel qu’on le retrouvera toujours. On lui suggéra l’idée d’envoyer à Maurepas cette même lettre qu’il venait d’écrire pour Machaut ; il n’y eut que la peine d’en changer l’adresse.16 Peut-être qu’on le déconcertait sans le convaincre ! Mais il n’avait pas la volonté pour défendre ce que son esprit avait conçu.
Le comte de Maurepas accourut du fond de l’exil où il avait été relégué pour des chansons. Ainsi tournait comme en moquerie, dès le début, cette physionomie sévère que Louis XVI entendait donner à son règne. Maurepas, de la famille des Phélippeaux, fils et petit-fils de ministres, secrétaire d’État lui-même à l’âge de seize ans, avait déjà fourni une longue carrière politique sous Louis XV. Il ne semblait point fait pour une disgrâce sous un tel maître, car il était le ministre véritable d’un prince paresseux et ennuyé. Personne ne savait mieux que M. de Maurepas se donner du loisir au sein des affaires, et amuser de plus d’anecdotes et de bons mots le travail du roi. Son esprit leste et sémillant faisait passer l’administration dans la causerie. La monarchie, il est vrai, pouvait être mieux servie que par ce conteur, qui savait faire du gouvernement un passe-temps. Il laissa dépérir la marine ; mais aucun ne se recommanda mieux aux convenances personnelles de Louis XV. De tous les courtisans ministres, il fut le plus frivole et le plus élégant ; cependant il fut disgracié. C’est que la frivolité de Maurepas était si naturelle qu’elle déjouait parfois son ambition. Il n’était point de ces politiques assez forts pour mettre leurs goûts et leurs instincts au service de leur fortune ; il ne ressemblait pas au prince de Kaunitz, dont la futilité réfléchie servait à masquer des desseins profonds ; Maurepas était maîtrisé par la sienne ; il perdait de vue l’ambition pour les bons mots. C’est qu’il y avait dans M. de Maurepas un page de cour sous un habit de secrétaire d’État. Cet esprit si léger qui s’échappait en saillies et qui oubliait tout dès qu’il y avait matière à un couplet, ne tint pas à la tentation d’en faire sur madame de Pompadour elle-même ; on ne saurait garantir si le roi y échappa ; c’était par ce point-là seulement que ce courtisan flexible bravait toute contrainte : il lui fallait, à défaut d’autre, la liberté des épigrammes. Les couplets du comte de Maurepas lui attirèrent une complète disgrâce et un exil de vingt-cinq ans. Il s’en consola comme pouvait le faire un homme de son caractère : il fit des petits vers plus que jamais, joua la comédie dans son château, et chansonna tous ceux qui avaient eu part à sa disgrâce : telle fut sa philosophie. Sa longue retraite et les années ne le rendirent pas plus grave. S’il eut du temps pour méditer, ce ne dut être que sur l’intrigue qui avait amené sa chute. Au reste, le comte de Maurepas, déchu dans la faveur du prince, s’éleva en raison de cette chute dans la faveur du public. Sous cette monarchie tempérée, comme on disait, par des chansons, celles du comte de Maurepas lui étaient comptées comme de l’indépendance.
Le rappel du vieux ministre fut bien accueilli par l’opinion ; on avait travaillé de plus d’un côté à lui aplanir la voie. Le ministère laissé par Louis XV à son successeur l’acceptait sans résistance. Son chef, le duc d’Aiguillon, qui était le neveu de Maurepas, crut se consolider par la rentrée de son oncle ; et il mit à son service toutes les influences dont il disposait. Bien que Maurepas eût penché autrefois vers les philosophes et les parlementaires, il se vit ainsi appuyé par le parti des jésuites et du pouvoir absolu, qui se rencontraient par hasard avec l’opinion. Le chancelier Maupeou, l’abbé Terray, le prince de Soubise, de Boynes, Bertin et la Vrillière, composaient le conseil : c’était de tous les ministères de Louis XV le plus vil et le plus haï : il avait pactisé avec la Dubarry ; on avait à lui reprocher de honteuses banqueroutes, la destruction des parlements et la ruine de la Pologne. Maurepas, à peine installé à Versailles, n’eut rien de plus à cœur, malgré la parenté et les obligations qui le liaient aux ducs d’Aiguillon et de la Vrillière, que de se débarrasser de pareils collègues. La faveur publique qui avait eu part à son rappel lui semblait bonne à conserver. D’ailleurs, le franc esprit de despotisme qui était le cachet du ministère de d’Aiguillon n’était point le fait d’un quasi-philosophe comme Maurepas. Il n’avait ni le goût ni le courage qu’il fallait pour charger ses vieux jours d’une pareille responsabilité : « Je ne veux point, disait-il, être traîné sur la claie pour les affaires de M. de Maupeou. »
Le comte de Maurepas mit en œuvre tout ce qu’il avait d’adresse pour s’emparer de l’esprit du roi ; il y réussit ; il le charma en lui faisant des anecdotes sentimentales sur le Dauphin. On dit que ses goûts frivoles et ses bons mots avaient d’abord choqué Louis XVI ; mais le génie souple de Maurepas se modifia près de lui. Son facile travail, sa clarté d’exposition et ce tour élégant qu’il donnait aux affaires, plurent au petit-fils comme à l’aïeul. Louis XVI était vraiment désireux et pressé d’apprendre ; il croyait se former vite dans les mains habiles de M. de Maurepas. Cet homme si fin avait à côté de ses instincts frivoles une intelligence nette et de l’aptitude au gouvernement : c’était un esprit lumineux, a dit M. de La Fayette, qu’on ne peut suspecter de partialité pour lui.
Le comte de Maurepas, sous le titre modeste de ministre d’État, posséda le crédit d’un premier ministre. Pour se l’assurer mieux, il en sacrifia les apparences ; il n’en prit point les émoluments ; sa simplicité économe plut à Louis XVI. Il travailla sans bruit à écarter tout ce qui pouvait lui faire ombrage ; il acheva de perdre dans l’esprit du roi le duc de Choiseul, et déjoua de ce côté les efforts de la reine. Maurepas, d’autre part, cherchait l’occasion de se délivrer de ses collègues ; il consultait l’opinion, et entretenait la pensée du roi sur un grand acte politique qu’on réclamait énergiquement. Le cri public s’élevait plus haut que jamais contre les ministres de Louis XV, et demandait le rappel de la magistrature qu’ils avaient exilée. M. de Maurepas, par dépit contre le règne précédent et certaines tendances de parti, inclinait vers cette grande mesure : il y était porté par les gens de lettres de son entourage ; il y était poussé enfin par la volonté publique, dont il s’inquiétait fort. Avec un homme du caractère de ce ministre, on ne peut dire au juste quand il prit son parti sur cette sorte de coup d’État. Toujours est-il qu’on le vit renvoyer d’abord le duc d’Aiguillon : espèce de sacrifice qu’il faisait à la reine de l’ennemi personnel du duc de Choiseul ; ses collègues le suivirent de près. La Saint-Barthélemy des ministres, comme on l’appela, fut fêtée par le peuple avec des manifestations sauvages ; on brûla les effigies de l’abbé Terray et du chancelier Maupeou. Le duc d’Aiguillon eut pour successeur au ministère des affaires étrangères le comte de Vergennes, et au ministère de la guerre le maréchal Du Muy. De Boynes, ministre de la marine, fut remplacé par l’intendant Turgot ; on donna les sceaux à Hue de Miromesnil ; enfin Turgot passa de la marine au contrôle général.
Quoique M. de Maurepas eût eu la plus grande part à ces choix, il lui avait fallu compter avec diverses influences ; aussi, le cabinet ne se ressentait-il pas d’un même esprit. Le comte de Vergennes, le maréchal Du Muy, étaient fort loin de Turgot quant aux principes de gouvernement. Le maréchal, recommandable par le caractère, avait été l’ami particulier du Dauphin ; il tenait comme lui aux vieilles traditions. Autorisé de ce souvenir du père, de l’appui des trois tantes, il convenait encore au roi par sa réputation d’honnête homme et sa simplicité de mœurs. Le comte de Vergennes avait les mêmes doctrines politiques ; il avait parcouru la carrière des ambassades, jusqu’au ministère de Choiseul, qui l’avait disgracié. Envoyé en Suède par le duc d’Aiguillon, il en arrivait avec le mérite d’un succès tout récent. On lui attribuait une part dans le coup d’État de Gustave III, qui venait d’abattre le gouvernement du sénat. Il importait assez à la France de relever une couronne alliée et de renverser une faction dévouée aux Russes, pour que l’on pût croire, en effet, qu’elle y avait mis la main. Le comte de Vergennes était resté dans le système des vieilles alliances ; ennemi de Choiseul et du parti autrichien, son élévation fut encore un échec pour la reine. Il venait en aide à Maurepas, en inquiétant doucement Louis XVI sur l’intervention de sa femme dans les affaires du dehors. Mais on accordait à M. de Vergennes plus d’expérience et d’habileté spéciale dans sa carrière que de caractère et de vues pour l’ensemble du gouvernement. Il était habile, en effet, mais il prenait souvent pour de la prudence sa cauteleuse timidité.
L’homme considérable de ce ministère, c’était Turgot ; Maurepas l’avait tiré de l’intendance de Limoges pour le placer d’abord à la marine. Issu d’une ancienne famille de magistrats, Turgot était devenu maître des requêtes, après avoir été prieur de Sorbonne, où il soutint des thèses de théologie avec éclat ; mais il ne se sentait point de vocation pour le sacerdoce ; malgré les instances de sa famille, il abandonna les ordres, et passa de la Sorbonne à l’Encyclopédie ; il avait une ardeur presque égale pour toutes les branches des connaissances humaines, et nourrissait dans la paix de ses études l’ambition d’un savoir universel. C’était un esprit qui, par son étendue et la nature de ses besoins, appartenait à son siècle et à l’école des libres penseurs17 ; c’était aussi une âme généreuse et vraiment passionnée pour le bien. Aucun homme de ce temps n’avait nourri plus que Turgot ces belles espérances de bonheur public qui commençaient à naître, et ne fit de sa vie un usage plus désintéressé. Il se sentait né pour l’étude et pour la retraite ; et cependant il entra, par une vertueuse conséquence de ses principes, dans la vie de l’action et de la pratique. Il avait promené son esprit à travers toutes les sciences, et jamais intendant ne s’appesantit comme lui dans les devoirs de sa charge. Placé par la tournure de son génie sur les hauteurs de la spéculation, c’était par amour pour les hommes, par désir sincère d’être utile, que, lui aussi, il aspirait à descendre. Ce que Turgot fit en dix ans dans sa province a de quoi surprendre ; il est même inouï que, sous Louis XV, dans ce temps de despotisme et d’abus, un intendant ait pu s’attribuer tant de pouvoir et de latitude pour le bien. Il relevait par là en quelque sorte les hommes dubon plaisir ; aux plus mauvais jours de ce règne, quand le temps était si dur pour tout le royaume, Turgot abolissait la corvée, rendait libre la circulation des blés, allégeait les charges publiques et osait afficher le souci des intérêts de tous. Il avait fait de sa province une espèce de Salente18 : c’était un Fénelon à l’œuvre, avec une intelligence plus vive de la réalité, un sens plus fort, une main plus virile. Ses principes étaient nouveaux, surtout pour un administrateur ; mais tel était l’ascendant de son caractère qu’il imposait aux ministres eux-mêmes, et qu’ils laissaient passer ses réformes avec étonnement et respect.
Oui, certes, il n’est rien qui soit plus à l’honneur de Turgot, et d’un effet plus frappant pour le siècle, que cette autorité singulière, que tout ce pouvoir de bien faire exercé librement par un intendant de Louis XV.
Le nom de Turgot fortifiait le ministère près de l’opinion ; mais il est à croire que Maurepas, qui n’avait jeté les yeux sur lui que dans cette vue, entendait bien le laisser à la marine, et limiter là son importance. Turgot, mis en contact avec le roi, put l’entretenir de ce qu’il avait fait pour une province et de ses vues d’administration. Louis XVI en fut touché, et lui donna le contrôle général.19
Les intendants tels que Turgot étaient si rares que l’élite de la société et les écrivains avaient souvent prononcé son nom. Les correspondances du moment en retentissent ; Voltaire écrit du fond de sa retraite : « On dit que nous avons un ministre des finances aussi sage que Sully, aussi éclairé que Colbert.20 » Écoutons-le encore avec sa grâce moqueuse : « Messieurs les Parisiens, je vous demande pardon de vous dire que vous êtes heureux. » Une des femmes qui témoigneront le mieux des impressions de la société, écrit de même en cette circonstance : « On commence à avoir besoin de se taire, pour se recueillir, et pour penser à tout le bien qu’on attend.21 »
Un esprit arrêté dans ses vues, tel que Turgot, ne pouvait manquer d’entrer en lutte ouverte contre le vieux système d’administration. Il appartenait à l’École des économistes, et son ministère devait être la mise en action de leur doctrine : « C’était la première fois, dit l’historien des systèmes économiques, qu’il était donné à la science de rencontrer un ministre disposé à réaliser toutes ses conceptions et à tenter sur le vif toutes ses expériences.22 » Turgot, tout livré à ses travaux d’intendant, trouva du loisir pour aider, par de nombreux écrits, aux progrès de la nouvelle science. L’École alors avait deux chefs, qui différaient sur certains points de la doctrine : Turgot adhéra aux grands principes ; mais pour le reste il prit position entre les deux camps, et y resta indépendant, tout en acceptant Quesnay et Gournay pour ses maîtres. Il resta fidèle aux bases qu’ils avaient établies, et son originalité consiste à embrasser toute la science dont Quesnay et Gournay voyaient seulement leurs côtés de prédilection. Turgot accepta du premier le principe sacramentel du produit net, regardant avec lui l’agriculture comme l’unique source de la richesse sociale, et, en conséquence de ce faux principe, ne voulant admettre d’autre impôt que l’impôt territorial. Turgot tenait plus particulièrement de Gournay, avec qui il avait vécu d’une façon intime, la doctrine de la liberté commerciale, de la concurrence illimitée. Il était ennemi de tout monopole, de toute barrière opposée au travail libre ; il disait comme le marquis d’Argenson : pas trop gouverner ; et il répétait, après Gournay, le mot devenu célèbre : « Laissez faire, laissez passer. »
Les réformes politiques de Turgot n’étaient pas moins arrêtées d’avance que ses plans économiques, et devaient en être le couronnement. On les retrouvera plus loin, dans un de ces Mémoires à l’aide desquels il entreprit de former l’esprit de Louis XVI ; car sa force allait dépendre du caractère personnel du roi.
Le contrôleur général avait à pourvoir d’abord à des nécessités urgentes ; le déficit était permanent, et n’avait point été comblé par le remède honteux des banqueroutes ; c’est ainsi que les finances avaient marché sous Terray. Turgot devait apporter avec lui d’autres secrets ; il avait là, comme en toutes choses, des idées invariablement fixées. Il fit connaître ces plans au roi, lui déclarant qu’il conduirait les finances sans banqueroute, sans emprunts, sans surcroît d’impôt. Une meilleure répartition des taxes, une perception moins vicieuse, des retranchements nombreux dans la dépense, enfin un heureux essor donné aux travaux de l’agriculture et de l’industrie, et qu’il attendait de ses réformes économiques, voilà sur quoi il comptait pour relever les finances de l’État. Le roi, ému de sympathie, pressa les mains de son ministre : « C’est à Votre Majesté personnellement, lui écrivait Turgot, c’est à l’homme honnête, à l’homme juste et bon plutôt qu’au roi que je m’abandonne. Le roi lui assura qu’il ne serait pas trompé.23 » Louis XVI avait refusé le don de joyeux avènement ; Turgot de même fit distribuer aux pauvres 300 mille francs que la ferme générale offrait au ministre à son entrée en charge. La dépense du trésor excédait la recette de 22 millions ; les anticipations montaient à 78 millions, les pensions de l’État n’étaient plus payées depuis quatre ans.
Turgot solda les pensions, et ranima le crédit par cette mesure ; il cassa le bail de trente-neuf ans des domaines royaux, et en fit monter les revenus. Dans le détail laborieux de son administration, des reformes et des innovations bien inspirées se succèdent sans interruption.24 La plus débattue de ces questions était alors celle du commerce des blés ; Machaut en avait rendu la circulation libre entre les provinces. Terray l’avait abolie dans l’intérêt d’une spéculation odieuse dont Louis XV tenait les fils dans ses mains, et qu’on désignait du nom de pacte de famine. Turgot rétablit la liberté du commerce des grains à l’intérieur. Les traces qu’il avait pu saisir dans les papiers de Terray des odieuses manœuvres favorisées par ces entraves durent l’affermir encore dans ses principes favoris.
Mais la grande question qui restait pendante était celle des parlements. Il y avait sur ce point deux partis à la cour et dans le ministère ; le public était presque unanime, et se déclarait très haut pour les anciens magistrats ; le comte de Maurepas étudiait la cour, et ménageait les dispositions du roi. Il se donnait auprès de l’opinion comme un partisan du rappel. Il alla se montrer à l’Opéra, et y fut applaudi ; puis il accourut à Versailles, et fit passer son petit triomphe pour le symptôme éclatant d’un sentiment général. Louis XVI était prévenu contre l’esprit des parlements, par les instructions du Dauphin son père et de ses gouverneurs. Il fut ébranlé par ces manifestations publiques dont on l’entretenait ; la jeune reine agissait sur lui dans ce sens, poussée par Choiseul, l’allié de la magistrature. Au sein de la famille royale, le rappel avait pour adversaires les tantes du roi, qui étaient à la merci du parti dévot,25 et M. le comte de Provence ; les premiers pas de ce prince dans la vie politique ne faisaient pas prévoir la position qu’il prendrait plus tard. Monsieur, voué dès le jeune âge à la vie de cabinet, homme d’études un peu frivole, mais réfléchi dans sa conduite, rédigea ou autorisa de son nom un Mémoire sur la question des parlements, et dont cette phrase résume l’esprit : « Le parlement actuel a remis sur la tête du roi la couronne que le parlement en exil lui avait ôtée, et M. de Maupeou, que vous avez exilé, a fait gagner au roi le procès que les rois ses aïeux soutenaient contre les parlements depuis deux siècles ; le procès était jugé, et vous, mon frère, vous cassez le jugement pour recommencer la procédure. » Les princes de Condé, représentants de l’esprit militaire et des idées de monarchie absolue, se prononçaient aussi contre le parlement. De l’autre part venaient la reine et le jeune comte d’Artois, frère du roi. De même que le comte de Provence, ce prince débuta par des idées dont il dévia beaucoup dans la suite : les deux frères changèrent de rôles avec le temps. Ce fut le comte d’Artois qui se tourna d’abord vers la cause parlementaire, et montra du goût pour les philosophes, par esprit de mode et par le crédit que la reine avait sur lui. Le parlement avait des alliés plus sûrs dans les princes de la maison d’Orléans, qui tenaient de tradition au parti de la magistrature, et qui marchaient plus près de l’opinion que leurs aînés. Mais le plus emporté de tous dans ce débat était le prince de Conti, dont la bruyante ambition y cherchait un point d’appui pour harceler le gouvernement.
Le ministère était partagé comme la cour : le garde des sceaux, de Miromesnil, venait de l’ancienne magistrature ; c’était un homme de capacité médiocre et sans caractère, complaisant ridicule de Maurepas, dont il avait gagné les bonnes grâces à jouer les rôles de Crispin dans son château. Il obéissait comme Sartines26 à l’impulsion du premier ministre, et travaillait plus à découvert que les autres au rappel. MM. de Vergennes, Du Muy, La Vrillière, par fidélité au pouvoir absolu, se prononcèrent contre le projet.
Turgot prit parti sur cette question avec toute la solidité de son caractère ; il ne courtisa pas la popularité. Sorti de la magistrature, il la connaissait à fond, et vit bien qu’il aurait en elle une ennemie opiniâtre. Il savait que penser de l’esprit de cette corporation jalouse, de ses préjugés égoïstes, de sa stérile et acariâtre opposition. Il comprit que son plan de réforme échouerait contre les remontrances, les refus d’enregistrement, et il se prononça contre le retour des parlements. Tous les moyens qu’avisait Maurepas ou que suggérait Miromesnil27 pour placer l’autorité royale à l’abri des atteintes de l’ordre judiciaire, tous ces palliatifs paraissaient vains et chimériques à Turgot ; il répondait que les traditions seraient les plus fortes, « que l’esprit de corporation est celui dont il est le plus difficile d’avoir raison, et qu’il n’y a que les corps pour se montrer ingrats sans scrupule, parce tous les éléments qui les composent sont sans responsabilité.28 » Le rôle politique dont l’ordre judiciaire s’était emparé faussait à ses yeux tous les principes de gouvernement. Turgot fit entendre au roi que tous ses projets allaient être compromis : « Je vous soutiendrai », lui répondit Louis XVI, et il céda à Maurepas contre son sentiment personnel.
Un historien attribue au vieux ministre, en cette affaire, des raisons de conduite singulièrement graves et désintéressées pour lui : « Un fait étonnant, mais certain, dit-il, c’est que le comte de Maurepas avait cru voir dans le monarque, son élève, un caractère trop absolu et trop inflexible, et qu’il se hâtait de profiter de son inexpérience pour lui ôter les moyens de régner despotiquement.29 » Ces vues profondes n’ont pas frappé beaucoup les contemporains, qui s’accordent à nous représenter Maurepas comme bien peu soucieux de l’avenir de l’État. Louis XVI, il est vrai, avait été élevé dans les maximes de la monarchie absolue, mais il n’avait de rude que les apparences, et Maurepas connaissait déjà par expérience la force réelle de sa volonté.
Une circulaire du 21 octobre 1774 rappela les magistrats exilés ; ils comptaient si bien sur le succès de leur cause qu’on en vit à l’avance se présenter en costume chez le garde des sceaux. Il fut décidé que le roi tiendrait un lit de justice, pour réintégrer l’ancien parlement. La solennité se fit à Paris, le 12 novembre 1774 ; Louis XVI parla en maître qui commande avant de pardonner : « Le roi notre aïeul, dit-il, forcé par votre résistance à ses ordres réitérés, a fait ce que le maintien de son autorité et l’obligation de rendre la justice à ses peuples exigeaient de sa sagesse ; je vous rappelle aujourd’hui à des fonctions que vous n’auriez jamais dû quitter ; sentez le prix de mes bontés et ne les oubliez jamais. »
Après cette allocution vinrent les édits qui devaient garantir l’autorité royale de toute nouvelle atteinte. Le parlement gardait son droit des remontrances, mais à condition de ne les renouveler qu’après l’enregistrement. D’autres prescriptions réglaient ses délibérations, et soumettaient son action à une discipline sévère. C’étaient à peu de choses près les dispositions de Maupeou, comme il a été remarqué30 : « On rétablissait l’ancien parlement, en le soumettant au régime du nouveau. »
Quant à ce dernier, il était voué à un triste rôle dans cette révolution judiciaire ; la docilité dont il avait fait preuve lui avait attiré la haine et le mépris. Le ridicule aussi s’était attaché à ce corps, et il n’est sorte d’affronts et d’avanies que ses membres n’eussent essuyés depuis quatre ans. Le gouvernement sembla prendre à tâche de les railler aussi ; peu de jours avant leur renvoi, le roi répondait à leurs alarmes : « Qu’il était surpris que sa chambre des vacations lui fît des remontrances sur des bruits populaires. » Quant à Maurepas, il y avait pour lui, dans cette situation où tant de gens se trouvaient molestés, une trop belle occasion de sarcasmes ; il n’y put résister. Les commissaires du nouveau parlement étant allés se plaindre à Versailles qu’ils ne pouvaient plus se rendre aux audiences sans être hués sur leur passage, Maurepas prit un air compatissant, et leur dit d’y aller en domino.
Ce renversement de l’œuvre de Maupeou, si fêté à Paris et dans les provinces, préjudicia pourtant sur quelques points à la bonne administration de la justice ; l’ancienne magistrature releva les abus que Maupeou avait atténués : la vénalité des charges, les frais ruineux de la procédure, l’incommode circonscription des ressorts judiciaires, avantages réels qui n’avaient pu faire passer l’acte despotique du chancelier.
On procéda de toutes parts au rétablissement des parlements de province, où les magistrats exclus ne laissèrent point de regrets. La Bretagne surtout, si entêtée de ses vieilles franchises, les abreuva d’affronts jusqu’à la fin. Le parlement Maupeou reprit à Paris son titre de grand conseil ; on le tint en réserve comme un instrument docile, comme une menace toujours suspendue sur la tête de la magistrature.
Mais on put voir, dès les premiers jours, que cette compagnie n’était ni bien touchée de reconnaissance, ni résignée à ses nouvelles attributions. À peine furent-elles replacées sur les fleurs de lis que les chambres assemblées protestèrent contre le lit de justice et les édits.31 Il était aisé de prévoir que ce corps tout triomphant n’acquiescerait pas par son silence à cette sorte de correction qu’on lui infligeait en le rappelant. Ses orateurs, dans leurs réponses, ne rendirent grâce au monarque que d’avoir cédé aux vœux de la nation ; ce premier conflit dura plusieurs mois. Il tardait moins à messieurs du parlement de reprendre leurs travaux judiciaires que de ressaisir leur rôle bruyant, d’occuper le public de leur importance. La magistrature retrouva ses alliés habituels dans le duc d’Orléans et le prince de Conti. Monsieur lui-même, qui semble déjà moins hostile au parlement depuis sa victoire, se porta garant auprès de lui des bonnes intentions de la cour.32
La magistrature eut le dernier mot dans ces premières taquineries. Maurepas, qui n’était déconcerté par rien, tourna l’échec en plaisanterie ; il fit entendre à Louis XVI que l’assemblée n’avait répliqué que pour la forme, et « que ce ne serait qu’un jeu pour un ministre comme lui de se faire obéir.33 »
Turgot poursuivait le grand travail de ses réformes, sans s’arrêter aux obstacles qui encombraient son chemin ; car les intérêts blessés formaient une ligue déjà forte et allaient devenir d’ardentes passions. On s’agitait autour de lui. Il avait supprimé des emplois, il avait tari la source de beaucoup de profits,34 et l’on savait sa ferme résolution de poursuivre ; mille gens menacés se mettaient en garde, et se plaignaient à grand bruit. Les enthousiastes de sa doctrine, qu’il associait trop à ses travaux, allaient colporter à l’avance l’annonce de ses projets, ou les chimères qu’ils pouvaient y mêler. L’esprit tranchant et absolu de la secte n’était pas propre à aplanir la route aux innovations. Turgot sentait bien qu’un peu de ridicule s’attachait à ses amis, qu’on appelait les frères de la doctrine économique, et qu’il en pouvait rejaillir quelque chose sur sa position : aussi voit-on qu’il cherche à les écarter avec ménagement. « La vérité, disait-il, n’est pas si facile à atteindre qu’on y puisse aller en troupe.35 » « Ils avaient, a-t-on dit, la folie de parler en prophètes, quand ils avaient le mérite de penser en bons citoyens.36 »
Un des projets que préparait le ministre donnait surtout l’éveil à de nombreux intérêts : c’était l’édit d’abolition des jurandes37 et des maîtrises : ce projet apportait d’avance un puissant renfort à ses ennemis, qui tentèrent de le faire tomber.
La mesure qui concernait le commerce des grains avait passé d’abord sans vive résistance ; quoique la récolte eût été mauvaise, Turgot tenta l’expérience, et la libre circulation prévint le renchérissement qu’on avait redouté. Confiant jusqu’au bout dans la vertu du principe, il fit vendre les blés dont l’État avait fait provision. Ce système de libre circulation entre les provinces était inattaquable ; mais, en dépit de l’expérience, il soulevait encore des controverses ; un des écrits les plus remarqués sur cette matière venait d’un banquier riche et considéré, M. Necker. C’était une guerre peu franche faite à Turgot. L’édit n’autorisait que la circulation à l’intérieur, tandis que M. Necker portait la controverse sur un autre terrain : le droit de libre exportation au dehors. C’était prêter, par anticipation, au ministre, un projet prématuré, que ses principes sans doute ne contredisaient pas, mais qui donnait plus de prise à son antagoniste ; l’ouvrage du reste, venait moins dans l’intérêt d’une idée que dans l’intérêt d’une position. Les amis de Turgot usèrent de vives représailles, et se soulevèrent contre cette méprise calculée.38
Mais le contrôleur général eut bientôt à faire face à d’autres attaques : des troubles populaires éclatèrent à propos des blés dans plusieurs provinces et aux portes de Paris. Il n’y avait point eu de symptôme de disette qui y préparât. Les subsistances ne dépassaient guère le taux ordinaire, surtout dans les contrées où se faisaient les attroupements. Les agents de ces désordres s’inquiétaient peu de paraître en affamés ; ils couraient les campagnes et répandaient sur les chemins ou dans les rivières tout ce qu’ils trouvaient de grains à piller. Louis XVI crut apaiser ces troubles en se montrant aux bandes qui entouraient Versailles ; il leur parla de son balcon ; il accorda à leurs cris une réduction du pain ; mais Turgot ordonna que le taux fût maintenu, et le fit publier. Louis XVI s’abandonnait au caractère plus encore qu’aux idées de son ministre ; il prenait ses leçons en hésitant, et n’avait pas assez de foi à la doctrine pour ne pas douter en présence des faits ; Turgot, qui ne doutait pas, « ne voulait point faire reculer le principe », disait-il ; il croyait voir dans ces désordres la main cachée de ses ennemis, et il n’hésita pas devant une répression sévère. Il était fort mal secondé, dans cette crise, par ses divers collègues : il soupçonna même Sartines et le lieutenant de police Lenoir de favoriser le complot, et il ne balança pas à renvoyer le dernier. La conduite du parlement lui fut ouvertement hostile ; ce corps fit à peu près cause commune avec l’émeute, et il fallut un lit de justice pour le réduire au silence.39 Le contrôleur général, muni des pleins pouvoirs du roi, mit les troupes à la poursuite des fuyards. Au bout de quelques jours le calme fut rétabli.
La source de ces désordres reste difficile à pénétrer. À bien des mouvements du même genre, il n’y a point à chercher d’autre origine que la turbulence naturelle et les terreurs paniques des basses classes, ou d’obscures manœuvres de l’intérêt privé. Mais l’émeute qui traversa Turgot prend, dans tous les témoignages contemporains, le caractère d’une machination politique.40 Il y avait dans cette fermentation un plan des mieux concertés ; c’était le coup d’un ennemi puissant. Maintenant quelle était la main cachée qui faisait mouvoir ces attroupements ? Rien ne fut éclairci à cet égard.
La diversité des soupçons prouverait le vague et l’incertitude de l’accusation ; chaque parti, chaque passion eut la sienne : on imputa ces troubles aux Anglais, au duc de Choiseul, aux anciens fournisseurs des blés. Turgot et son entourage en accusèrent tout haut le prince de Conti et les parlementaires. Mais il était plus difficile d’apporter des preuves que d’élever des soupçons, accrédités même par la vraisemblance, et des preuves patentes manquèrent à Turgot ; son crédit en souffrit un peu auprès de Louis XVI,41 et aussi peut-être des perplexités de conscience qui avaient agité le roi pendant la crise : « N’avons-nous rien à nous reprocher, disait-il, dans les mesures que nous prenons ? » La popularité de Turgot en resta également ébranlée ; dès la première année de son ministère, il lui avait fallu recourir à la force, au risque de se montrer rigoureux, comme un ministre endurci au gouvernement. Il mit un certain faste, si on peut le dire, dans les condamnations qui suivirent l’événement ; on pendit deux perturbateurs à une potence de quarante pieds. C’était une pensée d’humanité qui avait déterminé ce supplice : on donnait plus d’éclat au châtiment pour n’avoir pas à le multiplier ; mais le peuple, par malheur, n’y vit pas l’intention morale.
Turgot appartient par le caractère comme par l’esprit à la mâle famille des réformateurs ; quoiqu’il fût d’une bonté de cœur infinie, il aimait les principes à ce point que pour les mener à bien, l’intérêt de quelques individus le troublait peu. Il avait à ses idées économiques une foi d’apôtre. On put voir, dans une circonstance qui suivit de près l’émeute des blés, que la confiance de Turgot dans ses doctrines n’avait point faibli : ce fut à l’occasion du sacre de Louis XVI. Cette solennité attirait à Reims une grande affluence, et le gouvernement y pourvoyait d’habitude aux subsistances. Turgot repoussa cette pratique ; il abolit l’octroi et la compagnie privilégiée des marchands de Reims, et se confia pour l’approvisionnement à l’action libre du commerce ; le résultat justifia pleinement son attente.





























