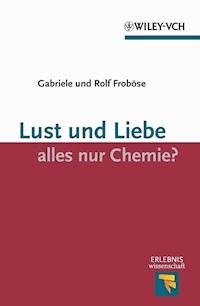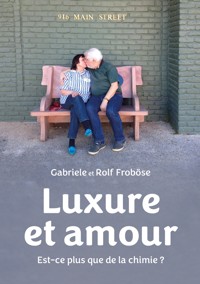
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
Les philosophes y ont réfléchi, les poètes ont écrit à leur sujet et les musiciens les ont chantés. L'amour, le désir et la passion touchent à un moment ou à un autre la vie de chacun – mais ils sont peu compris et constituent certains des plus anciens mystères de l'humanité. Pourquoi les gens tombent-ils amoureux? « Luxure et amour : est-ce plus que de la chimie ? » apporte des réponses à certaines de ces questions à travers les yeux de la science. Ce livre adopte une approche légère et divertissante pour expliquer les connaissances scientifiques actuelles sur les raisons pour lesquelles les gens sont attirés les uns par les autres, des premiers moments de la rencontre à la façon dont les émotions changent dans un partenariat durable. Le livre couvre les recherches dans les domaines de la chimie, de la biochimie, de la neurologie, de la psychiatrie, de la psychologie, de la physique et de la médecine tout en utilisant l'histoire d'amour d'un couple fictif pour emmener le lecteur dans un voyage expliquant la science. Ce livre captivant et inhabituel est idéal pour toute personne intéressée par la science derrière l'amour, le désir et la passion.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Préface
L’amour est sans doute aussi vieux que l’humanité. C’est pourquoi il est un fil conducteur dans d’innombrables livres, de l’Antiquité à la littérature moderne. Il en va de même dans les arts visuels, où le « thème n°1 » occupe également une place centrale. Le désir et la passion ont également inspiré la musique, de la chanson médiévale de Minne à la chanson populaire d’aujourd’hui en passant par la chanson française et les Beatles.
L’amour est néanmoins un phénomène mal compris. On le décrit en des termes tels que « indescriptiblement beau », « mystérieux » ou « excitant ». Mais de quoi s’agit-il ?
« L’amour n’est qu’un mot », a déclaré l’écrivain autrichien Johannes Mario Simmel, reflétant peut-être son expérience personnelle. Un peu plus prometteur, Henry Miller l’a qualifié de « boogie-woogie des émotions ».
Les « poèmes en prose » de l’écrivaine allemande Margot Bickel relatent le désir de tous les êtres humains de bonheur, de paix et d’unité. Sur la nature de l’amour, elle écrit :
« Qu’est-ce que l’amour ?
Peut-être une compréhension silencieuse,
un questionnement patient, une persévérance compréhensive,
une tendre solidarité, une défense fiable de l’autre,
une recherche commune, des arguments conciliants,
être là et y rester,
et de temps en temps des roses et un baiser ?
Qu’est-ce que l’amour ?
Je ne connais que des facettes
qui me donnent une idée
de l’humilité et de la majesté de l’amour.
Qu’est-ce que l’amour ?
Aimons et trouvons la réponse. »
En contraste avec Margot Bickel qui retient la réponse, son compatriote allemand Andreas Mackler en fournit de nombreuses. Dans son livre « Was ist Liebe…? 1 001 Citations geben 1 001 Antworten », il fournit une variété écrasante de déclarations, d’hypothèses, de revendications et d’affirmations classées autour du thème de l’amour.
« L’amour est de la chimie ! » Lorsque les auteurs font cette affirmation audacieuse, il ne s’agit pas « d’ajouter une 1 002e thèse sur l’amour au catalogue des interprétations. Bien que cette définition ne soit pas le fruit du travail d’un philosophe ou d’un génie littéraire, elle ne se veut pas, non plus, une déclaration provocatrice flottant dans l’air. Elle est plutôt le résumé de recherches interdisciplinaires modernes impliquant des chimistes, des experts médicaux, des chercheurs sur le cerveau, des spécialistes des hormones et des biochimistes.
Ensemble, ils ont réussi à comprendre progressivement les processus de la vie humaine et à interpréter les fonctions sous-jacentes en termes de réactions chimiques.
Nous ne voulons pas ainsi réduire la vie à la « chimie pure ». D’un autre côté, nous devons souligner que la chimie n’est pas une invention humaine, mais que tout dans la nature est basé sur elle. Cela vaut pour la poussière du désert du Sahara comme pour le plancton des océans et pour le cristal de roche comme pour les plantes, les animaux et les humains. Même si nous savourons un délicieux repas, éprouvons de la joie ou tombons amoureux, la chimie tire les ficelles en coulisses.
Nous vous invitons à nous rejoindre, ainsi que notre couple fictif Bianca et Michael, dans un voyage fantastique à travers la chimie des sens, qui gouverne l’amour, le désir et la passion, et qui rend ainsi la vie digne d’être vécue.
Gabriele et Dr. Rolf Froboese
Wasserburg am Inn (Allemagne), août 2024
CHAPITRE 1
Les mystères des montagnes russes émotionnelles
Les amoureux ferment les yeux lorsqu’ils s’embrassent,
car ils veulent voir avec leur cœur.
Daphnée du Maurier (écrivain, 1907-1989)
1. UNE JOURNÉE DANS LA VIE DE BIANCA ET MICHAEL
Michael n’est-il jamais arrivé aussi tôt à un aéroport ? Aujourd’hui est un jour très spécial. D’un rapide coup d’œil à l’écran, il découvre que le vol transatlantique qu’il attend arrivera à la porte B14 dans une heure.
À bord de ce vol se trouve Bianca, avec qui il est fiancé depuis six mois. Bianca, étudiante en médecine, a passé une grande partie de ses vacances d’été chez des proches aux États-Unis, où elle a fait un stage dans un hôpital, et elle a dû vivre de nombreuses expériences intéressantes. Pour Michael, en revanche, ingénieur informatique pour une entreprise européenne d’électronique, la séparation a semblé durer une éternité. Bien qu’il soit toujours occupé, il déteste penser aux longs week-ends passés seul.
« Eh bien, dans ce cas, j’aurais pu y aller doucement », se dit-il, « mais peu importe, mieux vaut être tôt à l’aéroport que tard ». L’idée de rester coincé dans les embouteillages, alors que Bianca, valises à la main, le cherche peut-être en vain, le met mal à l’aise.
En se promenant dans la zone des arrivées, Michael vérifie une dernière fois quelle sortie Bianca prendra en venant de B14. Il se rend compte que sa tension intérieure se relâche peu à peu et laisse place à une joie profondément ressentie. Pour passer le temps, il s’assoit dans le café appelé « Zeppelin », ce qui lui permet de voir directement le moniteur affichant les arrivées.
« Je prendrai un sandwich au poulet et un café », dit-il au serveur et il prend un journal. Il parcourt les gros titres, mais ne fait que sauter les articles en diagonale. Il a du mal à se concentrer aujourd’hui. Seul un article sur San Francisco retient son attention.
« Ses parents vivent à Monterey », se souvient-il. « La connaissant, il ne s’est pas contenté de voir les photos du Golden Gate Bridge.
Pendant que Michael est occupé à manger, le moniteur met à jour les informations sur les « arrivées ». L’avion arrive un peu plus tôt que prévu et atterrira dans quelques minutes, se rend-il compte. Nerveusement, il plie le journal et fait signe au serveur. Après avoir payé la note, il se dirige directement vers la sortie.
Michael observe avec enthousiasme la porte coulissante s’ouvrir et se fermer à intervalles rapprochés. Des touristes bronzés, lourdement chargés de valises et de sacs, se frayent un chemin à travers la foule qui attend. Des hommes d’affaires avec des mallettes se précipitent devant lui, tandis qu’une Japonaise est bouleversée, apparemment à la recherche de quelqu’un, et qu’un groupe de trois Arabes discutent tranquillement. Michael ne remarque que marginalement ces silhouettes, comme il le ferait pour les figurants d’un film.
Soudain, son expression se détend – Bianca entre par la porte. Elle le repère immédiatement, laisse le chariot avec la valise derrière elle et court vers lui. Sans voix, ils se serrent dans les bras l’un de l’autre. Lorsqu’ils s’embrassent, Bianca a les larmes aux yeux. Michael, remarquant l’odeur familière de son corps, n’a qu’une pensée en tête : « Nous sommes faits l’un pour l’autre ! »
Cette courte scène de la vie de deux jeunes gens devrait être familière à beaucoup d’entre nous. L’inquiétude, la tension, l’excitation, le désir combiné, puis la joie illimitée après la rencontre – qui n’a pas vécu ces montagnes russes d’émotions dans des situations similaires ?
2. POURQUOI NOTRE CERVEAU PRODUIT DES « PAPILLONS »
Figure 1. Hippocrate.
Même si ces deux-là peuvent avoir l’impression que le centre de leur amour se situe dans le cœur, en réalité, c’est seulement le cerveau qui est responsable des battements du cœur et des « papillons » dans le ventre. « Nous ne pensons pas avec le cœur, mais avec le cerveau », affirmait vers 400 av. J.-C. le médecin grec Hippocrate, qui vivait sur l’île de Kos. Mais il était très en avance sur son temps (figure 1). Même si l’organe que les Grecs appelaient « en kephale » (situé dans la tête) fascinait l’humanité depuis les débuts, il a fallu un long chemin pour comprendre que seul le cerveau est la source de nos pensées, de nos sentiments, de nos sensations et finalement de notre conscience.
Même nos ancêtres de la préhistoire devaient se demander d’où venait et où se trouvait la conscience. Ainsi, les peuples des cultures anciennes voyaient la tête comme la demeure des mauvais esprits. Comme nous le savons d’après des squelettes retrouvés à l’époque, certains peuples de cette époque avaient des trous creusés dans leur crâne – apparemment dans le but de guérir des maladies comme « l’obsession », bien que le succès ait dû être douteux.
Les anatomistes grecs comme Anaxagore ont cherché à localiser l’esprit dans le corps humain et pensaient que les cavités du cerveau contenaient le liquide qui représentait le souffle de l’esprit. Vers 500 av. J.-C., le Grec Alcméon de Crotone a réalisé des coupes d’animaux et a découvert que les nerfs connectaient les organes sensoriels au cerveau. Il en a conclu que le cerveau contenait le centre de la perception sensorielle et de la pensée. Cependant, il considérait le cerveau comme une glande qui sécrète des pensées comme les glandes lacrymales produisent des larmes.
Les anciens Égyptiens ont également relié les processus de pensée humaine au cerveau. Hérophile (335 av. J.-C.) et Érasistrate (300 av. J.-C.) ont été les premiers à briser le tabou interdisant les dissections de corps humains. Ils ont découvert que les personnes dont certains nerfs étaient coupés ne pouvaient plus voir. Ils ont ainsi développé le concept d’un système interconnecté dont le cerveau était le centre. Pour eux, le cerveau était le siège de l’âme et le centre de commande de tous les processus de pensée.
Le médecin romain Claude Galène a eu l’occasion de recueillir des informations auprès de nombreux gladiateurs blessés. Grâce à ces travaux, il a contribué à établir le concept développé par les Égyptiens selon lequel le cerveau est le centre de la pensée et de la mémoire humaines. Aristote, en revanche, avait des opinions très différentes. Contrairement à Hippocrate, il insistait sur l’idée – toujours privilégiée par les romantiques – que les êtres humains pensent avec leur cœur. Finalement, le modèle des chambres d’Anaxagore, qui a été amélioré au fil des siècles, est resté victorieux. Le philosophe médiéval en a fait un modèle très vivant, dans lequel la première chambre du cerveau sert à la perception et à la perspicacité. La deuxième chambre, selon le modèle, est destinée à la connaissance et au jugement, tandis que la troisième chambre est chargée d’enregistrer les résultats des deux chambres précédentes.
LÉONARD DE VINCI :ARTISTE ET CHERCHEUR
Lorsque Léonard de Vinci naît en 1452, l’Italie est sur le point de sortir du Moyen-Âge. L’Italie, et Florence en particulier, se trouve au cœur de la vie intellectuelle qui s’éveille à la Renaissance. Cette évolution historique, qui débute dans les cercles érudits des écrivains humanistes, est clairement liée aux progrès des sciences, aux changements dans le monde clérical et à l’émergence des structures économiques.
Figure 2. Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci (figure 2) est le fils d’un notaire respecté. Son père reconnaît très tôt le talent hors du commun de son fils et le soutient par tous les moyens dont il dispose. Ainsi, le jeune Léonard arrive à l’âge de 15 ans dans l’atelier du maître florentin Verrocchio et en 1472, à seulement 20 ans, il s’est déjà fait un nom parmi les peintres de la ville.
A partir de 1500 environ, Léonard de Vinci se consacre principalement à des études techniques et scientifiques. Dans d’innombrables dessins très précis de muscles, d’os et de cerveaux, il a essayé de retrouver les lois de la vie et de les combiner dans une cosmologie incluant tous les phénomènes de la nature.
Aux alentours de 1490, le génie polyvalent de la Renaissance, Léonard de Vinci, a déjà dressé une « carte de l’esprit » préliminaire, qui associait différentes fonctions mentales à diverses zones du cerveau divisées en trois parties.
Bien que les croquis du cerveau de Léonard n’aient aujourd’hui qu’un intérêt historique, ils laissent la place à une image beaucoup plus raffinée du cerveau et en dépit de ses fonctions, notre organe le plus intime n’a pas encore livré beaucoup de ses secrets. Aujourd’hui encore, de nombreux aspects du fonctionnement du cerveau apparaissent comme des points blancs sur la carte des connaissances scientifiques.
Le philosophe français René Descartes (1596-1650) avait une vision beaucoup plus technique, comparant le cerveau à une sorte de machine. Il imaginait qu’une substance contenue dans les enroulements du cerveau, qu’il appelait « pneuma », était mise sous pression par l’excitation provenant des organes sensoriels et dirigée vers les nerfs tubulaires par la glande pinéale. Ainsi, le pneuma se dirigerait vers les muscles et les ferait bouger.
Franz Josef Gall (1758-1828) a ému ses contemporains en affirmant que certaines actions du cerveau peuvent être ressenties à travers le crâne. Mais seuls Paul Broca (1824-1880) et Carl Wernicke (1848-1905) ont fourni des preuves scientifiques montrant que les fonctions cérébrales peuvent être attribuées à des régions spécifiques. Pour cela, les chercheurs ont étudié un certain nombre de patients souffrant de troubles du langage. Entre 1900 et 1920, Cécile et Oskar Vogt, en collaboration avec Korbinian Brodman, ont mené ce travail à son terme et ont dessiné les premières cartes « architecturales » détaillées du cortex.
2.1 Cartographier le cerveau, c’est comme décoder le génome
Alors que les premiers penseurs pensaient que des processus complexes comme l’apprentissage ou la mémoire pouvaient être confinés à une zone particulière du cerveau, les scientifiques d’aujourd’hui supposent que chaque activité cérébrale implique des groupes de cellules variées, certes éloignées dans l’espace, mais reliées par des fibres nerveuses. Des chercheurs dirigés par Karl Zilles au Centre de recherche de Jülich (Allemagne) se sont donné pour tâche de localiser ces nœuds et réseaux. Leur objectif ultime – la cartographie complète de toutes les fonctions cérébrales – est extrêmement ambitieux et pourrait être comparé au décodage du génome humain. Il devient déjà évident que les résultats de ces recherches soulèveront une multitude de nouvelles questions, qui occuperont des générations de scientifiques.
Il ne fait aucun doute que le cerveau est notre commande centrale qui gouverne toutes les fonctions corporelles. Cela s’applique non seulement aux modèles comportementaux simples comme manger, dormir, boire et réguler la chaleur, mais inclut les capacités les plus développées de l’esprit humain comme son don pour la culture, la musique, l’art, la science et le langage. Mais ce n’est que récemment que les chercheurs ont obtenu des informations sur les processus moléculaires du cerveau et ont décrypté les premiers éléments constitutifs et processus d’une chimie jusqu’alors inconnue qui contrôle tous nos processus de pensée – qu’ils soient conscients ou inconscients – et donc tout notre monde émotionnel, y compris l’amour. Lorsque Bianca et Michael ont couru l’un vers l’autre à l’aéroport, lorsqu’ils se sont serrés dans les bras et se sont fait des câlins, ces événements ont déclenché toute une cascade de réactions chimiques dans leurs cerveaux.
2.2 L’univers dans la tête de Bianca et Michael
Pourtant, il ne faut pas imaginer le cerveau de nos protagonistes comme un simple réacteur chimique. Car le cerveau serait complètement insensible s’il n’était pas relié à l’ensemble du corps humain par un réseau de fils d’une complexité inimaginable. Un maillage d’environ 380 000 fibres nerveuses, qui couvriraient la distance jusqu’à la Lune si elles étaient alignées bout à bout, assure le flux fluide d’informations entre le centre de commande et toutes les autres zones du corps humain.
Cela peut paraître incroyable, mais le matériel de notre tête se compose d’environ 100 milliards de cellules nerveuses, ce qui est comparable au nombre d’étoiles de la Voie lactée. Si l’on calculait le nombre de connexions théoriques possibles entre ces cellules, le résultat serait absolument ahurissant, car il existe plus de possibilités que d’atomes dans l’univers entier !
Werner Stangl, professeur à l’Institut de pédagogie et de psychologie de l’Université Johannes Kepler de Linz en Autriche, va encore plus loin et visualise ainsi ce nombre incroyablement élevé : « Si le cerveau contient au moins 15 milliards de cellules, leurs possibilités de connexion pourraient théoriquement stocker 210 milliards d’informations. Si nous voulions écrire ce nombre à raison d’un chiffre par seconde, cela nous prendrait 90 ans. »
Cette architecture unique permet au cerveau de faire plus que simplement représenter les informations qu’il acquiert. Contrairement à un appareil photo ou à un magnétophone, il dispose de moyens ingénieux de réduction des données. En d’autres termes, le cerveau sépare les données inutiles en interprétant les signaux enregistrés du monde extérieur en quelques fractions de seconde et en les additionnant pour former un monde personnalisé. Alors que Michael attendait Bianca à l’aéroport, son cerveau a reçu un million de fois plus d’informations que ce que sa conscience pouvait traiter.
Le cerveau vieillissant ne perd qu’un petit nombre de cellules
Selon le professeur Werner Stangl, nous perdons chaque jour entre 1 000 et 10 000 cellules cérébrales. « Même si l’on suppose qu’une personne perd chaque jour 10 000 de son réservoir initial de 15 milliards de cellules, il faudrait qu’elle atteigne l’âge de 410 ans pour perdre seulement 10 pour cent de son cerveau », calcule-t-il. Ces calculs montrent que la capacité du cerveau ne peut pas être le facteur limitant si les capacités de mémoire diminuent avec l’âge. Les raisons de ce déclin sont généralement à rechercher dans le manque d’entraî-nement. Lorsque les personnes ne sont plus sollicitées par leur environnement et leur vie professionnelle, lorsqu’elles n’ont plus besoin d’apprendre et que les exigences intellectuelles sont réduites, elles doivent prendre des mesures elles-mêmes et entraîner leur cerveau. Seule l’activité intellectuelle peut garantir la formation de nouveaux modèles et structures cérébrales. De cette façon, les capacités de réflexion et de mémoire peuvent non seulement être conservées, mais même améliorées avec l’âge, explique Stangl.
Pour mieux comprendre ce processus remarquable, qu’aucun ordinateur ne peut égaler, nous allons examiner de plus près le cerveau humain. Si l’on considère la moyenne statistique, le cerveau de Bianca et de Michael pèse environ 1 245 grammes et celui de Michael 1 375 grammes. La plus grande partie est le cerveau, qui a la taille d’un pamplemousse. Il se compose de deux moitiés différentes, les hémisphères gauche et droit, qui sont, entre autres, responsables des fonctions physiques de la moitié du corps située du côté opposé. Les hémisphères sont recouverts par les multiples plis et replis du cortex cérébral. Le cortex nous permet d’organiser, de mémoriser, de comprendre, de communiquer et d’être créatifs, d’inventer et d’évaluer les choses. Mais la partie la plus complexe et la plus remarquable du cerveau est l’hypothalamus, de la taille d’un petit pois, le « cerveau » du cerveau, pour ainsi dire. Il contrôle les besoins de base comme manger, boire, dormir, mais aussi la température corporelle, le pouls, les hormones et la sexualité. Par une combinaison de messages électriques et chétrucaux, l’hypothalamus contrôle également l’hypophyse. Cette dernière est la glande la plus importante de notre station de contrôle centrale et contrôle notre corps à l’aide d’hormones – des messagers chimiques qui atteignent leurs cellules cibles via la circulation sanguine (voir chapitre 5).
NOTRE CERVEAU EN UN COUP D’ŒIL
En gros, le cerveau humain peut être divisé en cinq zones : le tronc cérébral, le cervelet, le système limbique, le cerveau et les lobes du cortex.
Le tronc cérébral
Figure 3. Le cerveau humain.
C’est la partie la plus ancienne du cerveau. Elle s’est développée il y a plus de 500 millions d’années. Comme elle ressemble au cerveau complet d’un reptile, on l’appelle aussi cerveau reptilien. Nos ancêtres animaux avaient déjà ce cerveau, il est donc en charge de toutes les fonctions fondamentales de la vie : mouvements, chasse, toilettage, marquage territorial, rites, accouplement, accoutumance. Le cerveau reptilien contrôle également des fonctions vitales comme la respiration et la fréquence du pouls. Comme il conserve les habitudes et comportements ancestraux de manière pratiquement immuable, il n’a qu’une capacité d’apprentissage limitée, mais il peut nous donner la sensation de routine et de sécurité. En revanche, le cerveau reptilien ne connaît aucune émotion. C’est pourquoi le psychanalyste suisse C.G. Jung (1875-1961) a affirmé que certains comportements archétypiques des premiers temps de l’humanité sont basés dans le cerveau reptilien.
Le cervelet
Cette partie est située à l’arrière du tronc cérébral, sous le cerveau cérébral, dans la partie inférieure arrière du crâne (voir figure 3). Comme le cerveau cérébral, il se compose de deux hémisphères. Sa taille a presque triplé au cours du dernier million d’années d’évolution humaine. Le cervelet est principalement responsable de l’exécution correcte des mouvements du corps et de l’orientation dans l’espace. Le cervelet sert également à stocker les souvenirs et à exécuter des fonctions simples acquises. C’est également là que réside la capacité d’apprendre de nouveaux mouvements et de les rappeler « automatiquement » plus tard. Le cervelet stocke toutes les séquences de mouvements que nous apprenons, du lancer d’une balle au piano.
Quand nous marchons, courons ou saisissons un objet, tout semble se produire automatiquement. Mais en réalité, chaque mouvement nécessite une grande coordination. Ce n’est que lorsque nous sommes immergés dans un nouvel environnement que nous réalisons tout le travail que le cerveau doit fournir. Les astronautes exposés à l’apesanteur, par exemple, doivent réapprendre même des mouvements simples.
Le système limbique ou cerveau des mammifères
Le système limbique est un développement plus récent de l’évolution. Cette zone, la plus développée chez les mammifères, peut se prévaloir de 200 à 300 millions d’années d’histoire évolutive. Il est impliqué dans le contrôle de la température corporelle, de la pression artérielle, de la fréquence du pouls et du taux de glucose dans le sang. De plus, il joue un rôle important dans les réponses émotionnelles vitales. Le rire et les pleurs, l’enjouement et la sexualité, l’euphorie et la dépression sont basés ici. Toutes les informations destinées à être stockées dans la mémoire à long terme passent d’abord par cette partie du cerveau. La cognition rationnelle et les émotions se rencontrent ici.
Les éléments clés de cette zone sont l’hypothalamus et la glande pituitaire. Bien qu’il ne soit que de la taille d’un pois, l’hypothalamus contrôle des fonctions importantes comme manger, boire, dormir, être éveillé, la température corporelle et bien d’autres. Ce mécanisme de contrôle est basé sur une multitude de messages électriques et chimiques par lesquels l’hypothalamus contrôle l’hypophyse.
Le cerveau
La plus grande partie du cerveau humain est le cerveau. Il représente environ 85 % de la masse cérébrale totale et comprend la couche externe très développée, le cortex cérébral. Le cortex contient les centres responsables des mouvements, de la parole, de la vue et de l’ouïe.
De plus, notre cerveau est le siège de la conscience, de la volonté, de l’intelligence, de la mémoire et de la capacité d’apprentissage. Il se compose de deux hémisphères fortement plissés, séparés par une profonde incision. L’hémisphère gauche contrôle la moitié droite du corps et vice versa. Ainsi, les cellules nerveuses du champ moteur gauche sont activées si la main droite est touchée. Les deux parties sont reliées par un épais faisceau de nerfs, connu sous le nom de corps calleux, ce qui implique qu’elles échangent fréquemment des informations. Différents types de tâches auxquelles les humains sont confrontés sont répartis de manière inégale entre les hémisphères. Par exemple, le sens du temps et la capacité linguistique se situent principalement à gauche, la musicalité et le rythme à droite. Le traitement des informations se fait également différemment : à gauche, il se déroule en série (une chose après l’autre), tandis qu’à droite, il se déroule de manière plus parallèle (c’est-à-dire plusieurs choses à la fois). Une lésion d’une moitié du cerveau entraîne souvent la suppression de toutes les fonctions sensorielles et motrices du côté opposé du corps.
Cela s’observe souvent après un accident vasculaire cérébral.
Pour la plupart des gens, la moitié gauche du cerveau est dominante. C’est pourquoi il y a plus de droitiers que de gauchers, même si les influences culturelles y contribuent également.
Les lobes corticaux
Dans les deux moitiés, le cortex est divisé en quatre zones, appelées lobes. Parmi celles-ci, les lobes frontaux sont nécessaires principalement à la planification, à la prise de décision et au comportement orienté vers un objectif. Les lobes apicaux représentent le corps – ils reçoivent les informations sensorielles. Une partie des lobes pariétaux est responsable de la vision et est donc appelée cortex visuel. Les lobes temporaux semblent avoir plusieurs fonctions importantes. Parmi elles figurent l’audition, la conscience sensorielle et la mémoire. Le cortex est le siège des perceptions sensorielles et de leur connexion à l’appareil locomoteur et aux capacités intellectuelles. Pour les humains, c’est l’organe le plus important pour la survie, car il génère des capacités cruciales comme la cognition, la pensée, la combinaison, la mémoire – les conditions préalables à tout ce que nous appelons l’apprentissage. Il existe une interaction très complexe entre les informations entrantes, leur traitement et leur archivage, et la transmission des commandes aux organes du mouvement.
2.3 Réfléchissez avant d’agir ! – Ordre refusé, dit la moelle épinière
Avec le cerveau, la moelle épinière représente le système nerveux central, ou SNC. La moelle épinière sert de câble de communication, permettant aux messages du cerveau d’être transmis au reste du corps à grande vitesse. Cependant, elle agit également de manière indépendante en contrôlant un certain nombre de réflexes.
Cela rappellera à beaucoup de lecteurs le fameux réflexe rotulien que le neurologue déclenche en tapotant le tendon juste sous la rotule. Le tapotement provoque une brève extension du muscle extenseur, qui a son tour entraîne sa contraction. Beaucoup de ceux qui ont senti le marteau d’un médecin se demandent à quoi sert ce réflexe. La nature nous a très judicieusement donné ce réflexe lorsque nous avons commencé à marcher debout, car sans lui nous ne serions pas capables de nous tenir droit sans que nos genoux ne se déforment de temps en temps. Pour le neurologue, tester le réflexe rotulien est un outil de diagnostic important, car son absence peut indiquer un trouble grave du système nerveux central.
« Réfléchir avant d’agir » – peut être une instruction utile en général, mais elle ne s’applique pas aux réflexes. Il s’agit de mesures instantanées, qui sont immédiatement mises en action par la moelle épinière sans consultation du cerveau. Par exemple, lorsque vous touchez accidentellement un objet chaud et que votre main se retire automatiquement à la vitesse de l’éclair, bien que la douleur et la prise de conscience du danger ne s’enregistrent que plus tard. Ce réflexe de retrait est complètement inconscient. Grâce aux récepteurs de la main, aux neurones commutables de la moelle épinière et aux motoneurones menant aux muscles du bras, on peut éviter le pire.
Une coupe transversale de la moelle épinière se présente comme un disque rond de la largeur d’un doigt. Son noyau est constitué de la substance grise, en forme de papillon. Elle est composée de corps de cellules nerveuses serrés et sa couche extérieure est constituée de fibres de cellules nerveuses, la substance blanche.
En fonction de la taille d’une personne, la moelle épinière peut mesurer jusqu’à environ 45 centimètres, mais elle ne pèse en moyenne que 2,5 grammes. Elle commence au niveau de la moelle allongée du cerveau et traverse le canal des vertèbres jusqu’à la hauteur de la deuxième vertèbre. À intervalles réguliers, des paires de racines nerveuses partent de la moelle des deux côtés. La racine dorsale, c’est-à-dire la partie de la moelle orientée vers le dos, transmet les impulsions de toutes les parties du corps à la substance grise de la moelle épinière. A l’inverse, la racine nerveuse ventrale (c’est-à-dire orientée vers l’avant), le motoneurone, dirige les impulsions vers les muscles. Quelques millimètres seulement après leur sortie de la moelle épinière, les racines se recombinent pour former ce que l’on appelle les nerfs spinaux. Ceux-ci émergent du canal vertébral via le foramen intervertébral, c’est-à-dire les trous entre les vertèbres.
Dans la région du cou et des lombaires, la moelle épinière devient beaucoup plus épaisse. Dans ces zones, de nombreuses fibres nerveuses émergent, menant respectivement vers les épines et les jambes. Même si la moelle épinière elle-même se termine à la hauteur de la deuxième vertèbre lombaire, les fibres nerveuses de la partie inférieure de la moelle épinière descendent plus bas dans le canal vertébral. Elles se combinent pour former un épais faisceau de fibres, qui, petit à petit, des fibres nerveuses individuelles émergent entre les vertèbres. Ce faisceau rappelle la queue d’un cheval et a donc été nommé d’après le mot latin « cauda equina ».