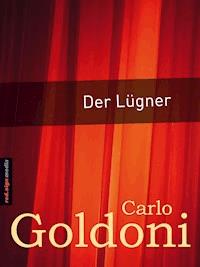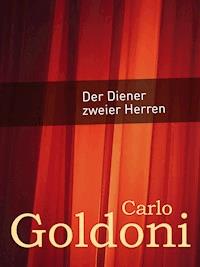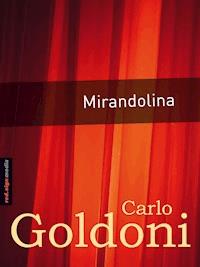1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epf
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Carlo Osvaldo Goldoni, né le 25 février 1707 à Venise et mort le 6 février 1793 à Paris, est un auteur dramatique italien, de langues italienne, vénitienne et française. Créateur de la comédie italienne moderne, il s’était exilé en France en 1762 à la suite de différends esthétiques avec ses confrères.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Carlo Goldoni
AU ROI
SIRE,
Comblé des graces et des bienfaits le Votre Majesté, il me restoit à desirer pour mon honneur et celui de ma Nation, la permission de lui dédier un Ouvrage, qui doit être probablement le dernier de ma vie.
Cette nouvelle faveur vient le m'être accordée; je suis content; je suis pénétré de respect, de reconnoissance.
Parvenu à l'âge de quatre-vingt ans, je n'écoute ni l'ambition de l'homme, ni les besoins le la vieillesse; mais je crois avoir acquis depuis le tems que je suis en France, le droit le m'intéresser au bonheur le cette Nation; et je ne forme les vœux que pour elle et son auguste Souverain.
Je demande à la Providence qu'il lui plaise m'accorder encore quelques jours d'existence pour voir prospérer les projets d'ordre et de bienfaisance, dont Votre Majesté s'est si utilement et si vigoureusement occupée.
C'est au milieu de Notables de son Royaume, c'est sous les yeux de l'Univers entier que Votre Majesté a déployé ses vues, et manifesté ses intentions pour le bien le ses Etats et pour le soulagement de son Peuple.
Le Patriotisme des François dans cette occasion ne s'est pas démenti; leurs avis, leurs conseils, leurs vœux, n'ont fait que seconder le zele paternel le Votre Majesté.
Que le Reglemens salutaires pour le présent! Que de perspectives heureuses pour l'avenir! Le cœur de Votre Majesté ne respire que pour rendre heureux ses fideles Sujets, et pour assurer la gloire de son siecle et de sa Couronne.
Je suis avec le plus profond respect,
SIRE,
DE VOTRE MAJESTÉ
Le très-humble, très-obéissant
et très-soumis Serviteur
GOLDONI
PRÉFACE
Il n'est pas d'Auteur, bon ou mauvais, dont la vie ne soit ou à la tête de ses Ouvrages, ou dans les Mémoires de son tems.
Il est vrai que la vie d'un homme ne devroit paroître qu'après sa mort; mais ces portraits faits après-coup, ressemblent-ils aux originaux? Si c'est un ami qui s'en charge, les éloges alterent la vérité; si c'est un ennemi, on trouve la satyre à la place de la critique.
Ma vie n'est pas intéressante; mais il peut arriver que, d'ici à quelque tems, on trouve dans un coin d'une ancienne Bibliotheque, une collection de mes Œuvres. On sera curieux, peut-être, de savoir qui étoit cet homme singulier qui a visé à la réforme du Théâtre de son pays, qui a mis sur la scene et sous la presse cent cinquante Comédies, soit en vers, soit en prose, tant de caractere que d'intrigue, et qui a vu, de son vivant, dix-huit éditions de son Théâtre. On dira sans doute: Cet homme devoit être bien riche; pourquoi a-t-il quitté sa patrie? Hélas! il faut bien instruire la postérité que Goldoni n'a trouvé qu'en France son repos, sa tranquillité, son bienêtre, et qu'il a achevé sa carriere par une Comédie Françoise, qui, sur le Théâtre de cette Nation, a eu le bonheur de réussir.
J'ai imaginé que l'Auteur pouvoit lui seul tracer une idée sûre et complette de son caractere, de ses anecdotes et de ses écrits; et j'ai cru qu'en faisant publier de son vivant les Mémoires de sa vie, et n'étant pas démenti par ses Contemporains, la postérité pourroit s'en rapporter à sa bonne foi.
C'est d'après cette idée, qu'en 1760, voyant qu'après ma premiere édition de Florence, mon Théâtre étoit au pillage par-tout, et qu'on en avoit fait quinze éditions sans mon aveu, sans m'en faire part, et ce qui est encore pis, toutes très-mal imprimées, je conçus le projet d'en donner une seconde à mes frais, et d'y placer dans chaque volume, au lieu de Préface, une partie de ma vie, imaginant alors qu'à la fin de l'Ouvrage l'histoire de ma Personne, et celle de mon Théâtre, auroient pu être complettes.
Je me suis trompé; quand je commençai à Venise cette édition de Pasquali, in-8° avec figures, je ne pouvois pas me douter que ma destinée étoit de traverser les Alpes.
Appellé en France en 1761, je continuai à fournir les changemens et les corrections que je m'étois proposés pour l'édition de Venise; mais le tourbillon de Paris, mes nouvelles occupations et la distance des lieux, ont diminué l'activité de mon côté, et ont mis de la lenteur dans l'exécution de la presse, de maniere qu'un Ouvrage qui devoit être porté jusqu'à trente volumes, et qui devoit être achevé dans l'espace de huit années, n'est encore, au bout de vingt ans, qu'au tome XVII°, et je ne vivrois pas assez pour voir cette édition terminée.
Ce qui m'inquiète et me presse pour le moment, c'est l'histoire de ma vie. Elle n'est pas intéressante, je le répete; mais ce que j'en ai donné jusqu'à présent dans les dix-sept premiers volumes, a été si bien reçu, que le Public m'engage à le continuer, d'autant plus que ce que j'ai dit jusqu'ici ne regarde que ma Personne, et ce qui me reste à dire doit traiter de mon Théâtre en particulier, de celui des Italiens en général, et en partie de celui des Françcois, que j'ai vu de près. Les mœurs des deux Nations, leurs goûts mis en comparaison, tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai observé, pourroit devenir agréable, et même instructif pour les Amateurs.
Je prends donc la tâche de travailler tant que je pourrai, et je le fais avec un plaisir inexprimable, pour arriver le plutôt possible à parler de mon cher Paris, qui m'a si bien reçu, qui m'a si bien amusé et si utilement occupé.
Je commence par fondre et mettre en François tout ce qu'il y a dans les Préfaces historiques des dix-sept volumes de Pasquali. C'est l'abrégé de ma vie, depuis ma naissance jusqu'au commencement de ce qu'on appelle en Italie la réforme du Théâtre Italien. On verra comment ce génie comique qui m'a toujours dominé, s'est annoncé, comment il s'est développé, les efforts inutiles que l'on a faits pour m'en dégoûter, et les sacrifices que j'ai fait à cette idole impérieuse qui m'a entraîné. Ceci formera la premiere Partie de mes Mémoires.
La seconde Partie doit comprendre l'historique de toutes mes Pieces, le secret des circonstances qui m'en ont fourni l'argument, la réussite, bonne ou mauvaise, de mes Comédies, la rivalité que mes succès m'ont excitée, les cabales que j'ai méprisées, les critiques que j'ai respectées, les satyres qu'en silence j'ai supportées, les tracasseries des Comédiens que j'ai surmontées. On verra que l'humanité est la même par-tout, que la jalousie se rencontre par-tout, et que par-tout l'homme tranquille et de sang-froid vient à bout de se faire aimer du Public, et de lasser la perfidie de ses ennemis.
La troisieme Partie de ces Mémoires contiendra mon émigration en France. Je suis si enchanté de pouvoir en parler à mon aise, que j'ai été tenté de commencer par-là mon Ouvrage; mais il faut de la méthode en tout. J'aurois été obligé, peut-être, de retoucher les deux Parties précédentes, et je n'aime pas à revenir sur ce que j'ai fait.
Voilà tout ce que j'avois à dire à mes Lecteurs: je les prie de me lire, et de me faire la grace de me croire; la vérité a toujours été ma vertu favorite, je me suis toujours bien trouvé avec elle: elle m'a épargné la peine d'étudier le mensonge, et m'a évité le désagrément de rougir.
PREMIERE PARTIE
CHAPITRE I
Ma naissance et mes Parens.
Je suis né à Venise, l'an 1707, dans une grande et belle maison, située entre le pont de Nomboli et celui de Donna-Onesta, au coin de la rue de Cà cent'anni, sur la paroisse de S. Thomas.
Jules Goldoni, mon pere, étoit né dans la même ville; mais toute sa famille étoit de Modene.
Charles Goldoni, mon grand pere, fit ses études au fameux College de Parme. Il y connut deux nobles Vénitiens et se lia avec eux de la plus intime amitié. Ceux-ci l'engagerent à les suivre à Venise. Son pere étoit mort; son oncle, qui étoit Colonel et Gouverneur du Final, lui en accorda la permission; il suivit ses camarades dans leur patrie; il s'y établit, il fut pourvu d'une Commission très-honorable et très-lucrative à la Chambre des Cinq Sages du Commerce, et il épousa en premieres noces Mademoiselle Barili, née à Modene, fille et sœur de deux Conseillers d'Etat du Duc de Parme. C'étoit ma grande-mere paternelle.
Celle-ci vint à mourir: mon grand-pere fit la connoissance d'une veuve respectable qui n'avoit que deux filles; il épousa la mere, et fit épouser la fille aînée à son fils. Elles étoient de la famille Salvioni; et sans être riches, elles jouissoient d'une honnête aisance. Ma mere étoit une jolie brune: elle boitoit un peu, mais elle étoit fort piquante; tout leur bien passa entre les mains de mon grand-pere.
C'étoit un brave homme, mais point économe. Il aimoit les plaisirs, et s'accommodoit très-bien de la gaîté Vénitienne. Il avoit loué une belle maison de campagne appartenante au Duc de Massa-Carrara, sur le Sil, dans la Marque-Trevisanne, à six lieues de Venise; il y faisoit bombance; les Terriens de l'endroit ne pouvoient pas souffrir que Goldoni attirât les Villageois et les Etrangers chez lui; un de ses voisins fit des démarches pour lui ôter la maison; mon grand-pere alla à Carrare, il prit à ferme tous les biens que le Duc possédoit dans l'Etat de Venise. Il revint glorieux de sa victoire; il renchérit sur sa dépense. Il donnoit la Comédie, il donnoit l'Opéra chez lui; tous les meilleurs Acteurs, tous les Musiciens les plus célebres étoient à ses ordres; le monde arrivoit de tous les côtés. Je suis né dans ce fracas, dans cette abondance; pouvois-je mépriser les Spectacles? Pouvois-je ne pas aimer la gaîté?
Ma mere me mit au monde presque sans souffrir: elle m'en aima davantage; je ne m'annonçai point par des cris, en voyant le jour pour la premiere fois; cette douceur sembloit, dès-lors, manifester mon caractere pacifique, qui ne s'est jamais démenti depuis.
J'étois le bijou de la maison: ma bonne disoit que j'avois de l'esprit, ma mere prit le soin de mon éducation, mon pere celui de m'amuser. Il fit bâtir un Théâtre de Marionnettes: il les faisoit mouvoir lui-même, avec trois ou quatre de ses amis; et je trouvois, à l'âge de quatre ans, que c'étoit un amusement délicieux.
En 1712, mon grand-pere vint à mourir; une partie de plaisir lui causa une fluxion de poitrine, qui, en six jours, le conduisit au tombeau. Ma grande-mere le suivit de près. Voilà l'époque d'un changement terrible dans notre famille, qui tomba tout d'un coup de l'aisance la plus heureuse dans la médiocrité la plus embarrassante.
Mon pere n'avoit pas eu l'éducation qu'il auroit dû avoir; il ne manquoit pas d'esprit, mais on avoit manqué de soin pour lui. Il ne put conserver l'emploi de son pere: un Grec adroit sut le lui enlever.
Les biens libres de Modene étoient vendus, les biens substitués étoient hypothéqués.
Il ne restoit que les biens de Venise, qui étoient la dot de ma mere et l'apanage de ma tante.
Pour surcroît de malheur, ma mere mit au monde un second enfant, Jean Goldoni, mon frere. Mon pere se trouva très- embarrassé; mais comme il n'aimoit pas trop à s'appesantir sous le poids de réflexions tristes, il prit le parti de faire un voyage à Rome pour se distraire. Je dirai dans le Chapitre suivant ce qu'il y fit, et ce qu'il est devenu. Revenons à moi, car je suis le héros de la piece.
Ma mere resta seule à la tête de la maison, avec sa sœur et ses deux enfans. Elle envoya son cadet en pension; et s'occupant uniquement de moi, elle voulut m'élever sous ses yeux. J'étois doux, tranquille, obéissant; à l'âge de quatre ans je lisois, j'écrivois, je savois mon catéchisme par cœur, et on me donna un Précepteur.
J'aimois beaucoup les livres: j'apprenois avec facilité ma Grammaire, les principes de la Géographie et ceux de l'Arithmétique; mais ma lecture favorite étoit celle des Auteurs comiques. Il n'y en avoit pas mal dans la petite Bibliotheque de mon pere; j'en lisois toujours dans les momens que j'avois à moi, et j'en copiois même les morceaux qui me faisoient le plus de plaisir. Ma mere, pourvu que je ne m'occupasse pas à des joujous d'enfant, ne prenoit pas garde au choix de mes lectures.
Parmi les Auteurs comiques que je lisois et que je relisois très-souvent, Cicognini étoit celui que je préférois. Cet Auteur Florentin, très-peu connu dans la République des Lettres, avoit fait plusieurs Comédies d'intrigue, mêlées de pathétique larmoyant et de comique trivial; on y trouvoit cependant beaucoup d'intérêt, et il avoit l'art de ménager la suspension, et de plaire par le dénouement. Je m'y attachai infiniment: je l'étudiai beaucoup; et à l'âge de huit ans, j'eus la témérité de crayonner une Comédie.
J'en fis la premiere confidence à ma bonne, qui la trouva charmante; ma tante se moqua de moi; ma mere me gronda et m'embrassa en même tems; mon Précepteur soutint qu'il y avoit plus d'esprit et plus de sens commun que mon âge ne comportoit; mais ce qu'il y eut de plus singulier, ce fut mon parrain, homme de robe, plus riche d'argent que de connoissances, qui ne voulut jamais croire que ce fût mon Ouvrage. Il soutenoit que mon Précepteur l'avoit revue et corrigée: celui-ci trouva le jugement indécent. La dispute alloit s'échauffer: heureusement une troisieme personne arriva dans l'instant, et les appaisa.
C'étoit M. Vallé, depuis l'Abbé Vallé, de Bergame. Cet ami de la maison m'avoit vu travailler à cette piece: il avoit été témoin de mes enfantillages et de mes saillies. Je l'avois prié de n'en parler à personne: il m'avoit gardé le secret; et dans cette occasion faisant taire l'incrédule il rendit justice à mes bonnes dispositions.
Dans le premier volume de mon édition de Pasquali, j'avois cité, pour preuve de cette vérité, l'Abbé Vallé, qui vivoit encore en 1770, me doutant bien qu'il y auroit d'autres parrains qui ne me croiroient pas.
Si le Lecteur me demandoit quel étoit le titre de ma piece, je ne pourrois pas le satisfaire; car c'est une bagatelle à laquelle je n'avois pas pensé en la faisant. Il ne tiendroit qu'à moi de lui en donner un aujourd'hui; mais j'aime à dire les choses comme elles sont, plutôt que de les embellir.
Enfin cette Comédie, ou pour mieux dire cette folie enfantine, a couru dans toutes les sociétés de ma mere. On en envoya une copie à mon pere; voici l'instant de revenir à lui.
CHAPITRE II
Mon premier voyage. - Mes Humanités.
Mon pere ne devoit rester à Rome que quelques mois, il y resta quatre ans; il avoit dans cette grande capitale du monde chrétien, un ami intime, M. Alexandre Bonicelli, Vénitien, qui venoit d'épouser une Romaine très-riche et qui jouissoit d'un état très-brillant.
M. Bonicelli reçut avec sensibilité son ami Goldoni: il le logea chez lui, il le présenta à toutes ses sociétés, à toutes ses connoissances, et il le recommanda vivement à M. Lancisi, premier Médecin et Camérier secret de Clément XI. Ce célebre Docteur qui a enrichi la République des Lettres et la Faculté d'éxcellens Ouvrages, s'attacha singulierement à mon pere, qui avoit de l'esprit et qui cherchoit de l'occupation.
Lancisi lui conseilla de s'appliquer à la Médecine: il lui promit sa faveur, son assistance, sa protection. Mon pere y consentit; il fit ses études au College de la Sapience, et fit son apprentissage dans l'hôpital du Saint-Esprit. Au bout de quatre ans il fut reçu Docteur, et son Mécene l'envoya à Perouse faire ses premieres expériences.
Le début de mon pere fut très-heureux: il avoit l'adresse d'éviter les maladies qu'il ne connoissoit pas; il guérissoit ses malades, et le Docteur Vénitien étoit fort à la mode dans ce pays-là.
Mon pere qui étoit peut-être bon Médecin, étoit aussi très-agréable dans la société; il réunissoit à l'aménité naturelle de son pays, l'usage de la bonne compagnie, où il avoit vécu. Il gagna l'estime et l'amitié des Bailloni et des Antinori, deux des plus nobles et des plus riches familles de la ville de Perouse.
C'est dans ce pays et dans cette heureuse position qu'il reçut le premier essai des bonnes dispositions de son fils aîné. Cette Comédie, toute informe qu'elle devoit être, le flatta infiniment; car, calculant d'après les principes de l'arithmétique, si neuf ans donnoient quatre carats d'esprit, dix-huit pouvoient en donner douze; et par progression successive, on pouvoit arriver jusqu'au degré de la perfection.
Mon pere se décida à me vouloir auprès de lui: ce fut un coup de poignard pour ma mere; elle résista d'abord, elle hésita ensuite, et finit par céder. Il se présenta une occasion la plus favorable du monde; notre maison étoit très-liée avec celle du Comte Rinalducci de Rimini, qui, avec sa femme et sa fille, étoit alors à Venise. Le Pere Abbé Rinalducci, Bénédictin, et frere du Comte, devoit aller à Rome; il s'engagea de passer par Perouse, et de m'y conduire.
Les paquets sont faits, l'instant arrive, il faut partir. Je ne vous parlerai pas des pleurs de ma tendre mere; tous ceux qui ont eu des enfans connoissent ces cruels momens. J'étois très-attaché aussi à celle qui m'avoit porté dans son sein, qui m'avoit élevé, qui m'avoit caressé; mais l'idée d'un voyage est pour un jeune homme unedistraction charmante.
Nous nous embarquâmes, le Pere Rinalducci et moi, au port de Venise, dans une espece de félouque, appellée Peota- Zuecchina, et nous fîmes voile pour Rimini. La mer ne me fit aucun mal; au contraire, j'avois un appétit excellent, nous mîmes pied à terre à l'embouchure de la Marecchia, où il y avoit des chevaux qui nous attendoient.
Quand on me proposa de monter à cheval, je me vis dans le plus grand embarras. A Venise, on ne voit point de chevaux dans les rues; il y a deux académies, mais j'étois trop jeune pour en profiter. J'avois vu, dans mon enfance, des chevaux à la campagne, je les craignois et je n'osois pas m'en approcher.
Les chemins de l'Ombrie que nous devions traverser, étoient montagneux; le cheval étoit la voiture la plus commode pour les passagers: il fallut s'y soumettre. On me prend à travers le corps, on me flanque sur la selle... Miséricorde! des bottes, des étriers, une bride, un fouet! Que faire de tout cela? J'étois balloté comme un sac; le Révérend Pere rioit de tout son cœur, les domestiques se moquoient de moi, j'en ris moi-même. Peu-à-peu je fis connoissance avec mon bidet: je le régalois de pain et de fruits; il devint mon ami, et en six jours de tems nous arrivâmes à Perouse.
Mon pere fut content de me voir, encore plus de me voir bien portant, je lui dis d'un air d'importance que j'avois fait ma route à cheval: il m'applaudit en riant, et m'embrassa tendrement.
Je trouvai notre logement fort triste dans une rue escarpée et très-vilaine: je priai mon pere de déménager; il ne le pouvoit pas, la maison étoit attenante à l'hôtel d'Antinori; il ne payoit point de loyer, et il étoit tout près des Religieuses de Sainte-Catherine, dont il étoit le Médecin.
Je vis la ville de Perouse: mon pere me conduisit lui-même par-tout; il commença par la superbe église de Saints Laurent, qui est la Cathédrale du pays, où l'on conserve et l'on expose l'Anneau avec lequel Saint Joseph épousa la Vierge Marie. C'est une pierre d'un transparent bleuâtre et d'un contour très-épais: voilà comme je l'ai vu; mais on dit que cet anneau change miraculeusement de couleur et de forme aux différens yeux qui l'approchent.
Mon pere me fit remarquer la citadelle que Paul III fit bâtir, du tems que Perouse jouissoit de la liberté républicaine, sous prétexte de régaler les Perousins d'un hôpital pour les malades et les pélerins: il y fit introduire des canons dans des charrettes chargées de paille; ensuite on cria: qui vive? Il fallut bien répondre: Paul III.
Je vis de beaux hôtels, de belles églises, de jolies promenades: je demandai s'il y avoit une salle de Spectacle, on me dit que non; tant pis, répondis-je, je n'y resterois pas pour tout l'or du monde.
Au bout de quelques jours, mon pere se détermina à me faire continuer mes études; c'étoit juste, je le voulois bien; les Jésuites étoient en vogue, il m y proposa: j'y fus reçu sans difficulté.
Les classes des humanités en Italie ne sont pas partagées comme en France; il n'y en a que trois: Grammaire inférieure, Grammaire supérieure, ou humanité proprement dite, et Rhètorique. Ceux qui profitent et emploient bien leur tems dans l'espace de trois ans, peuvent terminer leur cours.
J'avois fait à Venise ma premiere année de Grammaire inférieure: j'aurois pu entrer dans la supérieure; mais le tems que j'avois perdu, la distraction du voyage, les nouveaux maîtres que j'allois avoir, tout engagea mon pere à me faire recommencer mes études, et il fit très-bien; car vous allez voir, mon cher Lecteur, comme ce Grammairien Vénitien, qui ne manquoit pas de se vanter d'avoir composé une Piece, se trouva rapetissé en un instant.
L'année littéraire étoit avancée, on me reçut dans la classe inférieure comme un Ecolier très-fait, très-instruit pour la supérieure. On m'interrogea, je répondis mal, on me fit traduire, je bégayois; on me fit faire du latin, beaucoup de barbarismes et de sollécismes. On se moqua de moi: j'étois devenu le jouet de mes camarades, ils se plaisoient à me défier; tous mes combats étoient des chûtes; mon pere étoit au désespoir; j'étois étonné, mortifié; je me crus ensorcelé.
Le tems des vacances s'approchoit: on devoit donner le devoir qu'on appelle en Italie le Latin du passage; car ce petit travail doit décider du mérite des Ecoliers pour les faire monter à une autre classe, ou pour les faire rester dans la même; c'étoit le sort auquel, tout au plus, je devois m'attendre. Le jour arrive: le Régent dicte; les Ecoliers écrivent; chacun fait de son mieux. Je rassemble toutes mes forces, je me représente mon honneur, mon ambition, mon pere, ma mere; je vois mes voisins qui me regardent du coin de l'œil, et qui rient; facit indignatio versum. La rage, la honte m'enflamment; je lis mon theme, je sens ma tête fraîche, ma main légere, ma mémoire féconde; je finis avant les autres, je cachete mon papier, je l'apporte au Régent, et je m'en vais content de moi.
Huit jours après, on appelle et on rassemble les Ecoliers: on publie la décision du College. Premiere nomination, Goldoni en supérieure; voilà un brouhaha général dans la classe; on tient des propos indécens. On lit ma traduction à haute voix, pas une faute d'ortographe; le Régent m'appelle à la chaire: je me leve pour y aller, je vois mon pere à la porte, je cours l'embrasser.
CHAPITRE III
Suite du Chapitre précédent. - Nouvel amusement comique. - Arrivée de ma Mere à Perouse.
Le Pere Régent voulut me parler en particulier: il me fit un compliment; il me dit que, malgré les fautes grossieres que je faisois de tems en tems dans mes leçons ordinaires, il avoit deviné que je devois avoir de l'esprit par des traits de justesse qu'il rencontroit par-ci, par-là, dans mes themes et dans mes versions. Il ajouta que ce dernier essai l'avoit convaincu que je m'étois caché par malice, et il badina sur la ruse des Vénitiens.
Vous me faites trop d'honneur, mon Révérend Pere, lui dis-je, j'ai trop souffert pendant trois mois pour m'amuser à mes dépens; je ne faisois pas l'ignorant, je l'étois; c'est un phénomene que je ne saurois expliquer.
Le Régent m'exhorta de continuer à m'appliquer; et comme il devoit passer lui-même à la classe supérieure où j'allois entrer, il m'assura de sa bienveillance.
Mon pere, content de moi, tâcha de me récompenser et de m'amuser pendant le tems des vacances. Il savoit que j'aimois les Spectacles, il les aimoit aussi: il rassembla une société de jeunes gens; on lui prêta une salle dans l'hôtel d'Antinori, il y fit bâtir un petit Théâtre; il dressa lui-même les Acteurs, et nous y jouâmes la Comédie.
Dans les Etats du Pape (excepté les trois Légations), les femmes ne sont pas tolérées sur la scene. J'étois jeune, je n'étois pas laid, on me destina un rôle de femme, on me donna même le premier rôle, et on me chargea du Prologue.
Ce Prologue étoit une piece si singuliere, qu'il m'est resté toujours dans la tête, et il faut que j'en régale mon Lecteur. Dans le siecle dernier, la Littérature Italienne étoit sí gâtée, que prose et poésie, tout étoit ampoulé; les métaphores, les hyperboles et les antitheses tenoient la place du sens commun. Ce goût dépravé n'étoit pas encore tout-à-fait extirpé en 1720: mon pere y étoit accoutumé; voici le commencement du beau morceau qu'on me fit débiter.
Benignissimo Cielo! (je parlois à mes Auditeurs) ai rai del vostro splendilissimo sole eccoci quai farfalle, che spiegando le deboli ali de' nostri concetti, portiamo al bel lume il volo, etc. Cela voudroit dire bêtement en françois: Ciel très-benin, aux rayons le votre soleil très-éclatant, nous voilà comme des papillons qui, sur les foibles ailes de nos expressions, prenons notre vol vers votre lumiere, etc.
Ce charmant Prologue me valut un boisseau de dragées, dont le Théâtre fut inondé et moi presqu'aveuglé. C'est l'applaudissement ordinaire dans les Etats du Pape.
La Piece dans laquelle j'avois joué étoit la Sorellina di don Pilone: je fus beaucoup applaudi; car dans un pays où les Spectacles sont rares, les spectateurs ne sont pas difficiles.
Mon pere trouva que j'avois de l'intelligence, mais que je ne serois jamais bon Acteur; il ne se trompa point.
Nos représentations durerent jusqu'à la fin des vacances. A l'ouverture des classes, je pris ma place; à la fin de l'année je passai en Rhétorique, et j'achevai mes humanités, ayant gagné l'amitié et l'estime des Jésuites, qui me firent l'honneur de m'offrir une place dans leur société, que je n'acceptai pas.
Pendant ce tems-là il arriva beaucoup de changemens dans notre famille; ma mere ne pouvoit pas soutenir l'éloignement de son fils aîné, elle pria son époux de revenir à Venise, ou qu'il lui permît d'aller le rejoindre où il étoit.
Après beaucoup de lettres et beaucoup de débats, il fut décidé que Madame Goldoni viendroit avec sa sœur, et avec son cadet, se réunir au reste de sa famille; tout cela fut exécuté.
Ma mere, dans Perouse, ne put jouir d'un seul jour de bonne santé, l'air du pays lui étoit fatal; née et habituée dans le climat tempéré de Venise, elle ne pouvoit soutenir les frimats d'un pays montagneux.
Elle souffrit beaucoup; elle fut réduite presque à la mort, et elle sut surmonter les peines et les dangers tant qu'elle crut ma demeure nécessaire dans cette ville, pour ne pas m'exposer à interrompre mes études qui étoient si bien avancées.
Mes humanités finies et ma Rhétorique achevée, elle engagea mon pere à la satisfaire, et il s'y prêta de bon cœur. La mort de son protecteur Antinori lui avoit causé des désagrémens, les Médecins de Perouse ne le regardoient pas de bon œil; il prit le parti de quitter le Perousin, et de se rapprocher des marais de la mer Adriatique.
CHAPITRE IV
Mon voyage à Rimini. Ma Philosophie. - Ma premiereconnoissance avec les Comédiens.
Le projet fut exécuté en peu de jours; on acheta un carrosse à quatre places, mon frere y étoit par-dessus le marché, nous prîmes la route de Spoleti, qui étoit plus commode, et nous arrivâmes à Rimini, où toute la famille du Comte Rinalducci se trouvoit rassemblée, et où nous fûmes reçus avec des transports de joie.
Il étoit nécessaire pour moi que je ne misse pas une seconde fois des lacunes dans mes applications littéraires, mon pere me destinoit à la Médecine, et je devois étudier la Philosophie.
Les Dominicains de Rimini étoient en grande réputation pour la Logique, qui ouvre la carriere de toutes les sciences physiques et spéculatives, le Comte Rinalducci nous fit faire la connoissance du Professeur Candini, et je fus confié à ses soins.
M. le Comte ne pouvant pas me garder chez lui, on me mit en pension chez M. Battaglini, Négociant et Banquier, ami et compatriote de mon pere. Malgré les remontrances et les regrets de ma mere, qui n'auroit jamais voulu se détacher de moi, toute ma famille prit la route de Venise, où je ne devois la rejoindre que lorsqu'ils auroient jugé à propos de me rappeller.
Ils s'embarquerent pour Chiozza, dans une barque de ce pays-là; le vent étoit favorable, ils arriverent en très-peu de tems; mais ma mere étoit fatiguée, et ils s'y arrêterent pour se reposer.
Chiozza est une ville à huit lieues de Venise, bâtie sur des pilotis comme la capitale; on y compte quarante mille ames, tout peuple; des pêcheurs et des matelots, des femmes qui travaillent en grosse dentelle, dont on fait un commerce considérable, et il n'y a qu'un petit nombre de gens qui s'élevent au-dessus du vulgaire. On range dans ce pays-là tout le monde en deux classes, riches et pauvres; ceux qui portent une perruque et un manteau sont les riches, ceux qui n'ont qu'un bonnet et une capotte sont les pauvres; et souvent ces derniers ont quatre fois plus d'argent que les autres.
Ma mere se trouvoit très-bien dans ce pays-là, l'air de Chiozza étoit analogue à son air natal, son logement étoit beau, elle jouissoit d'une vue agréable et d'une liberté charmante; sa sœur étoit complaisante, mon frere étoit encore un enfant qui ne disoit rien, et mon pere, qui avoit des projets, fit part de ses réflexions à sa femme, qui les approuva.
Il falloit, disoit-il, ne retourner à Venise que dans une position à n'être à charge à personne; il falloit, pour cet effet, qu'auparavant il allât lui-même à Modene pour y arranger les affaires de la famille; cela fut exécuté: voilà mon pere à Modene, ma mere à Chiozza et moi à Rimini.
Je tombai malade, la petite vérole se déclara: elle étoit bénigne; M. Battaglini n'en fit part à mes parens que quand il me vit hors de danger; il n'est pas possible d'être mieux soigné, mieux servi que je le fus dans cette occasion.
A peine étois-je en état de sortir, mon hôte, très-attentif et très-zélé pour mon bien, me pressa d'aller revoir le Pere Candini.
J'y allois malgré moi: ce Professeur, cet homme célebre m'ennuyoit à périr; il étoit doux, sage, savant: il avoit beaucoup de mérite, mais il étoit Thomiste dans l'ame, il ne pouvoit pas s'écarter de sa méthode ordinaire; ses détours scholastiques me paroissoient inutiles, ses barbara, ses baraliptons me paroissoient ridicules. J'allois écrire sous sa dictée, mais au lieu de repasser mes cahiers chez moi, je nourrissois mon esprit d'une philosophie bien plus utile et plus agréable; je lisois Plaute, Térence, Aristophane, et les fragmens de Ménandre. Je ne brillois pas, il est vrai, dans les cercles qui se tenoient journellement: j'avois l'adresse cependant de faire comprendre à mes camarades que ce n'étoit ni la lourde paresse, ni la crasse ignorance qui me rendoient indifferent aux leçons du maître, dont la longueur me fatiguoit et me révoltoit; il y en avoit plusieurs qui pensoient comme moi.
La Philosophie moderne n'avoit pas encore fait les progrès considérables qu'elle a fait depuis, et il falloit se tenir (les Ecclésiastiques sur-tout) à celle de Saint Thomas ou à celle de Scot, ou à la péripatéticienne, ou à la mixte, qui toutes ensemble ne font que s'écarter de la Philosophie du bon sens.
J'avois bon besoin, pour soulager l'ennui qui m'accabloit, de me procurer quelque distraction agréable: j'en trouvai l'occasion j'en profitai; et l'on ne sera pas fâché, peut-être, de passer avec moi des cercles de la Philosophie à ceux d'une Troupe de Comédiens.
Il y en avoit une à Rimini qui me parut délicieuse; c'étoit pour la premiere fois que je voyois des femmes sur le Théâtre, et je trouvai que cela décoroit la scene d'une maniere plus piquante. Rimini est dans la légation de Ravenne, les femmes sont admises sur le Théâtre, et on n'y voit point, comme on voit à Rome, des hommes sans barbe ou des barbes naissantes.
J'allois les premiers jours à la Comédie fort modestement au parterre, je voyois de jeunes gens comme moi dans les coulisses: je tentai d'y parvenir, je n'y trouvai point de difficulté; je regardois du coin de l'œil ces demoiseiles, elles me fixoient hardiment. Peu à peu je m'apprivoisai; de propos en propos, de question en question, elles apprirent que j'étois Vénitien. Elles étoient toutes mes compatriotes, elles me firent des caresses et des politesses sans fin; le Directeur lui-même me combla d'honnêtetés: il me pria à dîner chez lui, j'y allai; je ne vis plus le Révérend Pere Candini.
Les Comédiens alloient finir leur engagement, et devoient partir; leur départ me faisoit vraiment de la peine. Un vendredi, jour de relâche pour toute l'Italie, hors l'Etat de Venise, nous fîmes une partie de campagne; toute la compagnie y étoit, le Directeur annonça le départ pour la huitaine; il avoit arrêté la barque qui devoit les conduire à Chiozza... A Chiozza! dis-je, avec un cri de surprise! -Oui, Monsieur; nous devons aller à Venise, mais nous nous arrêterons quinze ou vingt jours à Chiozza pour y donner quelques représentations en passant. - Ah, mon Dieu! ma mere est à Chiozza, et je la verrois avec bien du plaisir. - Venez avec nous; - oui, oui (tout le monde crie l'un après l'autre), avec nous, avec nous, dans notre barque; vous y serez bien, il ne vous en coûtera rien; on joue, on rit, on chante, on s'amuse, etc. Comment résister à tant d'agrément? pourquoi perdre une si belle occasion? J'accepte, je m'engage et je fais mes préparatifs.
Je commence par en parler à mon hôte, il s'y oppose très-vivement: j'insiste, il en fait part au Comte Rinalducci; tout le monde étoit contre moi. Je fais semblant de céder, je me tiens tranquille; le jour fixé pour partir, je mets deux chemises et un bonnet de nuit dans mes poches; je me rends au port, j'entre dans la barque le premier, je me cache bien sous la proue; j'avois mon écritoire de poche, j'écris à M. Battaglini, je lui fais mes excuses; c'est l'envie de revoir ma mere qui m'entrame, je le prie de faire présent de mes hardes à la bonne qui m'avoit soigné dans ma maladie, et je lui déclare que je vais partir. C'est une faute que j'ai faite, je l'avoue; j'en ai fait d'autres, je les avouerai de même.
Les Comédiens arrivent. - Où est M. Goldoni? - Voilà Goldoni qui sort de sa cave; tout le monde se met à rire; on me fête, on me caresse, on fait voile; adieu Rimini.
CHAPITRE V
La Barque des Comédiens. - Surprise le ma Mere. Lettre intéressante de mon Pere.
Mes Comédiens n'étoient pas ceux de Scaron; cependant l'ensemble de cette Troupe embarquée présentoit un coup d'œil plaisant.
Douze personnes, tant Acteurs qu'Actrices, un Souffleur, un Machiniste, un Garde du magasin, huit domestiqués, quatre femmes-de-chambre, deux nourrices, des enfans de tout âge, des chiens, des chats, des singes, des perroquets, des oiseaux, des pigeons, un agneau; c'étoit l'arche de Noé.
La barque étoit très-vaste, il y avoit beaucoup de compartimens, chaque femme avoit sa niche avec des rideaux; on avoit arrangé un bon lit pour moi à côté du Directeur, tout le monde étoit bien.
L'Intendant général du voyage, qui étoit en même tems Cuisinier et Sommelier, sonna une petite cloche qui étoit le signal du déjeûner; tout le monde se rassembla dans une espece de sallon qu'on avoit ménagé au milieu du navire par-dessus les caisses, les malles et les ballots; il y avoit sur une table ovale du café, du thé, du lait, des rôties, de l'eau et du vin.
La premiere Amoureuse demanda un bouillon, il n'y en avoit point, elle étoit en fureur; on eut toute la peine du monde à l'appaiser avec une tasse de chocolat; c'étoit la plus laide et la plus difficile.
Après le déjeûner, on proposa la partie, en attendant le dîner. Je jouois assez bien le tresset; c'étoit le jeu favori de ma mere, qui me l'avoit appris.
On alloit commencer un tresset et un piquet, mais une table de pharaon qu'on avoit établi sur le tillac, attira tout le monde, la banque annonçoit plutôt l'amusement que l'intérêt, le Directeur ne l'auroit pas souffert autrement. On jouoit, on rioit, on badinoit, on se faisoit des niches: la cloche annonce le dîner, on s'y rend.
Des macaroni! tout le monde se jette dessus, on en dévore trois soupieres; du bœuf à la mode, de la volaille froide, une longe de veau, du dessert et du vin excellent; ah, le bon dîner! il n'est chere que d'appétit.
Nous restâmes quatre heures à table; on joua de différens instrumens, on chanta beaucoup; la Soubrette chantoit à ravir, je la regardois attentivement, elle me faisoit une sensation singuliere; hélas! il arriva une aventure qui interrompit l'agrément de la société; un chat se sauva de sa cage, c'étoit le minet de la premiere Amoureuse, elle appella tout le monde au secours, on courut après lui: le chat qui étoit farouche comme sa maîtresse, glissoit, sautoit, se cachoit par-tout; se voyant poursuivi, il grimpa sur le mât. Madame Clarice se trouva mal; un matelot monte pour le ravoir, le chat s'élance dans la mer et il y reste; voilà sa maîtresse au désespoir, elle veut tuer tous les animaux qu'elle apperçoit, elle veut jetter sa femme-de-chambre dans le tombeau de son cher minet; tout le monde prend le parti de la femme-de-chambre; la querelle devient générale: le Directeur arrive, il en rit, il badine, il fait des caresses à la dame affligée: elle finit par rire elle-même, et voilà le chat oublié.
Mais c'est assez, je crois, et c'est peut-être trop abuser de mon Lecteur en l'entretenant de ces miseres, qui n'en méritent pas la peine.
Le vent n'étoit pas favorable, nous restâmes trois jours sur mer; toujours les mêmes amusemens, les mêmes plaisirs, le même appétit; nous arrivâmes à Chiozza le quatrieme jour.
Je n'avois pas l'adresse du logement de ma mere, mais je n'ai pas cherché long-tems. Madame Goldoni et sa sœur portoient une coëffe: elles étoient dans la classe des riches, et tout le monde les connoissoit.
Je priai le Directeur de m'y accompagner; il s'y prêta de bonne grace, il y vint: il s'y fit annoncer, je restai dans l'antichambre. - Madame, dit-il à ma mere, je viens de Rimini, j'ai des nouvelles à vous donner de M. votre fils. - Comment se porte mon fils? - Très-bien, Madame. - Est-il content de sa position? - Pas trop, Madame; il souffre beaucoup. - De quoi? - D'être éloigné de sa tendre mere. - Le pauvre enfant! je voudrois bien l'avoir auprès de moi. (J'entendois tout cela, et le cœur me battoit). - Madame, continua le Comédien, je lui avois offert de le conduire avec moi. - Pourquoi, Monsieur, ne l'avez-vous pas fait? - L'auriez-vous trouvé bon? - Sans doute. - Mais ses études? - Ses études! ne pouvoit-il pas y retourner? D'ailleurs, il y a des maîtres partout. - Vous le verriez donc avec plaisir? - Avec la plus grande joie. - Madame, le voilà. - Il ouvre la porte, j'entre: je me jette aux genoux de ma mere; elle m'embrasse, les larmes nous empêchent de parler. Le Comédien, accoutumé à de pareilles scenes, nous dit des choses agréables, prit congé de ma mere et s'en alla. Je reste avec elle, j'avoue avec sincerité la sottise que j'avois faite; elle me gronde et m'embrasse; nous voilà contens l'un de l'autre. Ma tante étoit sortie: quand elle rentre, autre surprise, autres embrassemens; mon frere étoit en pension.
Le lendemain de mon arrivée, ma mere reçut une lettre de M. Battaglini, de Rimini; il lui faisoit part de mon étourderie, il s'en plaignoit amerement, et lui annonçoit qu'elle recevroit incessamment un porte-manteau chargé de livres, de linge et de hardes, dont sa Gouvernante ne savoit que faire.
Ma mere en fût très-fâchée, elle pensa me gronder; mais à propos de lettre, elle se souvint qu'elle en avoit une de mon pere, très-intéressante: elle alla la chercher, me la remit, et en voici le précis:
"Ma chere femme
Pavie, 27 Mars 1721.
"J'ai une bonne nouvelle à te donner, elle regarde notre cher fils: elle te fera beaucoup de plaisir. J'ai quitté Modene, comme tu sais, pour aller à Plaisance, et pour y arranger les affaires avec M. Barilli, mon cousin, qui me doit encore un reste de dot de ma mere; et si je peux réunir cette somme aux arrérages que je viens de toucher à Modene, nous pourrons nous rétablir à nostre aise.
"Mon cousin n'étoit pas à Plaisance, il étoit parti pour Pavie, pour assister au mariage d'un neveu de sa femme. Je me trouvois en route, le voyage n'étoit pas long, je pris le parti de venir le rejoindre à Pavie. Je le trouve, je lui parle, il avoue la dette, et nous nous sommes arrangés. Il me payera en six années; mais voici ce qui vient de m'arriver en cette ville.
"Je vais descendre en arrivant à l'hôtel de la Croix rouge; on me demande mon nom, pour en faire la consigne à la Police; le lendemain, l'Aubergiste me présente un Valet-de-pied du Gouverneur, qui me prie très-poliment de me rendre à mon aise à l'hôtel du Gouvernement. Malgré le mot à votre aise, je n'étois pas à mon aise dans ce moment-là, et je ne pouvois pas deviner ce qu'on vouloit de moi.
"J'allai d'abord en sortant chez mon cousin; et après l'arrangement de nos affaires, je lui fis part de cette espece d'invitation, qui ne laissoit pas de m'inquiéter, et je lui demandai s'il connoissoit le Gouverneur de Pavie personnellement; il me dit que oui, qu'il le connoissoit depuis long-tems, que c'étoit le Marquis de Goldoni-Vidoni, une des bonnes familles de Crémone, et Sénateur de Milan.
"A ce nom de Goldoni, je bannis toute crainte, je conçus des idées flatteuses, et je ne me trompois pas.
"J'allai voir, dans l'après-midi, le Gouverneur; il me fit l'accueil le plus honnête et le plus gracieux: c'étoit ma consigne qui lui avoit donné l'envie de me connoître; nous causâmes beaucoup, je lui dis que j'étois originaire de Modene; il me fit l'honneur de m'observer que la ville de Crémone n'étoit pas bien éloignée de celle de Modene; il arriva du monde, il me pria à dîner pour le jour suivant.
"Je ne manquai pas de m'y rendre, comme tu peux croire; nous n'étions que quatre personnes à table, on dîna fort bien; les deux autres convives partirent après le café, nous restâmes seuls M. le Sénateur et moi.
"Nous parlâmes de bien des choses, principalement de ma famille, de mon état et de ma position actuelle; enfin, pour abréger ma lettre, il me promit qu'il tâcheroit de faire quelque chose pour mon fils aîné.
"Il y a à Pavie une Université aussi fameuse que celle de Padoue, et il y a plusieurs Colleges où on ne reçoit que des Boursiers. M. le Marquis s'engagea de m'obtenir une de ces places dans le College du Pape; et si Charles se conduit bien, il aura soin de lui.
"N'écris rien de tout cela à ton fils; à mon retour je le ferai revenir, et je veux me ménager le plaisir de l'en instruire moi-même.
"Je ne tarderai pas, j'espere, etc."
Tout ce que contenoit cette lettre étoit fait pour me fiatter, et pour me faire concevoir les espérances les plus étendues.
Je sentis alors l'imprudence de mon équipée; je craignois l'indignation de mon pere, et qu'il ne se méfiât de ma conduite dans une ville encore plus éloignée, et où j'aurois beaucoup plus de liberté.
Ma mere m'assura qu'elle tâcheroit de me garantir des reproches de mon pere, qu'elle prendroit tout sur elle, d'autant plus que mon repentir lui paroissoit sincere.
J'avois vraiment assez de raison pour mon âge; mais j'étois sujet à des escapades inconsidérées: elles m'ont fait beaucoup de tort, vous le verrez, et vous me plaindrez peut-être quelquefois.
CHAPITRE VI
Retour le mon Pere.-Dialogue entre mon Pere et moi. Mes nouvelles occupations. - Trait de jeunesse.
Ma mere vouloit me produire et me présenter à ses connoissances; mais je n'avois pour tout habillement qu'un vieux surtout qui m'avoit servi sur mer d'habit, de robe-de-chambre et de couvre-pieds.
Elle fit venir un Tailleur, je fus bientôt en état de paroître. J'employai mes premiers pas à aller voir mes compagnons de voyage, ils me virent avec plaisir: ils étoient retenus pour vingt représentations; j'avois mes entrées, je m'étois proposé d'en profiter, sous le bon plaisir de ma tendre mere.
Elle étoit fort liée avec l'Abbé Gennari, Chanoine de la Cathédrale. Ce bon Ecclésiastique étoit un peu rigoriste. Les Spectacles en Italie ne sont pas proscrits par l'Eglise Romaine, les Comédiens ne sont point excommuniés; mais l'Abbé Gennari soutenoit que les Comédies qu'on donnoit alors, étoient dangereuses pour les jeunes gens; il n'avoit peut-être pas tort, et ma mere me défendit le Spectacle.
Il falloit bien obéir; je n'allois pas à la Comédie, mais j'allois voir les Comédiens, et la Soubrette plus fréquemment que les autres. J'ai toujours eu par la suite un goût de préférence pour les Soubrettes.
Au bout de six jours, mon pere arrive; je tremble, ma mere me cache dans le cabinet de toilette, et se charge du reste. Il monte, ma mere va au devant de lui, ma tante aussi, voilà les embrassemens de coutume. Mon pere paroît fâché, sourcilleux: il n'a pas sa gaîté ordinaire, on le croit fatigué, ils entrent dans la chambre; voici les premiers mots de mon pere: Où est mon fils? Ma mere répond de bonne foi: Notre cadet est à sa pension. Non, non, répliqua mon pere en colere, je demande l'aîné, il doit être ici; vous me le cachez, vous avez tort, c'est un impertinent qu'il faut corriger. Ma mere interdite ne savoit que dire: elle prononça des mots vagues: mais... comment?... Mon pere l'interrompt en frappant des pieds: Oui, M. Battaglini m'a instruit de tout, il m'a écrit à Modene, j'ai retrouvé la lettre en y repassant. Ma mere le prie, d'un air affligé, de m'écouter avant que de me condamner. Mon pere, toujours en colere, redemande où j'étois. Je ne puis plus y tenir, j'ouvre la porte vitrée, mais je n'ose pas avancer. Sortez, dit mon pere à sa femme et à sa sœur, laissez-moi seul avec ce bon sujet. Elles sortent, je m'approche en tremblant: ah, mon pere!-Comment, Monsieur! par quel hazard êtes-vous ici? - Mon pere... on vous aura dit. - Oui on m'a dit que, malgré les remontrances, les bons conseils, et en dépit de tout le monde, vous avez eu l'insolence de quitter Rimini brusquement. - Qu'aurois-je fait à Rimini, mon pere? c'étoit du tems perdu pour moi. - Comment, du tems perdu! l'étude de la Philosophie, c'est du tems perdu? - Ah! la Philosophie scholastique, les syllogismes, les enthymêmes, les sophismes, les nego, probo, concedo; vous en souvenez-vous, mon pere? (il ne peut s'empêcher de faire un petit mouvement de levres qui annonçoit l'envie qu'il avoit de rire: j'étois assez fin pour m'en appercevoir, et je pris courage). Ah, mon pere! ajoutai-je, faites-moi apprendre la Philosophie de l'homme, la bonne morale, la physique expérimentale. - Allons, allons, comment es-tu venu jusqu'ici? - Par mer. - Avec qui? - Avec une Troupe de Comédiens. - Des Comédiens? - Ce sont d'honnêtes gens, mon pere. - Comment s'appelle le Directeur? - Il est Florinde sur la scene, et on l'appelle Florinde des Maccaroni. - Ah, ah! je le connois; c'est un brave homme: il jouoit le rôle de Don Juan dans le Festin de Pierre; il s'avisa de manger les maccaroni qui appartenoient à Arlequin, voilà l'origine de ce surnom. - Je vous assure, mon pere, que cette Troupe...- Où est-elle allée cette Troupe? - Elle est ici. - Elle est ici?-Oui, mon pere. - Joue-t-elle la Comédie ici? - Oui, mon pere.-J'irai la voir. - Et moi, mon pere? - Toi, coquin! Comment s'appelle la premiere Amoureuse? - Clarice.-Ah, ah, Clarice!... excellente, laide, mais beaucoup d'esprit. - Mon pere...- Il faudra donc que j'aille les remercier? - Et moi, mon pere? - Malheureux! - Je vous demande pardon. - Allons, allons; pour cette fois-ci...
Ma mere entre, elle avoit tout entendu; elle est très-contente de me voir raccommodé avec mon pere.
Elle lui parle de l'Abbé Gennari, non pas pour m'empêcher d'aller à la Comédie, car mon pere l'aimoit autant que moi, mais pour lui annoncer que ce Chanoine, attaqué de différentes maladies, l'attendoit avec impatience; qu'il avoit parlé à toute la ville de ce fameux Médecin Vénitien, éleve du célebre Lancisi, qu'on attendoit incessamment, et qu'il n'avoit qu'à se montrer pour avoir plus de malades qu'il n'en sauroit désirer.
Cela arriva en eflet; tout le monde vouloit du Docteur Goldoni; il avoit les riches et les pauvres, et les pauvres payoient mieux que les riches.
Il loua donc un appartement plus commode, et il s'établit à Chiozza pour y rester tant que la fortune lui seroit favorable, et jusqu'à ce que quelqu'autre Médecin à la mode vînt le supplanter.
Me voyant oisif, et manquant dans la ville de bons maîtres pour m'occuper, mon pere voulut faire lui-même quelque chose de moi.
Il me destinoit à la Médecine, et en attendant les lettres d'appel pour le College de Pavie, il m'ordonna de le suivre dans les visites qu'il faisoit journellement; il pensoit qu'un peu de pratique avant l'étude de la théorie, me donneroit une connoissance superficielle de la Médecine qui me seroit très-utile pour l'intelligence des mots techniques et des premiers principes de l'art.
Je n'aimois pas trop la Médecine: mais il ne falloit pas être récalcitrant; car on auroit dit que je ne voulois rien faire.
Je suivis donc mon pere: je voyois la plus grande partie de ses malades avec lui; je tâtois le pouls, je regardois les urines, j'examinois les crachats, et bien d'autres choses qui me révoltoient. Patience: tant que la Troupe continua ses représentations, qu'elle porta même jusqu'à trente-six, je me croyois dédommagé.
Mon pere étoit assez content de moi, et ma mere encore davantage. Mais un des trois ennemis le l'homme, et peut-être deux, ou tous les trois, vinrent m'attaquer et troubler ma tranquillité.
Mon pere fut appellé chez une malade fort jeune et fort jolie; il m'emmena avec lui, ne se doutant pas de quelle maladie il s'agissoit. Quand il vit qu'il falloit faire des recherches et des observations locales, il me fit sortir; et depuis ce jour-là, toutes les fois qu'il entroit dans la chambre de Mademoiselle, j'étois condamné à l'attendre dans un sallon fort petit et fort sombre.
La mere de la jeune malade, très-polie et bien honnête créature, ne souffroit pas que je restasse tout seul: elle venoit me tenir compagnie, et me parloit toujours de sa fille.
Grace au talent et aux soins de mon pere, son enfant étoit hors d'affaire; elle se portoit bien, et la visite de ce jour-là devoit être la derniere.
Je lui fis compliment: je la remerciai de sa complaisance pour moi, et je finis par dire: si je n'ai plus l'honneur de vous voir... - Comment, me dit-elle, nous ne vous verrons plus? - Si mon pere n'y vient pas. - Vous y pourrez bien venir. - Pour quoi faire? - Pour quoi faire! Ecoutez, ma fille se porte bien, elle n'a plus besoin de M. le Docteur; mais je ne serois pas fâchée qu'elle eût de tems à autre une visite d'amitié, pour voir... si les choses vont bien... si elle n'auroit pas besoin... de se purger...; si vous n'avez rien de mieux à faire, venez-y quelquefois, je vous en prie. - Mais, Mademoiselle voudroit-elle de moi? - Ah! mon cher ami, ne parlons pas de cela; ma fille vous a vu, elle ne demanderoit pas mieux que de lier connoissance avec vous. - Madame, c'est beaucoup d'honneur pour moi; mais si mon pere venoit à le savoir? - Il ne le saura pas; d'ailleurs ma fille est sa malade, il ne peut pas trouver mauvais que son fils vienne la voir. - Mais, pourquoi ne m'a-t-il pas laissé entrer dans la chambre? - C'est que... la chambre est petite; il fait chaud. - J'entens remuer; mon pere sort, je crois.- Allons, allons; venez nous voir. - Quand? - Ce soir, si vous voulez. - Si je le peux. - Ma fille en sera enchantée. - Et moi aussi.
Mon pere sort: nous nous en allons; je rêve toute la journée, je fais des réfiexions, je change d'avis à chaque instant. Le soir arrive, mon pere alloit à une consultation; et moi, à la nuit tombante, je vais regagner la porte de la malade qui se porte bien.
J'entre: beaucoup de politesses, beaucoup de gentillesses; on m'offre de me rafraîchir, je ne refuse rien; on cherche dans le garde-manger, il n'y a plus de vin; il faudrait en aller chercher, je mets la main à la poche. On frappe, on ouvre; c'est le domestique de ma mere, il m'avoit vu entrer, il connoissoit ces canailles-là; c'est un Ange qui l'a envoyé. Il me dit un mot à l'oreille; je reviens en moi-même, et je sorts dans l'instant.
CHAPITRE VII
Mon départ pour Venise.-Coup-d'œil le cette ville. Mon installation chez le Procureur.
Revenu de cet aveuglement où m'avoit plongé l'effervescence de la jeunesse, je regardois avec horreur le danger que j'avois couru.
J'étois naturellement gai, mais sujet, depuis mon enfance, à des vapeurs hypocondriaques ou mélancoliques, qui répandoient du noir dans mon esprit.
Attaqué d'un accès violent de cette maladie léthargique, je cherchois à me distraire, et je n'en trouvois pas les moyens; mes Comédiens étoient partis, Chiozza ne m'offroit plus d'amusement de mon goût, la Médecine me déplaisoit; j'étois devenu triste, rêveur: je maigrissois à vue d œil.
Mes parens ne tarderent pas à s'en appercevoir: ma mere me questionna la premiere: je lui confiai mes chagrins.
Un jour que nous étions à table en famille, sans convives étrangers et sans valets, ma mere fit tomber la conversation sur mon compte, et il y eut un débat de deux heures; mon pere vouloit absolument que je m'appliquasse à la Médecine: j'avois beau me remuer, faire des mines, bouder, il n'en démordoit pas; ma mere enfin prouva à mon pere qu'il avoit tort, et voici comment.
Le Marquis de Goldoni, dit-elle, veut bien prendre soin de notre enfant. Si Charles est un bon Médecin, son Protecteur pourra le favoriser, il est vrai, mais pourra-t-il lui donner des malades? Pourra-t-il engager le monde à le préférer à tant d'autres? Il pourroit lui procurer une place de Professeur dans l'Université de Pavie; mais, combien de tems et combien de travail pour y parvenir! Au contraire, si mon fils étudioit le Droit, s'il étoit Avocat, un Sénateur de Milan pourroit faire sa fortune sans la moindre peine et sans la moindre difficulté.
Mon pere ne répondit rien: il garda le silence pendant quelques minutes; il se tourna ensuite de mon côté, et me dit en plaisantant: Aimerois-tu le Code et le Digeste de Justinien? Oui, mon pere, répondis-je, beaucoup plus que les Aphorismes d'Hippocrate. Ta mere, reprit-il, est une femme: elle m'a dit de bonnes raisons et je pourrois bien m'y rendre; mais en attendant il ne faut pas rester sans rien faire, tu me suivras toujours. Me voilà encore dans le chagrin. Ma mere alors prend vivement mon parti; elle conseille mon pere de m'envoyer à Venise, de me placer chez mon oncle Indric, un des meilleurs Procureurs du Barreau de la capitale, et se propose de m'y accompagner elle-même et d'y rester avec moi jusqu'à mon départ pour Pavie. Ma tante appuie le projet de sa sœur; je leve les mains et je pleure de joie; mon pere y consent; j'irai donc incessamment à Venise.
Me voilà content: mes vapeurs se dissipent dans l'instant. Quatre jours après nous partons, ma mere et moi: il n'y a que huit lieues de traversée; nous arrivons à Venise à l'heure de dîner; nous allons nous loger chez M. Bertani, oncle maternel de ma mere, et le lendemain nous nous rendons chez M. Indric.
Nous fûmes reçus très-honnêtement. M. Paul Indric avoit épousé ma tante paternelle. Bon mari et bon pere, bonne mere et bonne femme, des enfans très-bien élevés: c'étoit un ménage charmant. Je fus installé dans l'étude; j'étois le quatrieme Clerc, mais je jouissois des privileges que la consanguinité ne pouvoit pas manquer de me procurer.
Mon occupation me paroissoit plus agréable que celle que mon pere me donnoit à Chiozza; mais l'une devoit être pour moi aussi inutile que l'autre.
En supposant que je dusse exercer la profession d'Avocat à Milan, je n'aurois pas pu profiter de la pratique du Barreau de Venise, inconnue à tout le reste de l'Italie; on n'auroit jamais pu deviner que, par des aventures singulieres et forcées, j'aurois plaidé un jour dans ce même Palais, où je me regardois alors comme un étranger.
Faisant exactement mon devoir et méritant les éloges de mon oncle, je ne laissois pas de profiter de l'agréable séjour de Venise, et de m'y amuser. C'étoit mon pays natal; mais j'étois trop jeune quand je l'avois quitté, et je ne le connoissois pas.
Venise est une ville si extraordinaire, qu'il n'est pas possible de s'en former une juste idée sans l'avoir vue. Les cartes, les plans, les modeles, les descriptions ne suffisent pas, il faut la voir. Toutes les villes du monde se ressemblent plus ou moins: celle-ci ne ressemble à aucune; chaque fois que je l'ai revue, après de longues absences, c'étoit une nouvelle surprise pour moi; à mesure que mon âge avançoit, que mes connoissances augmentoient, et que j'avois des comparaisons à faire, j'y découvrois des singularités nouvelles et de nouvelles beautés.
Pour cette fois-ci, je l'ai vue comme un jeune homme de quinze ans qui ne pouvoit pas approfondir ce qu'il y avoit de plus remarquable et qui ne pouvoit la comparer qu'a des petites villes qu'il avoit habitées. Voici ce qui m'a frappé davantage. Une perspective surprenante au premier abord, une étendue très-considérable de petites îles si bien rapprochées et si bien réunies par des ponts, que vous croyez voir un continent élevé sur une plaine, et baigné de tous les côtés d'une mer immense qui l'environne.
Ce n'est pas la mer, c'est un marais très-vaste plus ou moins couvert d'eau, à l'embouchure de plusieurs ports, avec des canaux profonds qui conduisent les grands et les petits navires dans la ville et aux environs.
Si vous entrez du côté de Saint-Marc, à travers une quantité prodigieuse de bâtimens de toute espece, vaisseaux de guerre, vaisseaux marchands, frégates, galeres, barques, bateaux, gondoles, vous mettez pied à terre sur un rivage appellé la Piazzetta (la petite Place), où vous voyez d'un côté le Palais et l'Eglise Ducales, qui annoncent la magnificence de la République; et de l'autre, la Place Saint-Marc, environnée de portiques élevés sur les dessins de Palladio et de Sansovin.
Vous allez par les rues de la Mercerie jusqu'au pont de Rialto, vous marchez sur des pierres quarrées de marbre d'Istrie, et piquetées à coup de ciseau pour empêcher qu'elles ne soient glissantes; vous parcourez un local qui représente une foire perpétuelle, et vous arrivez à ce Pont qui, d'une seule arche de quatre-vingt-dix pieds de largeur, traverse le grand canal, qui assure par son élévation le passage aux barques et aux bateaux dans la plus grande crue du flux de la mer, qui offre trois différentes voies aux passagers, et qui soutient sur sa courbe vingt-quatre boutiques avec logemens et leurs toits couverts en plomb.