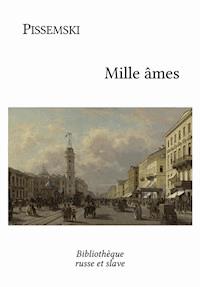
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le jeune et ambitieux Kalinovitch est nommé principal de collège dans une ville de province. Il s’y lie avec son prédécesseur, Godnieff, désormais à la retraite, et surtout avec la fille de celui-ci, Nastenka. Mais l'attrait du grand monde et ses rêves de gloire littéraire ne cessent de lui faire tourner ses regards vers Saint-Pétersbourg... Jamais réédité ni retraduit en France depuis 1886,
Mille âmes est un des très grands romans russes.
Traduction de Victor Derély, 1886.
EXTRAIT
Un jour parut dans le Bulletin des actes administratifs l’ordonnance suivante :
« L’assesseur de collège Godnieff, principal du collège d’E..., est admis à faire valoir ses droits à la retraite. » Plus loin, on lisait un autre décret ainsi conçu : « Le candidat Kalinovitch est nommé principal du collège d’E... »
À E... Godnieff possédait une maison à lui, avec un jardin, et, dans la banlieue, un bien de trente âmes. Veuf, il habitait avec sa fille, Nastenka, et sa femme de charge, Pélagie Eugraphovna. Cette dernière avait quarante-cinq ans et n’était pas des plus belles. Cela n’empêchait pas l’ispravnitza,1 une bien mauvaise langue, de dire que Pierre Mikhaïlitch devrait bien épouser sa charmante sommelière ; qu’au moins, ainsi, il n’y aurait pas de péché. À quoi les personnes plus équitables répondaient qu’il ne pouvait être question de péché entre ces deux vieilles gens, et que, dès lors, ils n’avaient aucun besoin de se marier ensemble.
Ce n’est pas exagérer de dire que Pierre Mikhaïlitch était connu non seulement dans la ville et dans le district, mais dans la moitié de la province ; chaque jour, à sept heures du matin, il sortait de chez lui pour aller au marché, et, chemin faisant, il avait coutume de causer avec toutes les personnes qu’il rencontrait. Apercevait-il, par hasard, la bourgeoise, sa voisine, à la fenêtre d’une petite maisonnette délabrée, il lui disait :
— Bonjour, Fékla Nikiphorovna.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alexeï Feofilaktovitch Pissemski né le 11 mars 1821 dans le gouvernement de Kostroma et mort le 21 janvier 1881 à Moscou, est un écrivain et dramaturge russe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 726
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE RUSSE —
Alexeï Pissemski
Писемский Алексей Феофилактович
1821 — 1881
MILLE ÂMES
Тысяча душ
1858
Traduction de Victor Derély, Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1886.
© La Bibliothèque russe et slave, 2014
© Victor Derély, 1886
Couverture : Piotr VERECHTCHAGUINE, Vue de la Perspective Nevski à Saint-Pétersbourg (1876)
Chez le même éditeur — Littérature russe
1. GOGOLLes Âmes mortes. Traduction d’Henri Mongault
2. TOURGUENIEVMémoires d’un chasseur. Traduction d’Henri Mongault
3. TOLSTOÏLes Récits de Sébastopol. Traduction de Louis Jousserandot
4. DOSTOÏEVSKIUn joueur. Traduction d’Henri Mongault
5. TOLSTOÏAnna Karénine. Traduction d’Henri Mongault
6. MEREJKOVSKILa Mort des dieux. Julien l’Apostat. Traduction d’Henri Mongault
7. BABELCavalerie rouge. Traduction de Maurice Parijanine
8. KOROLENKOLe Musicien aveugle. Traduction de Zinovy Lvovsky
9. KOUPRINELe Duel. Traduction d’Henri Mongault
10. GOGOLLe Révizor — Le Mariage. Traduction de Marc Semenoff
11. DOSTOÏEVSKIStépantchikovo et ses habitants. Traduction d’Henri Mongault
12. Les Bylines russes. Édition de Louis Jousserandot
13. PISSEMSKIMille âmes. Traduction de Victor Derély
14. RECHETNIKOVCeux de Podlipnaïa. Traduction de Charles Neyroud
15. TOURGUENIEVPoèmes en prose. Traduction de Charles Salomon
PREMIÈRE PARTIE
I
UN jour parut dans le Bulletin des actes administratifs l’ordonnance suivante :
« L’assesseur de collège Godnieff, principal du collège d’E..., est admis à faire valoir ses droits à la retraite. » Plus loin, on lisait un autre décret ainsi conçu : « Le candidat Kalinovitch est nommé principal du collège d’E... »
À E... Godnieff possédait une maison à lui, avec un jardin, et, dans la banlieue, un bien de trente âmes. Veuf, il habitait avec sa fille, Nastenka, et sa femme de charge, Pélagie Eugraphovna. Cette dernière avait quarante-cinq ans et n’était pas des plus belles. Cela n’empêchait pas l’ispravnitza,1 une bien mauvaise langue, de dire que Pierre Mikhaïlitch devrait bien épouser sa charmante sommelière ; qu’au moins, ainsi, il n’y aurait pas de péché. À quoi les personnes plus équitables répondaient qu’il ne pouvait être question de péché entre ces deux vieilles gens, et que, dès lors, ils n’avaient aucun besoin de se marier ensemble.
Ce n’est pas exagérer de dire que Pierre Mikhaïlitch était connu non seulement dans la ville et dans le district, mais dans la moitié de la province ; chaque jour, à sept heures du matin, il sortait de chez lui pour aller au marché, et, chemin faisant, il avait coutume de causer avec toutes les personnes qu’il rencontrait. Apercevait-il, par hasard, la bourgeoise, sa voisine, à la fenêtre d’une petite maisonnette délabrée, il lui disait :
— Bonjour, Fékla Nikiphorovna.
— Bonjour, batuchka,2 Pierre Mikhaïlitch, répondait-elle.
— Y a-t-il longtemps que vous êtes revenue du chef-lieu ?
— Depuis hier, monsieur. Je n’ai pas pu me procurer de charrette, et j’ai dû faire la route à pied, au milieu de cette boue. Ce que je me suis crottée !
— Comment vont les affaires ?
— Mes affaires, Pierre Mikhaïlitch, sont entre les mains de l’autorité.
— Allons, si elles sont entre les mains de l’autorité, tant mieux !
— Est-il bien vrai, mon père, que ce soit tant mieux ?
— Oui, oui, c’est tant mieux... disait Godnieff en s’éloignant.
À dire vrai, Pierre Mikhaïlitch ne savait même pas en quoi consistaient les affaires de sa voisine, ni si c’était réellement un bien pour elle qu’elles fussent entre les mains de l’autorité, mais il parlait ainsi à seule fin de la consoler.
S’il rencontrait le pope, Pierre Mikhaïlitch n’attendait pas qu’il fût près de lui pour le saluer.
— Bonjour, disait-il en ôtant sa casquette et en s’approchant pour recevoir la bénédiction du prêtre.
— Bonjour, répondait celui-ci de sa voix de basse.
— Eh bien, père, avez-vous lu mon livre, ou en avez-vous encore besoin ?
— Je l’ai lu, et j’avais l’intention de vous le rendre aujourd’hui même avec mes remercîments. C’est un charmant ouvrage !
— Oui, oui, un livre instructif... Rapportez-le-moi un de ces jours.
— Je n’y manquerai pas, répondait le pope.
Et, sur ce, il tirait sa plus belle révérence.
Rentré chez lui, Pierre Mikhaïlitch allait droit à la cuisine, où Pélagie Eugraphovna, la cuisinière, était déjà en train d’allumer le poêle.
— Voici pour toi, commandante ! Je t’apporte les biens de la terre ! disait-il en tendant un sac de nattes à la femme de charge. Celle-ci le prenait et commençait à en retirer les provisions, non sans hocher la tête et proférer des « Hé ! hé ! hé !... »
— Allons, voilà que tu te mets à bougonner ! Quelle grondeuse !... J’ai mal acheté, n’est-ce pas ?
— Fort bien, au contraire, répliquait avec une mordante ironie Pélagie Eugraphovna.
Jamais elle n’était contente des achats de Pierre Mikhaïlitch, et, à cet égard, elle avait parfaitement raison. Tantôt les marchands le trompaient sur le poids, tantôt ils lui vendaient comme fraîches des denrées gâtées. Or, l’économie domestique était la passion dominante de Pélagie Eugraphovna. Quoique d’origine allemande, elle ne savait s’exprimer qu’en russe. Comment et pourquoi était-elle venue dans cette petite ville de district ? Je l’ignore ; toujours est-il qu’elle pensa y mourir de faim ; ensuite elle entra à l’hôpital. Ce fut là que Pierre Mikhaïlitch eut occasion de la voir ; sans la connaître, il se mit, selon son habitude, à causer avec elle, et comme il était depuis peu devenu veuf, il la prit chez lui pour en faire la gouvernante de la petite Nastenka. Mais, entrée comme niania, Pélagie Eugraphovna attira peu à peu entre ses mains tout le gouvernement de la maison. Depuis le lever du jour jusqu’à une heure avancée de la nuit, elle vaquait aux divers soins du ménage, elle grimpait au grenier, descendait à la cave, bêchait dans le jardin, frottait, balayait ; enfin, à huit heures du matin, après avoir retroussé ses manches et ceint un tablier, elle s’occupait de la cuisine, et, pour lui rendre justice, il faut dire qu’elle s’acquittait très bien de cette tâche. Les salaisons et les marinades étaient surtout son triomphe. Par exemple, le poisson salé, qu’elle accommodait en botvinia3 pendant le grand carême, était tel que Pierre Mikhaïlitch n’en pouvait manger sans s’écrier :
— Messieurs, voilà du poisson et de la botvinia comme Lucullus lui-même n’en a jamais mangé !
Les plastrons de Pierre Mikhaïlitch, les cols et les manchettes de Nastenka, la femme de charge les lavait toujours elle-même, et je crois bien qu’elle aurait aussi blanchi tout le reste, si ses forces le lui avaient permis ; car, selon sa propre expression, le cœur lui saignait à la vue du linge blanchi par la repasseuse.
Il aurait été assez difficile de préciser quand dormait et de quoi se nourrissait Pélagie Eugraphovna ; elle-même, d’ailleurs, n’aimait pas qu’on l’entreprît sur ce sujet. Elle buvait son thé, pour ainsi dire, à ses moments perdus ; à la table de famille où son couvert était toujours mis, elle ne restait qu’une minute ; dès qu’on servait le rôti, elle se levait brusquement et s’en allait à la cuisine.
— Eh bien, commandante, pourquoi donc ne manges-tu jamais rien ? lui disait Pierre Mikhaïlitch, quand il la voyait reparaître ensuite.
— Puisque je vis, c’est donc que je mange, répondait en souriant Pélagie Eugraphovna, et elle retournait à la cuisine.
C’était avec beaucoup de répugnance qu’elle acceptait ses honoraires (cent vingt roubles assignats par an). D’ordinaire, à la fin de chaque mois, Pierre Mikhaïlitch lui remettait dix roubles.
— Qu’est-ce encore que cela ? disait la femme de charge.
— C’est votre argent. L’argent est une bonne chose. Vous plaît-il de le prendre et de m’en donner un reçu ? répondait Godnieff.
— Eh... finissez-en avec vos sottises ! reprenait Pélagie Eugraphovna, qui se détournait et commençait à regarder par la fenêtre.
— L’ordre, commandante, n’est pas une sottise. Veuillez prendre cet argent, insistait Pierre Mikhaïlitch.
— Comme si je n’avais pas chez vous la nourriture et le vêtement, répliquait-elle sans retourner la tête.
— Accepte, ma chère, je t’en prie ; tu sais que je n’aime pas cela ! poursuivait Godnieff de plus en plus pressant.
Pélagie Eugraphovna prenait l’argent avec colère et le jetait dédaigneusement dans le tiroir de sa table à ouvrage.
Chaque fois qu’avait lieu cette scène, bien que le mécontentement se montrât sur son visage, des larmes roulaient dans ses yeux.
— Il m’a recueillie quand j’étais dans la misère, il m’a empêchée de mourir de faim, et il me donne encore des gages, l’effronté ! Il a une fille : il ferait mieux d’amasser quelque chose pour elle ! grommelait en aparté la brave femme.
— Ne t’avise pas de me parler ainsi, entends-tu ? Je n’ai pas de leçons à recevoir de toi ! grondait à son tour Pierre Mikhaïlitch.
Ces paroles faisaient taire Pélagie Eugraphovna, mais, malgré cela, c’était toujours à contre-cœur qu’elle acceptait ses gages.
Quand il avait remis ses emplettes entre les mains de la femme de charge, Godnieff allait prendre son thé au salon avec Nastasia. Presque chaque matin une conversation de ce genre s’échangeait entre le père et la fille :
— Nastasia Pétrovna, vous êtes encore restée sur pied toute la nuit... Ce n’est pas bien, ma chérie, non, vrai, ce n’est pas bien... Il y a un temps pour le travail, un temps pour la récréation et un temps pour le sommeil.
— Je n’ai pu m’arracher à ma lecture, papa. J’ai déjà fini le roman d’hier.
— Tant pis. Comment allons-nous faire aujourd’hui ? Nous n’avons rien à lire pour ce soir.
— Si fait, je vous achèverai la lecture de ce roman ; moi-même je ne serai pas fâchée de le relire une seconde fois. Figurez-vous que ce Valentin devient un affreux homme...
— Allons, allons, ne raconte pas. Il m’est plus agréable d’être mis au courant des choses par l’auteur lui-même, interrompait Pierre Mikhaïlitch, et Nastasia en restait là de son récit.
Après cela, le plus souvent ils se quittaient. Nastenka passait la journée soit à lire, soit à faire des extraits, soit à se promener dans le jardin. Ni le ménage, ni les ouvrages de main ne l’occupaient. Godnieff revêtait son uniforme et se rendait au collège. Généralement il trouvait dans l’antichambre Gavrilitch, ancien soldat, attaché en qualité de storoj à l’établissement scolaire d’E... Il fallait la patience vraiment chrétienne de Pierre Mikhaïlitch pour conserver depuis dix ans un cuistre comme ce Gavrilitch : à la fois bête, paresseux et grossier, le vieux militaire laissait l’établissement dans un tel état de saleté que le directeur était obligé, au moins une fois par mois, de louer à ses frais des laveuses pour nettoyer les parquets. En outre, le storoj, qui adorait le chtchi4 et en mangeait toujours à son déjeuner, avait l’habitude de le faire cuire, pendant toute la nuit, dans le poêle du cabinet directorial. En entrant, Pierre Mikhaïlitch était suffoqué.
— Tu as encore étuvé du chtchi, grenadier ! disait-il ; quelle odeur ! il n’y a pas moyen de respirer !
— Allons, soit, j’en ai étuvé, on sait bien que tu n’as jamais autre chose à me dire, répliquait Gavrilitch.
— Mais, sans doute, tu en as étuvé ! Il faut que tu aies un joli aplomb pour le nier ! Fi, que c’est laid de mentir à ton âge !
— Regarde toi-même dans le poêle, tu verras bien qu’il n’y a rien.
— Je sais qu’il n’y a rien dans le poêle : tu as mangé ce que tu y avais fait cuire, tu as encore de la graisse sur ton museau, imbécile !... Et il se permet de répliquer, qui plus est ! Je te mettrai à la porte, tu entends !
— Mets-moi à la porte ! Si tu crois que je tiens à rester dans ta boîte !... répondait Gavrilitch, et il s’en allait.
— Imbécile ! répétait Pierre Mikhaïlitch.
Du reste, tout finissait par là.
Dans l’entre-classe, le directeur rédigeait des rapports, des comptes rendus ; ensuite il allait faire sa tournée d’inspection dans les diverses salles de cours. S’il avait à réprimer quelque désordre, il faisait la grosse voix et fulminait des menaces, d’ailleurs rarement suivies d’exécution.
En général, la sévérité répugnait à Pierre Mikhaïlitch. Au surplus, ce n’étaient pas encore les élèves qui lui donnaient le plus de mal ; quand il ne pouvait en venir à bout autrement, il leur faisait donner le fouet par Gavrilitch. Mais rien n’était plus pénible au vieillard que d’avoir à réprimander un des membres du personnel enseignant placé sous ses ordres. Un seul, il est vrai, se mettait parfois dans le cas de mériter des reproches : c’était le professeur d’histoire, Exarkhatoff, un homme intelligent, qui avait étudié dans une université et possédait à fond sa science.
Tout le long du mois, il se montrait paisible, taciturne et appliqué à ses devoirs ; mais dès le lendemain du jour où il avait touché son traitement, on le voyait arriver tout guilleret dans sa classe ; il plaisantait avec les élèves, puis allait se promener dans la rue, le chapeau sur l’oreille, le cigare aux lèvres, chantonnant, sifflotant et tout prêt à faire un mauvais parti à qui l’eût regardé de travers. Dans ces occasions-là, Exarkhatoff devenait fort épris du beau sexe et allait coqueter avec les blanchisseuses dans les bateaux amarrés au bord de la rivière... Les vitres, la vaisselle et les gens avaient grandement à souffrir de son ivresse.
Le lendemain, une fois les fumées du vin dissipées, il n’y avait pas plus tranquille que lui. Au temps où il faisait ses études à Moscou, il avait épousé une veuve chargée de cinq enfants et appartenant Dieu savait à quelle condition sociale. Cette femme, sotte et tracassière, était, disait-on, la cause des habitudes d’intempérance contractées par son mari. Lorsqu’elle voyait celui-ci en ribote, madame Exarkhatoff s’enfuyait chez des voisins ; mais dès que la raison était revenue au professeur, sa femme, non contente de lui faire une scène terrible, allait ensuite se plaindre de lui à son supérieur.
— Batuchka, Pierre Mikhaïlitch, ayez pitié de moi ! criait-elle en entrant comme une trombe dans le cabinet du directeur.
— Qu’est-ce qui est arrivé ? Que voulez-vous de moi ? demandait Godnieff, quoiqu’il devinât parfaitement le motif de cette visite.
— On sait bien de quoi il s’agit ! Il a bu pendant quarante-huit heures ! Je suis à bout de forces ; il ne reste plus une cuiller, plus une jatte à la maison, il a tout cassé. Moi-même, c’est à grand’peine que j’ai pu m’échapper vivante ; voilà la troisième nuit que je couche hors de chez moi, avec mes enfants.
— Mon Dieu ! mon Dieu ! disait Pierre Mikhaïlitch en haussant les épaules. Calmez-vous, madame ; je lui parlerai, et j’espère que ce sera pour la dernière fois.
— Batuchka, lavez-lui bien la tête ; ne pourriez-vous même pas lui donner le fouet ?
— Est-ce possible, madame ? Vous ne devriez pas parler ainsi, répliquait Pierre Mikhaïlitch. — Gavrilitch ! criait-il ensuite, allez appeler M. Exarkhatoff.
Vêtu d’un uniforme râpé, Exarkhatoff arrivait, la tête basse, le visage défait, une ecchymose sur l’œil gauche, bref, ne payant pas de mine.
— Nicolas Ivanitch, vous voilà encore adonné à votre malheureuse passion ! Vous connaissez sans doute l’adage grec : « L’ivresse est une démence en petit. » Eh bien ! quel plaisir y a-t-il à perdre la moitié de sa raison ? Un homme de votre intelligence, de votre éducation... ce n’est pas bien, non, ce n’est pas bien !...
— Pardon, Pierre Mikhaïlitch, je sens fort bien moi-même que j’ai tort, répondait le professeur en baissant encore plus la tête.
— Allons donc, crapule ! vociférait madame Exarkhatoff sans aucun souci de la présence du directeur ; tu reconnais tes torts en paroles, mais, au fond, tu ne sens rien du tout. Tu as cinq enfants, et c’est ainsi que tu pourvois à leur entretien ! Il faudra donc que je vole, que je mendie pour leur donner à manger !
— C’est pourtant vrai, disait Godnieff en hochant la tête.
— Pardon, Pierre Mikhaïlitch, répétait Exarkhatoff.
— Je crois à votre repentir, et j’espère que vous êtes maintenant corrigé pour toujours. Je vous prie de retourner à vos occupations, reprenait le principal. Eh bien, vous voyez, madame, ajoutait-il quand Exarkhatoff était sorti : je ne l’ai pas ménagé, je lui ai adressé l’admonestation qu’il méritait : à présent, vous n’avez plus lieu d’être affligée.
Mais madame Exarkhatoff n’était pas encore satisfaite.
— Et pourquoi n’ai-je plus lieu d’être affligée ? Qu’est-ce que vous lui avez fait ? Vous lui avez doucement passé la main sur la tête : est-ce ainsi qu’il aurait fallu traiter un pareil chien ? reprenait-elle.
— Ah ! comment une dame peut-elle tenir un tel langage ? répliquait Pierre Mikhaïlitch ; ce n’est pas par des injures, c’est par la douceur et l’amour que les époux doivent corriger les défauts l’un de l’autre.
— Avec ça que cet avorton en mérite, de l’amour ! répondait madame Exarkhatoff : si j’avais su, je ne serais pas venue : pour la réprimande que vous lui avez adressée, ce n’était pas la peine, achevait-elle en se retirant.
Pierre Mikhaïlitch souriait et se disait à part soi :
— Voilà une femme de caractère ! Ah ! quel caractère ! Elle a fait le malheur de son mari qui est un garçon si distingué !
En regagnant son logis, Godnieff était toujours heureux quand il rencontrait quelque propriétaire de sa connaissance, venu momentanément à la ville.
— Arrêtez... une petite minute ! criait-il.
Le propriétaire s’arrêtait.
— Êtes-vous pour longtemps ici ? demandait Pierre Mikhaïlitch.
— Pour jusqu’à demain.
— Êtes-vous invité à dîner quelque part aujourd’hui ?
— Non, je n’ai fait encore aucune visite.
— Eh bien, venez manger la soupe avec moi ; si vous refusez, je me fâche, je me brouille pour tout de bon avec vous. Nous ne nous sommes pas vus depuis un an.
— Je vous remercie. J’accepte, si cela ne vous dérange pas. Je vous demande seulement la permission de donner un coup de pied jusqu’au tribunal, et ensuite je suis à vous.
— Bien, bien ! Vous savez, c’est tout à fait sans cérémonie, à la fortune du pot ! Au revoir ! disait Pierre Mikhaïlitch.
Pélagie Eugraphovna ne cessait de s’élever contre cette habitude qu’il avait d’inviter ainsi les gens à brûle-pourpoint.
— Eh bien ! commandante, qu’est-ce que nous avons aujourd’hui pour dîner ? demandait-il en arrivant chez lui.
— Vous aurez de quoi manger, soyez tranquille.
— C’est que j’ai invité quelqu’un...
— Vous n’en faites jamais d’autres ! Est-ce que vous ne pourriez pas me prévenir en temps utile ? Comment voulez-vous que je me procure des vivres à cette heure-ci ?
— Allons, assez, commandante ! Celui qui n’aime pas à partager son repas avec un ami est un ladre.
Au fond, Pélagie Eugraphovna elle-même était de cet avis ; seulement, elle n’aimait pas à être prise au dépourvu. En dehors des hôtes d’occasion, Pierre Mikhaïlitch avait chaque jour à sa table son frère, Phlégont Mikhaïlitch Godnieff, capitaine en retraite. Ce dernier était célibataire, il recevait une pension de cent roubles et occupait un petit logement de deux pièces dans une maison voisine de celle de son frère. Aussi taciturne que Pierre Mikhaïlitch était causeur, le capitaine se bornait à répondre aux questions qu’on lui adressait, encore le faisait-il très laconiquement. Il aimait beaucoup les oiseaux et en avait chez lui jusqu’à cent espèces différentes. Il était, en outre, passionné pour la chasse et la pêche ; mais l’objet de son plus tendre attachement était sa chienne Diane. Il couchait avec elle, la lavait, ne s’en séparait jamais et, durant des heures entières, la regardait dormir sous la table ; ensuite il souriait.
— Qu’est-ce qui vous fait sourire, capitaine ? lui demandait Pierre Mikhaïlitch. Il appelait toujours son frère « capitaine ».
— Mais voyez donc Diane : elle dort, répondait celui-ci.
Phlégont Mikhaïlitch n’avait pas encore cessé de porter l’uniforme militaire. Grand fumeur, il avait toujours sur lui du tabac turc et une petite pipe d’écume, le tout enfermé dans une bourse brodée de perles. Cette bourse était l’ouvrage de Nastasia. Sur le désir de son oncle, la jeune fille avait figuré d’un côté un Cosaque tuant un Turc, de l’autre la citadelle de Varna. Tous les jours, une demi-heure avant l’arrivée de Pierre Mikhaïlitch, le capitaine faisait son apparition : il saluait Nastenka, lui baisait la main et s’informait de sa santé ; après quoi il prenait une chaise et restait silencieux.
— Eh bien, vous ne fumez pas ? lui disait sa nièce pour l’occuper à quelque chose.
— Si, je vais fumer, répondait-il ; puis il bourrait sa courte pipe, allumait de l’amadou qu’il avait fabriqué lui-même avec du papier à sucre, et commençait à fumer.
— Bonjour, capitaine ! disait en arrivant Pierre Mikhaïlitch.
Le capitaine se levait et s’inclinait respectueusement. Rien qu’à ce salut, on pouvait deviner en quelle profonde estime il tenait son frère. À table, s’il n’y avait pas de convive étranger, Pierre Mikhaïlitch faisait seul tous les frais de la conversation ; Nastenka ne parlait guère et mangeait fort peu ; le capitaine se taisait tout le temps et mangeait beaucoup ; Pélagie Eugraphovna quittait à chaque instant sa place. Après le dîner avait presque toujours lieu, entre les deux frères, le dialogue suivant :
— Où allez-vous ? Donner un coup d’œil à vos oiseaux, je suis sûr ? disait Pierre Mikhaïlitch en voyant le capitaine prendre sa casquette.
— Oui, il faut leur faire une petite visite, répondait Phlégont Mikhaïlitch.
— Que Dieu vous conduise ! Vous viendrez ce soir ?
Le capitaine s’en allait, après avoir promis de revenir le soir, et en effet, à l’heure du thé, on le voyait arriver avec sa blague, sa pipe et Diane.
Au thé succédait ordinairement une lecture. Phlégont Mikhaïlitch aimait surtout les ouvrages historiques et militaires, ce qui, du reste, ne l’empêchait pas d’écouter assez attentivement quand on lisait d’autres livres, et si, pendant la lecture, Diane venait à remuer ou à faire du bruit, il menaçait du doigt la chienne en lui disant à voix basse : « Couche ! »
Les jours de fête, la vie des Godnieff prenait un caractère un peu différent. Pierre Mikhaïlitch avait coutume d’aller entendre matines à sa paroisse, vêtu de sa grosse redingote de tous les jours, et coiffé de sa vieille casquette ; le capitaine assistait aussi à l’office du matin ; la cérémonie terminée, les deux frères retournaient chacun chez soi. Quelques heures plus tard, Pierre Mikhaïlitch se rendait à la messe avec Nastenka ; cette fois le directeur du collège avait un manteau neuf, un chapeau et un uniforme qui n’était pas celui des jours ouvrables ; le capitaine était, lui aussi, endimanché.
Après l’office, les deux vieillards allaient baiser la croix, puis ils s’embrassaient et se complimentaient à l’occasion de la fête. Le capitaine, en outre, s’approchait de Nastenka, s’informait de sa santé et lui adressait les félicitations d’usage. Au sortir de l’église, toute la famille prenait le chemin de sa demeure, où l’attendait le café préparé par Pélagie Eugraphovna. Dans ces circonstances, Pierre Mikhaïlitch était encore plus gai et mieux disposé que de coutume.
— Vous plairait-il, notre cher frère, de nous prêter votre pipe et votre tabac ? disait-il au moment de prendre la tasse de café hebdomadaire qu’il avait l’habitude de déguster en fumant.
Cette demande causait toujours le plus grand plaisir au capitaine. Il nettoyait consciencieusement sa pipe, la bourrait avec soin et, après l’avoir allumée, l’offrait à Pierre Mikhaïlitch, qui le récompensait par un baiser.
La nouvelle que Godnieff renonçait à ses fonctions surprit toute la ville.
— Vous avez pris votre retraite, Pierre Mikhaïlitch ? lui disait-on.
— Oui, monsieur, répondait-il.
— Quelle idée vous avez eue !
— Eh bien, quoi ? Il me semble que j’ai servi assez longtemps.
— Mais vous n’allez plus toucher que la moitié de votre traitement ?
— Qu’importe ! Grâce à Dieu, j’ai un morceau de pain, je ne suis pas en peine de vivre.
II
LE chapitre précédent fera sans doute supposer au lecteur que la famille dont je viens de lui présenter les différents membres était parfaitement heureuse. Cela aurait été vrai si Nastenka, ma future héroïne, n’avait fait ombre dans cet intérieur paisible. Cette même ispravnitza qui interprétait avec tant de malveillance les rapports de Pierre Mikhaïlitch et de Pélagie Eugraphovna, ne se montrait guère plus indulgente à l’égard de la jeune fille.
— Seigneur mon Dieu ! disait-elle, peut-il y avoir une créature aussi disgracieuse que cette pauvre Nastenka Godnieff !
— Qu’est-ce qu’elle a donc de si disgracieux ? Au contraire, elle est fort gentille, osait répondre l’ispravnik.
— Fort gentille ? répétait sa femme d’une voix sifflante de colère : elle danse abominablement, et, quand elle parle français, elle dit : Je ne vé pas, je ne pé pas.
— Ces gens-là ne sont pas riches, ils n’avaient pas le moyen de payer une gouvernante française, observait le mari, ce qui, naturellement, achevait d’exaspérer son irascible moitié.
Est-il besoin de dire que le jugement de cette dame était souverainement injuste ? Nastenka était, au contraire, fort bien de sa personne : petite, svelte, très brune, elle avait d’épais cheveux noirs et de grands yeux couleur de cerise mûre, qui, un peu à fleur de tête, donnaient à son visage une expression légèrement sentimentale : — bref, sa figure était charmante.
En ce qui concerne son éducation, je suis obligé de faire quelques réserves. La jeune fille était fort intelligente, bonne, sensible ; mais avec tout cela elle se tenait sur sa chaise comme si elle eût été bossue, elle ne savait pas valser à deux temps, ne pianotait pas du tout, et prononçait mal le français. Que voulez-vous ? Nastenka n’avait pas eu d’institutrice française pour l’initier à la bonne prononciation, elle n’avait pas pris de leçons de maintien dans un pensionnat, il ne s’était même trouvé près d’elle ni une sœur ni une tante pour lui inculquer les éléments de ce que Gogol appelle la science féminine.
Après la mort de sa femme, Pierre Mikhaïlitch n’avait pas eu le courage de se séparer de sa fille, et il l’avait élevée chez lui. Enfant, Nastenka était très indisciplinée : elle passait des journées entières à courir dans le jardin, à farfouiller dans le sable et même à jouer à saute-mouton avec les petits garçons de la localité. Une mendiante, qui venait chaque jour demander l’aumône dans la cour de Pierre Mikhaïlitch, ne manquait jamais de dire, quand elle la rencontrait :
— Quelle gamine que cette petite demoiselle ! Je vais la prendre et l’emporter dans mon sac.
Nastenka rougissait, mais elle ne perdait pas sa présence d’esprit, et regardait audacieusement la vieille. Inutile d’ajouter que Pélagie Eugraphovna n’avait sur elle aucune autorité.
La femme de charge restait saisie en voyant la fillette avec sa robe couverte de taches et ses souliers tout troués.
— Eh bien ! on t’en donnera, des vêtements en toile de Pétersbourg, pour que tu les arranges ainsi... Qu’est-ce que tu vas mettre à présent ? Non, Nastasia Pétrovna, je me plaindrai de vous à votre papa, menaçait-elle.
— Papa ne dira rien, répondait Nastenka, et elle courait elle-même auprès de son père.
— Papa, vois un peu comme je me suis salie, disait-elle.
— Très bien ! À la bonne heure, ma petite sauvagesse ! répondait-il. (La pétulance et le teint basané de l’enfant lui avaient fait donner par son père le surnom de sauvagesse.)
Nastenka sautait sur les genoux de Pierre Mikhaïlitch, l’embrassait, puis se couchait près de lui sur le divan et s’endormait. Durant des heures entières, le vieillard restait assis sans bouger, dans la crainte de la réveiller ; durant des heures entières, il tenait ses yeux fixés sur elle ; ensuite il la prenait avec précaution dans ses bras et allait la coucher.
« Que nous serions tous heureux, si ma pauvre femme n’était pas morte ! » songeait-il, et, les yeux pleins de larmes, il se retirait dans son cabinet, où il restait longtemps enfermé...
Quand Pélagie Eugraphovna faisait remarquer à Pierre Mikhaïlitch qu’il avait tort de gâter ainsi sa fille, il avait coutume de répondre :
— Empêcher un enfant de folâtrer, c’est empoisonner les meilleurs moments de la vie et assombrir la joie la plus pure, la plus sereine.
Ce fut lui-même qui se mit en devoir d’enseigner à Nastenka l’écriture, la religion, les deux premières parties de l’arithmétique et la grammaire. La petite fille apprenait très facilement. Avec quelle jubilation le père montrait à ses connaissances ces mots tracés en gros caractères par les petits doigts de l’enfant : « L’Amérique est très riche en or » !
— Messieurs, ma fille sera une calligraphe, oui, une calligraphe, je vous assure, disait Godnieff. Il aimait aussi à lui pousser des colles devant les étrangers, essayant de donner à ses questions un tour inusité :
— Dites-moi, par exemple, Nastasia Pétrovna, combien font deux neuf.
— Dix-huit, répondait sans hésitation Nastenka.
Le vieillard était aux anges.
Quand Nastenka eut quatorze ans, elle cessa de courir dans le jardin et de jouer avec ses poupées. En même temps, elle se fit scrupule d’embrasser son oncle le capitaine, qui venait de quitter le service ; lorsque, sur l’ordre de son père, elle s’y résignait, c’était en rougissant, et le capitaine, de son côté, rougissait aussi. Dans sa vie uniforme, comment et à quoi Pierre Mikhaïlitch pouvait-il occuper les moments de sa petite sauvagesse ? Sans s’en rendre compte, il lui fit partager son inclination dominante. Chez le directeur du collège, chaque soir, on lisait quelque chose : roman historique, roman d’aventures, roman de mœurs, almanach, article de revue, n’importe quoi. Nastenka commença par écouter avec l’inconsciente curiosité d’une enfant ; ensuite elle fit elle-même la lecture à son père ; et, finalement, elle se passionna pour les livres.
Ses débuts dans le petit monde du district ne furent pas très heureux. Elle atteignait sa dix-huitième année, quand vint s’établir dans la ville la générale Chévaloff. Cette dame, qui appartenait à la haute société, avait jusqu’alors passé les étés à sa campagne et les hivers dans les capitales. Si maintenant elle se fixait à E..., c’était pour y suivre un procès, dans lequel elle avait de grands intérêts engagés. Sa fille unique, mademoiselle Pauline, passait pour très intelligente et très instruite ; malheureusement le teint de cette personne annonçait une mauvaise santé, et, d’après le bruit public, il lui manquait deux côtes ; du reste, extérieurement, ce vice de conformation se laissait à peine deviner.
La générale était fort riche et d’une avarice extrême. Tout en faisant rapporter à son bien le plus possible, elle regardait à la dépense d’un kopeck. Sa lésinerie était telle, disait-on, qu’elle chicanait la nourriture non seulement à ses gens, mais à sa fille et à elle-même. En revanche, elle n’épargnait rien pour jeter de la poudre aux yeux. Dès son arrivée à E..., elle avait loué la plus belle maison de la ville et l’avait luxueusement meublée. La livrée de ses domestiques était irréprochable, comme aussi l’élégance de ses voitures. Pour achever de se poser, elle annonça qu’elle donnerait des soirées dansantes tous les jeudis jusqu’à la fin de l’hiver.
Dans la petite ville, tout le monde baissait pavillon devant elle ; d’ailleurs, la générale était très orgueilleuse et ne frayait presque avec personne, quoiqu’elle eût fait connaissance avec tous les fonctionnaires de la localité. La société du prince Ivan et de son aimable famille était, disait-elle sans détours, la seule où elle se trouvât dans son élément. (Le prince Ivan était un riche propriétaire du voisinage, parent éloigné de madame Chévaloff.)
Ce fut le hasard qui la mit en rapport avec Pierre Mikhaïlitch. Elle lui demanda la permission de prendre des livres à la bibliothèque du collège. Godnieff y consentit avec empressement, et, pour reconnaître cette gracieuseté, elle l’invita, ainsi que Nastenka, à assister à sa prochaine soirée.
La jeune fille fut un peu effrayée quand son père lui annonça qu’ils iraient au bal de la générale ; toutefois, l’invitation lui fit plaisir. Si ignorant qu’il fût des usages mondains, Pierre Mikhaïlitch comprenait qu’une jeune personne qui fait son entrée dans le monde doit être mise aussi élégamment que possible. Il tint conseil à ce propos avec Pélagie Eugraphovna. La résolution arrêtée entre eux fut qu’on achèterait la plus belle qualité de gaze pour la robe de Nastenka et le plus beau satin pour sa mantille. La femme de charge prit l’affaire très à cœur et changea jusqu’à sept fois les coupons achetés : toujours elle découvrait quelque défaut, soit dans la gaze, soit dans le satin. N’osant se charger de faire elle-même la robe, elle confia cette besogne à une couturière serve qu’elle installa dans sa propre chambre, afin de l’avoir constamment sous les yeux, tant que durerait le travail.
Pélagie Eugraphovna décida que Nastenka porterait au cou un collier de perles avec un fermoir en brillants, qui avait appartenu à la défunte femme de Pierre Mikhaïlitch, et elle passa plus d’une matinée à renfiler les perles et à frotter le fermoir pour le faire reluire. En sa qualité d’Allemande, la brave ménagère excellait dans la cuisine, mais la science des ajustements n’était pas son fait. La gaze choisie par elle était de bonne qualité, mais d’une couleur rose qui tirait grossièrement l’œil. De son côté, la couturière, peu au courant des façons du jour, fit descendre beaucoup trop bas la taille de la robe. Quant au collier de perles, il était plus riche que distingué : cela sentait la marchande endimanchée. Ni Nastenka, ni Pélagie Eugraphovna, ni Pierre Mikhaïlitch ne remarquèrent ces diverses incorrections.
La première était toujours sous l’influence d’une appréhension vague ; la seconde avait fait pour le mieux dans la mesure de ses moyens intellectuels, et, en ce qui concerne Godnieff, il n’entendait absolument rien à la toilette féminine. Lui-même mit son uniforme neuf, un gilet blanc à boutons brillants, et une cravate blanche : — d’ordinaire, il ne revêtait ce costume que pour aller à la messe le jour de Pâques. Quand Nastenka se montra à lui dans tous ses atours, il eut un cri d’admiration :
— Oh ! mais tu es mise comme une reine ! Bene !... Optime !... Allons, tourne un peu la tête... bien... très bien... Commandante, voyez donc comme notre Nastenka est belle !
— Eh ! Rangez-vous, ne vous mettez pas devant le jour, on ne peut rien voir ! répondit la femme de charge, qui, fort affairée, donnait le dernier coup de main à la toilette de sa jeune maîtresse.
Plusieurs invités se trouvaient déjà chez la générale lorsque Pierre Mikhaïlitch, donnant le bras à Nastenka, fit son entrée dans la salle brillamment éclairée. Le spectacle qu’il offrait en ce moment avait quelque chose de pénible, de touchant et d’un peu ridicule : il s’avançait d’un air fier, pleinement convaincu que sa fille allait être la reine du bal. Combien il était loin de se douter que la petite et maigrichonne Nastenka ne serait même pas remarquée à côté de la fille du prince Ivan, jeune personne de dix-huit ans dont l’éblouissante beauté attirait tous les regards ! Combien surtout l’eût stupéfié, s’il avait pu l’entendre, cette remarque murmurée par la grincheuse ispravnitza à l’oreille de son débonnaire mari :
— Allons, cela va bien : voilà qu’à présent les blattes font leur apparition dans les soirées du grand monde !
Dans le salon, Pierre Mikhaïlitch s’approcha de la maîtresse de la maison, à demi couchée sur un divan.
— Permettez-moi, Excellence, de vous présenter ma fille, dit-il en s’inclinant.
— Charmée ! dit en français la générale, et elle fit de la tête un léger salut.
Nastenka s’était assise à quelque distance sur un fauteuil. La générale tourna nonchalamment la tête vers elle, et, durant quelques instants, la regarda avec ses yeux gris. La jeune fille pensa qu’elle allait lui adresser la parole, mais il n’en fut rien. Sans lui rien dire, la générale se tourna de l’autre côté, où était assise, dans une attitude respectueuse, une dame très endiamantée, la femme du fermier des eaux-de-vie.
— Votre bracelet est fort beau ; combien l’avez-vous payé ? lui demanda-t-elle.
— Je n’en connais pas le prix, Excellence ; c’est un cadeau de mon mari, répondit la dame, dont le visage rayonnait, tant elle était heureuse d’avoir obtenu une parole de la générale.
Entra mademoiselle Pauline, qui venait seulement d’achever sa toilette ; elle alla droit à sa mère et lui baisa la main.
— Qui est cette jeune personne ? demanda-t-elle en clignant les yeux dans la direction de Nastenka.
Pour toute réponse, la mère ferma les yeux et sourit.
Nastenka n’était ni sotte, ni dépourvue d’amour-propre : elle remarqua tout cela, le comprit fort bien et devint toute rouge. Le bal commença. Les cavaliers étaient peu nombreux, et tous s’adressaient soit à la fille de la maîtresse du logis, soit aux autres demoiselles de leur connaissance. Aucun d’eux ne songeait à inviter Nastenka. Mais le désagrément de faire tapisserie n’était rien encore au prix de la mortification qui l’attendait. Au nombre des invités se trouvait un certain Médiokritzky, chef de bureau, qui jouissait des bonnes grâces de l’ispravnitza, et que cette dame avait présenté à la générale comme un homme pouvant lui être utile dans son procès.
Depuis qu’il s’occupait des affaires de madame Chévaloff, celle-ci se voyait dans la nécessité de l’admettre à ses réceptions, où, d’ordinaire, le jeune homme passait son temps à tendre ses gants et à tirer sur son gilet pour lui faire rejoindre la ceinture de son pantalon. Mais, ce soir-là, Médiokritzky, voyant que personne ne faisait attention à mademoiselle Godnieff, s’imagina que la jeune fille appartenait au même monde que lui, et, en conséquence, n’hésita pas à lui demander la faveur d’un quadrille. Nastenka ne crut pas devoir refuser, bien qu’elle sentît que l’invitation d’un semblable cavalier était un nouvel affront pour elle. Au moment où l’orchestre attaqua la première mesure, Médiokritzky n’avait même pas pensé à se pourvoir d’un vis-à-vis.
Heureusement mademoiselle Pauline s’en aperçut tout de suite et sauva la situation : elle dit à demi-voix quelques mots à son cavalier, un hussard en permission. « Oh ! mon Dieu, mon Dieu ! » fit celui-ci avec un haussement d’épaules ; puis tous deux allèrent se placer en face du couple dans l’embarras. Le jeune chef de bureau, qui avait appris tout seul le quadrille français, ne le dansait pas très bien, et dans la cinquième figure il perdit tout à fait la carte. Vis-à-vis de sa dame, il se renfermait dans un silence absolu, se bornant à la regarder de temps à autre avec des yeux langoureux. Le quadrille fini, il l’invita aussitôt pour le suivant.
Un nuage se répandit sur les yeux de Nastenka ; peu s’en fallut qu’elle ne fondît en larmes ; mais, faisant un effort sur elle-même, elle accepta l’invitation. Quand ils se remirent en place pour la danse, un sourire moqueur se montra sur plusieurs visages. L’attitude de Médiokritzky fut la même que précédemment : durant tout le quadrille, il ne dit pas un mot à sa danseuse, et ensuite il l’invita encore pour le suivant. N’ayant aucun usage du monde, le jeune homme ignorait qu’il n’est pas reçu de danser toute la soirée avec la même dame.
Pour le coup, Nastenka n’y tint plus : prétextant un mal de tête, elle planta là ce malencontreux cavalier et se rendit auprès de son père, qui, le visage rayonnant d’une satisfaction béate, était assis à côté d’une table de jeu. Au premier regard jeté sur sa fille, le vieillard s’effraya de la voir si pâle.
— Qu’est-ce que tu as, mon âme ? lui demanda-t-il d’une voix inquiète.
— Rentrons à la maison : je ne me sens pas bien, répondit Nastenka.
— Partons, partons ! reprit Pierre Mikhaïlitch, qui se leva sur-le-champ. Votre Excellence voudra bien m’excuser, dit-il à la générale en traversant le salon : ma fille est souffrante.
Nastenka ne fut pas plus tôt rentrée chez elle qu’elle quitta en toute hâte sa toilette de bal et se jeta sur son lit. Le lendemain elle s’éveilla avec des yeux rougis par les larmes, et se jura de ne plus aller nulle part. La lecture devint dès lors son unique distraction. Elle lisait tout ce qui lui tombait sous la main. Quand elle eut épuisé la littérature russe, elle déclara à son père qu’elle voulait apprendre le français. Pierre Mikhaïlitch, qui connaissait bien cette langue, mais qui la prononçait mal, se chargea de la lui enseigner. Nastenka s’adonna jour et nuit à cette étude, et au bout de six mois elle lisait à peu près couramment. Tout en lui ouvrant l’esprit, les livres ne laissaient pas d’exciter à un haut degré son imagination.
Elle commença à vivre dans un monde particulier, peuplé des Homère, des Horace, des Oniéguine, des héros de la révolution française. Elle se représenta l’amour chez la femme comme un sentiment fait avant tout d’abnégation, l’existence dans la société comme un supplice, le jugement de l’opinion publique comme une niaiserie, dont il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. Le milieu qui l’entourait lui devint insupportable. L’honnête Pierre Mikhaïlitch, toujours content de tout, l’irritait, particulièrement quand le vieillard disait du bien de quelque personne d’E... ou racontait quelque événement survenu dans la localité ; elle lui en voulait même de l’appétit avec lequel il mangeait. En un mot, la jeune fille, dans sa mauvaise humeur, ne faisait grâce ni à elle-même ni à son entourage, et chaque jour elle se montrait plus étrange.
Ainsi, l’idée d’aller à cheval lui étant venue tout à coup, elle exigea absolument que son père lui achetât une selle, et, quoique le cheval des Godnieff n’eût jamais été monté, quoique elle-même n’eût jamais pris aucune leçon d’équitation, elle partit au grandissime galop, à l’inexprimable épouvante de Pierre Mikhaïlitch. Toutefois, on la vit revenir saine et sauve, bien que pâle et tremblant de tous ses membres. Une autre fois, elle s’avisa de faire à pied un pèlerinage à trente verstes de la ville, et cette équipée l’obligea à garder le lit pendant quinze jours.
Toutes ces bizarreries, tous ces caprices, Pierre Mikhaïlitch les mettait sur le compte d’un agacement nerveux ; il considérait encore sa fille à peu près comme une enfant, et ne doutait pas qu’à la saison prochaine, quelques bains froids n’eussent raison de tout cela. En même temps, le vieillard était ravi de constater que de jour en jour Nastenka acquérait plus de connaissances, ou, comme il disait, élargissait son horizon intellectuel.
— Quelles belles facultés tu loges dans ta petite tête ! Si tu étais un garçon, on ferait de toi un poète, observait-il.
La jeune fille écoutait en rougissant, car elle était déjà poète, et, presque chaque jour, écrivait des vers à l’insu des siens.
Le temps s’écoulait ainsi. Nastenka atteignit sa vingtième année sans que personne l’eût demandée en mariage. Quand je dis personne, je me trompe. Après le bal dont on a lu plus haut le récit, l’odieux Médiokritzky avait pris l’habitude de venir, chaque dimanche, passer la soirée chez les Godnieff. Il apportait avec lui une guitare et, au bout de quelques minutes, demandait la permission de chanter quelque chose en s’accompagnant sur son instrument. Pierre Mikhaïlitch, qui avait la bonté de le recevoir chez lui, avait aussi celle de l’écouter. Presque toujours le chef de bureau commençait comme il suit, en adressant un tendre regard à Nastenka :
Mon esquif, dans les ténèbres,
Se heurte contre un écueil,
Sans que mes destins funèbres
Vous mettent la larme à l’œil.
Le dénouement fut une visite inopinée de l’ispravnitza, qui vint un beau matin demander à Pierre Mikhaïlitch la main de Nastenka pour son favori. Le vieillard sourit.
— Nous vous sommes bien reconnaissants, Marie Ivanovna, dit-il, de la peine que vous avez prise, et nous remercions Médiokritzky de l’honneur qu’il nous fait ; mais ma fille est encore trop jeune.
L’ispravnitza fit la grimace ; en général elle n’aimait pas la contradiction, et, dans la circonstance présente, elle était loin de s’y attendre.
— C’est ce qu’on a coutume de dire, Pierre Mikhaïlitch, quand on n’a pas de bonnes raisons à donner, répliqua-t-elle ; je ne sais pas, mais il me semble que ce jeune homme est un excellent parti pour Nastasia Pétrovna. S’il est pauvre, après tout, pauvreté n’est pas vice.
— Non, sans doute, reprit Godnieff un peu piqué ; et si nous ne pouvons agréer la demande de M. Médiokritzky, ce n’est nullement à cause de sa pauvreté, mais parce que son éducation laisse beaucoup à désirer, et que, dit-on, sa moralité est assez mauvaise.
— Au point de vue de l’éducation, je crois que les deux époux n’auraient rien à s’envier l’un à l’autre, riposta aigrement l’ispravnitza.
Nastenka, qui assistait à cette scène, ne put se contenir :
— Vous avez vous-même une fille en âge d’être mariée, Marie Ivanovna, dit-elle ; si Médiokritzky vous plaît tant, que n’en faites-vous votre gendre ?
— Il ne peut pas être le mari de ma fille, répondit avec force la visiteuse.
— Pourquoi donc pensez-vous qu’il puisse être le mien ? reprit d’un ton hautain la jeune fille devenue pourpre.
— Ah ! mon Dieu ! s’écria l’ispravnitza, je ne pense rien du tout ; je me borne à vous transmettre la demande du jeune homme, parce qu’il m’a instamment priée de le faire ; il faut croire qu’il avait quelque lieu de compter sur une réponse favorable ; peut-être lui a-t-on donné des espérances : je n’en sais rien.
Ces mots mirent Nastenka hors d’elle-même ; des larmes se montrèrent dans ses yeux.
— Si quelqu’un lui a donné des espérances, répliqua-t-elle d’une voix tremblante de colère, c’est apparemment vous, et non moi ! Je vous prie de ne pas vous inquiéter de mon sort et de vous dispenser, à l’avenir, de semblables démarches.
Là-dessus, elle quitta précipitamment la chambre. L’ispravnitza la suivit d’un regard moqueur.
— Votre réponse sera-t-elle la même, Pierre Mikhaïlitch ? demanda-t-elle.
— Exactement la même, Marie Ivanovna, répondit le vieillard, et si j’ai un regret, c’est que vous vous soyez chargée d’une mission qui est une offense pour nous.
— Et moi, je le regrette plus encore, car dans ces sortes de choses il faut être très circonspect et bien savoir à quelles gens on aura affaire, dit l’ispravnitza, tandis que, d’un geste saccadé, elle nouait les brides de son chapeau et remettait son boa autour de son cou ; après quoi, elle se hâta de sortir.
Godnieff la reconduisit jusqu’à l’antichambre, puis revint auprès de sa fille, qu’il trouva en larmes.
— Qu’est-ce que c’est, Nastenka ? Pourquoi pleures-tu ? Comment n’es-tu pas honteuse ? Quelle faiblesse de caractère !
— C’est terrible, papa ! Bientôt elle viendra demander ma main pour son laquais. Il aurait fallu la mettre à la porte !
— Allons, allons, calme-toi ! Comme tu prends facilement la mouche ! La moindre niaiserie te fait sortir de tes gonds ! Tiens, lis-moi quelque chose, cela vaudra mieux, reprit le vieillard.
Mais Nastenka n’était pas en état de lire.
Cet incident acheva de la brouiller avec le petit monde du district. Ne faisant aucune visite, elle ne voyait ses connaissances que chez elle, à l’église, ou sur le boulevard, quand il lui arrivait, les soirs d’été, de s’y promener avec son père. Dans ces rencontres, la jeune fille ne saluait jamais la première ; si on lui adressait la parole, elle se taisait ou ne répondait que par monosyllabes et d’un air ennuyé.
III
TROIS semaines après la promulgation de l’arrêté dont il a été question au commencement de ce récit, Pierre Mikhaïlitch lisait, à la grande satisfaction du capitaine, l’histoire de la campagne de 1812 par Danilevsky, et Nastenka, assise près de la fenêtre, regardait distraitement les terrains vagues éclairés par la pâle lumière de la lune. Dans l’antichambre retentit soudain la grosse voix de Gavrilitch qui parlait à la servante :
— Eh bien ! grenadier, qu’est-ce que tu viens faire ? cria Pierre Mikhaïlitch.
— J’ai à vous parler, répondit le cuistre en passant sa tête grêlée dans l’entrebâillement de la porte : le nouveau directeur est arrivé, il a convoqué les professeurs à son logement pour demain à huit heures : ils doivent se présenter en grande tenue.
— Vraiment ! Ce garçon-là est, paraît-il, à cheval sur la discipline ! Il mène son monde militairement ! C’est votre genre, cela, hein, capitaine ? dit Pierre Mikhaïlitch en s’adressant à son frère.
— Oui, en effet, répondit celui-ci d’un air profond.
— Où donc M. le nouveau directeur est-il descendu ? continua le vieillard.
— À l’auberge, chez Afonka le manchot, répondit avec une sorte d’irritation Gavrilitch.
— Tu t’es rendu auprès de lui ?
— Non, pourquoi y serais-je allé ? C’est la femme d’Afonka qui est venue me faire la commission.
— Eh bien, va notifier la chose à MM. les professeurs.
— Pas aujourd’hui : il est tard, on ne me recevrait pas ; j’irai demain.
— Soit ; seulement vas-y de bonne heure ; tu diras à MM. les professeurs de se mettre en uniforme et de passer chez moi ; nous partirons d’ici tous ensemble. Mais toi-même tu ferais bien de te raser et de quitter tes bottes de feutre. Surtout aie soin de ne pas étuver du chtchi dans le poêle de la direction.
— Allons, encore le chtchi ! Tu n’as jamais que cela à la bouche ! grommela l’invalide, qui sortit, non sans fermer violemment la porte après lui.
Godnieff souriait en le regardant s’éloigner.
Cette fois, du reste, Gavrilitch s’acquitta de son office avec une ponctualité inaccoutumée. Il ne faisait pas encore jour que déjà il était allé avertir les professeurs. Ceux-ci, à leur tour, se réunirent entre six et sept heures chez Pierre Mikhaïlitch. Tous éprouvaient un vague sentiment de crainte. D’ailleurs, ils étaient loin d’être au complet. Il y avait là, outre le professeur d’histoire, Exarkhatoff, que le lecteur connaît déjà, le professeur de mathématiques Lébédeff et le professeur de littérature Roumiantzeff. Lébédeff, sorte de géant, avait presque toujours la barbe et les cheveux en désordre, et il parlait d’une voix de basse très épaisse. À cet extérieur rébarbatif correspondait une violente passion pour la chasse, surtout la chasse à la grosse bête. Ce professeur était, sans contredit, le meilleur fusil de la province, et il n’avait pas abattu moins de trente ours dans sa vie. Rapproché de Phlégont Mikhaïlitch par la communauté des goûts cynégétiques, il s’était lié d’une étroite amitié avec le capitaine. Le professeur de littérature ne ressemblait en rien à son collègue de la classe de mathématiques ; c’était un petit jeune homme chétif et très timide, ce qui le disposait à la servilité ; avec cela, grand parleur et visant à l’élégance d’un petit-maître. Dans la circonstance présente, il arriva vêtu d’un paletot qu’il jugeait très fashionable, mais, sur le conseil de Pierre Mikhaïlitch, il se hâta de retourner chez lui pour se mettre en uniforme.
Godnieff lui-même avait arboré la tenue réglementaire.
— Messieurs, commença le vieillard d’une voix un peu émue, le moment de nous séparer est arrivé : je vous souhaite à tous sincèrement l’affection de votre nouveau chef ; pour ce qui est de moi, j’ai été très content de vous, et je donnerai de vous tous un excellent témoignage.
— Nous aurions voulu servir toute notre vie sous vos ordres, Pierre Mikhaïlitch, dit Lébédeff.
— Oui, toute notre vie. Pour moi, je le dis bien haut : quand je suis arrivé ici, je n’avais pas de quoi payer mon cocher, je n’avais pas un vêtement mettable, et c’est à vos bienfaits que je dois tout... ajouta Roumiantzeff en levant les yeux au ciel.
Exarkhatoff ne disait rien, mais les soupirs qui s’échappaient de sa poitrine étaient plus éloquents que des paroles.
Ces marques de sympathie causèrent un sensible plaisir au vieux principal.
— Je vous remercie de m’avoir ainsi compris, répondit-il. Du reste, j’ai quelquefois été vif dans mes observations ; peut-être ai-je blessé quelqu’un d’entre vous : ne gardez pas le souvenir des torts que j’ai pu me donner.
— Nous ne pouvons conserver de vous qu’un bon souvenir, reprit Lébédeff.
— Vous nous avez toujours parlé comme un père parle à ses enfants, dit à son tour Roumiantzeff.
— Je vous suis très, très reconnaissant, mes amis, fit Pierre Mikhaïlitch profondément ému ; si je ne puis vous exprimer en ce moment tout ce que j’éprouve, croyez bien que mon cœur bat à l’unisson des vôtres. Dieu veuille que l’harmonie, la bonne entente règnent toujours entre vous et votre nouveau chef !
En prononçant ces mots, il s’efforçait de refouler les larmes qui lui étaient venues aux yeux.
Exarkhatoff continuait à tenir la tête baissée. Tout à coup il se mit à sangloter bruyamment et courut se cacher dans un coin.
— Eh bien, qu’est-ce que c’est ? N’êtes-vous pas honteux ? Passe encore pour un vieillard comme moi ; à mon âge, cette faiblesse est excusable... Finissez, dit Pierre Mikhaïlitch, qui, lui-même, avait peine à comprimer ses sanglots. Allons, il est temps de partir ! acheva-t-il, et il se mit en marche, suivi de ses subordonnés.
Dans la cour d’Afonka le manchot, nos savants hommes rencontrèrent la logeuse en personne ; c’était une robuste paysanne, vêtue d’une saraphane5 d’indienne. Elle traînait un énorme baquet rempli d’eau sale, que, du reste, elle abandonna aussitôt.
— Bonjour, messieurs, bonjour ! dit-elle en s’inclinant.
— Ne pourriez-vous pas, ma chère, informer M. Kalinovitch que MM. les professeurs sont venus lui rendre leurs devoirs ? dit Pierre Mikhaïlitch à la logeuse.
— Tout de suite, messieurs, tout de suite ; je vais le lui faire dire par mon garçon. En attendant, donnez-vous la peine d’entrer dans la chambre ; il a ordonné de vous introduire là.
La chambre où la logeuse fit entrer les visiteurs commandait une autre pièce, mais la porte de communication était fermée à la clef. Pierre Mikhaïlitch et les professeurs attendirent pendant près d’un quart d’heure ; à la fin, la porte s’ouvrit, Kalinovitch parut. C’était un jeune homme grand et maigre, au visage intelligent et d’une pâleur jaunâtre. L’épée au côté, le chapeau claque à la main, il portait un uniforme tout neuf, mais non d’un drap très fin ; son gilet de piqué était d’une blancheur irréprochable. Pierre Mikhaïlitch prit la parole :
— J’ai l’honneur de vous présenter en ma personne votre prédécesseur, l’assesseur de collège Godnieff.
Kalinovitch lui tendit le bout de ses doigts.
— Permettez-moi de vous présenter MM. les professeurs, ajouta le vieillard.
Kalinovitch inclina légèrement la tête.
— Monsieur Exarkhatoff, professeur d’histoire, commença Pierre Mikhaïlitch.
— Où avez-vous fait vos études ? demanda Kalinovitch.
— À la faculté des lettres de l’Université de Moscou, répondit de sa voix triste Exarkhatoff.
— Vous avez achevé le cours ?
— J’ai fait deux ans.
— Il connaît son affaire à fond et mériterait, par son savoir, d’occuper une chaire de l’enseignement supérieur, intervint Godnieff. Peut-être même l’avez-vous connu à l’Université ? Si j’en juge par votre âge, vous avez dû vous trouver là en même temps que lui.
— Nous étions là beaucoup d’étudiants, répliqua Kalinovitch.
Exarkhatoff leva les yeux sur lui et ensuite les baissa. Il avait très bien connu Kalinovitch à l’Université, attendu que tous deux étaient de la même génération et, pendant deux ans, s’étaient assis sur le même banc ; mais, sans doute, le nouveau directeur ne jugeait pas à propos de renouer connaissance avec son ancien camarade.
— M. Lébédeff, professeur de mathématiques, poursuivit Godnieff.
— Où avez-vous fait vos études ? questionna de nouveau Kalinovitch.
— À l’institut d’arpentage, répondit laconiquement Lébédeff.
Kalinovitch tourna les yeux vers Roumiantzeff ; celui-ci, sans attendre qu’on l’interrogeât, prit l’attitude du soldat sans armes et débita tout d’une haleine son curriculum vitæ :
— Élevé aux Enfants trouvés de Moscou, puis professeur de musique dans une maison particulière ; mais, ayant des charges de famille, a désiré entrer dans le service public.
— MM. les professeurs ici présents se distinguent tous par leur instruction, leur moralité et leur zèle... observa Pierre Mikhaïlitch.
Kalinovitch eut un léger sourire ; le vieillard s’en aperçut.
— Je parle ainsi, continua-t-il, sans aucune préoccupation personnelle ; ma carrière est achevée, et je n’ai plus d’ambition à nourrir ; tout ce que j’en dis, c’est uniquement pour appeler sur eux votre bienveillance. Vous êtes un homme nouveau : votre recommandation en leur faveur aura un grand poids aux yeux de l’autorité.
— Je me ferai un agréable devoir... murmura Kalinovitch. Puis, s’adressant à Pierre Mikhaïlitch : Voulez-vous vous asseoir ? ajouta-t-il. Quant aux professeurs, il les salua comme les supérieurs ont coutume de saluer leurs subordonnés pour leur signifier que l’audience est terminée ; mais tout d’abord ceux-ci ne comprirent pas et restèrent en place.
— Je ne vous retiens pas, messieurs, dit Kalinovitch.
Exarkhatoff sortit le premier ; les autres le suivirent. Roumiantzeff, avant de quitter la chambre, s’arrêta sur le seuil et fit une révérence très humble. Pierre Mikhaïlitch fronça le sourcil : il était vexé que son successeur n’eût pas trouvé un mot aimable à dire aux professeurs et ne leur eût même pas offert des sièges.
Il voulait aussi se retirer ; mais Kalinovitch l’invita de nouveau à s’asseoir et s’humanisa jusqu’à lui avancer une chaise.
— Ce sont tous d’excellentes gens, voulut poursuivre le vieillard quand il se fut assis.
Kalinovitch n’eut pas l’air de l’avoir entendu, et, après un moment de silence, demanda :
— Est-ce qu’il y a de la bonne société ici ?
— Sans doute... ! Nous avons ici d’excellents fonctionnaires, ils vivent ensemble en bon accord ; chez nous, il n’y a ni querelles, ni divisions ; notre ville est renommée depuis longtemps pour l’esprit de concorde qui y règne.
— Et la vie est gaie ?
— Comment donc ! On se réunit tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre ; on s’amuse.
— Ne pouvez-vous pas m’indiquer quelques personnes ?
— Parfaitement, mais qui désirez-vous que je vous signale ?
— Vous avez un gorodnitchi ?
— Oui : Théophylacte Séménitch Koutchéroff, un vieillard des plus respectables.
— Il a de la famille ?
— Oui, et même une famille très nombreuse.
— Ensuite ?
— Ensuite l’ispravnik et sa femme ; le procureur, un jeune homme encore célibataire, mais qui doit bientôt se marier : il va épouser la fille du gorodnitchi.
— Vous avez aussi un maître de poste ?
— Je crois bien ! Seulement, il est vieux et ne sort plus guère.
— Voilà pour les employés. Et les propriétaires ? demanda Kalinovitch.
— En fait de propriétaires résidant à demeure ici, nous n’avons que la générale Chévaloff.
— Elle est riche ?
— Elle a de la fortune. On prétend qu’elle est millionnaire ; il faut dire aussi que c’est une générale authentique.
— C’est une femme encore jeune ?
— Non, elle est vieille. Elle a une fille d’un certain âge, qui n’est pas mariée.
— Dites-moi, je vous prie, demanda Kalinovitch après être resté un moment silencieux, y a-t-il ici des voitures ?
— Vous voulez sans doute parler des voitures de place ? Il n’y en a pas une seule, répondit Pierre Mikhaïlitch ; elles ne seraient d’aucune utilité ici ; or c’est, vous le savez, un principe d’économie politique que la production se règle sur le besoin.
Kalinovitch devint pensif.
— Cela m’est assez désagréable : je comptais faire aujourd’hui quelques visites, dit-il.
— Si telle est votre intention, vous n’avez pas à vous tourmenter pour si peu, répliqua Godnieff ; permettez-moi de mettre mon véhicule à votre disposition. J’ai un bon cheval, et mon drojki, quoique démodé, n’est pas mauvais non plus. Beaucoup de propriétaires s’en servent pour faire leurs courses, quand ils viennent à la ville.
— Vous me comblez ; mais, vraiment, je ne sais si je puis...
— Allons donc ! Tout ce que j’ai est à votre service.
— Je vous remercie.
— C’est moi qui vous suis très obligé ; seulement, voici, je mets à mon offre une petite condition : quiconque m’emprunte mon cheval doit dîner chez moi ; je ne prête mon équipage qu’à ce prix.
— La condition est très agréable à remplir, répondit en souriant Kalinovitch ; mais je ne sais pas à quelle heure je serai libre.
— Disposez de votre temps comme bon vous semblera, reprit Pierre Mikhaïlitch en se levant. Au plaisir de vous revoir, ajouta-t-il, et il salua pour prendre congé.
Kalinovitch lui tendit sa main tout entière et le reconduisit poliment jusqu’à la porte.
Godnieff revint chez lui plus soucieux qu’il n’avait coutume de l’être.
— Jeunes gens, jeunes gens ! s’écria-t-il plusieurs fois durant la route, vous avez peut-être plus d’esprit que nous autres vieillards, mais vous n’avez guère de cœur !
De retour au logis, il s’empressa, selon son habitude, d’annoncer à Pélagie Eugraphovna qu’il aurait quelqu’un à dîner.
— Bien ! répondit-elle, et elle courut à la cave.
Après avoir changé de vêtements et donné l’ordre d’envoyer son équipage à Kalinovitch, Pierre Mikhaïlitch passa au salon, où se trouvait sa fille.
Il l’embrassa, s’assit et retomba dans ses réflexions.
— Eh bien, papa, vous avez vu le nouveau directeur ? demanda Nastenka.
— Oui, ma chère, j’ai eu le bonheur de faire sa connaissance, répondit Pierre Mikhaïlitch avec un demi-sourire.
— Il est jeune ?
— Jeune... élégant... et l’on voit qu’il ne manque pas d’intelligence... mais il paraît un peu fier. Il aurait été le premier magistrat de la province, qu’il n’aurait pas reçu nos jeunes gens d’un air plus hautain... Ce n’est pas bien... un pareil début ne lui fait pas honneur.
— S’il est si fier, pourquoi l’avez-vous invité à dîner ?
— Parce que je tiens à lui parler au sujet des professeurs, je veux les lui présenter sous leur vrai jour, répondit Pierre Mikhaïlitch.
Il mettait cette raison en avant pour dissimuler la vraie : au fond, en invitant Kalinovitch, il avait simplement obéi à cette tendance hospitalière qui lui faisait inviter à dîner le premier venu.
— Du moins, je ne lui aurais pas envoyé le cheval : il pouvait bien venir à pied, observa Nastenka.
— Cesse de dire des bêtises ! répliqua avec vivacité Pierre Mikhaïlitch. Qu’importe que je lui aie prêté le cheval ! Il ne le mangera pas. Ce monsieur a des visites à faire ; il ne peut pas courir la ville à pied.
— Des visites ! il est arrivé d’hier, et aujourd’hui il veut faire des visites ! s’écria railleusement Nastenka.
— Qu’est-ce qu’il y a là d’étonnant ? Il a raison.
— Il se donne des airs importants vis-à-vis des professeurs, et il s’empresse d’aller faire des courbettes aux autres ; il faut qu’il soit bête pour se conduire ainsi !
— Comme tu es toujours prompte à condamner les gens, Nastenka ! Je ne vois rien de bête là dedans. Puisqu’il doit vivre dans notre ville, il est tout naturel qu’il désire en connaître les habitants.
— Si c’est un homme intelligent, il en aura vite assez.
— Pourquoi cela ? il n’y a ici que des personnes respectables. Vois-tu, mon âme, continua Godnieff en frappant du doigt sur la table, ce qui me déplaît fort en toi, c’est cette haine que tu nourris contre tout le monde ! D’où vient cela ? Qu’est-ce qu’on t’a fait ?
— Personne, je pense, n’a besoin de mon amour.
— Dieu nous ordonne d’aimer nos semblables, et c’est en même temps un besoin de notre propre cœur ; le misanthrope est à la fois malheureux et coupable, dit gravement le vieillard.
Nastenka lui répondit par un sourire presque méprisant. Sur ce thème, le père et la fille avaient de vives et fréquentes discussions.
IV
À midi, Kalinovitch, ayant remplacé sa tenue officielle par un frac, une cravate de satin noir et un gilet de velours de même couleur, mit, par-dessus le tout, un paletot neuf, et sortit de son logement pour aller faire ses visites. Mais, à la vue de l’équipage qui lui avait été envoyé, il recula saisi : le cheval dont Pierre Mikhaïlitch avait parlé en termes si flatteurs était sans doute fort bien nourri, grâce à l’active sollicitude de Pélagie Eugraphovna, mais sa tête lourde, ses oreilles pendantes, ses grosses jambes attestaient un âge respectable, un tempérament lymphatique et un caractère tranquille. Le harnais, acheté aussi par la femme de charge, se distinguait plutôt par la solidité que par l’élégance.





























